Par Misia Sert, Paris, Gallimard (Nrf), 1952
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Against Expression?: Avant-Garde Aesthetics in Satie's" Parade"
Against Expression?: Avant-garde Aesthetics in Satie’s Parade A thesis submitted to the Division of Graduate Studies and Research of the University of Cincinnati In partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF MUSIC In the division of Composition, Musicology, and Theory of the College-Conservatory of Music 2020 By Carissa Pitkin Cox 1705 Manchester Street Richland, WA 99352 [email protected] B.A. Whitman College, 2005 M.M. The Boston Conservatory, 2007 Committee Chair: Dr. Jonathan Kregor, Ph.D. Abstract The 1918 ballet, Parade, and its music by Erik Satie is a fascinating, and historically significant example of the avant-garde, yet it has not received full attention in the field of musicology. This thesis will provide a study of Parade and the avant-garde, and specifically discuss the ways in which the avant-garde creates a dialectic between the expressiveness of the artwork and the listener’s emotional response. Because it explores the traditional boundaries of art, the avant-garde often resides outside the normal vein of aesthetic theoretical inquiry. However, expression theories can be effectively used to elucidate the aesthetics at play in Parade as well as the implications for expressability present in this avant-garde work. The expression theory of Jenefer Robinson allows for the distinction between expression and evocation (emotions evoked in the listener), and between the composer’s aesthetical goal and the listener’s reaction to an artwork. This has an ideal application in avant-garde works, because it is here that these two categories manifest themselves as so grossly disparate. -
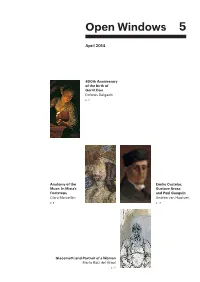
Open Windows 5
Open Windows 5 April 2014 400th Anniversary of the birth of Gerrit Dou Dolores Delgado p. 3 Anatomy of the Emilio Castelar, Muse: In Misia’s Gustave Arosa Footsteps and Paul Gauguin Clara Marcellán Andrea van Houtven p. 8 p. 13 Giacometti and Portrait of a Woman Marta Ruiz del Árbol p. 17 Open Windows 5 We present the fifth issue of Ventanas, which includes an homage to Gerrit Dou on the 400th anniversary of his birth; an analysis of the patron and muse Misia Sert on the occasion of the loan of her portrait to the recent exhibition at the Musée d’Orsay; a study on the influence of the collector Gustave Arosa on Gauguin, based on the testimony of Emilio Castelar; and, finally, an explanation of how the recent identification of the sitter for Giacometti’s Portrait of a Woman allows us to become more familiar with the artist’s creative process. Open Windows 5 April 2014 © Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 400th Anniversary of the birth of Gerrit Dou “Wonderful, lively, strong [and] powerful” Joachim von Sandrart1 Dolores Delgado Anonymous Introduction and biography Gerrit Dou, 18th century. Print from Antoine- Joseph Dézallier d’Argenville, Abrégé de la vie des plus fameux peintres, Paris, 1745 Gerrit Dou, also known as Gerard Dou, was born on 7th April 1613 in Leiden, where he became enormously popular, particularly among the social elite, and lived for the whole of his life. Leiden, whose university was founded in 1575, was a large commercial centre which attracted intellectuals and painters (including Aertgen [1498–1568] and Lucas van Leyden [1494–1533]), engravers, and stained-glass window designers, among these Gerrit’s own father, Douwe Jansz, himself a glazier and engraver. -

Art History Newsletter 23
MAY - A PAINTING FROM THE NATIONAL GALLERY Some members enjoyed this challenge, others didn’t and some went completely off piste and chose paintings not actually in the National Gallery! However, it was a very busy meeting with 12 people discussing their chosen painting. We started with Nancy and The Paston Treasure commissioned by Sir Robert Paston in the mid 1670s to illustrate the valued possessions of the family which had been collected on their many journeys around the world. Unfortunately, shortly after the painting was completed the treasures had to be sold as the family finances failed. The Paston Treasure c1665 - Unknown Dutch artist Next Jean B told us of Pietro Longhi whose early paintings were religious but gradually he started to paint everyday happenings in Venice, his home town. This painting chronicles Clara the rhinoceros brought to Europe in 1741 by a Dutch sea captain and impresario from Leyden., Douvemont van der Meer. This rhinoceros was exhibited in Venice in 1751 Exhibition of a Rhinoceros at Venice c1751 Oil on canvas 62 x 50cms Wendy’s choice was this famous painting by John Constable was shown in the Paris Salon of 1824 and won a gold medal although when previously shown in the Royal Academy in 1821 it failed to impress! The Haywain 1821 - Oil on canvas 130cm x 185cm John Constable 1776-1837 Aelbert Cuyp was one of the leading Dutch landscape artists during the Dutch Golden Age in the 17th century. Jan chose this painting which is the artist’s largest surviving landscape. The light is reminiscent of Italian painters although Cuyp never travelled there and was probably River Landscape with Horseman and Peasants c1658-60 inspired by other Dutch artists who Oil on canvas 123 cm x 241cm had. -

California State University, Northridge Jean Cocteau
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, NORTHRIDGE JEAN COCTEAU AND THE MUSIC OF POST-WORLD WAR I FRANCE A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Master of Arts in Music by Marlisa Jeanine Monroe January 1987 The Thesis of Marlisa Jeanine Monroe is approved: B~y~ri~jl{l Pfj}D. Nancy an Deusen, Ph.D. (Committee Chair) California State University, Northridge l.l. TABLE OF CONTENTS Chapter Page ABSTRACT iv INTRODUCTION • 1 I. EARLY INFLUENCES 4 II. DIAGHILEV 8 III. STRAVINSKY I 15 IV • PARADE 20 v. LE COQ ET L'ARLEQUIN 37 VI. LES SIX 47 Background • 47 The Formation of the Group 54 Les Maries de la tour Eiffel 65 The Split 79 Milhaud 83 Poulenc 90 Auric 97 Honegger 100 VII. STRAVINSKY II 109 VIII. CONCLUSION 116 BIBLIOGRAPHY 120 APPENDIX: MUSICAL CHRONOLOGY 123 iii ABSTRACT JEAN COCTEAU AND THE MUSIC OF POST-WORLD WAR I FRANCE by Marlisa Jeanine Monroe Master of Arts in Music Jean Cocteau (1889-1963) was a highly creative and artistically diverse individual. His talents were expressed in every field of art, and in each field he was successful. The diversity of his talent defies traditional categorization and makes it difficult to assess the singularity of his aesthetic. In the field of music, this aesthetic had a profound impact on the music of Post-World War I France. Cocteau was not a trained musician. His talent lay in his revolutionary ideas and in his position as a catalyst for these ideas. This position derived from his ability to seize the opportunities of the time: the need iv to fill the void that was emerging with the waning of German Romanticism and impressionism; the great showcase of Diaghilev • s Ballets Russes; the talents of young musicians eager to experiment and in search of direction; and a congenial artistic atmosphere. -

Title Japonisme in Polish Pictorial Arts (1885 – 1939) Type Thesis URL
Title Japonisme in Polish Pictorial Arts (1885 – 1939) Type Thesis URL http://ualresearchonline.arts.ac.uk/6205/ Date 2013 Citation Spławski, Piotr (2013) Japonisme in Polish Pictorial Arts (1885 – 1939). PhD thesis, University of the Arts London. Creators Spławski, Piotr Usage Guidelines Please refer to usage guidelines at http://ualresearchonline.arts.ac.uk/policies.html or alternatively contact [email protected]. License: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives Unless otherwise stated, copyright owned by the author Japonisme in Polish Pictorial Arts (1885 – 1939) Piotr Spławski Submitted as a partial requirement for the degree of doctor of philosophy awarded by the University of the Arts London Research Centre for Transnational Art, Identity and Nation (TrAIN) Chelsea College of Art and Design University of the Arts London July 2013 Volume 1 – Thesis 1 Abstract This thesis chronicles the development of Polish Japonisme between 1885 and 1939. It focuses mainly on painting and graphic arts, and selected aspects of photography, design and architecture. Appropriation from Japanese sources triggered the articulation of new visual and conceptual languages which helped forge new art and art educational paradigms that would define the modern age. Starting with Polish fin-de-siècle Japonisme, it examines the role of Western European artistic centres, mainly Paris, in the initial dissemination of Japonisme in Poland, and considers the exceptional case of Julian Żałat, who had first-hand experience of Japan. The second phase of Polish Japonisme (1901-1918) was nourished on local, mostly Cracovian, infrastructure put in place by the ‘godfather’ of Polish Japonisme Żeliks Manggha Jasieski. His pro-Japonisme agency is discussed at length. -

Robert Lehman Papers
Robert Lehman papers Finding aid prepared by Larry Weimer The Robert Lehman Collection Archival Project was generously funded by the Robert Lehman Foundation, Inc. This finding aid was generated using Archivists' Toolkit on September 24, 2014 Robert Lehman Collection The Metropolitan Museum of Art 1000 Fifth Avenue New York, NY, 10028 [email protected] Robert Lehman papers Table of Contents Summary Information .......................................................................................................3 Biographical/Historical note................................................................................................4 Scope and Contents note...................................................................................................34 Arrangement note.............................................................................................................. 36 Administrative Information ............................................................................................ 37 Related Materials ............................................................................................................ 39 Controlled Access Headings............................................................................................. 41 Bibliography...................................................................................................................... 40 Collection Inventory..........................................................................................................43 Series I. General -

Receptions of Toulouse-Lautrec's Reine De Joie Poster in the 1890S Nineteenth-Century Art Worldwide 8, No
Ruth E. Iskin Identity and Interpretation: Receptions of Toulouse-Lautrec’s Reine de joie Poster in the 1890s Nineteenth-Century Art Worldwide 8, no. 1 (Spring 2009) Citation: Ruth E. Iskin, “Identity and Interpretation: Receptions of Toulouse-Lautrec’s Reine de joie Poster in the 1890s,” Nineteenth-Century Art Worldwide 8, no. 1 (Spring 2009), http://www.19thc-artworldwide.org/spring09/63--identity-and-interpretation-receptions-of- toulouse-lautrecs-reine-de-joie-poster-in-the-1890s. Published by: Association of Historians of Nineteenth-Century Art Notes: This PDF is provided for reference purposes only and may not contain all the functionality or features of the original, online publication. ©2009 Nineteenth-Century Art Worldwide Iskin: Receptions of Toulouse-Lautrec's Reine de joie Poster in the 1890s Nineteenth-Century Art Worldwide 8, no. 1 (Spring 2009) Identity and Interpretation: Receptions of Toulouse-Lautrec’s Reine de joie Poster in the 1890s by Ruth E. Iskin The ideology of the inexhaustible work of art, or of “reading” as re-creation, masks— through the quasi-exposure which is often seen in matters of faith—the fact that the work is indeed made not twice, but a hundred times, by all those who are interested in it, who find a material or symbolic profit in reading it, classifying it, deciphering it, commenting on it, combating it, knowing it, possessing it. Pierre Bourdieu.[1] Toulouse-Lautrec’s 1892 poster Reine de joie, which promoted a novel by that name, represents an elderly banker as a lascivious, balding, pot-bellied Jew whose ethnic nose is pinned down by a vigorous kiss from a dark-haired, red-lipped courtesan (fig. -

Churchill on the Riviera Winston Churchill, Wendy Reves and the Villa La Pausa Built by Coco Chanel by Nancy Smith
Churchill on the Riviera Winston Churchill, Wendy Reves and the Villa La Pausa Built by Coco Chanel By Nancy Smith Winston Churchill’s Intrigues with the Owners of La Pausa, the Riviera Villa Built by Coco Chanel, Purchased by Emery and Wendy Reves, and Acquired in 2015 by the House of Chanel ii Churchill on the Riviera Wendy Reves, 1987, in the courtyard of villa La Pausa, with Lena and Ivana and her “mayordomo” Flavio Berio iii Dedicated to my daughter Christina, for whom Wendy Reves is a childhood memory © Nancy Smith 2017 - ISBN: 978-1-62249-366-1 Published by Biblio Publishing The Educational Publisher Inc. Columbus, Ohio BiblioPublishing.com iv Contents Illustrations ix Prologue xvii Chapter 1: Winston Churchill Undermines the Love Affair of Coco Chanel and the Duke of Westminster 1 Chapter 2: Early Life of Wendy Russell, later Wendy Reves 39 Chapter 3: Dates of Fashion Model Wendy Reves with Cary Grant 53 Chapter 4: Dates of Model Wendy Russell with Errol Flynn 71 Chapter 5: Dates of Wendy Reves with Howard Hughes 89 v Nancy Smith Chapter 6: Coco Chanel and the Nazi Spy 111 Chapter 7: Wendy Russell Meets Churchill’s Literary Publisher, Emery Reves 125 Chapter 8: Coco Chanel Sells Villa La Pausa to Emery Reves and Reopens her Couture House 133 Chapter 9: Wendy Reves and Greta Garbo 141 Chapter 10: Winston Churchill Tries to Find Peace at Villa La Pausa 159 Chapter 11: Memories of Winston Churchill 175 Chapter 12: Aristotle Onassis Disrupts the Reves’ Relationship with Winston Churchill 185 vi Churchill on the Riviera Chapter 13: Wendy and “Mr. -

The Piano at the Ballet II
The Piano at the Ballet II Francis Poulenc (1899-1963) Les Biches (“The Darling Girls”) (1923/1947)– excerpts 11:19 (published by Heugel) 1 Rondeau 3:28 2 Andantino 3:53 3 Final 3:58 Henri Sauguet (1901-1989) Les Forains (“The Fairground Entertainers”) (1945) – excerpts 18:44 (published by Editions Salabert) 4 Prologue 1:20 5 Entrée des Forains 4:37 6 Le Prestidigitateur 1:27 7 Le Prestigitateur et la Poupée 2:32 8 La petite fille à la chaise 1:47 9 Visions d’art 3:02 10 Le Cloune 1:23 11 Les Soeurs Siamoises 2:33 Jean Françaix (1912-1997) Serenade for Small Orchestra (1934) 10:17 (published by Schott & Co) 12 Vif 3:16 13 Andantino con moto 2:40 14 Un poco allegretto 1:12 15 Vivace 3:08 Maurice Thiriet (1906-1972) L’Oeuf à la coque (“The Boiled Egg”) (1949) – excerpts 10:09 (published by S.E.M.I.) 16 Métamorphose des poules 3:29 17 Variation I “Genre: Boite à Musique” 2:14 18 Variation III “Valse Lent” 1:44 19 Cancan final endiablé 2:41 Boris Asafiev (1884-1949) “The Flames of Paris” (1931) – Pas de deux 5:39 (publisher unknown) 20 Introduction (Allegro moderato) 1:26 21 Philippe’s Variation (Allegro molto moderato) 0:57 22 Jeanne’s Variation (Allegretto) 1:12 23 Coda (Allegro) 2:03 Claude Debussy (1862-1918), transcribed by Henri Büsser (1872-1973) Printemps (Suite Symphonique) 15:23 (published by Durand S.A.) 24 I 8:33 25 II 6:50 Igor Stravinsky (1882-1971) “Pulcinella” (1920) – excerpts 8.21 (published by Chester Music) 26 Allegro moderato, mezzo-forte e staccato – Allegro 2:35 27 Gavotta (Allegro moderato) – Variation I (Allegretto) – Variation II (Allegro più tosto moderato) 3:57 28 Vivo 1:48 Total playing time 79.54 It is believed that all these pieces are receiving their première recording in piano form Anthony Goldstone, piano Recorded in St. -

DP COCO ANGL:Mise En Page 1
CLAUDIE OSSARD, CHRIS BOLZLI and VERONIKA ZONABEND present MADS MIKKELSEN ANNA MOUGLALIS Afilm by INTERNATIONAL SALES Wild Bunch JAN KOUNEN Cannes office: 4 La Croisette - 2nd floor With ELENA MOROZOVA - NATACHA LINDINGER - GRIGORI MANOUKOV CAROLE BARATON +33 6 20 36 77 72 ANATOLE TAUBMAN - NICOLAS VAUDE [email protected] LAURENT BAUDENS Screenplay by +33 6 70 79 05 17 CHRIS GREENHALGH [email protected] Adapted by VINCENT MARAVAL +33 6 11 91 23 93 CARLO DE BOUTINY et JAN KOUNEN [email protected] Adapted from the novel Coco & Igor by CHRIS GREENHALGH GAEL NOUAILLE +33 6 21 23 04 72 [email protected] SILVIA SIMONUTTI A EUROWIDE FILM PRODUCTION +33 6 20 74 95 08 In association with HEXAGON PICTURES [email protected] In partnership with CANAL+ and TPS STAR www.wildbunch.biz and WILD BUNCH With the support of REGION ILE-DE-FRANCE INTERNATIONAL PRESS CHARLES MCDONALD In association with CINEMAGE 3 Cannes office: c /o Premier PR Villa Ste Hélène 45, Bd d’Alsace Running time : 1h55/Scope/Dolby SRD 06400 Cannes Office Tel.: +33 (0)4 97 06 30 61 [email protected] 4 COCO CHANEL & IGOR STRAVINSKY PARIS 1913 At the Theatre Des Champs-Elysées, Igor Stravinsky premieres his The Rite Of Spring. Coco Chanel attends the premiere and is mesmerised… But the revolutionary work is too modern, too radical: the enraged audience boos and jeers. A near riot ensues. Stravinsky is inconsolable. Seven years later, now rich, respected and successful, Coco Canel meets Stravinsky again - a penniless refugee living in exile in Paris after the Russian Revolution. -

Misia Sert, Une “Récolteuse De Génies”
critiques n OliVier cariguel n misia sert, une “récolteuse de génies” isia Sert reste un nom incontournable de la vie artistique de la Belle Époque à la fin des années trente. Pour ceux qui ont eu la malchance de ne pas en profiter, l’exposition Misia, reine de Paris mprésentée au musée d’Orsay de juin à septembre se prolonge au musée Bonnard jusqu’au 6 janvier 2013 dans une version adaptée à ses espaces (1). Ce jeune musée inauguré au Cannet en 2011 fera on l’espère le plein de visiteurs et de Misia, la reine du Cannet et de la Côte d’Azur. « Belle panthère impérieuse et sanguinaire », selon Eugène Morand, conservateur du Dépôt des marbres près du Champ-de-Mars à Paris et père de Paul, l’écrivain et diplomate, elle eut une 1. Guy Cogeval et Isabelle Cahn (dir.), Misia, vie éblouissante qui commença par un épisode tra- reine de Paris, gique. Née en 1872 à Saint-Pétersbourg, Sophie Olga Gallimard-Musée d’Orsay, catalogue de l’exposition Zénaïde Godebska, dite Misia, est le troisième enfant coproduite par le musée d’Orsaylivres et le de Sophie Servais, fille d’un violoncelliste belge, et de musée Bonnard, Cyprien Godebska, un sculpteur d’origine polonaise. à l’affiche au musée Bonnard jusqu’au Misia est venue au monde avec un parfum de scandale. 6 janvier 2013. L’exposition se divise en Le drame se noue comme dans le meilleur vaudeville. deux parties : « Misia Sophie découvre une lettre de son mari dans laquelle et le cercle de la Revue blanche » et « Misia elle apprend qu’il est amoureux de sa tante (la sœur de Belle Époque : la scène la belle-mère de Cyprien). -

Maurice Ravel Was Occasionally
La Valse Maurice Ravel aurice Ravel was occasionally giv- considerably. What had formerly signified Men to commenting on earlier cultural buoyant joie de vivre assumed an ominous achievements through his own music, even tone in retrospect. The self-satisfied pleasure to an extent that may be said to prefigure of 19th-century Vienna had led to national the postmodern obsessions of the late 20th hubris and international catastrophe. By the century. One such historical strand of music time Ravel composed La Valse, in 1919–20, the that intrigued Ravel was the Viennese waltz, gaiety of the Viennese ballroom could no lon- which reached its apex in the hundreds of ger be presented without knowing comment. examples by Johann Strauss II and came to Instead, Ravel’s 20-minute tone poem reveals symbolize the somewhat formalized joyful- itself, ever so gradually, to be a sort of danse ness of 19th-century Austria. To some, it also macabre. The interval of the tritone (the aug- suggested the assumed cultural superiority mented fourth or diminished fifth), histori- of a city (and a populace) that could boast of cally understood to convey some diabolical having supported some of the most notable connotation, is shot through the melodies of composers of all time, from the age of Haydn La Valse, yielding a bitonal sense of some- and Mozart through the period of Beetho- thing being out of kilter. One can’t help feel- ven and Schubert to the era of Brahms and ing that the ballroom the piece depicts is Bruckner and the modernist fin-de-siècle oddly out of focus.