Historique Complet
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Préfecture Du Pas-De-Calais Arrondissement De Boulogne-Sur-Mer
PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS ARRONDISSEMENT DE BOULOGNE-SUR-MER ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PLAN PARTICULIER DES RISQUES LITTORAUX (PPRL)DU BOULONNAIS AU TITRE DE LA SUBMERSION MARINE Concernant les communes d’Ambleteuse, Audinghen, Audresselles, Tardinghen, Wimereux, Wimille, Wissant RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE et ANNEXES DU RAPPORT (Doc ½) CONCLUSIONS ET AVIS SUR LE PROJET DE PPRL DU BOULONNAIS Décision de Monsieur le Président du tribunal administratif du 7 Mars 2017 Arrêté Préfectoral du 11 avril 2017 portant sur l’ouverture de l’enquête publique Commission d’Enquête Président : Michel NIEMANN Membres titulaires : Dominique DESFACHELLES Vital RENOND Enquête publique N° E1700032/59 du 15 mai au 16 juin 2017 CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS SUR LE PROJET DU PPRL DU BOULONNAIS AU TITRE DE LA SUBMERSION MARINE ................................................................................ 4 PRÉSENTATION DU PROJET ............................................................................................ 4 CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DU PROJET DE PLUi ..................... 4 LE SERVICE PORTEUR DU PROJET ................................................................................ 4 LE DOSSIER DE L’ENQUÊTE ............................................................................................ 5 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE ............................................... 6 LA PARTICIPATION DU PUBLIC ..................................................................................... 7 CONCLUSIONS -

Pas-De-Calais
OBSERVATOIRE DES CENTRES SOCIAUX Le Développement du Pouvoir d’Agir des habitants ET ESPACES DE VIE SOCIALE DU PAS-DE-CALAIS Le pouvoir d’agir, c’est la possibilité concrète pour les personnes d’exercer Les centres sociaux et les espaces de vie sociale partagent un plus grand contrôle sur ce qui est important pour elles, leurs proches, « des orientations communes : les groupes auxquels elles s’identifient. » . DÉFINITION DE YANN LE BOSSÉ . des lieux « d’accueil » de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, au sein desquels la mixité sociale est favorisée Les centres sociaux du Pas-de-calais investissent pleinement le soutien au développement du . des lieux d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, pouvoir d’agir dans leur pratique quotidienne. A titre d’exemple, des bénévoles et des salariés du de concevoir et de réaliser des projets individuels et/ou collectifs. centre social Marie-Jeanne Bassot de Sangatte et l’Espace socioculturel de la Lys à Aires-sur-la- Lys ont participé à la formation « soutenirlepouvoird’agirdeshabitants » animée par la Fédération des centres sociaux Nord Pas- de-Calais. En2018,quatresalariésducentresocialetcultureldeSangattedontmoi-mêmeavonssuivi cette formation, échelonnée sur plusieurs mois. L’équipe a ainsi pris du recul sur ses pratiques Les centres sociaux « _ et postures professionnelles et l’a mis en pratique en accompagnant un groupe d’habitants àlacréationdecabinesàlivressurlacommunedeSangatteBlériot-Plage. Animés par une équipe de professionnels et de bénévoles, ils développent un projet Ce projet est un bel exemple de soutien du développement du pouvoir d’agir des habitants. » JÉRÉMY - DIRECTEUR DU CENTRE d’animation globale et portent des missions complémentaires : . -

Barrières De Dégel 2019-2020
CLASSEMENT DES ROUTES DEPARTEMENTALES EN PERIODE DE POSE DE BARRIERES DE DEGEL Limitation du tonnage autorisé Tableau annexé à l'arrêté N° AD19046 (Hiver 2019/2020) RD n° LOCALISATION Hiver courant T Hiver rigoureux T 1 A Pas-en-Artois jusqu'à Thievres 12 7.5 1 De Beaumets à la RD 6 vers Mondicourt à Pas en Artois 12 7.5 3 De Agny à la RD 23 à Sailly au bois 12 7.5 3 entre les deux branches de la RD 60 LL 3 De Arras (RD 917) à la RD 60 à Achicourt 12 7.5 3E1 Entre la résidenceSt Michel et la SERNAM 12 7.5 3E1 A Arras et St Laurent Blangy (rue des Rosatis) 12 7.5 3E1 De la rue St Michel à la résidence St Michel LL 3E1 Entre la rue St Michel et la résidence St Michel à Arras LL 3E1 Accés à la SERNAM à partir de la RD 260 LL 3E1 Entre la RD 260 et la voie d'accès au port fluvial LL 5 De la limite du Département du Nord à la RD 15 à Havrincourt 12 7.5 5 De la limite du Département du Nord à la RD 14 à Lagnicourt- Marcel 12 7.5 5 De la RD 956 à Ecoust St Mein à la RD 14 Lagnicourt-Marcel 12 7.5 5 De Ecoust St Mein à la RD 60 à Beaurains 12 7.5 5E4 De la RD 917 à Beaurains à la RD 3 à Achicourt 12 7.5 6 De la RN 25 (Mondicourt) à la RD 1 (Pas-en-Artois) 12 12 6E1 De la RN 25 à la RD 6 en direction de Pas-en-Artois 7.5 7.5 6E1 De la RN 25 à la limite de la Somme (Lucheux) LL 7 De Bancourt à la RD 19 à Bertincourt 12 7.5 7 De la RD 339 à Habarcq à la RD 919 à Avette 12 7.5 7 De Bapaume (RD 917) à Bancourt L 12 7 A Beaumetz-les-Loges entre la RN 25 et la RD 62 LL 7 Entre Achiet-le-Grand et la RD 929 à Avesnes-les-Bapaume LL 8 Entre la RN 25 et -

Port De Boulogne Sur Mer/Calais Site De Boulogne Sur Mer
PORT DE BOULOGNE SUR MER/CALAIS SITE DE BOULOGNE SUR MER Capitainerie : Jetée Sud‐Ouest ‐ B.P. 756 ‐ 62321 BOULOGNE‐SUR‐MER CEDEX Tél. : 03 21 80 34 68 Tour de Contrôle (24 h/24 h) : 03 21 80 34 67 ‐ Fax : 03 21 80 34 70 E‐ mail : ddtm‐dml‐capb@pas‐de‐calais.gouv.fr M. Jérôme ABOTSI Commandant de Port du Port de BOULOGNE SUR MER RENSEIGNEMENTS UTILES Mise à jour Janvier 2020 Direction Déléguée d’Exploitation : Station de pilotage CALAIS/BOULOGNE : 96, bd Gambetta ‐ B.P 698 28 rue Jean Noël Dubout 62321 BOULOGNE /MER Cedex 62100 CALAIS Tel : 03 21 10 35 00 ‐ Fax : 03 21 83 42 76 Tél : 03 21 96 40 18 [email protected] C.C.I LITTORAL HAUTS DE FRANCE [email protected] 24 Bd des Alliés – CS 50199 62104 CALAIS CEDEX Tél : 0 820 20 62 59 ‐ Fax : 03 21 99 62 01 Remorquage : Cie Boulonnaise de Remorquage & de Sauvetage Division des Douanes de Boulogne : 14, quai de la Colonne 1, rue Roger Salengro ‐ B.P 77 62100 CALAIS 62230 OUTREAU Tél : 03 21 34 60 18 ‐ Fax : 03 21 34 48 60 Tél : 08 90 21 03 56 ‐ Fax : 03 21 31 43 10 Hôtel de police : Lamanage Boulogne : 9, rue Perrochel ‐ 62200 BOULOGNE /MER Cedex S.E.P.D Tél : 03 21 99 48 48 24 Bd des Alliés 62100 CALAIS DML Tél : 03 21 99 62 98 92, bd Gambetta ‐ BP 629 62200 BOULOGNE /MER Cedex Tél : 03 61 31 33 00 ‐ Fax : 03 61 31 32 93 Service des Phares & Balises 256, avenue Sarraz‐Bournet Sous‐Préfecture : 62480 LE PORTEL 131, Grande Rue ‐ B.P 649 Tél : 03 21 10 35 56 ‐ Fax : 03 21 32 18 46 62200 BOULOGNE /MER Cedex Tél : 03 21 99 49 49 Société Nationale de Sauvetage en Mer -

62-Pas-De-Calais-Arrêté Préfectoral Relatif À L'ouverture Et À La Fermeture
Préfet du Pas-de-Calais CAMPAGNE DE CHASSE 2019-2020 EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE DE LA CHASSE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS ARTICLE 1 er : la période d’ouverture de la chasse à tir est fixée pour le département du Pas-de-Calais pour toutes les espèces de gibiers chassables sauf celles indiquées à l’article 2 : du 15 septembre 2019 à 10 heures au 29 février 2020 à 18 heures ARTICLE 2. : par dérogation à l’article 1er ci-dessus, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes : Dates Dates Espèces Conditions spécifiques d’ouverture de clôture de gibier Du 1er juin à l’ouverture générale s’appliquent les dispositions de l’arrêté préfectoral de tir anticipée du 27 mai 2019. Pendant cette période, le chevreuil ne peut être chassé qu’à l’approche ou à l’affût, uniquement à balle ou à l’arc de chasse, par les détenteurs d’une autorisation préfectorale et du bracelet chevreuil ou d’une copie dans la mesure où il n’y ait pas plus de chasseurs en action de chasse sur le territoire que de bracelets. À partir de l’ouverture générale, il est recommandé de tirer à balle. Si le tir n’est pas réalisé à balle, il doit être réalisé au minimum avec du plomb N° 4 dans la série de 1er 29 Paris (diamètre de 3.25 mm). Chevreuil juin février Pour rappel, dans les zones humides l’utilisation de la grenaille de plomb est 2019 2020 interdite, l’utilisation de munitions de substitution (n°2) est obligatoire. -

Sentier Du Parcours Impérial
Balades et Randonnées pédestres 10 SENTIER DU PARCOURS IMPÉRIAL ◗ KM 14 km 3h30KM 1 Dans la vallée du Denacre, Sentier du vous pourrez croiser de jolies Parcours demeures et manoirs du Impérial XIXème siècle, dont la plupart ont été construites en pierre de 10 2 Baincthun. On y trouve éga- lement fermes, étangs et cas- cades… ce milieu humide est un véritable corridor biologique apprécié par nombre d’oiseaux et de mammifères. En point de vue, vous aurez le choix entre les côtes anglaises du Fort de la Crèche, les côtes 3 françaises (de Wimereux au Cap Gris Nez) du Calvaire des Marins, en passant par le port de Boulogne. 1. Cascade du Denacre 2. La Poudrière 3. La Colonne de la Grande Armée. PUNCH Communication PUNCH 03 Communication 21 32 69 69 Sentier Commune de départ : Wimille du Parcours Stationnement et accès au sentier : La colonne de la Grande Armée : cette colonne de 53 m de Parking de la Colonne à Wimille 1 haut en marbre du Boulonnais, érigée à la gloire de Napoléon Parking du chemin du Denacre à Wimille 3 Impérial par les soldats du Camp de Boulogne, immortalise le camp où Parking à côté de l’office de tourisme à Wimereux 180 000 hommes ont été rassemblés par l’Empereur pour (attention payant) 6 préparer l’invasion de l’Angleterre. On peut y visiter le parc ainsi Parking du Moulin Wibert à Boulogne-sur-Mer 9 que le Musée de la Légion d’Honneur. Coordonnées GPS : WIMILLE Latitude : 50.741126 - Longitude : 1.618866 Le Fort de la Crèche : est une ancienne batterie de côte implantée en 1879 sur les lieux d’un ancien fort Napoléonien. -

Cérémonie De Remise Des Trophées Performance Client Et Performance
- Cérémonie de remise des communiqué trophées Performance client et de presse - Performance commerciale Claire Van Ryssel, vice-présidente de la CCI Littoral Hauts-de-France, a accueilli les commerçants pour la cérémonie de remise des trophées Qualité Commerce, avant de laisser Paul Lammin, président de la Commission Commerce LHF s’adresser à l’assistance. Il a rappelé que la démarche Qualité commerce a été lancée en 2003 bénéficiant du soutien du Conseil Régional dans le cadre du Programme Régional Commerce. Elle s’intègre dans l’opération « Commerçant Hauts-de-France » qui fédère un ensemble d’actions menées par les CCI en faveur du commerce de proximité. En 2016, Qualité Commerce a évolué pour laisser place au Programme Performance Client qui se décline en deux prestations : - La formule simple qui comprend un diagnostic réalisé par un cabinet indépendant sur la base d’une visite client mystère, un audit web et un appel mystère - La formule complète qui se déroule en 3 étapes : un diagnostic réalisé par un cabinet indépendant, un entretien avec un conseiller et un accompagnement individualisé. Les progrès sont analysés par un second audit. - D’autres critères importants pour le consommateur sont désormais pris en compte, tels que le numérique, l’environnement, l’accessibilité… Ce programme Performance client proposé au commerce traditionnel fournit aux TPE les moyens de résister et d’affirmer leur différence face au commerce dit « organisé ». En effet, il permet : - d’améliorer la satisfaction de la clientèle dont les attentes ne cessent -

Saint-Martin-Boulogne 5 Stationnement Et Accès Au Sentier : Parking À L’Entrée Du Magasin Décathlon ZAC Du Mont-Joie À Saint-Martin-Boulogne
CHEMINS DE RANDONNÉE Commune de Saint-Martin-Boulogne 5 STATIONNEMENT ET ACCÈS AU SENTIER : parking à l’entrée du magasin Décathlon ZAC du Mont-Joie à Saint-Martin-Boulogne. COORDONNÉES GPS : Latitude : 50.731906 - Longitude : 1.645652 RECommaNDATIONS • Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des gestionnaires des sites, des agriculteurs et des forestiers. • Protégez la faune, la flore et l’environnement, emportez vos détritus. • Respectez la signalisation ainsi que les aménagements en bordure du circuit. • Dans le cas de modifications des itinéraires (améliorations, Par ce parcours, le randonneur découvrira déviations pour causes de travaux...) suivez le nouveau que la nature est encore très présente à balisage qui ne correspond plus alors à la description. Saint-Martin-Boulogne. Le passage par l’Arboretum et sa grande variété d’essences vous conduira sur le plateau de la Waroquerie, où vous contemplerez le panorama Boulonnais, avant de flâner dans l’un des plus charmants hameaux de la commune : Ostrohove. Vous emprunterez le Ravin de Pitendal, entretenu par Eden 62. 5 PARCOURS SAINT-MARTIN- 5 BOULOGNE PARCOUrs PARCOUrs du du Val Saint-Martin PARCOURS Val Parcours réalisés par le service communication, tél. : 03 21 32 84 84 Entretien des parcours réalisé par le service © Mairie - Saint-Martin-Boulogne tous réservés droits Saint-Martin Environnement de la municipalité, tél. : 03 21 92 37 69 Départ : Mont-Joie et l’association Rivages Propres, tél. : 03 21 10 46 97 KM 8,8 km KM Mairie de Saint-Martin-Boulogne 2h10 313, -

RÉFÉRENDUM DE 1958 Constitution De La Vème République Préfecture
RÉFÉRENDUMS - 1 RÉFÉRENDUM DE 1958 Constitution de la V ème République Préfecture. Cabinet du préfet • Déroulement de la campagne électorale 1W45524/2 Prévisions des résultats : rapports des sous-préfets et du préfet au ministre de l’Intérieur. 1W45524/3 Propagande communiste : rapports des Renseignements généraux. 1W45524/4 Propagande socialiste : rapports des Renseignements généraux. 1W45524/7 Note sur la présence de ressortissants marocains sur certaines listes électorales. • Résultats 1W45524/6 Déroulement du référendum : rapport du préfet au ministre de l’Intérieur. 1W45524/5 Suivi des résultats. Sous-préfecture de Lens 1724W41/1 Activité politique et presse : rapports des Renseignements généraux antérieurs et postérieurs à la consultation. Coupures de presse. RÉFÉRENDUMS - 2 RÉFÉRENDUM DE 1961 Autodétermination de l’Algérie Préfecture. Cabinet du préfet • Déroulement de la campagne électorale 1W45524/8 Organisation matérielle du scrutin : circulaire ministérielle. Allocution prononcée le 20 décembre 1960 par le général de Gaulle. 1W45524/8 Prévisions : rapport du 23 décembre 1960. 1W45524/8 Position des organisations politiques : rapport des Renseignements généraux. • Résultats 1W45524/8 Rapport post-électoral du préfet au ministre de l’Intérieur. Sous-préfecture de Lens 1724W41/2 Affiche de l’allocution du général de Gaulle. Affiche reproduisant l’arrêté de convocation des électeurs. 1724W41/3 Activité politique et presse : rapports des Renseignements généraux. Coupures de presse et tracts de propagande. RÉFÉRENDUMS - 3 RÉFÉRENDUM DU 8 AVRIL 1962 Accords d’Évian Préfecture. Cabinet du préfet • Instructions 1W45528/1 Instructions ministérielles et préfectorales. • Résultats 1W45528/3 Prévisions sur les résultats, exposé et appréciations sur les résultats du référendum : rapport du préfet au ministre de l’Intérieur. 1W45528/2 Résultats par circonscription, par canton et par commune. -

Note De Présentation Ppri De La Vallée Du Wimereux
Maître d’ouvrage Maître Maître d’œuvre Maître PPRI du bassin versant du Plan de Prévention du de Prévention Plan Consultationsofficielles Notedeprésentation Risque Inondation Risque Wimereux © DREAL Hauts-de-France Décembre Décembre 2019 Échelle : 1 SOMMAIRE LA GESTION DU RISQUE 1 - Préambule...................................................................................................................................5 2 - Un processus global porté par l’ensemble des acteurs du territoire...................................6 2.1 - Les principes de la gestion des risques naturels.....................................................................................................................................................6 2.2 - Le citoyen..................................................................................................................................................................................................................7 2.3 - Les collectivités.........................................................................................................................................................................................................7 2.4 - L’État.........................................................................................................................................................................................................................8 2.5 - Responsabilités.........................................................................................................................................................................................................8 -
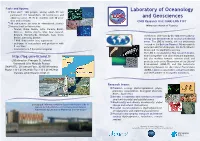
Laboratory of Oceanology and Geosciences
Facts and figures: Total staff: 100 people, among which 55 are Laboratory of Oceanology permanent (33 researchers, 22 technicians and administrators), 35 Ph.D. students and 10 post- and Geosciences docs and contracts CNRS Research Unit (UMR) LOG 8187 80 publications per year in international journals International collaborations: Wimereux (North of France) - Taiwan, China, Russia, India, Canada, Brazil, Morocco, Tunisia, Algeria, USA, New Zealand, Belgium, Netherlands, Denmark, Italy, Great The themes addressed by the LOG refer to Ocea- Britain, Germany, Greece... nology and Geosciences in coastal and littoral - 7 PhD. thesis under joint supervision areas. The LOG is mainly, but not exclusively - exchange of researchers and professors with focused on the Eastern Channel. Other research 5 countries, areas include French Guyana, the North Atlantic - involvement in 5 European programs Ocean and the Mediterranean Sea. The LOG is organized into five research teams, http://log.univ-littoral.fr each having their own objectives and expertise, but also working towards common goals and LOG director: François G. Schmitt projects, such as the Observation of the Littoral Université Lille Nord de France Environment (SOMLIT) and the Automatic SMW-USTL, 28 avenue Foch, 62930 Wimereux Monitoring Network for the Littoral Environment Phone: +33-3 21 99 29 00, Fax: +33-3 21 99 29 01 (MAREL), micro-scale studies, estuarine studies [email protected] and development of ecosystem indicators. Research teams: Plankton ecology (bacterioplankton, -

Cahier De 16 Pages Dans Ce Numéro
L’Écho du Pas-de-Calais no 197 – Février 2020 11 Février 2020 no 197 ISSN 1254-5171 L’timps passé i’est oute ! www.pasdecalais.fr p. 9 Photo ©wjarek - stock.adobe.com Ruée vers l’orchidée p. 14 Photo Yannick Cadart La « vétithèque » p. 15 Photo Yannick Cadart Février au volant CAHIER DE 16 PAGES DANS CE NUMÉRO DANS SAVOURER Lire page 4 LES CONCOURS Solène Elliott et Nicolas Poizot au lycée hôtelier du Touquet - Photo Jérôme Pouille 2 À360° l’air livre L’Écho du Pas-de-Calais no 197 – Février 2020 Annoncer un événement, proposer un reportage… une seule adresse : 5 rue du 19-Mars 1962 Du grand Photo Jérôme Pouille 62000 Dainville Sommaire 4 Vie des territoires athlé-spectacle 13 Expression des élus 14 Vécu 15 Sport 16 Arts & Spectacles 18 À l’air livre 19 Tout ouïe LIÉVIN • Casting de rêve le mercredi 19 février à partir de 19 h pour le meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais Trophée EDF et grande soirée d’athlétisme en perspective. Une belle brochette de champions, médaillés aux derniers mondiaux à Doha ou aux Jeux Olympiques de Rio s’est donné rendez-vous à l’Arena stade couvert de Liévin pour un meeting qui intègre cette année le circuit mondial. Le public suivra particulièrement 20 Agenda le concours du saut à la perche avec chez les femmes la vice-championne olympique et du monde, l’Américaine Sandi Morris, la Suédoise Angelica Bengtsson et chez les hommes l’Américain Sam Kendricks, champion du monde en 2019 et 3e meilleur performer mondial de tous les temps avec 6,06 mètres, le Suédois Armand Duplantis.