Le Dispositif D'approvisionnement En Eau De La Colonie Romaine De Saldae
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

De La Cité Romaine De Saldae À La Fondation Hammadide D'al-Nāṣiriyya
De la cité romaine de Saldae à la fondation hammadide d’al-Nāṣiriyya (IIIe/IXe-Ve/XIe siècle) Aurélien Montel To cite this version: Aurélien Montel. De la cité romaine de Saldae à la fondation hammadide d’al-Nāṣiriyya (IIIe/IXe- Ve/XIe siècle) : histoire de Béjaïa, une ville en transition. Revue d’Histoire Méditerranéenne, Univer- sité de Bejaïa, 2020, 2, pp.60-72. halshs-02864940 HAL Id: halshs-02864940 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02864940 Submitted on 5 Aug 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Revue d’histoire méditerranéenne. Numéro : 02, juin 2020. Reçu le : 19 avril 2020 Révisé le : Le 03 mai 2020 Accepté le : 01 juin 2020 De la cité romaine de Saldae à la fondation hammadide d’al- e e e e 1 Nāṣiriyya (III /IX -V /XI siècles) : Histoire de Bejaia, une ville en transition. From the Roman city of Saldae to the hammadid foundation of al-Nāṣiriyya (3rd/9th-5th/11th centuries): History of Bejaia, a city in transition. Dr. MONTEL Aurélien Université Lumière-Lyon 2 Résumé e La cité romaine de Saldae est mentionnée pour la dernière fois au V siècle de notre e e ère. -

7 the Roman Empire
Eli J. S. Weaverdyck 7 The Roman Empire I Introduction The Roman Empire was one of the largest and longest lasting of all the empires in the ancient world.1 At its height, it controlled the entire coast of the Mediterranean and vast continental hinterlands, including most of western Europe and Great Brit- ain, the Balkans, all of Asia Minor, the Near East as far as the Euphrates (and be- yond, briefly), and northern Africa as far south as the Sahara. The Mediterranean, known to the Romans as mare nostrum(‘our sea’), formed the core. The Mediterranean basin is characterized by extreme variability across both space and time. Geologically, the area is a large subduction zone between the African and European tectonic plates. This not only produces volcanic and seismic activity, it also means that the most commonly encountered bedrock is uplifted limestone, which is easily eroded by water. Much of the coastline is mountainous with deep river valleys. This rugged topography means that even broadly similar climatic conditions can pro- duce drastically dissimilar microclimates within very short distances. In addition, strong interannual variability in precipitation means that local food shortages were an endemic feature of Mediterranean agriculture. In combination, this temporal and spatial variability meant that risk-buffering mechanisms including diversification, storage, and distribution of goods played an important role in ancient Mediterranean survival strategies. Connectivity has always characterized the Mediterranean.2 While geography encouraged mobility, the empire accelerated that tendency, inducing the transfer of people, goods, and ideas on a scale never seen before.3 This mobility, combined with increased demand and the efforts of the imperial govern- ment to mobilize specific products, led to the rise of broad regional specializations, particularly in staple foods and precious metals.4 The results of this increased con- It has also been the subject of more scholarship than any other empire treated in this volume. -

Sustainability and ‘The Fall of the Western Roman Empire’: Grain, Labor Markets, and Military Policies
Sustainability and ‘The Fall of the Western Roman Empire’: Grain, Labor Markets, and Military Policies Master’s Thesis Presented to The Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences Brandeis University Graduate Program in Ancient Greek and Roman Studies Dr. Cheryl Walker, Advisor In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts in Ancient Greek and Roman Studies by Hunter M. Bruno May 2018 Copyright by Hunter Bruno © 2018 ABSTRACT Sustainability and ‘The Fall of the Western Roman Empire’: Grain, Labor Markets, and Military Policies A thesis presented to the Graduate Program in Ancient Greek and Roman Studies Graduate School of Arts and Sciences Brandeis University Waltham, Massachusetts By Hunter M. Bruno The issue of societal sustainability is relevant to both modern and ancient civilizations. Ancient Rome was defined and influenced by the issue of sustainability because it was integral to the fundamental structure of the Roman society. In the 5th Century CE, the fall of the Western Roman Empire took place because of consequences that resulted from the issue of sustainability. The societal factors of grain production, military policy, and labor markets all served to influence the sustainability of the Roman West. Roman military policy defined the nature of the Roman economy and established the type of labor system that it employed. Free and unfree labor markets structured the agrarian economy and formed the Roman system of internal taxation and rent collection. Local and commercial grain producers were relied upon to maintain the populations of the Roman West, uphold the Roman military, and sustain the growing servile populations. -
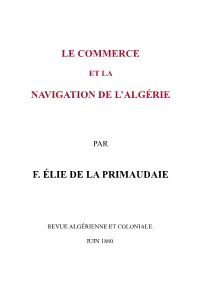
Commerce Et Navigation.Indd
LE COMMERCE ET LA NAVIGATION DE L’ALGÉRIE PAR F. ÉLIE DE LA PRIMAUDAIE REVUE ALGÉRIENNE ET COLONIALE. JUIN 1860. Livre numérisé en mode texte par : Alain Spenatto. 1, rue du Puy Griou. 15000 AURILLAC. D’autres livres peuvent être consultés ou téléchargés sur le site : http://www.algerie-ancienne.com Ce site est consacré à l’histoire de l’Algérie. Il propose des livres anciens (du 14e au 20e siècle) à télécharger gratuite- ment ou à lire sur place. REVUE ALGÉRIENNE ET COLONIALE. JUIN 1860. LE COMMERCE ET LA NAVIGATION DE L’ALGÉRIE AVANT LA CONQUÊTE FRANÇAISE. Encore un mot sur cette époque intéressante du moyen âge, où la France trouve pour l’ouvre de civilisation quelle accomplit en Algérie de si précieux encouragements. Carrette. AVERTISSEMENT. Les anciens portulans dont je me suis servi pour composer cette description de l’Algérie au moyen âge sont au nombre de dix : 1° Le recueil de Visconti, dont l’original existe à la biblio- 2 COMMERCE ET NAVIGATION DE L’ALGÉRIE thèque impériale de Vienne. Ce portulan, le plus ancien du moyen âge, est aussi l’un des plus exacts. Il contient plusieurs cartes marines très étendues et porte l’inscription suivante : Petrus Visconte de Januâ fecit istas tabulas anno Domini MCCCXVIII. 2° L’atlas catalan de l’an 1375, dessiné par Jacques Ferrer, navigateur de Majorque, qui fait partie des manuscrits de la Bibliothè- que impériale(1). Il a été publié dans le tome XIV, IIe partie, des Notices et Extraits des Mss., avec un mémoire de MM. Buchon et Tastu. -

Le Librator Nonius Datus Et L'aqueduc De Saldae
Le Librator Nonius Datus et l'aqueduc de Saldae Hocine Djermoune To cite this version: Hocine Djermoune. Le Librator Nonius Datus et l'aqueduc de Saldae. 2016. <hal-01325522> HAL Id: hal-01325522 https://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/hal-01325522 Submitted on 2 Jun 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License Le Librator Nonius Datus et l’aqueduc de Saldae Hocine DJERMOUNE 2 juin 2016 Résumé Préambule Les travaux d’hydrauliques romains, sont parmi les instruments les plus importants ayant permis la coloni- sation, à l’instar de l’organisation militaire et adminis- trative des provinces, et de la mise en place des réseaux Malgré la fameuse réputation qui lui est faite depuis routiers (voies de communication et le Limes). Des- la découverte de l’inscription de Nonius Datus en 1866 quels a découlée la romanisation de larges territoires à Lambèse, l’aqueduc de Saldae et son tunnel et ses de la méditerranée. Ces travaux constituent un do- ouvrages d’art n’ont jamais été documentés et étudiés maine de prédilection pour la recherche archéologique. -

The Two Mauretaniae: Their Romanization and The
THE TWO MAURETANIAE: THEIR ROMANIZATION AND THE IMPERIAL CULT by CLAUDIA GIRONI submitted in fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS in the subject ANCIENT HISTORY at the UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA SUPERVISOR : PROF. U.R.D. VOGEL JOINT SUPERVISOR : DR M. KLEIJWEGT Date submitted November 1996 SUMMARY The 'Romanization' of the African provinces of Mauretania Tingitana and Mauretania Caesariensis was in fact a two-way process of exchange between Roman and African elements which resulted in a uniquely Romano-African civilization. The imperial cult highlights issues common to all Romanization processes, such as ruler-subject interaction and the role of local initiative in bringing about change, as well as unique issues such as the impact of politics on emperor-worship. The success of the imperial cult was hampered by the fact that only a select few - notably the wealthy local elite - derived direct benefit from the process, and by the fact that, because the pre-Roman Mauretaniae had no established ruler-cults, the imperial cult failed to assimilate with local tradition. As a result, the cult was unable either to make a decisive impact on the Romanization of the Mauretanians, or to achieve any real religious unity among them. KEY TERMS Romanization; Imperial cult; North African history; Roman empire; Mauretania Tingitana; Mauretania Caesariensis; Mauri; Religious syncretism; Roman gods; Roman priests; African religion, ancient. DECLARATION I declare that "The two Mauretaniae : their Romanization and the imperial cult" is my own work and that all the sources that I have used or quoted have been indicated and acknowledged by means of complete references. -

Shaping the Dioceses of Asiana and Africa in Late Antiquity
Shaping the Dioceses of Asiana and Africa in Late Antiquity SHAPING THE DIOCESES OF ASIANA AND AFRICA IN LATE ANTIQUITY Joey van Kuijck Student number: S4154630 Thesis Advisor: Dr. D. Slootjes Date of Submission: 15-06-2016 1 Shaping the Dioceses of Asiana and Africa in Late Antiquity SHAPING THE DIOCESES OF ASIANA AND AFRICA IN LATE ANTIQUITY CONTENTS List of Abbreviations: 03 Introduction 04 Status Quaestionis 06 Chapter One 09 Establishment and Transformation of the Traditional African Provinces Chapter Two 16 The reasoning behind the division of Roman Africa Chapter Three 21 The Kingdom of Pergamon, the Seleucids and the diocese of Asiana Chapter Four 25 Asiana and the logic behind its provincial changes Chapter Five 31 Administrating Asiana and Africa Epilogue 34 The way forward Appendices 36 Appendix I: Used Latin Inscriptions Appendix II: Used Greek Inscriptions and Translations Bibliography 43 2 Shaping the Dioceses of Asiana and Africa in Late Antiquity List of Abbreviations: AE: Année Épigraphique BSA: Annual of the British School at Athens CIL: Corpus Inscriptionum Latinarum FIR²: Fontes Iuris Romani Ante-iustiniani, edition altera ILAlg: Inscriptions Latines de l‘Algérie ILS: Inscriptiones latinae selectae (Dessau) IRT: Inscriptions of Roman Tripolitania MAMA: Monumenta Asiae Minoris Antiqua OGIS: Orientis Graecae inscriptiones selectae SEG: Supplementum Epigraphicum Graecum TAM: Tituli Asiae Minoris 3 Shaping the Dioceses of Asiana and Africa in Late Antiquity Introduction When the Roman Empire was faced by many difficulties in the third century, which were affecting the internal stability of the realm, drastic reforms were needed in order to overcome the prevalent crisis. Although there were emperors who tried to reform the state, none of them could reign long enough, since they were targets of usurpers and their assassins. -

Book Reviews
BOOK REVIEWS RUS AFRZCUM. TERRA ACQUA OLZO NELL' excavation and survey (78-80,by S. Abram). A list AFRICA SETTENTRZONALE. SCAVO E RZC- of sites (81-84) and bibliography (85-93) are also OGNZZZONE NEI DINTORNI DI DOUGGA provided. The second half of the volume is taken up (ALTO TELL TUNISINO), MOSTRA PALAZZO with the exhibition photographs, in colour and THUN, TORRE MIRANA, TRENT0 23 black-and-white. which are of high quality. The NOVEMBRE 2000-7 GENNAZO 2001. By many colour photographs of structures and the M. de Vos (ed.) Universita degli Studi di landscape are a particular delight. Trento/Znstitut National du Patrimoine de The description of the Dougga aqueduct is the Tunis, Trento 2000. ISBN 88-8443-003-8, pp. first detailed treatment of this structure since its 104 + r~umerouspages of colour and black- description (with very few illustrations) by Louis and-white illustrations; 7 folding maps and Carton in 1896,s and comprehension of the plans. L.It. 35,000. monument is greatly improved by the inclusion of accurate plans. photographs and drawings of Considering the fertility of the North African coun- several of the seven arcaded bridges which carry the tryside and the exceptional state of preservation of aqueduct across valleys. We now have another well remains there, relatively little field survey work has illustrated and documented North African aqueduct been done there by comparison with other parts of to set alongside studies of the Cherchel and the circum-Mediterranean world. The survey proj- Carthage aqueducts.9 The illustrations -
A La Recherche D'icosium In: Antiquités Africaines, 2,1968
Marcel Le Glay A la recherche d'Icosium In: Antiquités africaines, 2,1968. pp. 7-54. Citer ce document / Cite this document : Le Glay Marcel. A la recherche d'Icosium. In: Antiquités africaines, 2,1968. pp. 7-54. doi : 10.3406/antaf.1968.888 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/antaf_0066-4871_1968_num_2_1_888 Antiquités africaines t, 2, 1968, p. 7 - 54 A LA RECHERCHE D'ICOSIUM par Marcel LE G LAY C'est le Père Hardouin qui, le premier, proposa d'identifier Icosium à Alger. A la suite de quoi le docteur Shaw, qui en 1832 habitait Alger en qualité de chapelain du Consulat d'Angleterre, commença à rassembler les documents et les preuves, pour affirmer que la ville des Corsaires correspondait bien à l'antique Icosium. Depuis lors, l'identification n'a plus été remise en cause. Et les savants, les uns amateurs, les autres professionnels — parmi eux on retiendra en particulier les noms de Berbrugger, de Devoulx, de Gavault, de S. Gsell et de L. Leschi — se sont mis patiemment à l'affût de toutes les Antiquités qui sor taient du sol d'Alger à l'occasion des travaux de démolition et de construction entrepris depuis l'installa tionfrançaise en 1830 pour essayer de retrouver le contact avec le passé. Comme il arrive pour beaucoup de villes, le livre de l'histoire d'Alger s'ouvre sur une légende. Non pas un merveilleux conte de fées ou une fantastique légende mythologique. Mais une méchante histoire d'abandon et de jalousie. C'est un grammairien de la seconde moitié du IIIe siècle de notre ère, Solin, qui l'a rapportée : « Hercule passant en cet endroit fut abandonné par vingt hommes de sa suite, qui y choi sirent l'emplacement d'une ville dont ils élevèrent les murailles ; et, afin que nul d'entre eux ne pût se glorifier d'avoir imposé son nom particulier à la nouvelle cité, ils donnèrent à celle-ci une désignation qui rappelait le nombre de ses fondateurs » (Solin, XXV, 17). -

Durham E-Theses
Durham E-Theses A study of the municipal aristocracies of the roman empire in the west, with special reference to north Africa Jarrett, Michael Grierson How to cite: Jarrett, Michael Grierson (1958) A study of the municipal aristocracies of the roman empire in the west, with special reference to north Africa, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/1980/ Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in Durham E-Theses • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full Durham E-Theses policy for further details. Academic Support Oce, Durham University, University Oce, Old Elvet, Durham DH1 3HP e-mail: [email protected] Tel: +44 0191 334 6107 http://etheses.dur.ac.uk 2 A STUDY OF THE MUITICIM ARISTOCRACIFS' OF THE ROMAN EMIYM IN THE WEST,, WM SIWIAL ROSH= TO NOMIL AFRMA A dissertation presented for the degree of by Doctor of Philosophy in the University of Duxham J(jCfLkn G. JME=,, B. A., p Hatfield College. The copyright Of this tfiesis rest$ with the author. from No quotation it should be published without his prior written consent and information derived May, 1958. -

The Transformation of the Roman Auxiliary Soldier in Thought and Practice
The Transformation of the Roman Auxiliary Soldier in Thought and Practice by Jonathan James McLaughlin A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Greek and Roman History) in the University of Michigan 2015 Doctoral Committee: Professor David S. Potter, Chair Associate Professor Ian S. Moyer Professor Raymond Van Dam Professor Arthur Mfw Verhoogt © Jonathan James McLaughlin 2015 Dedication This dissertation is dedicated to my mother, Kathleen Rose (Gilronan) McLaughlin (1955-2011), whose self-sacrifice, encouragement, and love inspired all those around her. ii Acknowledgements I would not have been able to complete this dissertation without the aid and support of many advisors, colleagues, and friends. As chair of this project, David Potter always expressed confidence in my ideas and my writing, while also providing expert scholarly and professional advice. Ray Van Dam urged me to carefully consider my assumptions as well as the structure of my argument. I enjoyed discussing theoretical issues with Ian Moyer, while Arthur Verhoogt rightly pushed me to consider context and case studies. Bruce Frier, Sara Forsdyke, and other faculty in the Department of Classical Studies and Department of History provided guidance, intellectual insight, and friendship. I learned that writing, in many ways, is a team effort. I cannot express enough gratitude to Leslie Pincus and my fellow history graduate student participants in the Department of History’s Dissertation Writing Seminar. Over two separate semesters the seminar provided the structure, feedback, and accountability I needed to craft two chapter drafts. Paul Barron and my fellow interdisciplinary graduate student participants in the Rackham/Sweetland Dissertation Writing Institute (spring semester 2013) provided a similarly supportive writing environment. -

1854 Smith Dictionary of Greek and Roman Geography
Dictionary of Greek and Roman Geography (1854) William Smith, LLD, Ed. From http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.04.0064:entry=africa-geo&highlight=thenae (Thenae is mentioned on pp. 2, 5 & 8) A´FRICA ( Ἀφρική: Adj. Afer, Africus, Africanus), the name by which the quarter of the world still called Africa was known to the Romans, who received it from the Carthaginians, and applied it first to that part of Africa with which they became first acquainted, namely, the part about Carthage, and afterwards to the whole continent. In the latter sense the Greeks used the name Libya ( Ἀφρική only occurring as the Greek form of the Latin Africa); and the same name is continually used by Roman writers. In this work the continent is treated of under LIBYA; and the present article is confined to that portion of N. Africa which the Romans called specifically Africa, or Africa Propria (or Vera), or Africa Provincia ( Ἀφρικὴ ἡ ἰδίως ), and which may be roughly described as the old Carthaginian territory, constituted a Roman province after the Third Punic War (B.C. 146). The N. coast of Africa , after trending W. and E. with a slight rise to the N., from the Straits of Gibraltar to near the centre of the Mediterranean, suddenly falls off to the S. at C. Bon (Mercurii Pr.) in 37° 4 ′ 20 ″ N. lat., and 10° 53 ′ 35 ″ E. long., and preserves this general direction for about 3° of latitude, to the bottom of the Gulf of Khabs, the ancient Lesser Syrtis; the three chief salient points of this E.