AOC Chateau Chalon
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Liste De Soutien Des Candidats Front De Gauche Aux Élections Présidentielles Et Législatives De 2012
Liste de soutien des candidats Front de Gauche aux élections Présidentielles et législatives de 2012. « Derrière Jean Luc MELENCHON avec Nelly FATON sur LONS, Francis LAHAUT à St CLAUDE et Patrick VIVERGE à DOLE, faisons entendre nos voix. » L’Humain d’Abord. Liste des Soutiens (432) Geneviève ABADIE Technicienne de Labo en retraite Bruno BURLETT Infirmier CHS St Ylie ORCHAMPS Jacques DEMOUGEOT Psychologue scolaire retraité FRANGY Jean Pascal BURONFOSSE Vigneron Bio et CHAPELLE VOLAND Annie ABRIEL La vieille Loye Solidaire ROTALIER Michel DEMOUGEOT MONTAIN Christian ABRIEL Educateur La vieille Loye Anne Marie CABITZA ASH St Ylie DOLE Christophe DESPRES CHS ST Ylie DOLE Lola ABRIEL LONS le SR René CADOT Maire de GIZIA Martine DEY-MARTIN retraitée éducation nationale Hanane ACHBAR DOLE Frantz CAMBERLIN Délégué syndical DOLE DAMPARIS Sami ACHOURA DOLE Marie Thérèse CAMPY MARNOZ Rosette DEZAN ARBOIS Monique AELLEN DOLE Marc CAPELLI Agent ERDF LES PIARDS Richard DHIVERS Syndicaliste L'ETOILE Christian AHLEN ouvrier TAVAUX Michel CAQUARD Prof à la retraite VINCELLES Raphaëlle DIDIER MARNOZ Ayhan AKENGIN Cafetier ST LAURENT en Gdvx François CAROU Syndicaliste PUBLY Renée DOLE DOLE Florence ALLAGNAT Médiat. vie scolaire LONS le SR Jean CARPENTIER POLIGNY Patricia DUBUIS Guichetière Poste ST LAURENT en J AMIENS SALINS A CARVAL SAINT CLAUDE Gdvx Jade AMREIN TOURMONT Marcel CASSAN BLOIS sur SEILLE Michel DUCROT CHAMPAGNOLE Catherine ANCEAU POLIGNY Elisabeth CAUMONT Conseillère Municipale LES Michel DUCROT militant CGT, INDECOSA logement Renée ANDREETTO SAINT CLAUDE PIARDS LONS le SR Jean Michel ARNOLD Retraité SOLVAY TAVAUX Dominique CAUTARD PREMANON François DUFLOS MOUCHARD Estelle ARQUES GRUSSE Christine CAVET MONNIERES Jeff DUGOURG Rioel AYACHE DOLE Hubert CEDOT Resp Politique et assoc Michel DUSSOUILLEZ CHALONVILLARS Isabelle AZZOLIN VILLARD St SAUVEUR VERNANTOIS, Jean Marie ECOIFFIER Maire de BRIOD, Jacques BACHELU THIONVILLE Daniel CESCO-RESIA Adjoint FONCINE LE BAS Laurence. -
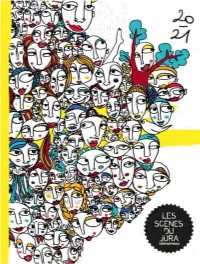
Association Des Scènes Nationales L’Opéra De Dijon, Des Établissements De Ème Prépare, L’Effet Scènes 4 Édition, Un Formations, Des Lieux De Diffusion
Pour mieux vous repérer ! Légende la durée du spectacle 0h00 la catégorie du tarif + l’âge à partir duquel le spectacle est conseillé 7 TP : spectacle Tout Public 7+ Sélection [Tribu] Ce spectacle est une création Une nouveauté de la saison 20-21. C’est une création maison ! Les Scènes du Jura soutiennent ce projet (par une aide financière, un accueil en résidence, un accompagnement…) Une proposition d’un artiste complice Des Befores & Afters autour du spectacle Une garderie pour les 3-11 ans On en parle ! Presse / prix / récompense Aller + loin ! Référence / lien / autour du spectacle Faire avec ! Participer / atelier / stage Faire corps Le spectacle vivant… Quelle meilleure voie pour s’évader du réel et recréer, se perdre et se retrouver, se comprendre et se dépasser ? C’est à cette expérience sensible et physique, divertissante et inattendue que nous vous convions. Les éclats de rire, le partage de points de vue et d’émotions ont pour un temps disparu de nos lieux. Vous avez montré par votre générosité et votre attention votre soutien à votre Scène nationale et aux équipes artistiques. Un grand merci à vous toutes et tous, spectateurs, partenaires des projets, élus et mécènes : grâce à vous, nous avons pu dédommager les artistes et techniciens que nous ne pourrons accueillir cette saison. Le désir de se décentrer, de prendre des chemins de traverse colore l’esprit du projet que j’ai dessiné pour les prochaines années. La particularité du Jura reste pour moi un terrain de jeu inépuisable pour explorer, inventer et stimuler les désirs de création. -

N° 7-2 Juillet 2009
N° 7-2 PREFECTURE DU JURA JUILLET 2009 I.S.S.N. 0753 - 4787 Papier écologique 8 RUE DE LA PREFECTURE - 39030 LONS LE SAUNIER CEDEX - : 03 84 86 84 00 - TELECOPIE : 03 84 43 42 86 - INTERNET : www.jura.pref.gouv.fr 566 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE FRANCHE-COMTE .........................................................................................................................................................................................................................567 Arrêté n° 09-123 du 13 juillet 2009 portant subdélégation de signature ................................................................................................567 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE .....................................................................569 Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage - Formation spécialisée dégâts de gibier - Compte rendu de la réunion du 10 juillet 2009 .....................................................................................................................................................................................569 Arrêté préfectoral n° 2009/472 du 29 juin 2009 portant création d’une réserve de chasse et de faune sauvage sur le territoire de l’ACCA de VILLERS ROBERT ................................................................................................................................................................570 Arrêté préfectoral n° 2009/473 du 29 juin 2009 portant création d’une -

WINE Talk: April 2015
Licence No 58292 30 Salamanca Square, Hobart GPO Box 2160, Hobart Tasmania, 7001 Australia Telephone +61 3 6224 1236 [email protected] www.livingwines.com.au WINE Talk: April 2015 The newsletter of Living Wines: Edition 53 Welcome to the April 2015 newsletter (even though today is the fourth day of May)! There is lots of information in this month’s edition especially about forthcoming natural wine events in Australia. We are holding our first event for both the public and the trade in Hobart in two weeks, so have a look for the details below. There is also information about three other events, the Handmade event in Melbourne, the SoulfulWine event to be held at a still secret location in Melbourne in July and, of course, Rootstock which is to be held in November this year at CarriageWorks in Sydney. We also have information on six new producers whose wines will be arriving in our June container along with many of our existing suppliers’ wines. We have five special packs this month and one secret one buried away in the depths of the newsletter. The first pack is a six pack of good value wines with three reds and three lovely whites for just under $150! We then have a pack highlighting the grapes of the Jura. We have chosen 6 wines based on the six different grape varieties. There is also an article on the Jura later in the newsletter which explains more about this fascinating region. We have assembled a six-pack of three different wines from Loire Valley producer Toby Bainbridge to highlight his winemaking skill. -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2021
Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 39 JURA INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 39 - JURA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 39-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 39-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 39-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 39-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, -

1. Presentation Du Schema Departemental Des Carrieres Du Jura
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie Secrétariat d'Etat à l'Industrie RIRE FRANCHE-COMTÉ UNICEM Bourgogne PREFECTURE DU JURA Franche-Comte Schéma départemental des carrières du département du Jura Rapport de synthèse Etude réalisée dans le cadre des actions de Service public du BRGM 9S-G-043 octobre 1997 R 39052 BRGM itHiMram A« Mtmu M U> IUM Schéma départemental des carrières du Jura Mots clés : matériaux, carrières, granuláis, ressources, besoins, exploitation, environnement, département du Jura (France). En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : (1996) - Schéma départemental des carrières du département du Jura - Rapport de synthèse. Rapport BRGM R 39052, 105 p., 7 fig., 10 ann., 4 planches hors texte. © BRGM, 1996, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l'autorisation expresse du BRGM. Rapporf BRGM R 39052 Schéma départemental des carrières du Jura Synthèse Le schéma départemental des carrières du Jura, décidé en Commission des Carrières, a été réalisé conformément au décret du Ministère de l'Environnement n° 94-603 du 11 juillet 1994 qui fixe le contenu du document, ainsi que les modalités de son élaboration, de sa diffusion et de sa mise à jour ultérieure. L'élaboration du schéma a bénéficié d'une large concertation grâce à la création d'un groupe de travail piloté par la DRIRE et assisté par le BRGM en qualité de chargé de mission, réunissant divers organismes et administrations qui ont apporté leur concours. Le schéma des carrières du Jura concerne principalement les granulats qui, en tonnage, représentent environ 80% de la totalité des matériaux extraits dans le département. -
La Reculée De Salins Est La Plus Septentrionale Des Reculées Externes Du Jura
Géologie locale La reculée de Salins est la plus septentrionale des reculées externes du Jura. La reculée de Salins : Elle est moins typique et sa morphologie est plus complexe vraie ou fausse reculée ? que les autres reculées car la vallée de la Furieuse recoupe des organisations géologiques Mont Poupet Les reculées du plateau lédonien différentes : Reculée de Salins-les-Bains 300 • à l’amont elle entaille les Fort Saint-André Mouchard 500 Fort Belin Fu rieu 400 se couches horizontales du plateau Reculée d’Arbois d’Ivory/Thésy. Elle est donc ici Pretin Salins- Cuis anc les-Bains e 300 G ro une vraie reculée ; z o n n e 400 • à l’aval, elle entaille les structu- Arbois Les Planches res chamboulées du Poupet/Fort Reculée de Poligny Orain Belin/Fort St-André. Ses formes Reculée de Miéry 300 ne sont plus, alors, celles d’une Poligny 500 Brenne 300 reculée. 400 Miéry Zone aval de la reculée de Salins Reculée de À l'arrière-plan, des reliefs isolés (Mont Poupet, Fort Belin, Baume-les-Messieurs Fort Saint André) encadrent la vallée de la Furieuse eille S 300 Château- 500 Chalon Le plateau lédonien est relativement encaissée. C'est le domaine de la "fausse" Voiteur Blois/s/Seille Serein reculée, induite par une organisation géologique complexe entaillé par 6 reculées structurée par des failles chevauchantes. Reculée de Revigny principales débouchant Baume-les- Elles ont empilé les séries calcaires du Jurassique moyen Messieurs sur le vignoble et la Bresse. Elles drainent les eaux du les unes sur les autres, qui sont demeurées en relief. -

Le Réseau MOBIGO Dans Le Jura
Le réseau MOBIGO dans le Jura conditions de circulation Dernière mise à jour : 4/4/19 8:40 P = circuit Primaire, retard ou Ne circule Ligne transporteur Origine / destination normale Observations Type de circuit S = circuit Secondaire, perturbée pas (P / S / LR) LR = ligne structurante TOTAUX 286 1 7 100 TRANSDEV / ARBOIS TOURISME Navettes DOLE 1 160 TRANSDEV TAXENNE - GENDREY 1 161 TRANSDEV La BARRE-La BRETENIERE-ORCHAMPS Primaire 1 162 TRANSDEV RPI SERMANGE - GENDREY 1 163 TRANSDEV Ecole Concordia RANCHOT 1 164 TRANSDEV RPI PAGNEY - OUGNEY - VITREUX primaires 1 165 TRANSDEV BRANS - THERVAY - Gpe Sco DAMMARTIN 1 166 TRANSDEV CHAMPAGNEY - RPI Scolaire Dammartin 1 167 TRANSDEV RPI MONTMIREY-OFFLANGES - MOISSEY 1 168 TRANSDEV RPI PEINTRE MONTMIREY 1 169 TRANSDEV RPI PLUMONT - ETREPRIGNEY 1 170 TRANSDEV Pt MERCEY-DAMPIERRE-FRAISANS Prim/Collèg 1 172 TRANSDEV ORCHAMPS - FRAISANS Collège 1 173 TRANSDEV LA BARRE - FRAISANS Collège 1 174 TRANSDEV DAMPIERRE-FRAISANS Prim et collège 1 175 TRANSDEV MONTEPLAIN - ORCHAMPS 1 176 TRANSDEV OFFLANGES - PESMES Collège 1 177 TRANSDEV PAGNEY - PESMES Collège 1 178 TRANSDEV DAMMARTIN Champagnolot - PESMES Collège 1 179 TRANSDEV OUR - FRAISANS Collège 1 180 TRANSDEV RANS - ORCHAMPS 1 210 KMJ FROIDEVILLE - LONS LE SAUNIER 1 211 KMJ MOLAY - TAVAUX Collège 1 212 KMJ ST GERMAIN LES ARLAY - BLETTERANS Collèg 1 213 KMJ CHAPELLE-VOLAND - BLETTERANS Collège 1 214 KMJ FONTAINEBRUX-BLETTERANS Collège 1 215 KMJ BOIS DE GAND - BLETTERANS 1 216 KMJ COSGES - BLETTERANS 1 217 ARBOIS TOURISME BALIASEAUX - CHAUSSIN Collège -

Liste Des Circuits Hebdomadaires Sorties Exceptionnelles Consignes De Securite Adhesions Contact Liste Des Circuits Hebdomadaires
LISTE DES CIRCUITS HEBDOMADAIRES SORTIES EXCEPTIONNELLES CONSIGNES DE SECURITE ADHESIONS CONTACT LISTE DES CIRCUITS HEBDOMADAIRES Les sorties sont le mercredi avec départ à 17h15. Les lieux de départ sont : MESSIA (vers l'esplanade de loisirs, route de Chilly), MONTMOROT (vers la Mairie), LES ABATTOIRS (zone industrielle de PERRIGNY) et MACORNAY (sur la place du camion à pizzas). Si exceptionnellement il pleut le mercredi (ce qui n'arrive presque jamais!!), nous nous retrouvons le jeudi, même lieu, même heure (contacter les autres participants à l'aide de la liste des contacts). Cette année, la première sortie est prévue le mercredi 27 mars à MESSIA et la dernière sortie le 02 octobre à MACORNAY, pour les mercredis suivants les sorties s'effectueront suivant le soleil et la chaleur. SORTIES EXCEPTIONNELLES à définir Les sorties sur 2 jours s'effectueront conjointement avec la section marche de l'ASCE 39. LES CONSIGNES DE SECURITE Le port du casque est obligatoire à chaque sortie. Comme l'indique le code de la route (article R431-7), lorsque nous roulons en groupe, nous devons faciliter la circulation des autres usagers de la route, c'est-à-dire se mettre en file indienne. Alors n'utilisons pas toute la chaussée, PARTAGEONS LA ROUTE !! De plus restons courtois. Lors des arrêts (aux carrefours, en haut des bosses, dans les courbes...), il est impératif de se grouper hors de la chaussée (accotement, parking, délaissé...) pour ne pas gêner les autres usagers et être visible. ADHESIONS ANNUELLES A L'ASCE 39 pour les personnes du MEDDTL (équipement), du MAAPPRAT (agriculture) et du CG39 (ayant étaient employées par la DDE): catégorie C : 7 euros catégorie B : 12 euros catégorie A : 18 euros pour les retraités de la DDT : 6 euros pour les personnes veuves (DDT) : 4 euros pour les personnes extérieures : 16 euros les cotisations sont à payer avant le 04 avril 2013, passé cette date elles seront doublées. -

Arrêté De Protection De Biotope Des Corniches Calcaires
ARRÊTÉ DE PROTECTION DE BIOTOPE DES CORNICHES CALCAIRES ARRETE PREFECTORAL N°2013186 – 0010 DU 05 JUILLET 2013 PORTANT PROTECTION DE BIOTOPE DES CORNICHES CALCAIRES DU DEPARTEMENT DU JURA Le Préfet du Jura, Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite, - Vu le Code de l’environnement, notamment les articles L 411.1, L 411.2, L 415-1 à L 415-6 et R 411.1 à R 411.6, 411.9 à 411.17, R 414.1 à 24 et R 415-1; - Vu l'arrêté ministériel du 22.06.1992 fixant la liste des espèces végétales protégées en région Franche-Comté complétant la liste nationale, - Vu l'arrêté ministériel du 23.04.2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire, - Vu l'arrêté ministériel du 29.10.2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, - Vu l'arrêté ministériel du 19.11.2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, - Vu l'arrêté ministériel du 23.04.2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire, - Vu l’avis de la Chambre Départementale d'Agriculture du Jura en date du 10.10.2012, - Vu l'avis du service départemental de l'Office National des Forêts en date du 03.10.2012, - Vu l'avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites du Jura siégeant en formation de protection de la nature en date du 18.03.2013, - Vu les comptes-rendus des réunions de concertation organisées, notamment avec les organismes d'escalade (FFME, Jura Vertical le 25.11.2010), les organismes -

8. 2. 90 Gazzetta Ufficiale Delle Comunità Europee N. C 30/35
8. 2. 90 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 30/35 Proposta di direttiva del Consiglio del 1989 relativa all'elenco comunitario delle zone agrìcole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia) COM(89) 434 def. (Presentata della Commissione il 19 settembre 1989) (90/C 30/02) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando che la richiesta di cui trattasi verte sulla classificazione di 1 584 695 ha, di cui 8 390 ha ai sensi visto il trattato che istituisce la Comunità economica dell'articolo 3, paragrafo 3, 1511 673 ha ai sensi europea, dell'articolo 3, paragrafo 4 e 64 632 ha ai sensi dell'articolo vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE; 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (*), modificata da ultimo dal regolamento considerando che i tre tipi di zone comunicati alla (CEE) n. 797/85 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, Commissione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE ; che, in effetti, il vista la proposta della Commissione, primo tipo corrisponde alle caratteristiche delle zone montane, il secondo alle caratteristiche delle zone svantag visto il parere del Parlamento europeo, giate minacciate di spopolamento, in cui è necessario considerando che la direttiva 75/271/CEE del Consiglio, conservare l'ambiente naturale e che sono composte di del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle terreni agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni zone -
Carte Touristique Pays Du Jura
Maison Pasteur/CIVJ, - Création et réalisation : rectoverso communication - Impression : Est Imprim rectoverso communication - Impression : - Création et réalisation : Maison Pasteur/CIVJ, Maison de la Haute Seille/CIVJ, Philippe Bruniaux/CIVJ, Albisser Hund/CDT Jura, Claudia Hendrick Monnier/CIVJ, Tourisme, Vision/Jura Studio Xavier Servolle/CIVJ, Tourisme, Stéphane Godin/Jura Waltefaugle/Orbagna, Nicolas : Verso Denis Maraux/CDT Jura Jean-Loup Mathieu/CDT Jura, Shutterstock, Tourisme, Michel Loup/Jura Tourisme, Stéphane Godin/Jura Recto : Edition 2015 - Crédit photos : www.jura-vins.com www.jura-tourism.com 2 Salins-les-Bains 8 Nozeroy 9 Haute Vallée de la Saine 10 Les Cascades du Hérisson 11 Le Lac de Vouglans L’Échappée Jurassienne à Foncine et le Lac de Chalain Itinéraire des grands sites du Jura Conseil général du Jura. du général Conseil soutien financier du du financier soutien Cet itinéraire de randonnée du Jura relie la plaine aux hauteurs du massif. Ses 300 Jura Tourisme avec le le avec Tourisme Jura km de sentiers pédestres balisés et homologués (GR®) permettent de découvrir Document réalisé par par réalisé Document la richesse de ce territoire et ses trésors inattendus… Chacun peut se créer son [email protected] Entre deux forts Colline éternelle Le spectacle de l’eau ! Plongées en eaux claires Le géant d’émeraude propre programme de randonnée sur l’Echappée Jurassienne, de 2 à 14 jours à la Tél. 03 84 66 26 14 26 66 84 03 Tél. carte, selon ses envies, son niveau de marche, et la durée de son choix… Et pour 39600 ARBOIS 39600 Prenez un site naturel exceptionnel - le fond d’une grande « reculée ».