La Saison Des Choix
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Struggle for Worker Rights in EGYPT AREPORTBYTHESOLIDARITYCENTER
67261_SC_S3_R1_Layout 1 2/5/10 6:58 AM Page 1 I JUSTICE I JUSTICE for ALL for I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I “This timely and important report about the recent wave of labor unrest in Egypt, the country’s largest social movement ALL The Struggle in more than half a century, is essential reading for academics, activists, and policy makers. It identifies the political and economic motivations behind—and the legal system that enables—the government’s suppression of worker rights, in a well-edited review of the country’s 100-year history of labor activism.” The Struggle for Worker Rights Sarah Leah Whitson Director, Middle East and North Africa Division, Human Rights Watch I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I for “This is by far the most comprehensive and detailed account available in English of the situation of Egypt’s working people Worker Rights today, and of their struggles—often against great odds—for a better life. Author Joel Beinin recounts the long history of IN EGYPT labor activism in Egypt, including lively accounts of the many strikes waged by Egyptian workers since 2004 against declining real wages, oppressive working conditions, and violations of their legal rights, and he also surveys the plight of A REPORT BY THE SOLIDARITY CENTER women workers, child labor and Egyptian migrant workers abroad. -

'Bread, Dignity and Social Justice': the Political
briefing paper page 1 ‘Bread, Dignity and Social Justice’: The Political Economy of Egypt’s Transition Jane Kinninmont Middle East and North Africa Programme | April 2012 | MENAP BP 2012/01 Summary points zz In Egypt’s 2011 uprising, political and economic grievances were closely linked in attempts to address complex problems of corruption and injustice. But the cross- class, cross-ideology coalition that united behind the uprising has predictably fragmented, and different groups now have divergent views on the applicability of liberal economic policies to Egypt. zz The Islamist parties which between them won a majority in the 2011–12 parliamentary election appear to favour the continuation of a broadly pro-market policy, although, like all parties, they have emphasized the need for greater ‘social justice’ and less corruption. Leftist groups and trade unions remain largely unrepresented in parliament and tensions may be brewing between labour and Islamist forces over economic policy. zz Uncertainty over future economic policy is currently deterring investment. Although economic policy was not the main focus in the parliamentary election campaign, there is a pressing need for all parties to develop their economic blueprints further. zz Debates over the role of the state, the free market and the nature of globalization are part of democratic self-determination. Rather than repeating old mantras about the intrinsic desirability of a smaller public sector, external actors need to remember that economic policy advice on the role of the state is not purely technical but value-laden. www.chathamhouse.org ‘Bread, Dignity and Social Justice’: The Political Economy of Egypt’s Transition page 2 Introduction and revealed the transformative potential of street protest, When a popular uprising overthrew President Hosni bottom-up coalition-building and mass campaigning. -

Egypt's Uprising and Its Fate
Egypt's Uprising and Its Fate https://internationalviewpoint.org/spip.php?article7157 Egypt Egypt's Uprising and Its Fate - IV Online magazine - 2021 - IV556 - May 2021 - Publication date: Monday 24 May 2021 Copyright © International Viewpoint - online socialist magazine - All rights reserved Copyright © International Viewpoint - online socialist magazine Page 1/5 Egypt's Uprising and Its Fate CALLING THE OCCUPATION of Tahrir and other urban squares in Egypt and the January-February 2011 ouster of former president Hosni Mubarak a "revolution" as is common is not a helpful characterization of the events. The terms Arab Spring and Arab Winter are even less helpful because they obscure the social struggles of the decade preceding Mubarak's ouster, which continue today. According to the Arab Network for Human Rights Information, in the last quarter of 2020 there were 73 labor (33) and social (40) protests, including 11 strikes. [1] This is considerably fewer than the pace of collective action from 2004 to 2016, and many protests suffered severe repression. But it's a much higher level of social struggle than during the Nasser, Sadat or the first two decades of the Mubarak eras. The popular uprising of January 25, 2011 was partly, although not necessarily consciously, directed against neoliberal Washington Consensus economic policies. In that sense it is comparable to and continuous with the "Bread Intifada" of January 1977, one of the earliest of the roughly 150 anti-IMF food riots from the late 1970s to the early 1990s. The clearest expression of this political economy-driven element in the uprising was the nearly 3500 collective actions, including 570 strikes involving some 2.5 million workers, from 1998 to 2010. -
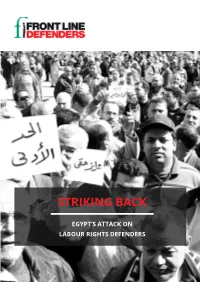
Striking Back
STRIKING BACK EGYPT’S ATTACK ON LABOUR RIGHTS DEFENDERS Cover Photo: Mai Shaheen Thousands of workers at Egypt's biggest textile company strike for minimum wage, payment of delayed bonuses, and a change in company leadership, Mahalla, February 2014. Table of Contents Executive Summary 5-9 I. Egyptian Labour: Resistance & Repression 10-13 II. Militarism & Poverty Under Sisi 14-15 III. Restrictive Legislation 16-18 IV. Case Study: French Naval Group and the Alexandria Shipyard Military Trial 19-27 V. Arrest, Detention, Imprisonment 28-30 VI. Threats to Lawyers & Lack of Representation 31-32 VII. Firing 33-34 VIII. Gendered Attacks 35-36 IX. Weaponizing Poverty 37 - 39 X. Assembly & Association 40-42 XI. Recommendations 43-45 “The government message right now is that striking does not get you rights, it gets you fired and on military trial.” - WHRD and labour leader “Workers are offered freedom for resigning from their jobs. But whether you’re in prison or free without a job, either way, your family has no money for food.” - Labour rights defender January 2019 Executive Summary Labour rights defenders in Egypt are facing more risks than they have in decades, according to interviews with human rights defenders (HRDs) conducted by Front Line Defenders. As increasing numbers of working class Egyptians on the side of the road outside Cairo, his body smeared descend into poverty in a struggling economy, labour with blood. rights activism demanding safe working conditions, a minimum wage and freedom of assembly is critical. Now one of the most dangerous topics in the country, However, the regime of President Abdel Fatteh al-Sisi labour rights was for decades Egypt’s most powerful has punished labour rights defenders with arrests, social mobiliser. -

The Political Aesthetics of Global Protest : the Arab Spring and Beyond, P
eCommons@AKU Individual Volumes ISMC Series 2014 The olitP ical Aesthetics of Global Protest : the Arab Spring and Beyond Pnina Werbner Editor Martin Webb Editor Kathryn Spellman-Poots Editor Follow this and additional works at: https://ecommons.aku.edu/uk_ismc_series_volumes Part of the African History Commons, Asian History Commons, Islamic World and Near East History Commons, and the Political History Commons Recommended Citation Werbner, P. , Webb, M. , Spellman-Poots, K. (Eds.). (2014). The Political Aesthetics of Global Protest : the Arab Spring and Beyond, p. 448. Available at: https://ecommons.aku.edu/uk_ismc_series_volumes/3 The Political Aesthetics of Global Protest The Arab Spring and Beyond Edited by Pnina Werbner, Martin Webb and Kathryn Spellman-Poots in association with THE AGA KHAN UNIVERSITY (International) in the United Kingdom Institute for the Study of Muslim Civilisations The opinions expressed in this volume are those of the authors and do not necessarily reflect those of the Aga Khan University, Institute for the Study of Muslim Civilisations. © editorial matter and organisation Pnina Werbner, Martin Webb and Kathryn Spellman-Poots, 2014 © the chapters, their several authors, 2014 First published in hardback in 2014 by Edinburgh University Press Ltd The Tun – Holyrood Road 12 (2f) Jackson’s Entry Edinburgh eh8 8pj www.euppublishing.com Typeset in Goudy Oldstyle by Koinonia, Manchester and printed and bound in Spain by Novoprint A CIP record for this book is available from the British Library ISBN 978 0 7486 9334 4 (hardback) ISBN 978 0 7486 9335 1 (paperback) ISBN 978 0 7486 9350 4 (webready PDF) ISBN 978 0 7486 9351 1 (epub) The right of the contributors to be identified as authors of this work has been asserted in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988 and the Copyright and Related Rights Regulations 2003 (SI No. -

Assessing Democracy Assistance: Egypt
Assessing Democracy Assistance: Egypt1 Kristina Kausch2 Researcher at FRIDE This report is FRIDE’s contribution to a project entitled ‘Assessing Democracy Assistance’ that is being carried out by the World Movement for Democracy. The project aims to gather views on how democracy support can be improved and its impact enhanced. Other case studies and a synthesis report can be found at www.fride.org. A window of social mobilisation in 2004–2005 left many hopeful that a democratic breakthrough in Egypt was near. Keen to improve its strained relations with the US government, the Mubarak regime opened up space for the media and civil society and allowed for the first multi- candidate presidential elections. A short period of boosting activism and mobilisation led to the founding of independent newspapers and brought citizens from all societal bearings to the streets to claim their rights under the anti-Mubarak slogan ‘Kefaya’ (Enough). This period of hope, Project Report however, came to an end following the 2005 parliamentary elections Assessing Democracy in which Muslim Brotherhood independent candidates were able to Assistance win 88 seats. Legitimised by the ‘war on terror’, the regime responded with a backlash and closed up most of the public space that it had previously opened. A set of constitutional amendments in March 2007 further reduced the space permitted to political parties and extended the state’s security powers. The only serious presidential contender, Ayman Nour, was punished for having attempted to challenge Mubarak, and was sentenced to two years’ imprisonment on fraud charges. Co-financed by: Following pressure from the US, Nour was released in February 2009, but immobilised politically. -

After Mubarak, Before Transition: the Challenges for Egypt’S Democratic Opposition
Interface: a journal for and about social movements Event Analysis Volume 4 (1): 102 - 112 (May 2012) Teti and Gervasio, After Mubarak, before transition After Mubarak, Before Transition: The Challenges for Egypt’s Democratic Opposition Andrea Teti and Gennaro Gervasio Context: The Military and the “Deep State” Unlike Tunisia’s more orderly and quicker transition, over a year after the removal of ex-President Hosni Mubarak, the situation in Egypt remains confused. The Supreme Council of the Armed Forces (SCAF), the military junta which took over from the former President, has undertaken certain steps towards transition, but opinion on their intentions remains deeply divided. Increasingly, it is clear that they constitute the hard core of Mubarak’s regime, that they are fighting for their survival, and that in this struggle, they are more than prepared to sacrifice the demands for freedom and social justice which were at the core of the uprising which began on January 25th, 2011. Appreciating the complexities of the wider political situation in Egypt is crucial to understand the magnitude of the obstacles which independent civil society groups face in Egypt today. The basic demand of the uprising, in Egypt as in Tunisia, is encapsulated by one of its best-known slogans: ash-sha’b yurid isqaat an-nizaam, the people want the downfall of the regime. It was not simply a question of removing Mubarak, but of ending the entire clientelistic, authoritarian system which made life intolerable for ordinary Egyptians: decades of systematic abuse of power by the police and security services, corruption from the highest political levels to the most lowly bureaucrats, rising living costs and low wages, and unemployment are only a few of the more high-profile difficulties. -

Volume 3 No 191 2 February 2011 30P/80P for a Workers’ Government
So& Wloirkdersa’ Lirbeirtty y Volume 3 No 191 2 February 2011 30p/80p For a workers’ government Murdoch under Double Why floods? pressure page 2 dip? page 5 page 10 Egypt: support democratic revolution and workers’ freedom No to Islamist counter-revolution! No to army takeover! See pages 5-8 NEWS What is the Alliance for Workers’ Liberty? Will Murdoch be saved? Today one class, the working class, lives by wing scandal sheet — ploiting the story — well, selling its labour power to another, the amusing but nothing to do they have all been doing it capitalist class, which owns the means of with us. We should resist for years! production. Society is shaped by the that. What the phone-hacking capitalists’ relentless drive to increase Press Watch This is fast turning into scandal shows beyond their wealth. Capitalism causes poverty, By Pat Murphy Britain’s equivalent of the doubt is the extent to unemployment, the blighting of lives by infamous Dreyfus case in which the various compo - overwork, imperialism, the destruction of the environment and France in the way it is ex - nents of Britain’s ruling much else. Rupert Murdoch’s News story. posing the corruption of an class are interwoven with Against the accumulated wealth and power of the International group has Then others became con - overconfident, unaccount - each other, with mutual in - capitalists, the working class has one weapon: solidarity. long been the bane of the vinced that they too had able ruling class. terests and personnel, all of The Alliance for Workers’ Liberty aims to build solidarity left. -

Popular Committees and Independent Trade Unions Giuseppe Acconcia
The Uprisings in Egypt: Popular Committees and Independent Trade Unions Giuseppe Acconcia Goldsmiths College University of London PhD To Shaimaa al-Sabbagh (1983-2015) 2 “We will topple this regime, created on the back of the protest law” (Mahiennour el-Massry, 2014) 3 Table of Contents Abstract List of Abbreviations Introduction............................................................................................................12 1.1 The Breakdown of Authoritarian Regimes 1.1.1 Islamists and Dissent in Authoritarian Regimes 1.1.2 The “Deep State” and Infitah Policies 1.1.3 The Protests before the 2011 Uprisings 1.1.4 Democracy: Continuity and Change 1.2 Methodology and Ethical Issues 1.2.1 Ethical Issues 1.3 Case Selection and Research Design 1.3.1 Sayeda Zeinab 1.3.2 Mahalla al-Kubra 1.3.3 Research Design and Dissertation Chapter Outline Chapter 2: The Uprisings in Egypt: the Unachieved Coalition..................42 From an Authoritarian Regime to a Military Regime 2.1 Strategies: the “Egyptian Street” 2.1.1 A Definition of Social Movements 2.1.2 Occupation of Public Space 2.1.3 Overlapping Interests and Non-Collective Identities 2.1.4 A Comparative Perspective with the Iranian Revolution 2.2 Applying SM and NSM Literature to the Egyptian Case 2.2.1 The Social Movements and Party Politics 2.2.2 The Muslim Brotherhood and Party Politics 4 Chapter 3: The Uprisings in Egypt: State, Society and the Working Class..........................................................................................................................80 -
A Critical Analysis on Media Coverage of the Egyptian Revolution
Örebro University School of Humanities, Education and Social Sciences 2010‐2012 A CRITICAL ANALYSIS ON MEDIA COVERAGE OF THE EGYPTIAN REVOLUTION: THE CASE OF AL-AHRAM, AL-MASRY AL-YOUM, THE TELEGRAPH AND THE WASHINGTON POST MA Thesis Global Journalism Supervisor: Prof. Stig‐Arne Nohrstedt Author: Ahmed Magdy Youssef Word of Gratitude First of all, I would like to thank my university mentor, Stig-arne Nohrsted, as being the one who helped me in carrying out this thesis. Actually, I found succour in him during the thesis project. Not surbrisingly, he was replying back to my questions all the time, though, sometimes, he was very busy. Also, I would like to thank my loving wife Hend and my “naughty” son Hamza, whose boundless love keeps pushing me forward all the time. ii ABSTRACT The Egyptian protest movement which brought down the Egyptian regime headed by President Hosni Mubarak, not only gripped the minds and hearts of the Egyptians, but it captured the interest of the national and international media as well. The research aims at answering questions related to the kind of frames employed in four newspapers; namely, Al-Ahram, Al-Masry Al-Youm, The Telegraph and The Washington Post, in light of the protest paradigm, in addition to the way the same four newspapers tried to explore and identify the characteristics of war and peace journalism, according to Galtung’s dichotomous model, not to mention to trace how the four newspapers in hand depicted the protesters. To achieve this, two methods were applied in this study; notably, frame analysis, and critical discourse analysis. -

From Driver of Change to Marginalized Actor: Egypt's New Unionism from a Comparative Perspective Abdalla, Nadine; Wolff, Jonas
www.ssoar.info From driver of change to marginalized actor: Egypt's New Unionism from a comparative perspective Abdalla, Nadine; Wolff, Jonas Veröffentlichungsversion / Published Version Arbeitspapier / working paper Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with: Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Abdalla, N., & Wolff, J. (2016). From driver of change to marginalized actor: Egypt's New Unionism from a comparative perspective. (PRIF Working Papers, 31). Frankfurt am Main: Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-49032-2 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine This document is made available under Deposit Licence (No Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, non- Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, transferable, individual and limited right to using this document. persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses This document is solely intended for your personal, non- Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für commercial use. All of the copies of this documents must retain den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. all copyright information and other information regarding legal Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle protection. You are not allowed to alter this document in any Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument document in public, to perform, distribute or otherwise use the nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie document in public. dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke By using this particular document, you accept the above-stated vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder conditions of use. -

The Right to Freedom of Expression in Egypt, Morocco and Tunisia in the Period from 2011 to the Present
Avocats A Sans Frontières the right the to freedomrightthe right of expression to freedom of expression The state of the right to freedom to freedomof expression in Egypt, Morocco and Tunisia, from 2011 to 2015 By Christopher Roberts for ASF of expressionwww.asf.be the right the rightto freedom of expression Headquarter rue de Namur 72 1000 Brussels to freedom Belgium Tel.: +32 (0)2 223 36 54 Avocats Sans Frontières www.asf.be of expressionASF - August 2016 Founded in Belgium in 1992, Avocats Sans Frontières (ASF) is an international NGO specialising in the defence of human rights and support for justice in countries in fragile and post-conflicts situations. For over 20 years, ASF has been implementing programmes which improve access to justice for persons in vulnerable situations. Picture © Mohamed Nidhal Battiche THE AUTHOR Christopher Roberts holds a BA in International Relations from Brown University, an MA in Critical Theory from the School of Oriental and African Studies, and a JD from NYU School of Law. For two years prior to commencing his JSD at NYU he worked as Arthur Helton Fellow and Legal Officer with the Arab Regional Program of the Cairo Institute for Human Rights Studies in Cairo, Egypt. Christopher Roberts is a member of the African Litigants Group, a group of lawyers involved in litigation before the African Commission and Court, and has served as a legal expert to the Commission, including as the chief legal consultant in charge of preparing the Commission’s Guidelines on the Rights to Freedom of Association as it Pertains to Civil Society and Peaceful Assembly.