Henrichapelle FR
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
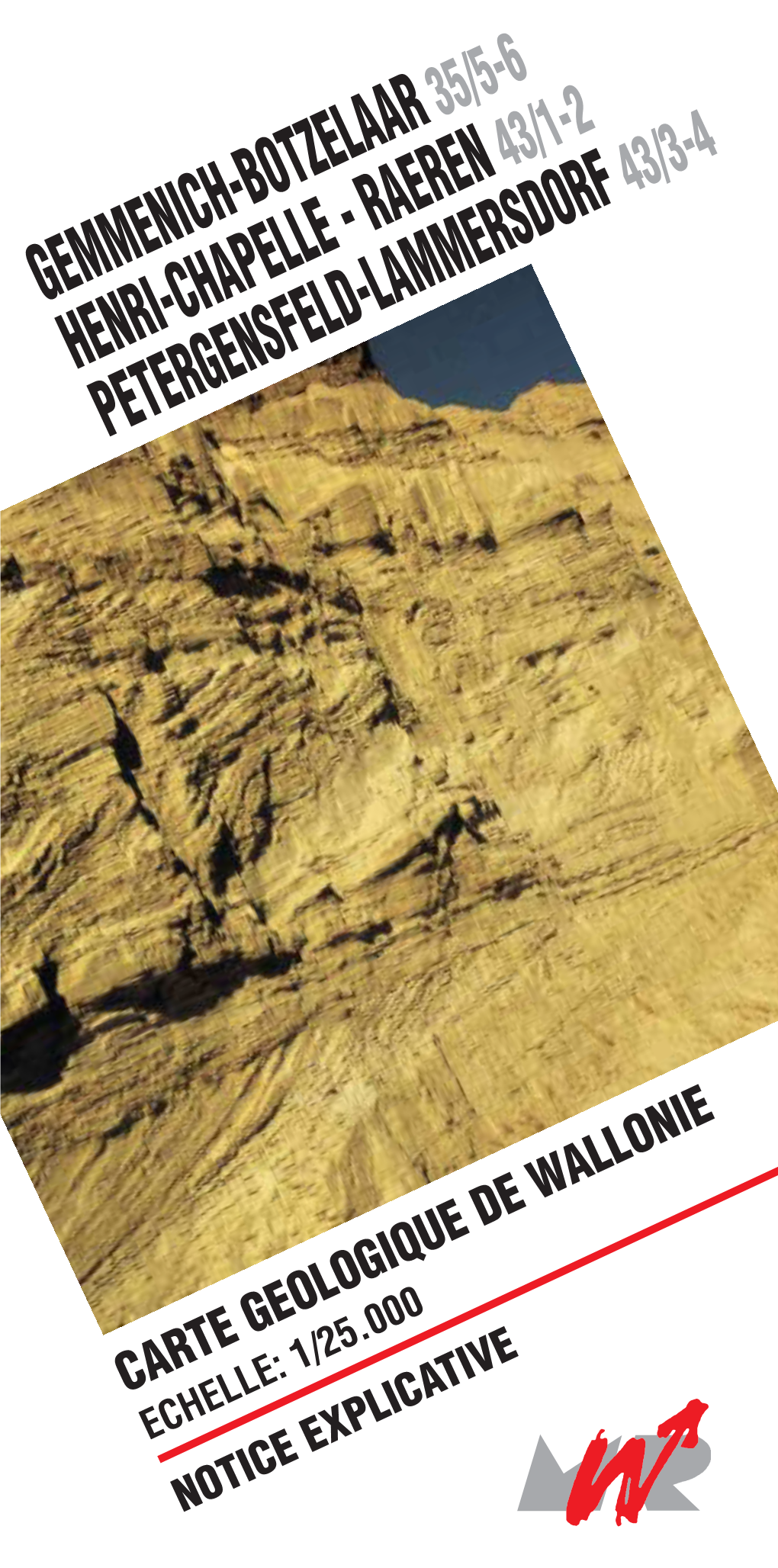
Load more
Recommended publications
-
Henrichapelle D
GEMMENICH-BOTZELAAR 35/5-6 HENRI-CHAPELLE - RAEREN 43/1-2 PETERGENSFELD-LAMMERSDORF 43/3-4 GEMMENICH-BOTZELAAR 35/5-6 - HENRI-CHAPELLE - RAEREN 43/1-2 - PETERGENSFELD-LAMMERSDORF 43/3-4 ERLÄUTERUNGEN WALLONIE : 1/25.000 GEOLOGISCHE KARTE DER WALLONIE MASSSTAB: 1/25.000 GEOLOGISCHE KARTE DER ERLÄUTERUNGEN GEMMENICH-BOTZELAAR HENRI-CHAPELLE - RAEREN PETERGENSFELD-LAMMERSDORF Martin LALOUX Service géologique de Belgique rue Jenner 13 B-1000 Bruxelles Fernand GEUKENS Instituut voor Aardwetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Redingenstraat 13 bis B-3000 Leuven Pierre GHYSEL Service géologique de Belgique rue Jenner 13 B-1000 Bruxelles Luc HANCE Service géologique de Belgique rue Jenner 13 B-1000 Bruxelles deutsche Fassung : Thomas SERVAIS U.F.R. Sciences de la Terre - SN5 Laboratoire de Paléontologie UPRESA 8014 du CNRS F-59655 Villeneuve d’Ascq cedex France Abbildung der Titelseite : Sandgrube in Kelmis. Wand mit Schrägschichtungen in den Sanden der Aachen Formation (Oberkreide). Photo J. Laschet, 1998. ERLÄUTERUNGEN 2000 Kartenblätter Gemmenich-Botzelaar n° 35/5-6 Henri-Chapelle - Raeren n° 43/1-2 Petergensfeld - Lammersdorf n° 43/3-4 Zusammenfassung Die Kartenblätter Henri-Chapelle - Raeren, Petergens- feld - Lammersdorf und Gemmenich-Botzelaar befinden sich im Nordosten der Provinz Lüttich. Drei Haupteinheiten, die mehr oder weniger den geographischen Unterteilungen ent- sprechen, lassen sich unterscheiden: - im südöstlichen Teil schliessen die kambrischen und ordovi- zischen Gesteine des Stavelot Massivs auf, die durch die ka- ledonische und die variszische Orogenese gefaltet und ge- stört wurden. Dieses Gebiet entspricht den Ausläufern der Lütticher Ardennen; - im Nordwesten des Stavelot Massivs ist ein Grossteil des kartographisch aufgeschlossenenen Gebietes durch Gestei- ne aufgebaut, die vom Unterdevon bis ins Namür reichen und die durch die variszische Gebirgsbildung gefaltet und gestört wurden. -

Measurements and Design Calculations for a Deep Coaxial Borehole Heat Exchanger in Aachen, Germany
Hindawi Publishing Corporation International Journal of Geophysics Volume 2013, Article ID 916541, 14 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/916541 Research Article Measurements and Design Calculations for a Deep Coaxial Borehole Heat Exchanger in Aachen, Germany Lydia Dijkshoorn,1 Simon Speer,2 and Renate Pechnig3 1 Institute for Applied Geophysics and Geothermal Energy, E.On Energy Research Center, RWTH Aachen University, Mathieustraße 10, 52074 Aachen, Germany 2 Institute for Mining Engineering I, RWTH-Aachen University, Wullnerstraße¨ 2, 52056 Aachen, Germany 3 Geophysica Beratungsgesellschaft mbH, Lutticherstraße¨ 32, 52064 Aachen, Germany Correspondence should be addressed to Lydia Dijkshoorn; [email protected] Received 21 December 2012; Accepted 24 February 2013 Academic Editor: Jean-Pierre Burg Copyright © 2013 Lydia Dijkshoorn et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. This study aims at evaluating the feasibility of an installation for space heating and cooling the building of the university inthe center of the city Aachen, Germany, with a 2500 m deep coaxial borehole heat exchanger (BHE). Direct heating the building in ∘ winter requires temperatures of 40 C. In summer, cooling the university building uses a climatic control adsorption unit, which ∘ requires a temperature of minimum 55 C. The drilled rocks of the 2500 m deep borehole have extremely low permeabilities and porosities less than 1%. Their thermal conductivity varies between 2.2 W/(m⋅K) and 8.9 W/(m⋅K). The high values are related to the ∘ quartzite sandstones. -

A Taxonomic Study of the Calcicolous Endolitic Species of the Genus Verrucaria (Ascomycotina, Verrucariales) with the Lid-Like and Radiately Opening Involucrellum
A taxonomic study of the calcicolous endolitic species of the genus Verrucaria (Ascomycotina, Verrucariales) with the lid-like and radiately opening involucrellum. Josef Halda Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov n. Kn., [email protected] Abstract This study describes anatomy, ontogenesis and history of taxonomy of calcicolous endolitic species of the genus Verrucaria, which have been treated as Bagliettoa and Protobagliettoa (Verrucaria sect. Sphinctrina), and that are characterized by black, flat (lid-like) radiate crackling involucrellum, completely endolitic thallus and presence of macrosferoid cells formed by hy- phae in the lower part of the medullar layer. Most of the revised taxa were described by Servít (more than 100), and show a large taxo- nomic heterogeneity. Consequently, a detailed study had to be done to unify the group again. The characteristic characters have been recognized as the size and shape of the involucrellum and the development of the cortex layer. Following diacritic characters were recognized just morphological variations that originate regularly during ontogenesis. After revision the num- ber of species reducedfrom more than twenty to four: V. baldensis, V. limborioides, V. marmorea and V. parmigerella. The genus Bagliettoa differs from the genus Verrucaria in different forming of involucrellum, other significant characters (ascus morphology and further structures of hymenium), usually used to define lichen genera are identical. Therefore, a new section Bagliettoa has been estab- lished within the genus Verrucaria, which is well defined by the way of opening and shape of involucrellum. The genus Protobagliettoa has been separated from the genus Bagliettoa artifi- cially for the absence of ascospores in 1955 by Servít. -

Physical Properties of Carboniferous and Devonian Rocks Drilled in The
Physical properties of Carboniferous and Devonian Rocks drilled in the RWTH-1 borehole Lydia Dijkshoorn (Applied Geophysics, RWTH Aachen, Lochnerstraße 4-20, 52064 Aachen, Germany; e-mail: [email protected] Beratungsgesellschaft mbH Renate Pechnig (Geophysica Beratungsgesellschaft mbH, Lütticherstraße 32, 52064 Aachen, Germany ; e-mail: [email protected] Cuttings investigations in the RWTH-1 borehole Core-Log integration of physical properties 8 Log Log/Core Log Core Core Core We present the physical properties of the Carboniferous and The density varies from 2.64 g/cm³ and 2.84 g/cm³ with a mean of Cores samples were available for three sections (1392-1515 Caliper Resistivity VP Gamma Ray Density Vp Suszept. (in) (ohm-m) (km/s) (API) (g/cm³) (km/s) (SI) Devonian Rocks drilled in the 2500 m deep RWTH-1 borehole. The 2.78 g/cm³. The thermal conductivity (TC) varies between 2.2 m, 2128-2143 m, 2536-2544 m) covering a total length of 150 8910 100 1000 56 80 120 2.7 2.8 2.9 56 10 20 30 borehole is located in the center of Aachen, in only few meter W/m/K and 8.9 W/m/K (Fig. 3). The high values can be explained by m. On the cores, the following physical properties were 1390 distance to the University main building. The geological setting is in a high percentage of quartz. Quartz cemented clean sandstones measured by a multi-sensor core logger: gamma density, front of the Aachen Overthrust , the large southeast dipping fault are frequently observed in the deeper part of hole below 1895 m. -

Subcommission on Devonian Stratigraphy Newsletter No. 31
------S------D------S------ SUBCOMMISSION ON DEVONIAN STRATIGRAPHY NEWSLETTER NO. 31 R.T. BECKER, Editor WWU Münster Germany December 2016 ISSN 2074-7268 SDS NEWSLETTER 31 Editorial The SDS Newsletter is published annually by the International Subcommission on Devonian Stratigraphy of the IUGS Subcommission on Stratigraphy (ICS). It publishes reports and news from its membership, scientific discussions, Minutes of SDS Meetings, SDS reports to ICS, general IUGS information, information on past and future Devonian meetings and research projects, and reviews or summaries of new Devonian publications. Editor: Prof. Dr. R. Thomas BECKER Institut für Geologie und Paläontologie Westfälische Wilhelms-Universität Corrensstr. 24 D-48149 Münster, Germany [email protected] Circulation 120 hard copies, pdf files of current and past issues are freely available from the SDS Homepage at www.unica.it/sds/ Submissions have to be sent electronically, preferably as Word Documents (figures imbedded or as separate high-resolution jpg or pdf files), to the Editor or to Mrs. S. KLAUS, IGP, Münster (sklaus@uni- muenster.de). Submission deadline for No. 32 is the end of June 2017. Please ease the editing by strictly keeping the uniform style of references, as shown in the various sections. The Newsletter should be quoted as: “SDS Newsletter, 31: p. x-y.” Content: Message from the Chairman (J.E. MARSHALL) 1 Obituaries Paul SARTENAER (D. BRICE) 2-4 CHEN Xiu-Qin (J. A. TALENT) 4-8 Horst BLUMENSTENGEL (H. GROOS-UFFENORDE & D. WEYER.) 8-16 Michael E. SCHUDACK (R. T. BECKER) 16-17 SDS Reports 1. Minutes of the Brussels Business Meeting 2015 (L. -
Die Erforschungsgeschichte Der Eifel-Geologie -200 Jahre Ein
Die Erforschungsgeschichte der Eifel-Geologie -200 Jahre ein klassisches Gebiet geologischer Forschung- Von der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Naturwissenschaften genehmigte Dissertation vorgelegt von Dipl.- Geol. Sabine Rath aus Aachen Berichter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Werner Kasig, Aachen Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wilhelm Meyer, Bonn Univ.-Prof. Dr. phil. Gerd Flajs, Aachen Tag der mündlichen Prüfung: 18.12.2003 Diese Dissertation ist auf den Internetseiten der Hochschulbibliothek online verfügbar. Kurzzusammenfassung Kurzzusammenfassung Die vorliegende Arbeit soll dem Leser die über 200 jährige Erforschungsgeschichte der Eifelgeologie näher bringen, bei der auch die Zusammenhänge von der Entwicklung einer Natur- zu einer Kulturlandschaft verdeutlicht werden. Es wird ein Bogen zwischen der historischen und der wissenschaftlichen Erforschungsgeschichte der Geologie für einen regional begrenzten Raum, die Eifel, gespannt. Schwerpunktmäßig ist die Darstellung auf die Anfänge der Erforschung und die wichtigsten klassischen Fakten aus der Eifelregion begrenzt. Dem Leser wird die Vorgeschichte des heutigen Wissenstands und ein Einblick in die lange Erforschung dieser Landschaft vermittelt, die gebietsweise in Zusammenhang mit den bergbaulichen Tätigkeiten steht. Die Eifel spielt national und auch international eine wichtige Rolle in der Entwicklung der geologischen und der paläontologischen Wissenschaft, nicht -

Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 Een Toets Van De Ambities Van Maastricht En De Euregio 2 Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 Maastricht Culturele Hoofdstad 2018
30 juli 2010 Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 Een toets van de ambities van Maastricht en de Euregio 2 Maastricht culturele hoofdstad 2018 Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 EEn toEts van dE aMbitiEs van Maastricht En dE EurEgio berenschot: Erasmus universiteit: Bart drenth arjo Klamer thessa syderius claudine de With rosanne stotijn erwin dekker anna lambrechtse 30 juli 2010 4 Maastricht culturele hoofdstad 2018 Een toets van de ambities van Maastricht en de Euregio 5 inhoud samenvatting . 7 Waarom wil Maastricht culturele hoofdstad worden? . 7 Wat zijn de criteria van de europese unie? . 7 hoe verhoudt MCH2018 zich tot haar ambitie? . 9 hoe verhoudt MCH2018 zich tot de eisen van de europese unie? . 11 aandachtspunten in relatie tot andere vier belangrijkste kandidaten . 13 Vervolgstappen . 15 1 . inleiding . 17 1 1. Vraag . 17 1 .2 Visie op de opdracht . 18 1 .3 Onderzoeksaanpak . 19 1 .4 Activiteiten . 21 1 .5 Leeswijzer . 21 2 . Partners in de euregio . 23 2 1. De euregio . 23 2 .2 Interregionale culturele samenwerking . 24 2 .3 Bestaande platforms en grensoverschrijdende projecten . 24 2 .4 Cultureel en economisch profiel van de steden en regio’s binnen de euregio . 27 3 . cultuurbeleving . 37 3 1. Inleiding . 37 3 .2 Euregio . 39 3 .3 Maastricht . 40 3 .4 Sittard-Geleen . 44 3 .5 Heerlen . 47 3 .6 Luik . 50 3 .7 Aken . 53 3 .8 Hasselt . 56 3 .9 Beleving en ambitie . 59 3 10. Samenvatting sWOT . 60 4 . hoofdambitie . 61 4 1. Inleiding . 61 4 .2 Draagvlak voor de hoofdambitie . 61 4 .3 Wat is het doel van MCH2018? . 61 4 .4 Proces of einddoel? . -
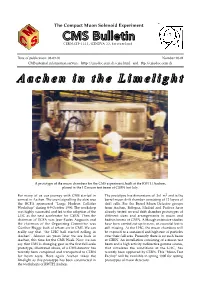
Aachen in the Limelight
The Compact Muon Solenoid Experiment CERN,CH–1211, GENEVA 23, Switzerland Date of publication: 06-09-96 Number 96-01 CMS internal information servers: http://cmsdoc.cern.ch/cms.html and ftp://cmsdoc.cern.ch Aachen in the Limelight A prototype of the muon chambers for the CMS experiment, built at the RWTH Aachen, placed in the H2 muon test beam at CERN last July. For many of us our journey with CMS started in The prototype has dimensions of 3x1 m2 and is the earnest in Aachen. The event signalling the start was barrel muon drift chamber consisting of 12 layers of the ECFA sponsored "Large Hadron Collider drift cells. For the Barrel Muon Detector groups Workshop" during 4-9 October 1990. The workshop from Aachen, Bologna, Madrid and Padova have was highly successful and led to the adoption of the already tested several drift chamber prototypes of LHC as the next accelerator for CERN. Then the different sizes and arrangements in muon and chairman of ECFA was Jean-Eudes Augustin and hadron beams at CERN. Although extensive studies the chairman of the Organizing Committee was have been carried out up to now, an essential test is Günther Flügge both of whom are in CMS. We can still missing. At the LHC, the muon chambers will really say that "the LHC ball started rolling in be exposed to a sustained and high rate of particles Aachen". Almost six years later we are back in over their full area. Presently there is no such beam Aachen, this time for the CMS Week. -

Research Article Measurements and Design Calculations for a Deep Coaxial Borehole Heat Exchanger in Aachen, Germany
Hindawi Publishing Corporation International Journal of Geophysics Volume 2013, Article ID 916541, 14 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/916541 Research Article Measurements and Design Calculations for a Deep Coaxial Borehole Heat Exchanger in Aachen, Germany Lydia Dijkshoorn,1 Simon Speer,2 and Renate Pechnig3 1 Institute for Applied Geophysics and Geothermal Energy, E.On Energy Research Center, RWTH Aachen University, Mathieustraße 10, 52074 Aachen, Germany 2 Institute for Mining Engineering I, RWTH-Aachen University, Wullnerstraße¨ 2, 52056 Aachen, Germany 3 Geophysica Beratungsgesellschaft mbH, Lutticherstraße¨ 32, 52064 Aachen, Germany Correspondence should be addressed to Lydia Dijkshoorn; [email protected] Received 21 December 2012; Accepted 24 February 2013 Academic Editor: Jean-Pierre Burg Copyright © 2013 Lydia Dijkshoorn et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. This study aims at evaluating the feasibility of an installation for space heating and cooling the building of the university inthe center of the city Aachen, Germany, with a 2500 m deep coaxial borehole heat exchanger (BHE). Direct heating the building in ∘ winter requires temperatures of 40 C. In summer, cooling the university building uses a climatic control adsorption unit, which ∘ requires a temperature of minimum 55 C. The drilled rocks of the 2500 m deep borehole have extremely low permeabilities and porosities less than 1%. Their thermal conductivity varies between 2.2 W/(m⋅K) and 8.9 W/(m⋅K). The high values are related to the ∘ quartzite sandstones. -
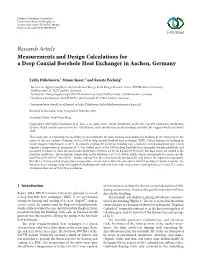
Research Article Measurements and Design Calculations for a Deep Coaxial Borehole Heat Exchanger in Aachen, Germany
Hindawi Publishing Corporation International Journal of Geophysics Volume 2013, Article ID 916541, 14 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/916541 Research Article Measurements and Design Calculations for a Deep Coaxial Borehole Heat Exchanger in Aachen, Germany Lydia Dijkshoorn,1 Simon Speer,2 and Renate Pechnig3 1 Institute for Applied Geophysics and Geothermal Energy, E.On Energy Research Center, RWTH Aachen University, Mathieustraße 10, 52074 Aachen, Germany 2 Institute for Mining Engineering I, RWTH-Aachen University, Wullnerstraße¨ 2, 52056 Aachen, Germany 3 Geophysica Beratungsgesellschaft mbH, Lutticherstraße¨ 32, 52064 Aachen, Germany Correspondence should be addressed to Lydia Dijkshoorn; [email protected] Received 21 December 2012; Accepted 24 February 2013 Academic Editor: Jean-Pierre Burg Copyright © 2013 Lydia Dijkshoorn et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. This study aims at evaluating the feasibility of an installation for space heating and cooling the building of the university inthe center of the city Aachen, Germany, with a 2500 m deep coaxial borehole heat exchanger (BHE). Direct heating the building in ∘ winter requires temperatures of 40 C. In summer, cooling the university building uses a climatic control adsorption unit, which ∘ requires a temperature of minimum 55 C. The drilled rocks of the 2500 m deep borehole have extremely low permeabilities and porosities less than 1%. Their thermal conductivity varies between 2.2 W/(m⋅K) and 8.9 W/(m⋅K). The high values are related to the ∘ quartzite sandstones. -

Hit the Spot
HIT THE SPOT CAPBUSINESSLIGA IN THE RIGHT PLACE AT THE RIGHT TIME, MAKING THE RIGHT DECISION: SUCCESS BECOMES 0 : 0 It’s part of a smart business stra- UNAVOIDABLE. tegy to seek out economically dynamic regions with strong growth potential. Regions such as Baesweiler, with its well-balanced mix of industries ran- ging from manufacturing to trades and services. Even more so now, with the new CAP Businessliga off ering a unique location designed especially to support young businesses in all sorts of ways, so they can focus on their core competen- cies and grow from there. The place and the time are right – and we are certain that those who make the right decision now will soon reap the rewards. CAPBUSINESSLIGA Tom Virt Hermann Gatzweiler TITLE CONTENDER Ten individual units across a total area of 16,000 1 : 0 Since the closure of its coal mines, square metres, located directly adjacent to Carl the town of Baesweiler has experienced a remarkable turnaround. Over the past Alexander Park, the region’s regeneration showpiece. few decades, determined municipal This is the CAP Businessliga, a new technology and and business leaders have been pre- business park, which has close links with Baesweiler’s paring the rebirth of this small but strategically located region. And today International Technology and Service Centre ITS. Baesweiler is playing in the top league of business locations, presenting an at- tractive proposition for up-and-coming businesses from around the world. At the forefront is the CAP Businessliga, THE NEW CAP BUSINESSLIGA part of Carl Alexander Park, the first Eu- Regionale 2008 project to be completed.