Friedrich Nietzsche. Vie, Œuvres, Fragments
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Kunst – Kapital Das Nietzsche-Archiv Und Die Moderne Um 1900 Klassik
Kult – Kunst – Kapital Das Nietzsche-Archiv und die Moderne um 1900 Klassik Stiftung Weimar Jahrbuch 2020 Klassik Stiftung Weimar Jahrbuch 2020 Kult – Kunst – Kapital Das Nietzsche-Archiv und die Moderne um 1900 Herausgegeben von Ulrike Lorenz und Thorsten Valk Inhalt Ulrike Lorenz Vorwort 7 Thorsten Valk Einleitung Politik der Apotheose Die Vermarktungsstrategien des Nietzsche-Archivs 9 Helmut Heit Vom Kult zum Kapital Nietzsches Weg zum philosophischen Weltereignis 19 Ralf Eichberg Zwischen Betulichkeit und Monumentalität Die Anfänge des Nietzsche-Gedenkens in Naumburg und Röcken 49 Kerstin Decker Eine Linie mit Willen zur Macht? Die Architekturen des Neuen Weimar 63 Hansdieter Erbsmehl Moderne »Überkultur« in Weimar Harry Graf Kessler, Elisabeth Förster-Nietzsche und der erotische Nietzscheanismus 85 Gerrit Brüning Distanzierte Freundlichkeit Hugo von Hofmannsthals Beziehung zu Elisabeth Förster-Nietzsche 107 Milan Wenner Spannungsvolle Nähe Oswald Spengler und das Nietzsche-Archiv im Kontext der Konservativen Revolution 133 Ulrich Sieg »Sanft in der Form, hart in der Sache« Die Bedeutung Elisabeth Förster-Nietzsches für die universitäre Etablierung ihres Bruders 153 6 inhalt Johannes Waßmer Kampf um ein philosophisches Erbe Die Werkpolitik des Nietzsche-Archivs 171 Alexander Rosenbaum »Im Geist des Philosophen« Henry van de Veldes Einbandentwürfe zu den Nietzsche-Vorzugsausgaben des Leipziger Insel-Verlags 205 Anna-Sophie Borges Ecce Dementia? Friedrich Nietzsche in Fotografien und Radierungen von Hans Olde 225 Gerda Wendermann Der -
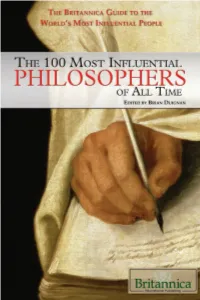
The 100 Most Influential Philosophers of All Time 7 His Entire Existence in Those Terms
Published in 2010 by Britannica Educational Publishing (a trademark of Encyclopædia Britannica, Inc.) in association with Rosen Educational Services, LLC 29 East 21st Street, New York, NY 10010. Copyright © 2010 Encyclopædia Britannica, Inc. Britannica, Encyclopædia Britannica, and the Thistle logo are registered trademarks of Encyclopædia Britannica, Inc. All rights reserved. Rosen Educational Services materials copyright © 2010 Rosen Educational Services, LLC. All rights reserved. Distributed exclusively by Rosen Educational Services. For a listing of additional Britannica Educational Publishing titles, call toll free (800) 237-9932. First Edition Britannica Educational Publishing Michael I. Levy: Executive Editor Marilyn L. Barton: Senior Coordinator, Production Control Steven Bosco: Director, Editorial Technologies Lisa S. Braucher: Senior Producer and Data Editor Yvette Charboneau: Senior Copy Editor Kathy Nakamura: Manager, Media Acquisition Brian Duignan: Senior Editor, Religion and Philosophy Rosen Educational Services Jeanne Nagle: Senior Editor Nelson Sa: Art Director Nicole Russo: Designer Introduction by Stephanie Watson Library of Congress Cataloging-in-Publication Data The 100 most influential philosophers of all time / edited by Brian Duignan.—1st ed. p. cm.—(The Britannica guide to the world’s most influential people) “In association with Britannica Educational Publishing, Rosen Educational Services.” Includes Index. ISBN 978-1-61530-057-0 (eBook) 1. Philosophy. 2. Philosophers. I. Duignan, Brian. II. Title: One hundred most -

Cover Next Page > Cover Next Page >
cover cover next page > title : Nietzsche : A Novel SUNY Series in Contemporary Continental Philosophy author : Krell, David Farrell. publisher : State University of New York Press isbn10 | asin : 0791429997 print isbn13 : 9780791429990 ebook isbn13 : 9780585043111 language : English subject Nietzsche, Friedrich Wilhelm,--1844-1900--Fiction, Philosophers--Germany--Fiction, Biographical fiction. publication date : 1996 lcc : PS3561.R423N54 1996eb ddc : 813/.54 subject : Nietzsche, Friedrich Wilhelm,--1844-1900--Fiction, Philosophers--Germany--Fiction, Biographical fiction. cover next page > If you like this book, buy it! file:///D|/gigapedia/Nietzsche%20A%20Novel/files/cover.html4/28/2009 4:44:26 PM page_i < previous page page_i next page > Page ii SUNY Series in Contemporary Continental Philosophy Dennis J. Schmidt, editor < previous page page_i next page > If you like this book, buy it! file:///D|/gigapedia/Nietzsche%20A%20Novel/files/page_i.html4/28/2009 4:44:27 PM page_iii < previous page page_iii next page > Page iii Nietzsche A Novel David Farrell Krell State University of New York Press < previous page page_iii next page > If you like this book, buy it! file:///D|/gigapedia/Nietzsche%20A%20Novel/files/page_iii.html4/28/2009 4:44:27 PM page_iv < previous page page_iv next page > Page iv Published by State University of New York Press, Albany ©1996 David Farrell Krell All rights reserved Printed in the United States of America No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission. No part of this book may be stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means including electronic, electrostatic, magnetic tape, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior permission in writing of the pub- lisher. -

Die Philosophie Elektrizität Erdgas Fernwärme
GESCHÄFTSBERICHT ZUM GESCHÄFTSJAHR 01.10.2005 BIS 30.09.2006 TWERKE WEIMARADTS ERSORGUNGS-GMBHTVADTS DIE PHILOSOPHIE ELEKTRIZITÄT ERDGAS FERNWÄRME Weimars philosophische Energien 1 Stadtwerke Konstellation 3 Management 5 Qualität am neuen Standort 7 Personalbericht 9 Unser Engagement 11 Bericht des Aufsichtsrates 13 Lagebericht 15 Bilanz 20 Gewinn- und Verlustrechnung 22 Anlagevermögen 24 Anhang 26 Bestätigungsvermerk 32 DIE PHILOSOPHIE DER ENERGIEN oder die Energie der Philosophen IM KLASSISCHEN WEIMAR Ursache, Sinn und Daseinsform der Im Kampf um die Wahrheit haben uns seine Einflüsse und sein letztlich Energien haben das Leben und Den- viele brillante Analytiker, überzeugen- trauriges Ende. ken des Homo sapiens seit Anfang an de Logiker und stringente Methodiker Als unleugbares Glied in der histori- bewegt. das Denken gelehrt und die Energie schen Kette deutscher einflussreicher des Menschen als Willensstärke, Tat- Philosophen und klassischer Philolo- Natürliche Erscheinungen, Vorgänge kraft und Nachdruck definiert, mit gen behalten vor allem seine Apho- und Wirkungen beeindruckten den der er in der Lage sei, die positive Ent- rismen bis heute einen tiefgründigen Menschen, erzeugten Gefühle und den wicklung der Gesellschaft selbst zu Charme und sind in ihrer Konsequenz Wunsch nach Erkenntnis. gestalten. auch künftigen Nachdenkens wert. Aber erst mit dem Wissen kam die Ver- Ein Philosoph, welcher zwischen die Die bis in unsere Zeit währende Nietz- nunft und die Weisheit und mit der Mühlsteine der Anschauungen spät- sche-Forschung ringt -

The Consolations of Philosophy by Alain De Botton
ALAIN DE BOTTON The Consolations of Philosophy Alain de Botton is the author of On Love, The Romantic Movement, Kiss and Tell, How Proust Can Change Your Life, The Consolations of Philosophy, and The Art of Travel. His work has been translated into twenty languages. He lives in Washington, D.C., and London, where he is an Associate Research Fellow of the Philosophy Programme of the University of London, School of Advanced Study. The dedicated Web site for Alain de Botton and his work is www.alaindebotton.com. ALSO BY ALAIN DE BOTTON On Love The Romantic Movement Kiss & Tell How Proust Can Change Your Life The Art of Travel FIRST VINTAGE INTERNATIONAL EDITION, APRIL 2001 Copyright © 2000 by Alain de Botton All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. Published in the United States by Vintage Books, a division of Random House Inc., New York, and simultaneously in Canada by Random House of Canada Limited, Toronto. Originally published in Great Britain by Hamish Hamilton, a division of Penguin Books, Ltd., London and subsequently in hardcover by Pantheon Books, a division of Random House, Inc., New York, in 2000. Vintage is a registered trademark and Vintage International and colophon are trademarks of Random House, Inc. Permissions acknowledgments appear on this page–this page. The Library of Congress has cataloged the Pantheon edition as follows: De Botton, Alain. The consolations of philosophy / Alain de Botton. p. cm. 1. Philosophical counseling. I. Title. BJ595.5.D43 2000 101—DC21 99-052188 eISBN: 978-0-307-83350-1