Extraits De Reckoning with Homelessness De Kim Hopper
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Télécharger Le Plan D'accès Aux Nouveaux Locaux De L
FEDERATION NATIONALE DES AGENCES D'URBANISME Rue de Clichy Rue de Londres quai 27 Paris Saint-Lazare Charles-de-Gaulle quai 1 Paris Saint-Lazare Gare du Nord Gare Saint-Lazare Rue d’Amsterdam Gare de l’Est Cour Saint-Lazare Cour du Havre Sortie 10 de Rome Saint-Lazare Seine Gare de Lyon Sortie 3, Montparnasse Bercy Passage du Havre Rue Saint-Lazare Austerlitz Saint-Lazare Saint-Lazare de la Victoire Passage du Havre Rue Sortie 1, Sortie Rue de la Chaussée d’Antin Cour de Rome 10h-20h 90 Orly Saint-Lazare Place G. Sortie 2 Berry Rue de l’Isly Rue du Havre 30 98 bis 89 Rue de Rome Place Rue Joubert 16 G. Berry 29 17 DEPUIS Gare de Lyon DEPUIS Passage de Provence LES GARES LES AÉROPORTS Rue de Provence Gare Saint-Lazare Saint-Lazare Paris - Boulevard Haussmann Saint-Lazare Charles de Gaulle Printemps Printemps Galeries Galeries 5 min Lafayette Lafayette Sortie 1 Rue de Mogador Chaussée d’Antin Gare Montparnasse Rue Auber Gare d’Austerlitz Saint-Lazare Rue Charras La Fayette Rue Pasquier Gare du Nord Sortie 1 5 min Rue des Mathurins Asnières - Gennevilliers Havre Caumartin Suivre les panneaux Sortie 1 Saint-Denis - Université Auber « Accès Gare de Lyon » Rue Tronchet Saint-Lazare Saint-Lazare Sortie 2 et traverser la Seine. Sortie 3 Saint-Lazare Bd Haussmann, côté pair Place G. Berry Rue Gluck Gare du Nord Saint-Lazare Paris - Orly Rue Castellane Rue de Caumartin Saint-Lazare Rue de l’Arcade Saint-Lazare Sortie 1 Orlyval PARKING INFORMATIONS Saint-Lazare Antony Opéra Place G. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°75-2020-178 Publié Le 9 Juin 2020
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°75-2020-178 PREFECTURE DE PARIS PUBLIÉ LE 9 JUIN 2020 1 Sommaire Préfecture de Police 75-2020-06-05-016 - Arrêté n° 2020-00466 portant interdiction des rassemblements revendicatifs sur le Champ-de-Mars le samedi 6 juin 2020. (2 pages) Page 3 75-2020-06-08-004 - Arrêté n°2020-00470 autorisant à titre dérogatoire un lieu où les prélèvements d’échantillons biologiques pour l'examen de biologie médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » peuvent être réalisés par la SELAS BIOLAM LCD. (2 pages) Page 6 75-2020-06-09-002 - Arrêté n°2020-00471 accordant des récompenses pour actes de courage et de dévouement. (1 page) Page 9 75-2020-06-09-003 - Arrêté n°2020-00472 accordant des récompenses pour actes de courage et de dévouement. (1 page) Page 11 75-2020-06-09-004 - Arrêté n°2020-00473 accordant des récompenses pour acte de courage et de dévouement. (1 page) Page 13 75-2019-12-19-011 - LISTE DES ARRÊTÉS D'AUTORISATION A PUBLIER RELATIFS A L'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION APRES AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE VIDÉOPROTECTION DU 19/12/2019. (98 pages) Page 15 75-2020-02-06-019 - Liste des arrêtés d'autorisation à publier relatifs à l'installation d'un système de vidéoprotection après avis de la commission départementale de vidéoprotection du 6 février 2020. (36 pages) Page 114 2 Préfecture de Police 75-2020-06-05-016 Arrêté n° 2020-00466 portant interdiction des rassemblements revendicatifs sur le Champ-de-Mars le samedi 6 juin 2020. -

Paris Lo W Budg Et
→ Press file 2019 – Paris Convention and Visitors Bureau T Contrary to popular belief, you don’t need a lot of money to have a good time in Paris! There are many free or cheap things to do and see in the French capital. It’s quite possible to go shopping, eat out, stay in a hotel, play sport and soak up culture without breaking the bank. But you do need some insider knowledge and a bit of advance planning to get the most out of the city all year round when you’re on a tight budget. There are many affordable ways to explore Paris. You can gain entry to the most unexpected places, see up-and-coming performers at below-the-radar venues, go to some great concerts, watch artists at work in their studios, visit the permanent collections of the major national museums, get a haircut, have a makeover and buy designer clothes – all of it for little or no money. Thank you Paris! LOW BUDGE PARIS FOR FREE (OR NEARLY FREE) Culture without spending a cent PARIS Look out for free shows and exceptional openings so you can enjoy your share of cultural events in the city. In Paris, you can get free entrance to cultural events, and enjoy various kinds of entertainment, without opening your wallet. What with music festivals, outdoor cinema, free shows and guided tours, there’s no chance you’ll get bored! > Major cultural events Concerts, performing arts, heritage visits, and multicultural events: whether you’re a music fan, an art lover or simply curious, there are plenty of opportunities to see different sides to Paris without spending a centime. -

PARIS Cushman & Wakefield Global Cities Retail Guide
PARIS Cushman & Wakefield Global Cities Retail Guide Cushman & Wakefield | Paris | 2019 0 Regarded as the fashion capital of the world, Paris is the retail, administrative and economic capital of France, accounting for near 20% of the French population and 30% of national GDP. Paris is one of the top global cities for tourists, offering many cultural pursuits for visitors. One of Paris’s main growth factors is new luxury hotel openings or re-openings and visitors from new developing countries, which are fuelling the luxury sector. This is shown by certain significant openings and department stores moving up-market. Other recent movements have accentuated the shift upmarket of areas in the Right Bank around Rue Saint-Honoré (40% of openings in 2018), rue du Faubourg Saint-Honoré, and Place Vendôme after the reopening of Louis Vuitton’s flagship in 2017. The Golden Triangle is back on the luxury market with some recent and upcoming openings on the Champs-Elysées and Avenue Montaigne. The accessible-luxury market segment is reaching maturity, and the largest French proponents have expanded abroad to find new growth markets. Other retailers such as Claudie Pierlot and The Kooples have grown opportunistically by consolidating their positions in Paris. Sustained demand from international retailers also reflects the current size of leading mass-market retailers including Primark, Uniqlo, Zara brands or H&M. In the food and beverage sector, a few high-end specialised retailers have enlivened markets in Paris, since Lafayette Gourmet has reopened on boulevard Haussmann, La Grande Épicerie in rue de Passy replacing Franck & Fils department store, and more recently the new concept Eataly in Le Marais. -

How Much Tradition Does the Future Need?
LIGHTLIFE 6 Spring 2011 High-performance LIGHTLIFE LED products by Zumtobel fascinate users with their high efficiency, — Topic: How much tradition does the future need? excellent colour rendition, maintenance-free operation and sophisticated design. 6 The interaction with intelligent Combination of historical and modern archi- lighting control systems tecture in international projects in the fields of creates dynamic solutions office and communication, presentation and providing a perfect combination retail, art and culture, education and knowledge of lighting quality and energy efficiency. Topic: How much tradition does the future need? Intelligent lighting solutions by Zumtobel strike a perfect balance of lighting quality LED lighting solutions and energy efficiency – by Zumtobel HUMANERGY BALANCE. set standards in terms of design freedom and provide exceptionally brilliant light. Zumtobel provides perfect LED lighting solutions for any application area. www.zumtobel.com www.zumtobel.com/LED www.zumtobel.com Dr. Harald Sommerer, CEO Zumtobel Group about the continuity of tradition and modernity at Zumtobel Dr. Harald Sommerer (Photo: Jens Ellensohn) BUILDING BRIDGES TO THE FUTURE WITH LIGHT Tradition and progress are integral components of the Zum- lies in the harmonious integration of the design instrument tobel brand. Both parameters are at the heart of our day-to- light in new and old structures, thereby facilitating a dialogue day company operations. Zumtobel is measured on the basis between architecture, light and the environment. This is often of its history as well as its ability to face new challenges and accompanied by a confrontation between continuity and develop ground-breaking, future-oriented solutions. Before contrasts. Traditional shapes and structures are united with taking a decisive step forward, it‘s just as important to look new elements. -

Affaires Relatives Principalement À L’Urbanisme, Au Logement Et Aux Transports (1966-1976)
ARCHIVES DE PARIS Service préfectoral chargé de l’administration municipale Préfecture de Paris, cabinet du préfet Affaires municipales Interventions de particuliers auprès du préfet ; affaires relatives principalement à l’urbanisme, au logement et aux transports (1966-1976) PEROTIN /101/76/1 1 à 44 Répertoire numérique détaillé dactylographié par N. Bourokba 2004 Délai de communicabilité : les art. 1 à 15 sont communicables au terme d’un délai de 50 ans (vie privée) ; les art. 16 à 44 sont communicables au terme d’un délai de 25 ans Cabinet du Préfet de Paris, Cab.VI Côte 101/76/1 Interventions du particulier auprès du préfet 2 INTRODUCTION Contexte. – Le versement PEROTIN 101/76/1 est l’une des composantes du fonds du cabinet du préfet de Paris. Le cabinet du préfet de Paris exerçait avant la création de la Mairie de Paris, un rôle comparable à celui de l’actuel cabinet du Maire de Paris : outre la réponse aux multiples demande d’interventions de particuliers, son rôle était de préparer les décisions du préfet. Contenu. – Le présent versement reflète ces deux rôles, principalement pour la période 1967-1973 : les quinze premiers articles contiennent en effet des demandes d’intervention, tandis que les articles 16 à 42 témoignent de l’activité du cabinet sur plusieurs projet concernant Paris. Le point commun des deux parties de ce versement est de toucher aux questions d’urbanisme entendues au sens large puisqu’on peut trouver des informations sur les domaines suivants : - la voirie et les déplacements ; - l’habitat et le logement ; - les équipements socioculturels. Les articles 1 à 15 renferment des demandes d’intervention adressée au préfet, ainsi que les réponses qui lui ont été faites : la matière est relativement pauvre, mais très variée. -
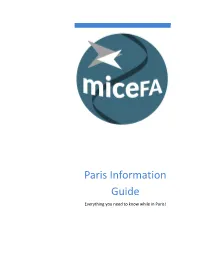
Paris Information Guide Everything You Need to Know While in Paris!
Paris Information Guide Everything you need to know while in Paris! Table des matières Contact Information ............................................................................................................... 5 Our address .................................................................................................................................................................................. 5 How to get there ......................................................................................................................................................................... 5 Office Hours ................................................................................................................................................................................. 5 The MICEFA Team ................................................................................................................... 6 Communication ...................................................................................................................... 7 Student Mail and E-mail ......................................................................................................................................................... 7 Cell Phones or “Téléphones portaBles” ............................................................................................................................ 7 Cell Phone carriers ................................................................................................................................................................... -

Liste Des Points De Vente Partenaires Acceptant La Carte Cadeau SPIRIT of CADEAU
Liste des points de vente partenaires acceptant la carte cadeau SPIRIT OF CADEAU Votre enseigne : 1.2.3 Enseigne Adresse Code postal Ville 1.2.3 22-24 RUE DU MARECHAL FOCH 01000 BOURG EN BRESSE 1.2.3 C.C. VAL-THOIRY 01710 THOIRY 1.2.3 C.C. NICE ETOILE 24 AVENUE JEAN MEDECIN 06000 NICE 1.2.3 84 RUE D ANTIBES 06400 CANNES 1.2.3 C.C. NICE CAP 3000 06700 ST-LAURENT-DU-VAR 1.2.3 C.C. POLYGONE RIVIERA - AVENUE DES ALPES - ZAC DU QUARTIER ST JEAN 06800 CAGNES SUR MER 1.2.3 C.C. MARQUES AVENUE AVENUE DE LA MAILLE 10800 ST-JULIEN-LES-VILLAS 1.2.3 31 RUE DU PONT DES MARCHANDS 11100 NARBONNE 1.2.3 C.C. BONNE SOURCE 24 BOULEVARD DE CREISSEL 11100 NARBONNE 1.2.3 37 RUE ST FERREOL 13001 MARSEILLE 1.2.3 C.C. VALENTINE GRAND CENTRE ROUTE LA SABLIERE 13011 MARSEILLE CEDEX 11 1.2.3 6 RUE MEJANES 13100 AIX-EN-PROVENCE 1.2.3 PL DE L EGLISE ST MICHEL 13300 SALON DE PROVENCE 1.2.3 CC AVANT CAP 13480 CABRIES 1.2.3 3 RUE DU MOULIN 14000 CAEN 1.2.3 C.C.R. MONDEVILLE2 14120 MONDEVILLE CEDEX 1.2.3 10 RUE SAINT YON 17000 LA ROCHELLE 1.2.3 40 RUE MIREBEAU 18000 BOURGES 1.2.3 50 COURS NAPOLEON 20000 AJACCIO 1.2.3 38 BD PAOLI 20200 BASTIA 1.2.3 C.C. TOISON D'OR 81 ALLEE DE LA CASCADE 21000 DIJON CEDEX 1.2.3 26 RUE TAILLEFER 24000 PERIGUEUX 1.2.3 PLACE LOUIS DE LA BARDONNERIE 24100 BERGERAC 1.2.3 15 RUE EMILE AUGIER 26000 VALENCE 1.2.3 7 PLACE DU CYGNE 28000 CHARTRES 1.2.3 C.C. -

Pan-European Footfall 2017-2018
REAL ESTATE PAN-EUROPEANFOR A CHANGING WORLD FOOTFALL ANALYSIS Key global and lifestyle cities 2017-2018 PROPERTY DEVELOPMENT TRANSACTION CONSULTING VALUATION PROPERTY MANAGEMENT INVESTMENTRETAIL MANAGEMENT Real EstateReal Estate forfor a a changing changing world world CONTENT Macroeconomics ............ 04 Amsterdam .......................... 30 Helsinki ...................................... 46 Warsaw ...................................... 62 Synthesis ................................... 06 Athens ......................................... 32 Lisbon ........................................... 48 Zurich ............................................ 64 Barcelona ................................ 34 Munich ........................................ 50 London ........................................ 10 Brussels ..................................... 36 Oslo ................................................. 52 Methodology ........................ 67 Paris ................................................ 14 Budapest ................................. 38 Prague ......................................... 54 Results by country ........ 68 Madrid ........................................ 18 Copenhagen ....................... 40 Rome ............................................. 56 Contacts ..................................... 70 Milan .............................................. 22 Dublin ........................................... 42 Stockholm .............................. 58 Berlin ............................................. 26 Frankfurt .................................. -

Entreprises Le Neuvième a La Cote !
MENSUEL D’INFORMATION DE LA MAIRIE DU NEUVIÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS NUMÉRO 14 NEUVIÈME PLUS VERT NEUVIÈME PLUS DYNAMIQUE NEUVIÈME VAGUE Réseau de bus du 9e Rencontre avec Valérie Pécresse Demandez votre Pass Culture Neuf — p. 7 — p. 10 — p. 20 PARISNEUF ENTREPRISES LE NEUVIÈME A LA COTE ! DATES Prochains événements ÉDITO e avec la Mairie du 9 Delphine Bürkli 6 rue Drouot Maire du 9e 01 71 37 75 09 arrondissement de Paris CONSEILS DU 9E ARRONDISSEMENT Lundis 24 avril et 22 mai à 18h30. © DR. 22/04 La Chasse aux N’œufs. Trois années utiles. Square Montholon à 10h. Vous êtes un peu plus de 60 000 habitants à avoir choisi d’élire domicile dans le 9e, un arrondissement familial et résidentiel mais aussi à forte attraction 27/04 économique, culturelle et touristique avec ses 125 000 visiteurs journaliers… Conférence "Le 1 dans le Neuf” un Paris en condensé. Il y a trois ans, quasiment jour pour jour, vous m’accordiez votre avec Erik Orsenna. confiance en m’élisant Maire. Salle Rossini à 19h30. Pour que le 9e soit définitivement tourné vers ses habitants, ses visiteurs et ses acteurs économiques, nous avons, depuis 2014, lancé de nombreux chantiers dont nous vous rendons compte régulièrement dans ces pages mais également 03/05 lors de réunions de concertation. Projection “Une histoire de fou”. Les quartiers Pigalle-Martyrs, Blanche-Trinité, Anvers Montholon, En présence de Robert Guediguian. Opéra-Chaussée d’Antin et Faubourg-Montmartre se transforment pour Salle Rossini à 19h30. rendre les rues plus agréables, propres et végétalisées, plus aisément accessibles aux piétons, favoriser la circulation des vélos et celle des véhicules propres car c’est cela, la ville de demain. -

Retailers France - City Centers Period 2015-2019
% Retailers France - City Centers Period 2015-2019 codata-retail.com Summary % Retailers France - City Centers Definitions - Method .................................................................. 05 Period 2015-2019 Definitions and Formulas. ......................................................................... 06 Additional details ........................................................................................ 07 A lively and dynamic city cannot be conceived without France – City Centers – Period 2015-2019 – flourishing and attractive businesses. As national and Evolution of the Percentage of Retailers - Trends ..................09 international Retailers are undoubtedly the traffic builders behind any commercial site, it is useful to understand their Municipalities with less than 40,000 inhabitants .................................... 10 evolution in city centers. Municipalities from 40,000 to 79,999 inhabitants ................................... 18 To establish a relevant diagnosis on this vital issue, it is essential to have reliable measurement tools: a “Trade Municipalities from 80,000 to 119,999 inhabitants ................................. 21 Observatory” is unavoidable. Municipalities from 120,000 to 199,999 inhabitants ............................... 22 This is what Codata has been offering for 25 years. Our data Municipalities from 200,000 inhabitants and more ................................ 23 collectors-managers survey the land throughout the year relying on identical data collection rules everywhere. This -

EDITION FRAGRANCES Du 12 Au 15 Octobre 2016 Accès
Accès JEU CONCOURS 109 rue Saint-Lazare SANS OBLIGATION D’ACHAT EDITION FRAGRANCES 75009 Paris Bus Pour participer au jeu concours, 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 32 - 43 il vous suffit de compléter ce bulletin - 53 - 66 - 68 - 80 - 81 - 94 - 95 de participation puis de l’imprimer. Rendez-vous au Passage du Havre Métro dans l’une des six boutiques partenaires Accès direct par la station Saint-Lazare, pour déposer votre bulletin dans l’urne prévue à cet effet. lignes : 3 - 12 - 13 - 14 Station Havre Caumartin, lignes : 3 - 9 Tirage au sort et mail envoyé Une aux gagnants le lundi 17 octobre 2016 RER E : station Hausmann – St-Lazare carte cadeau RER A : station Auber à gagner NOM* * Champs obligatoires dans les boutiques partenaires ! GARE SAINT-LAZARE SAINT-LAZARE Rue de la Chaussée d’Antin Rue d’Amsterdam Rue Saint-Lazare PRÉNOM* HAUSSMANN - SAINT-LAZARE CODE POSTAL* Rue du Havre du Rue Rue de Caumartin HAVRE-CAUMARTIN Bd Haussmann Rue Auber EMAIL* AUBER CHAUSSÉE D’ANTIN - Rue Tronchet LAFAYETTE En cochant cette case, j’accepte de recevoir la newsletter du centre commercial Passage Horaires du Havre. J’ai pris connaissance du règlement du jeu Du lundi au samedi de 9h30 à 20h (disponible à l’adresse www.passageduhavre.com) Jeudis et vendredis nocturnes et je l’accepte. jusqu’à 20h30 Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique pour la gestion des gagnants. Les destinataires des données sont le personnel de la société Eurocommercial Properties Caumartin SNC. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.