1-RP PLU Avensan Projet-1-42
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Publication of a Communication of Approval of a Standard
29.7.2019 EN Official Journal of the European Union C 254/3 V (Announcements) OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (2019/C 254/03) This notice is published in accordance with Article 17(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (1). COMMUNICATION OF APPROVAL OF A STANDARD AMENDMENT ‘Haut-Médoc’ Reference number: PDO-FR-A0710-AM03 Date of communication: 10.4.2019 DESCRIPTION OF AND REASONS FOR THE APPROVED AMENDMENT 1. Demarcated parcel area Description and reasons This application includes the applications with reference PDO-FR-A0710-AM01 and PDO-FR-A0710-AM02, submit ted on 7 April 2016 and 12 January 2018, respectively. The following is inserted in chapter I, point IV(2) of the specification after the words ‘16 March 2007’: ‘ 28 September 2011, 11 September 2014, 9 June 2015, 8 June 2016, 23 November 2016 and 15 February 2018, and of its standing committee of 25 March 2014’. The purpose of this amendment is to add the dates on which the competent national authority approved changes to the demarcated parcel area within the geographical area of production. Parcels are demarcated by identifying the parcels within the geographical area of production that are suitable for producing the product covered by the regis tered designation of origin in question. Accordingly, as a r esult of this amendment, a new point (b) has been added -
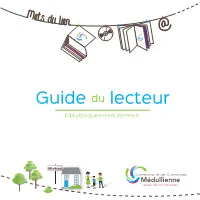
Guide Du Lecteur
Guide du lecteur bibliotheques-medullienne.fr Bibliothèques LE PORGE Le Réseau des bibliothèques en bref Le mot du Président La lecture est un formidable vecteur d’émotions, fortes et STE-HELENE LE TEMPLE nombreuses. Elle est aussi • bibliothèques : 7 un enjeu de citoyenneté, de Brach, Castelnau, Listrac, Le Porge, Sainte-Hélène, Salaunes et Saumos construction de la personnalité. SAUMOS Elle est propice au dialogue, au partage et aux échanges. • 3 dépôts : Elle est, enfin, un support Avensan, Moulis et Le Temple exceptionnel pour rêver et enrichir son imaginaire. Les élus de la CDC Médullienne ont décidé la mise • 60 bibliothécaires à votre écoute BRACH en réseau des bibliothèques du territoire. C’est un nouvel espace qui s’ouvre à chacun : • 30 000 livres, CD, DVD… à découvrir sur place ou à emporter des lieux d’accueil et de conseil multipliés, un site SALAUNES internet qui permet, depuis chez soi, de consulter la liste des œuvres disponibles, de les réserver BIBLIONAVETTE • 1 biblio-navette circulant dans les communes et de se les faire livrer dans le site de son choix. Si les bibliothèques se mettent en réseau, • 1 carte de lecteur individuelle pour emprunter ou réserver se dématérialisent, c’est bien sûr pour profiter (sur place ou en ligne) CASTELNAU des avantages de la modernité. Mais ne nous y trompons pas : le contact avec le livre, les échanges humains au sein de nos bibliothèques • 1 site internet avec un catalogue en ligne restent irremplaçables. LISTRAC Ce guide dévoile le fonctionnement du Réseau Médullien des bibliothèques et du site internet qui • 0 € : c’est totalement gratuit ! lui est associé. -

Liste Des Villes Et Villages Du Département De La Gironde
Liste des villes et villages du département de la Gironde Communes du département de la Gironde en A Abzac Aillas Ambarès-et-Lagrave Ambès Andernos-les-Bains Anglade Arbanats Arbis Arcachon Arcins Arès Arsac Artigues-près-Bordeaux Arveyres Asques Aubiac Aubie-et-Espessas Audenge Auriolles Auros Avensan Ayguemorte-les-Graves Communes du département de la Gironde en B Bagas Baigneaux Balizac Barie Baron Barsac Bassanne Bassens Baurech Bayas Bayon-sur-Gironde Bazas Beautiran Bégadan Bègles Béguey Belin-Béliet Bellebat Bellefond Belvès-de-Castillon Bernos-Beaulac Berson Berthez Beychac-et-Caillau Bieujac Biganos Birac Blaignac Blaignan Blanquefort Blasimon Blaye Blésignac Bommes Bonnetan Bonzac Bordeaux Bossugan Bouliac Bourdelles Bourg Bourideys Brach Branne Brannens Braud-et-Saint-Louis Brouqueyran Bruges Budos Communes du département de la Gironde en C Cabanac-et-Villagrains Cabara Cadarsac Cadaujac Cadillac Cadillac-en-Fronsadais Camarsac Cambes Camblanes-et-Meynac Camiac-et-Saint-Denis Camiran Camps-sur-l'Isle Campugnan Canéjan Cantenac Cantois Capian Caplong Captieux Carbon-Blanc Carcans Cardan Carignan-de-Bordeaux Cars Cartelègue Casseuil Castelmoron-d'Albret Castelnau-de-Médoc Castelviel Castets-en-Dorthe Castillon-de-Castets Castillon-la-Bataille Castres-Gironde Caudrot Caumont Cauvignac Cavignac Cazalis Cazats Cazaugitat Cénac Cenon Cérons Cessac Cestas Cézac Chamadelle Cissac-Médoc Civrac-de-Blaye Civrac-en-Médoc Civrac-sur-Dordogne Cleyrac Coimères Coirac Comps Coubeyrac Couquèques Courpiac Cours-de-Monségur Cours-les-Bains Coutras -

Réseau Médullien Des Bibliothèques 2019 : Une Année Placée Sous Le Signe De L'animation Et Des Partenariats
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2019 RÉSEAU MÉDULLIEN DES BIBLIOTHÈQUES 2019 : UNE ANNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE L'ANIMATION ET DES PARTENARIATS Dès le début de l'année, le service Lecture Publique a accueilli Mélanie Molinier, qui a pris ses fonctions en tant qu'animatrice du Réseau Médullien des bibliothèques. Les missions de Maylis Cassaigne ont été redéfinies pour s'orienter vers l'accompagnement des projets, la communication et la gestion du catalogue informatisé. D'autre part, la CdC Médullienne a été sollicitée par la DRAC Nouvelle Aquitaine pour signer un Contrat Territoire-Lecture (CTL). Ce dispositif, reposant sur deux à trois grands objectifs, sera cofinancé à 50%. Les objectifs pour l’année 2019 étaient les suivants : Accompagner la création de la ludobibliothèque Rééditer le Guide du Lecteur et réaliser un Guide destiné aux collectivités Réaliser un état des lieux complet du Réseau Médullien des bibliothèques, de sa création à aujourd'hui, afin de mettre en lumière les objectifs choisis pour le CTL Réaliser un diagnostic sur l’offre culturelle du territoire et les partenaires existants et mettre en oeuvre un programme permettant d'offrir à l'ensemble de la population des animations de qualité sur des sujets divers Poursuivre les permanences dans chaque bibliothèque pour un travail de fond sur les collections Poursuivre les permanences d’accueil du public pour éviter les fermetures estivales Dans ce rapport d’activité, vous découvrirez les réalisations effectuées en 2019 et les statistiques du Réseau Médullien au 31 décembre. R É A L I S A T I O N S Inauguration de Pass'Temple Jusqu'au mois de mai, la ludobibliothécaire, aidée des coordinatrices du réseau et de bénévoles, a poursuivi ses achats afin d'ouvrir le nouvel équipement avec des étagères bien garnies. -

Cet Été, Des Sorties Carrément Cool En Gironde. Plus De 25 Sites À Découvrir
Cet été, des sorties CARrément cool en Gironde. Plus de 25 sites à découvrir. Retrouvez Les Estivales sur transports.nouvelle-aquitaine.fr La Région vous transporte PLAN LES ESTIVALES Phare de POINTE-DE-GRAVE Cordouan Le Verdon Soulac-sur-mer Les Estivales, c’est quoi ? 718 Grayan " Le Gurp " 713 Les Estivales sont des sites touristiques pouvant être desservis par certaines lignes des cars régionaux pendant les vacances d’été 712 Montalivet du 7 juillet au 29 août 2021. " Les Bains " Vendays- Montalivet Lesparre Seul, en couple, entre amis ou en famille, paysages variés des plages et grands voyagez à petits prix sur les lignes des lacs de la côte Atlantique aux vignobles , cars régionaux soit le trajet Aller-Retour des activités nature et des activités HOURTIN PLAGE 711 3,60 € par personne à la journée ! Partez nautiques en passant par les parcours découvrir les innombrables richesses de Tèrra Aventura et son jeu de « Chasse PAUILLAC Hourtin locales du Nouvelle-Aquitaine, des aux Trésors » en Gironde. Bref, un vaste Hourtin Le Port visites patrimoniales de villes pleines de choix pour composer le programme de charme aux villages de caractère, des vos escapades à la journée ! BLAYE CARCANS OCÉAN Carcans Cussac Bombannes Carcans 715 Plassac 710 Soussans 202 AVENSAN Bourg Cet été, partez à la découverte de cette belle région 716 Prignac-et- LACANAU Macau Marcamps SAINT-ANDRÉ- OCÉAN 702 DE-CUBZAC avec des idées de sorties et de visites 100 % Nouvelle-Aquitaine Lacanau Le Pian 310 CARrément cool ! 611 201 705 LIBOURNE LE PORGE 701 304 OCÉAN -

' Les Fiches Familles Pour La Rentree Scolaire '
Les fiches' familles pour la rentree' scolaire ACTIVITES' PERISCOLAIRES' & EXTRASCOLAIRES 2020 -2021 Les fiches familles pour la rentree' scolaire sommaire fiche 1 : Une équipe à votre service fiche 2 : Les structures périscolaires fiche 3 : Durant la semaine d'école fiche 4 : En période scolaire fiche 5 : Les différents temps d'accueil périscolaire 5A | L'accueil du matin et du soir 5B | L'accueil du mercredi 5C | L'école multisport et éveil sportif fiche 6 : Les centres de loisirs fiche 7 : Les vacances sportives fiche 8 : De l'inscription à la facturation Les messages de vos élus Avec ses onze lieux Au total, plus de 2 400 d'accueil périscolaire, familles sont inscrites neuf structures pour à nos services, le mercredi, des que ce soit pour centres de loisirs l'accueil du matin et des vacances avant la classe sportives pour ou le soir après, le les vacances mercredi ou encore scolaires, la CdC pendant les vacances Médullienne assume la scolaires. compétence des services péri- et extrascolaires pour les dix communes Vos enfants sont accueillis par des équipes du territoire. professionnelles, engagées et fédérées autour d'un programme d'activités, Tous ces services comptent beaucoup dans développé dans toutes les structures... des 10 votre quotidien que ce soit pour la socialisation, communes de la CdC Médullienne. l'éveil et le bien-être des enfants, pour articuler temps familial et activités professionnelles Les futurs programmes d'activités mais aussi pour le budget familial. seront travaillés dans les prochaines semaines avec nos partenaires (CAF, Avec l'augmentation de la population, notre MSA, Département de la Gironde et capacité d'accueil devrait augmenter afin Éducation Nationale notamment) pour être de répondre aux besoins croissants des renouvelés sur la base du nouveau projet familles... -

Tirage Du 28 02 2020 Lesparre
Arrondissement de Lesparre TIRAGE AU SORT DU VENDREDI 28/02/2020 – ARRONDISSEMENT DE LESPARRE Numéro du panneau Nom de la commmune Nom de la liste Nom du tête de liste d'affichage attribué ARSAC ENSEMBLE DEMAIN Mme Nadine DUCOURTIOUX 1 AVENSAN UNE EQUIPE UNIE POUR AVENSAN Mme Marlène LAGOUARDE 1 CARCANS CARCANS PAR PASSION M. Thierry DESPREZ 1 CARCANS CARCANS, Agir et Vivre ENSEMBLE M. Patrick MEIFFREN 2 CASTELNAU DE MEDOC CASTELNAU AUJOURD’HUI ET DEMAIN M. Eric ARRIGONI 1 CASTELNAU DE MEDOC LA FORCE DE L'ESPERIENCE M. Jean-Claude DURRACQ 2 CASTELNAU DE MEDOC ENSEMBLE POUR L’AVENIR M. Guy COUBRIS 3 LISTE d'ENTENTE DE TOUTES CISSAC MEDOC M. Jean MINCOY 1 TENDANCES CUSSAC FORT MEDOC A l’ECOUTE DE CUSSAC Mme Corinne FONTANILLE 1 CUSSAC FORT MEDOC NOTRE PRIORITE, LES CUSSACAIS M. Jean-Claude MARTIN 3 CUSSAC FORT MEDOC GARDONS LE CAP POUR CUSSAC M. Dominique FEDIEU 2 GAILLAN EN MEDOC GAILLAN 2020 M. Bertrand TEXERAUD 1 GAILLAN EN MEDOC RESOLUMENT POUR GAILLAN M. Gille CUYPERS 2 LE COEUR DE L’ACTION POUR GRAYAN- GRAYAN ET L'HOPITAL Mme Florence LEGRAND 2 ET-L’HOPITAL GRAYAN-ET-L’HOPITAL – ACTIVE ET GRAYAN ET L'HOPITAL M. Alain BOUCHON 1 SOLIDAIRE HOURTIN POUR HOURTIN AVEC NOUS M. Christophe BIROT 2 HOURTIN HOURTIN 2020 M. Jean-Marc SIGNORET 1 LACANAU LACANAU M. Jean-Yves MAS 3 LACANAU HORIZONS LACANAU M. Neil PIOTON 2 VIVRE ENSEMBLE AVEC LAURENT M. Eric BONNEFOND (pour Laurent LACANAU 1 PEYRONDET PEYRONDET) LAMARQUE AGIR POUR VIVRE MIEUX A LAMARQUE M. Nicolas RAIMOND 1 CONTINUONS ENSEMBLE POUR LAMARQUE M. -

Arrondissement De Lesparre Page 1 TIRAGE AU SORT DU VENDREDI
Arrondissement de Lesparre TIRAGE AU SORT DU VENDREDI 28/02/2020 – ARRONDISSEMENT DE LESPARRE Numéro du panneau Nom de la commmune Nom de la liste Nom du tête de liste d'affichage attribué ARSAC ENSEMBLE DEMAIN Mme Nadine DUCOURTIOUX 1 AVENSAN UNE EQUIPE UNIE POUR AVENSAN Mme Marlène LAGOUARDE 1 CARCANS CARCANS PAR PASSION M. Thierry DESPREZ 1 CARCANS CARCANS, Agir et Vivre ENSEMBLE M. Patrick MEIFFREN 2 CASTELNAU DE MEDOC CASTELNAU AUJOURD’HUI ET DEMAIN M. Eric ARRIGONI 1 CASTELNAU DE MEDOC LA FORCE DE L'ESPERIENCE M. Jean-Claude DURRACQ 2 CASTELNAU DE MEDOC ENSEMBLE POUR L’AVENIR M. Guy COUBRIS 3 LISTE d'ENTENTE DE TOUTES CISSAC MEDOC M. Jean MINCOY 1 TENDANCES CUSSAC FORT MEDOC A l’ECOUTE DE CUSSAC Mme Corinne FONTANILLE 1 CUSSAC FORT MEDOC NOTRE PRIORITE, LES CUSSACAIS M. Jean-Claude MARTIN 3 CUSSAC FORT MEDOC GARDONS LE CAP POUR CUSSAC M. Dominique FEDIEU 1 GAILLAN EN MEDOC GAILLAN 2020 M. Michel TEXERAUD 1 GAILLAN EN MEDOC RESOLUMENT POUR GAILLAN M. Gille CUYPERS 2 LE COEUR DE L’ACTION POUR GRAYAN- GRAYAN ET L'HOPITAL Mme Florence LEGRAND 2 ET-L’HOPITAL GRAYAN-ET-L’HOPITAL – ACTIVE ET GRAYAN ET L'HOPITAL M. Alain BOUCHON 1 SOLIDAIRE HOURTIN POUR HOURTIN AVEC NOUS M. Christophe BIROT 2 HOURTIN HOURTIN 2020 M. Jean-Marc SIGNORET 1 LACANAU LACANAU M. Jean-Yves MAS 3 LACANAU HORIZONS LACANAU M. Neil PIOTON 2 VIVRE ENSEMBLE AVEC LAURENT M. Eric BONNEFOND (pour Laurent LACANAU 1 PEYRONDET PEYRONDET) LAMARQUE AGIR POUR VIVRE MIEUX A LAMARQUE M. Nicolas RAIMOND 1 LAMARQUE CONTINUONS ENSEMBLE POUR LAMARQUE M. -

CONSEIL MUNICIPAL Procès-Verbal De La Séance Du Lundi 19 Août 2019 À 18H30
CONSEIL MUNICIPAL Procès-Verbal de la séance du Lundi 19 août 2019 à 18h30. L’an deux mille dix-neuf, le lundi dix-neuf août, à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de la commune d’AVENSAN, régulièrement convoqué le mercredi quatorze août deux mille dix-neuf, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, à la Mairie, sous la présidence de M. Patrick BAUDIN, le Maire d’AVENSAN. Présents : M. Patrick BAUDIN, Mme Brigitte DAULIAC, Mme Christel DELORD, M. Henri DUTHIN, M. Henri ESCUDERO, Mme Dominique FORMENT, M. Yannick GOTTIS, M. Patrick HOSTEIN, M. Christophe JACOBS, Mme Marlène LAGOUARDE, M. Patrick NURBEL, Mme Francine PIENS, Mme Christine TRIVES. Absents excusés : M. Didier BOURSIER (procuration à Mme Marlène LAGOUARDE), Mme Christelle CHEVALIER, Mme Martine MOREAU. Absents : M. Jean-Claude GALMOT, Mme Martine JOURDAN, M. Jean-Yves LALANDE. Monsieur le Maire a procédé à l’appel des membres du conseil Municipal. Le quorum étant atteint, M. le Maire ouvre la séance à 18h30. A été élue à l’unanimité secrétaire de séance : Mme Dominique FORMENT Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour de cette assemblée : Approbation du procès-verbal de la séance précédente (mardi 9 juillet 2019) Acquisition de la parcelle cadastrée WP 181 au lieu-dit Romefort sur le territoire de la commune Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté de communes Médullienne dans le cadre d’un accord local Questions diverses 1- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE (MARDI 9 JUILLET 2019) Lors de cette séance, le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du mardi 9 juillet 2019 a été adopté à l’unanimité. -

CONSEIL COMMUNAUTAIRE Réunion Du 7 Décembre 2010
Médullienne Communauté de Communes CONSEIL COMMUNAUTAIRE Réunion du 7 décembre 2010 Le Conseil Communautaire dûment convoqué par lettre en date du 2 décembre 2010, s’est réuni sous la présidence d’Yves LECAUDEY, le mardi 7 décembre à 18h30 à la salle APS du Temple. Etaient présents : AVENSAN Michel HEE Francine PICAUT BRACH Denis CHAUSSONNET CASTELNAU-DE-MEDOC Jean-Claude DURRACQ Bernard DIOT Joël DURET LISTRAC-MEDOC Michel PRIOLLAUD Marie-Hélène CHANFREAU MOULIS-EN-MEDOC Christian LAGARDE Evelyne VICENTE Jean-Pierre CAMPISTRE LE PORGE Martial ZANINETTI Annie FAURE SAINTE-HELENE Yves LECAUDEY Pierre DUBOURG Allain CAMEDESCASSE SALAUNES Jean-Marie CASTAGNEAU Josiane ECHEGARAY Annie TEYNIE SAUMOS Fernand GAILLARDO Pierre François de LANGEN LE TEMPLE Jean-Luc PALLIN Jean-Pierre BIESSE Stéphane MARTIN Etait également présente : Marie-Renée CAULET, Directrice Générale des services Etaient excusés : Michel TRAVERS, délégué de la Commune d’AVENSAN Didier PHOENIX, délégué de la Commune de BRACH Carmen PICAZO, déléguée de la Commune de BRACH Allain BOUCHET, délégué de la commune de LISTRAC-MEDOC Jésus VEIGA, délégué de la commune de LE PORGE Claudette MOUTIC, déléguée de la commune de SAUMOS Bernard LAPEYRE, Receveur communautaire A l’ordre du jour : Adoption du compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 1er décembre 2010 que vous trouverez ci-joint LOGEMENT ET CADRE DE VIE . Fixation des tarifs 2011 des emplacements des Aires d’accueil . Adoption du Budget 2011 des Aires d’accueil PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT . BUDGET ANNEXE « ORDURES MENAGERES » o D.M. 1 - Budget Ordures ménagères o Fixation des tarifs de redevance spéciale 2011, adoption de la liste des assujettis o Marché de collecte porte à porte – tri sélectif – Collecte séparée des Journaux/Magazines . -

Blaye / Bordeaux Canal Des 2 Mers by Bike - Atlantic / Mediterranean Sea
http:www.francevelotourisme.com 30/09/2021 Blaye / Bordeaux Canal des 2 Mers by bike - Atlantic / Mediterranean sea From Blaye, cross the Gironde Estuary by ferry to Lamarque, in the midst of the Médoc, a peninsula packed with some of the greatest wine territories (or appellations) in the world. A provisional route takes you along quiet roads through the Médoc’s vines, fields and heaths to the edge of the city of Bordeaux, at Blanquefort. From here, a cycle track leads you gently to the heart of the great wine town. Bordeaux is a splendid, dynamic city, its exceptional architectural heritage listed as a World Heritage Site. Amidst its grand quarters, sample its many lively, trendy cultural and gastronomic offerings. The route Départ Arrivée Provisional route. Blaye Bordeaux From Lamarque, head for Arcins, following a quiet road crossing through vineyards, passing via the Château de Malescas. Durée Distance 3 h 19 min 49,94 Km At Arcins, take care crossing the D 2 road to reach Moulis-en-Médoc, followed by Avensan. Be especially careful cycling along the D 208 road from Avensan to Niveau Thématique Arsac. Continue to Le Pian-Médoc, and on to the north I cycle often In the vineyards side of Blanquefort, where you join a cycle track at the round-about by the Lycée Agro-Viticole. This cycle track leads into the heart of Bordeaux, via the quays alongside the Garonne River. SNCF Train Services Moulis-Listrac train station (3km from Lamarque): On the TER regional line Bordeaux > Pointe de Grave (11 trains daily) Bordeaux St-Jean train station: -

Arrondissement De Lesparre Libellé Commune N° Panneau Liste Libellé Etendu Liste Sexe Nom Prénom Sortant Arsac 1 ARSAC TERRE
Arrondissement de Lesparre Libellé commune N° Panneau Liste Libellé Etendu Liste Sexe Nom Prénom Sortant Arsac 1 ARSAC TERRE D'ENVIE M DUBO Gérard S Avensan 1 AVENSAN VOTRE VILLAGE VOS ÉLUS M BAUDIN Patrick S Cantenac 1 BIEN VIVRE À CANTENAC M BOUCHER Éric S Carcans 1 ENSEMBLE NATURELLEMENT M SABAROT Henri S Castelnau-de-Médoc 1 CASTELNAU AVANCE AVEC VOUS M DURRACQ Jean-Claude S Castelnau-de-Médoc 2 CASTELNAU AUTREMENT ERIC ARRIGONI M ARRIGONI Eric S Castelnau-de-Médoc 3 ENSEMBLE C'EST MAINTENANT M ESPAGNET Christian S Cissac-Médoc 1 LISTE D'ENTENTE DE TOUTES TENDANCES M MINCOY Jean S Cussac-Fort-Médoc 1 ENSEMBLE CONSTRUISONS NOTRE AVENIR M FÉDIEU Dominique S Cussac-Fort-Médoc 2 CUSSAC AUTREMENT M MARTIN Jean-Claude Gaillan-en-Médoc 1 GAILLAN DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE M HENRY Jean-Brice S Grayan-et-l'Hôpital 1 GRAYAN POUR DEMAIN M LAPORTE Serge S Hourtin 1 HOURTIN AU QUOTIDIEN M SIGNORET Jean-Marc S Hourtin 2 HOURTIN EN TOUTE SIMPLICITÉ M ARHEX-LAMOTHE Robert Hourtin 3 HOURTIN AU COEUR M SORHAITZ Jacques S Hourtin 4 HOURTIN PASSIONNEMENT M JAFFRELOT Daniel S Jau-Dignac-et-Loirac 1 LE TEMPS DU RENOUVEAU M COUTREAU Gilles S Jau-Dignac-et-Loirac 2 AVEC LES JOVISIENS LE NOUVEL ELAN M PAOLI Yann-René Lacanau 1 VIVONS LACANAU AVEC LAURENT PEYRONDET M PEYRONDET Laurent S Lacanau 2 LACANAU, DES PROJETS ET UN AVENIR PARTAGÉS M BACCIALONE Olivier Lacanau 3 LACANAU A COEUR M DAVID Jean-Michel S Lamarque 1 LAMARQUE AVENIR M SAINT-MARTIN Dominique S Lesparre-Médoc 1 LA LISTE ! M GUIRAUD Bernard S Lesparre-Médoc 2 DROITE-UNIE@LESPARRE-MEDOC M BOULLIER Jacques Lesparre-Médoc 3 UN COEUR, DES VALEURS, UN AVENIR POUR LESPARRE M STORA Patrick Listrac-Médoc 1 LISTRAC-AUTREMENT M THOMAS Christian S Listrac-Médoc 2 LE RENOUVEAU POUR LISTRAC M BACQUEY Claude S Listrac-Médoc 3 LISTRAC POUR TOUS M BOUCHET Allain S Listrac-Médoc 4 BIEN VIVRE À LISTRAC-MÉDOC M PRIOLLAUD Michel S Margaux 1 MARGAUX, UN DÉVELOPPEMENT ..