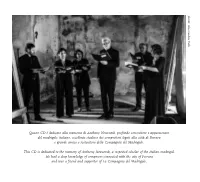polyphonies de la Renaissance
samedi 8 et dimanche 9 mars 1997
cité de la musique
François Gautier, président Brigitte Marger, directeur général polyphonies de la Renaissance
Ces quatre concerts consacrés aux polyphonies espagnoles, francoflamandes et italiennes de la Renaissance et du premier Baroque témoignent tous d'une fascinante période de transition. A travers toutes ces œuvres pourtant si diverses, on voit apparaître peu à peu une brisure esthétique, une rupture de plus en plus radicale avec un système de pensée et des traditions d'écriture hérités de la mentalité symbolique médiévale. Pour l'ensemble des artistes de cette époque, quel que soit leur champ d'étude ou leur nationalité, l'œuvre d'art ne doit plus, comme cela était la règle précédemment, représenter, par des proportions idéales dictées par la symbolique des nombres, cette réalité supérieure qui nous est cachée par les apparences trompeuses du monde. La Renaissance triomphante préfère se référer à Aristote pour énoncer une nouvelle fois cette règle qui va régir les trois siècles de création artistique à venir : l'art doit être à l'imitation de la nature. Les arts plastiques se doivent ainsi d'être figuralistes, tandis que la musique va devenir le médium idéal pour évoquer toute la profondeur mysté- rieuse de la nature humaine. « Peindre les passions », movere gli affetti : tels vont être les nouveaux mots d'ordre des compositeurs. Ainsi, la conception du « beau en musique », qui s'était orientée durant tout le Moyen-Age vers le contrepoint et la superposition de voix différentes pourtant équivalentes en intérêt, mais qui prônait aussi l'indissociabilité du traitement vocal et instrumental, changea progressivement : sa dimension symbolique s'estompa dès lors au profit d'une nouvelle dimension humaniste, pour ne pas dire humaine.
Denis Morrier
samedi 8 mars - 16h30 / amphithéâtre du musée
musique profane du Siècle d'or
Juan del Encina
Triste Espana sin ventura - Antonilla es desposada Tan buen ganadico - Pues que tu, Reina del cielo
Francisco Guerrero
Si tus penas no pruevo (texte Lope de Vega) Huyd, huyd - Todo quanto pudo dar
Juan Vásquez
Con qu é la lavaré - En la fuente del rosel Si no os uviera mirado
Mateo Romero « Maestro Capitán »
A quién contaré mis quejas ? (texte Lope de Vega)
anonyme début XVIIe siècle
En Belén est á n mis amores - Como suele el blanco zisne Soberana Maria
Juan Vásquez
Soledad tengo de ti - O dulce contemplaci ó n (texte Garci- Sanchez) - De los á lamos vengo, madr e
La Colombina Maria Cristina Kiehr, soprano Claudio Cavina, alto Josep Benet, ténor et direction Josep Cabré, baryton
(concert sans entracte - durée : 55 minutes)
polyphonies de la Renaissance
musique profane du Siècle d'or
Des points de vue économique, politique et artistique, le XVIe siècle espagnol mérite son qualificatif de « Siècle d'Or ». Régénérée par les richesses arrachées aux populations du Nouveau Monde, l'Espagne était alors devenue la nation la plus puissante d'Europe. Succédant aux Rois Catholiques et héritier des maisons de Castille, d'Aragon, de Bourgogne et de Habsbourg, Charles Quint mena cette domination à son apogée, en régnant sur un immense empire « où le soleil ne se couchait jamais ». Cette puissance et cette richesse favorisèrent tout naturellement les arts, comme en témoigne l'extraordinaire floraison de la production musicale, qu'elle soit religieuse ou profane. Parallèlement aux chefsd'œuvre sacrés de Morales, Guerrero, puis Victoria, on vit en effet se développer un répertoire profane d'une grande qualité, révélant un art de cour raffiné, encore entaché de traditions courtoises médiévales. Le célèbre Juan del Encina (1469-1529) est le musicien et le poète le plus fréquemment rencontré dans les cancioneros espagnols (Palacio, Medinace ll i...), ces précieux manuscrits constituant les principales sources du répertoire profane et courtisan de l'époque des Rois Catholiques. Reconnu comme l'un des écrivains les plus importants du Siècle d'or (il est considéré comme « l'inventeur » du théâtre hispanique), il est également l'un des principaux maîtres du villancico, genre poético-musical le plus abondamment cultivé dans les Cancioneros avec les romances et les canciones. Ces trois formes relèvent encore de l'art de la glose médié- vale, puisqu'elles reposent sur un principe de commentaire conceptuel et musical d'après un thème initial, donné ou proposé. L'inspiration poétique des villancicos de Juan del Encina est très variée : certains
textes relèvent de la dévotion mariale (pues que tu, Re i na del cie lo ), d'autres
sont des poèmes de circonstance (comme celui évoquant la mort de l'infant Juan, en 1497, dans Triste Espa ñ a sin ventura). Certains appar-
tiennent au genre pastoral (Antoni ll a es desposada, Ta buen ganadico), un
genre très prisé qui évoque l'illusion bucolique et transpose le monde obsédant de l'amour courtois dans le cadre prétendument naturel et paradisiaque des bergers.
Le renom de Francisco Guerrero (1528 - 1599) s'étendit au-delà des Pyrénées, puisqu'il fut abondamment publié, tant en Espagne qu'à Venise. Après avoir été chanteur à la Cathédrale de Séville, il étudia à Tolède auprès de Cristobal de Moralès, puis fut nommé suc-
2 | cité de la musique
polyphonies de la Renaissance
cessivement maître de chapelle des cathédrales de Jaen, de Malaga et enfin de Séville. Il légua un impressionnant corpus de près de cinq cents compositions, d'une grande variété d'écriture, passant du strict contrepoint en style josquinien à trois ou quatre voix, aux plus exubérantes compositions polychorales, dans la mouvance moderne vénitienne. Ses vi ll ancicos furent publiés dans son recueil de Canciones y Vi ll anescas espirituales. Ecrits en langue castillane, ils font pour la plupart référence à des sujets religieux (comme la rédemption pour Todo quando pudo dar) : ils suivent en cela l'évolution du genre, qui tend à devenir paraliturgique au cours du XVIe siècle. Leur style peut être défini par une dévotion douce et sereine, à rapprocher d'un certain mysticisme espagnol (celui de Sainte Thérèse d'Avila ou d'Ignace de Loyola) ainsi que Guerrero le rappela lui-même dans la préface d'un de ses livres : « Je n'ai jamais prétendu caresser les oreilles des personnes pieuses avec mes chansons, mais au contraire inciter leurs âmes à la contemplation dévote des mystères sacrés. » JuanVasquez (1510 - 1560), né à Badajoz, reçut sa première éducation musicale dans la cathédrale de cette ville, dont il devint Maestro di Capilla en 1545. En 1550, il part pour Séville et entre au service du gentilhomme Don Antonio de Zuñiga. S'il nous a légué une importante production religieuse, il excellait aux yeux de ses contemporains dans le domaine profane. Il publia trois volumes de chansons, dont deux seulement nous sont intégralement parvenus, constitués aux trois quarts de vi ll ancicos. On y décèle une influence des formes italiennes plus modernes, soulignée par la présence de nombreux madrigalismes. Certaines de ses oeuvres obtinrent une grande popularité,
comme De los alamos vengo, Madr e , qui fut absorbé par la tradition
populaire espagnole, et inspira maints compositeurs (Manuel de Falla cite en effet cette mélodie dans le premier mouvement de son
Concerto pour clavecin).
Mateo Romero (1575 - 1647), né Mathieu Rosmarin dans les Flandres alors sous domination espagnole, partit à la mort de son père pour Madrid, pour entrer dans la Maîtrise de la Chapelle Royale. Il y gravit progressivement tous les échelons de la hiérarchie avant d'être nommé Maestro di Capilla en 1598, poste qu'il conservera jusqu'en 1534. Romero favorisa l'introduction du stile nuovo en Espagne, en particulier dans ses 53 vi ll ancicos où l'on décèle une influence du style madrigalesque italien.
D. M.
notes de programme / 3
polyphonies de la Renaissance
Pleure, pleure, car tu perdis celui qui devait t'exalter. Dans sa tendre jeunesse Dieu voulut te l'enlever.
Juan del Encina
Triste Espana sin ventura,
Todos te deven llorar, Despoblada d'alegria, para nunca en ti tornar.
Antonilla es desposada
hagotele Juan saber,
Tormentos, penas, dolores te vineron a poblar.
Jur'a diez, no puede ser !
Sembróte Dios de plazer porque naciesse pesar.
No seas ten rebelado que yo la vi desposar y mucho de su cantar vi el lugar regocijado. Y a Toribio el desposado, vi atestado de plazer. Jur'a diez, no puede ser !
Hizote la mas dichosa para mas te lastimar. Tus vitorias y triunfos ya se hovieron de pagar :
Llora, llora, pues perdiste quien te havia de ensalçar. En su tierna juventud
A los grandes brinquejones que davan en el portal, nos encontrammos yo y Pascual, por medio de los garzones. te lo quiso Dios llevar.
- Pauvre
- Espagne
Comimos picatostones y diéronnos a beber,
sans fortune,
Tous doivent te pleurer, jur'a diez, no puede ser !
La joie t'a désertée, pour ne jamais retourner.
Antoinette est épousée
Jean te le fait savoir,
Tourments, peines, douleurs vinrent te peupler.
Parbleu, cela ne se peut !
Dieu sema en toi plaisir pour que naquît regret.
Ne sois pas si retourné car je l'ai vu prendre époux et grand part de son chant j'ai vu l'endroit régaler. Et ceToribio l'épousé
Il te fit la plus heureuse pour mieux te blesser. Tes victoires et tes triomphes ont dû cher se payer : j'ai vu enflé de plaisir. Parbleu, cela ne se peut !
4 | cité de la musique
polyphonies de la Renaissance
Un si bon p 'tit bétail,
surtout en tel val
Face aux grandes secousses qu'ils donnaient au portail, nous nous trouvâmes moi et Pascal, au milieu des amoureux. c'est plaisir de le garder. Bétail d'altitude et d'une telle caste, très vite se gâte en mauvaise pâture. Mais en bonne verdure, surtout en tel val,
Nous mangeâmes des brochettes, l'on nous donna à boire, parbleu, cela ne se peut ! c'est plaisir de le garder.
Il est bon de garder cette chose pré- cieuse
Tan buen ganadico,
y mas ganadico, y mas en tal valle,
- plazer es guardalle.
- qui, convoitée, finit par être dérobée.
Bétail infaillible, surtout en tel val,
- c'est plaisir de le garder.
- Ganada d'altura y mas de tal casta,
muy presto se gasta en mala pastura. Y en buena verdura, y más en tal valle, plazer es guardalle.
Berger qui s'enferme en val sûr, les loups, j'te jure, le laissent en paix. Bétail de montagne, amené en tel val,
- c'est plaisir de le garder.
- Conviene guardalla la cosa preciosa
qu'en ser codiciosa procuran hurtalla. Ganado sin falla, y màs en tal valle, plazer es guardalle.
Berger de bon gré toujours serais, car tant de joie me donne ce troupeau que j'ai soin de ne jamais le quitter,
- mais toujours le garder.
- Pastor que s'encierra en valle seguro,
los lobos te juro que no le den guera. Ganado de sierra, traspuesto en tal
valle,
Pues que tu, Reina del cielo,
tanto vales, plazer es guardalle. da remedio a nuestros males. Tu que reinas con el Rey de aquel reino celestial, tú lumbre de nuestra ley, ley del linaje humanal : pues para quitar el mal tanto vales,
Pastor de buen grado yo siempre seria, pues tanta alegria me da este ganado que tengo cuidado de nunca dexalle, más siempre guardalle.
da remedio a nuestros males.
notes de programme | 5
polyphonies de la Renaissance
toi qui est odeur d'odeurs, toi qui donnes gloire très certaine : si contre la mort très morte tu ne nous vaux,
Tú, Virgen que mereciste ser Madre de tal Senor, tú que cuando le pariste le pariste sin dolor, il n'y a remède à nos maux. pues con nuestro Salvador
tanto vales, da remedio a nuestros males.
Tú que eres flor de las flores, tú que del cielo eres puerta, tú que eres olor de olores, tú que das gloria muy cierta : si de la muerte muy muerta no nos vales, no hay remedio en nuestro males.
Puisque toi, Reine des ci eux,
tu vaux tant, donne remède à nos maux. Toi qui règnes avec le Roi de ce règne céleste, toi lumière de notre loi, loi du lignage humain : puisque pour ôter le mal tu vaux tant, donne remède à nos maux.
Toi, Vierge qui mérita d'être Mère d'un tel Seigneur, toi qui en le mettant au monde le fit sans douleur, puisque avec notre Sauveur tu vaux tant, donne remède à nos maux.
Toi qui es fleur des fleurs toi qui du ciel es porte,
6 | cité de la musique
samedi 8 mars - 20h / salle des concerts
le gothique franco-flamand
Nicolas Gombert
Media vita, motet à 6 voix Je prens congie, chanson à 8 voix
Pierre de Manchicourt
Reges terrae, motet à 6 voix
Matthias Pipelare
Vrai Dieu d'amours, chanson à 4 voix
entracte
Antoine Brumel
M esse « Et ecce terrae motus » à 12 voix
Paul Van Nevel, direction Huelgas Ensemble
Paul van Nevel et l'ensemble Huelgas sont ambassadeurs culturels de la Flandre et leurs concerts sont donnés sous les auspices du gouvernement flamand
polyphonies de la Renaissance
le gothique franco-flamand
La vie fort aventureuse de Nicolas Gombert (c. 1495 - 1560) reste aujourd'hui encore emplie de zones d'ombres. Né probablement dans le village de La Gorgue, dans les Flandres méridionales, il aurait été l'élève de Josquin avant d'entrer en 1526 comme chanteur dans la Chapelle Impériale de Charles Quint. Il en gravit progressivement les échelons hiérarchiques pour atteindre le titre honorifique de Maître des Enfants de la Chapelle Impériale. Il semble cependant que Gombert ait été condamné aux galères après 1540 pour avoir violé un des enfants placés sous son autorité. Ayant obtenu le pardon de l'Empereur, Gombert revint ensuite finir ses jours à Tournai. Quelques 160 motets lui sont attribués, parmi lesquels Media Vita, au texte si sombre et dramatique. Ils forment la part la plus représentative de son style, révélant une expressivité mélodique et un souci d'intelligibilité du texte anticipant sur beaucoup de préoccupations d'auteurs postérieurs : on ne s'étonnera donc pas que Monteverdi ait choisi une mélodie empruntée
à un motet de Gombert (in ill o Tempore) pour former le cantus firmus de sa messe à six voix publiée en 1610 (Sanctissime Missa senisVocibus...ac
Vespere). La chanson à huit voix Je prens congie tient une position particulière dans la production profane de Gombert, qui compte plus de 70 chansons. Malgré son exceptionnelle ampleur polyphonique, c'est une composition intimiste fondée sur un subtil jeu contrapuntique d'imitations, dont le caractère nostalgique est accentué par une exceptionnelle cadence conclusive mineure.
Le parcours de Pierre de Manchicourt (1510 -1564) peut être rapproché de celui de Mateo Romero, puisque leurs carrières respectives les menèrent des Flandres à la cour d'Espagne. Manchicourt étudia à la Cathédrale d'Arras, puis œuvra successivement à Tours et à Tournai, où il fut nommé Maître de Chapelle en 1545. En 1559, il succéda à Nicolas Payen au poste de Maître de la Chapelle royale de Philippe II, à Madrid, poste qu'il conservera jusqu'à sa mort. L'examen chronologique des motets de Manchicourt fait apparaître une considérable évolution stylistique : au début de sa carrière, il demeure fidèle à des modèles déjà considérés comme archaïques, intégrant par la suite les innovations techniques apportées par Josquin (équilibre de texture, contrepoint imitatif rigoureux...), comme le révèle son motet à six voix Reges Terrae.
8 / cité de la musique
polyphonies ds la Renaissance
Matthias Pipelare (c. 1450 - c. 1515) est également flamand d'origine. Il a travaillé à Anvers avant de devenir maître des chœurs à Hertogenbosch, la capitale du Nord-Brabant. Sa renommée fut telle qu'il est encore mentionné, dans le traité Ornitoparchus, traduit par John Dowland en 1609, parmi les auteurs dont les œuvres « coulent de la vrai fontaine de l'Art ». Sa chanson à quatre voix Vrai Dieu d'Amour, qui nous est parvenue dans deux versions, fait apparaître un style homophonique moderne, proche de celui de Pierre de la Rue. Le joyau du programme proposé par Paul van Nevel est sans conteste
l'impressionnante Messe à 12 voix « Et ecce Terrae motus » d'Antoine
Brumel (c. 1460 - ap 1510). Né à Chartres, il œuvra tout d'abord dans la somptueuse cathédrale de sa ville natale, avant d'être appelé à Genève, puis à Notre-Dame de Paris. Il partit ensuite pour l'Italie, comme Maestro di Cape ll a à la cour d'Alfonso I d'Este à Ferrare : une cour restée fameuse pour l'intérêt que la dynastie d'Este porta à la musique moderne tout au long du XVIe siècle. C'est pour Alfonso I que Brumel composa sa Messe à 12 voix, qui compte parmi les compositions les plus exceptionnelles du répertoire franco-flamand. Sa conception polyphonique reste sans équivalent pour l'époque, puisqu'elle fait appel à quatre groupes de trois voix égales, avec pour « axe névralgique » les six voix médianes. Techniquement, les exigences vocales sont extrêmes à toutes les voix, chacune d'entre elles participant d'une manière égale au discours polyphonique. Celui-ci exploite un cantus firmus, une mélodie de référence empruntée au début de l'antienne pascale « Et ecce Terrae motus », qui vient irriguer toute la composition. Cette messe dut marquer les esprits, puisque Roland de Lassus la fit exécuter à Munich, plus de cinquante années après la mort du compositeur. Il copia de sa propre main la partition, précisant en marge les noms de chaque chanteur requis pour l'occasion, lui-même assurant la partie de T e nor secundus : un hommage des plus révélateurs !
D.M.
notes de programme | 9
polyphonies de la Renaissance
Pierre de Manchicourt
Nicolas Gombert
Reges terrae
Media vita
Reges terrae congregati sunt Convenerunt in unum dicentes : « Eamus in Judeam et inquiramus ubi est qui natus est Rex Magnus Cuius stellam vidimus. Alleluia. »
Media vita in morte sumus ; quem quaerimus adiutorem, nisi te Domine ? Qui pro peccatis nostris iuste irasceris. Sancte Deus, Sancte fortis, Sancte et misericors
Et venientes invenerunt puerum Cum Maria matre eius
Salvator noster, amarae morti ne tradas nos.
Et procedentes adoraverunt eum
Offerentes ei aurum, thus et myrrham. Alleluia.
Au milieu de la vie nous sommes dans la mort ; Qui invoquons-nous pour nous aider, sinon toi, Seigneur ?
Matthias Pipelare
Toi, qui t'irrites à juste raison de nos péchés.
Vray Dieu d'amours
Vray dieu d'amours confortez l'amoureux
Dieu Saint, Sainte Puissance, notre Saint et Miséricordieux Sauveur, Ne nous livre pas à la mort amère.
traduction Jacques Fou rn ier
Qui nuit et jour vit en tresgrant martir Pour la belle au gent corps et gracieux Qui ne me veult de joye ou jeux nantir Pour vray vous dis sans en rien mentir Si vous requiers que j'aye allegement Joye et soulas au lieu de grief tourment
Je prens congie
Je prens congie de mes amours desquelles me fault partir. Hellas ! nul ne me vient donner secours
Donnés scours ne soyés esgaree Car j'ay douleurs plains de gemissement dont dois plourer et bien gémir, si suis ie mis en plus décent martire. Je dis adieu a mes amours soudainement men voye morir.
Dueil angoisseux rage desmesuree S'il advenoit que fusse il heureux Qu'à mon désir peusisse parvenir Oncques amant ne fust si vertueux S'amour vouloit à mon faict convenir Mais il me faict angoisse soustenir
10 | cité de la musique
polyphonies de la Renaissance
Gloria
N'avoir ne puis repos aulcunement
Pour la belle qui me point ardamment Et enflambit jouant a desperee
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax
Pour elle j'ay desconfort asprement Dueil angoisseux rage desmesuree hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorifcamus te. Gratias agimus tibi
Son doulx regard tresplaisant et
joyeux propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex caelestis, Deus, Pater omnipotens, Domine Fili unigenite, Jesu Christe.
Et son gent corps me font grant desplaisir Quant je la voys je suis assez songneux De l'honnourer pour luy faire plaisir Puis la servy quant j'ay temps et loisir Je vueil mais suis sans quelque esbatement
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi miserere nobis,
Triste pensif dolent entierement Qui me point fort c'est dure destinee O dieu d'amour ostés moy briefvement suscipe deprecationem nostram.
Dueil angoisseux rage desmesuree
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis,
Prince d'amours je requiers humblement quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus,
Qu'on voit priant que ma tres destree Vueille enchasser de moy hastivement Dueil angoisseux rage desmesuree. tu solus altissimus, Jesu Christe. Cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Amen.