Rhuis-Vermand 0002.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Annonces 4 Juillet 21
Dimanche MESSES EN SEMAINE : A l’église de Pont-Sainte-Maxence 4 juillet 2021 ème Lundi 5 (vert) 18h30 Paroisse Sainte Maxence 14 dimanche Mardi 6 (vert) 9h00 pas de messe 2, rue du Moustier – 60700 Pont-Sainte-Maxence du temps ordinaire Tel : 03 44 72 22 30 Année B Mercredi 7 (vert) 9h00 Courriel : [email protected] site de la paroisse : www.paroissesaintemaxence.net Jeudi 8 (vert ) 9h00 Josselyne MARLANGE Horaires des messes : https://messes.info Vendredi 9 (vert) 9h00 Maurice GILLE 9H30 chapelet Samedi 10 (vert) 9H00 « Un prophète n’est méprisé que dans son pays » (Mc 6, 1-6) MESSES DOMINICALES : 15 e dimanche du temps ordinaire Samedi 10 : 18h30 – Fleurines : Roger ANA, Claude HOUTARDE, Ginette PREVOT Dimanche 11 : 9h30 - pas de messe 11h00 – Pont-Sainte-Maxence : Ottilia et Livio UBER, Jérôme PERDIGUERO, René et Laura LHERMITE 11h00 – Brenouille : Ismelda BOURON, Colette BAILLET Défunts de la semaine : Claude HOUTARDE (90 ans), le 1 er juillet à Fleurines er Ginette PREVOT (83 ans), le 1 juillet à Pont Intentions de messe du week-end : Françoise TOSSER (67 ans), le 2 juillet à Pont Laurent LANDRY (61 ans), le 2 juillet à Pont Samedi 18h30 – PONTPOINT : les défunts de la famille de ROBERVAL, Joseph Mariage à venir : Ludovic PICOT et Magali MENOT, le 10 juillet à Pont DELEMOTTE Dimanche 9h30 – SARRON : Pierre VIALATTE, Isabelle MAURY-VIALATTE, RELAIS MENSUEL D’ADORATION Fernand DROUIN Le vendredi 9 juillet, de 10h00 à 19h30, à l’oratoire. Dimanche 11h00 - PONT-SAINTE-MAXENCE : Ottilia et Livio UBER, Philippe Inscription -

Tableau Récapitulatif Des Délibérations Des Communes Et EPCI
Tableau récapitulatif des délibérations des communes et EPCI OISE COMMUNES Approuvé le Refusé le Nature de l’avis APREMONT 06/09/2019 Sans réserve AUGER-SAINT-VINCENT 19/09/2019 Sans réserve AUMONT-EN-HALATTE 16/09/2019 Sans réserve AVILLY-SAINT-LEONARD 14/06/2019 Sans réserve BARBERY 05/09/2019 Sans réserve BARON 01/07/2019 BEAUREPAIRE 13/09/2019 Sans réserve BETHISY-SAINT-PIERRE 20/06/2019 BORAN-SUR-OISE 11/06/2019 Sans réserve BOREST 17/06/2019 Sans réserve BRASSEUSE 19/09/2019 Sans réserve BRENOUILLE 27/06/2019 CHAMANT 16/09/2019 CHANTILLY 19/09/2019 Sans réserve COURTEUIL 16/09/2019 Sans réserve COYE-LA-FORET 20/09/2019 Sans réserve CREIL 24/06/2019 Sans réservé ERMENONVILLE 25/06/2019 Sans réserve EVE N’a pas délibéré FLEURINES 17/09/2019 Sans réserve FONTAINE-CHAALIS 16/09/2019 Sans réserve FRESNOY-LE-LUAT 17/09/2019 Sans réserve GOUVIEUX 25/06/2019 Sans réserve LA CHAPELLE-EN-SERVAL 09/07/2019 Sans réserve LAMORLAYE 11/09/2019 Sans réserve LES AGEUX 24/06/2019 MONCEAUX N’a pas délibéré MONT L’EVEQUE 31/08/2019 Sans réserve MONTAGNY-SAINTE-FELICITE 14/06/2019 Sans réserve MONTEPILLOY 17/06/2019 Sans réserve MONTLOGNON 27/06/2019 Sans réserve MORTEFONTAINE 17/09/2019 Sans réserve NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 02/09/2019 Sans réserve NERY 09/07/2019 ORRY LA VILLE 19/06/2019 Sans réserve PLAILLY 16/07/2019 Sans réserve PONT SAINTE MAXENCE 18/09/2019 Sans réserve PONTARME 14/06/2019 Sans réserve PONTPOINT 09/09/2019 Sans réserve PRECY-SUR-OISE 19/07/2019 Sans réserve RARAY 17/06/2019 Sans réserve RHUIS 24/06/2019 Sans réserve ROBERVAL 05/07/2019 -

Histoire Et Patrimoine De Pont-Sainte-Maxence N°1
Histoire et Patrimoine de Pont-Sainte-Maxence n°1 Service histoire et patrimoine sommaire Le mot du maire p 3 Le service «Histoire et Patrimoine» Le garant de notre mémoire p 4 Témoignages p 8 Le phare d’Auvelais p 10 Site archéologique de Pont-Sainte-Maxence p 12 À découvrir, à redécouvrir p 16 Informations p 17 Annexes p 18 Règlement intérieur p 22 Carte postale de couverture : «Sainte Maxence vierge et martyre» Au Ve siècle, Maxence, fille de Malcolm, roi des Scots en Irlande, se convertit à la foi chrétienne. Avicin, un prince païen demande la main à son père. Maxence refuse et s’enfuit en Gaule, au bord de l’Oise, à Pont-Sainte-Maxence. Avicin la retrouve et lui tranche la tête. La légende raconte que Maxence ramasse la tête ensanglantée et marche jusqu’au lieu où elle souhaite être enterrée, près d’une fontaine située dans l’actuelle rue Sainte Maxence. Autrefois, Sainte Maxence se fêtait le 20 novembre. Aujourd’hui la foire de Pont qui se tient le troisième dimanche de novembre en est l’héritage. Directeur de publication : Arnaud Dumontier Rédacteurs : Bruno Vermeulen, Jean Davesne, Nathalie Le Bozec, Christiane Sauvage Avec la collaboration du groupe de travail «histoire et patrimoine» ainsi que Mathilde Fleurette, responsable de la coordination, de l’animation ville et du patrimoine. Témoignages : Marie-Thérèse Blanchon et Françoise Dupuy Crédit photos : Bernard Bodart, Michel Urli, Marie-Thérèse Blanchon, service histoire et patrimoine Réalisation : Christophe Hénin, responsable communication ville de Pont-Sainte-Maxence Tirage : 1 000 exemplaires, 4e trimestre 2016 À René BLANCHON… et commentées avec le talent et la bienveillance qui le caractérisaient. -
FAIRE Du Théâtre, De La Danse, De La Musique ?
FAIRE du théâtre, de la danse, de la musique ? LA MANEKINE ! LE CIAH ! 2020/2021 www.lamanekine.fr Pratiquez avec les artistes de la saison ! 4 allée René Blanchon - 60700 Pont-Sainte-Maxence Que vous soyez débutant ou confirmé, enfant, adolescent ou adulte, La Manekine vous propose une expérience artistique et humaine avec les artistes qui font vivre la saison. En vous inscrivant à un atelier théâtre et/ou de danse hip-hop, plongez dans ces bulles de curiosité et de liberté pour pratiquer avec une joyeuse exigence ! Théâtre JEUNES Les ateliers sont encadrés par Anthony Binet, auteur, metteur en 6 À 17 ANS scène et comédien, co-directeur de la compagnie La Pièce Montée. LA MANEKINE - LE MERCREDI HORAIRES 14h00 - 15h00 : enfants 15h15 - 16h15 : enfants 16h30 - 17h30 : enfants 17h30 - 19h00 : adolescents TARIFS Résidents CCPOH : 80 € Non résidents CCPOH : 120 € Ce tarif est annuel et comprend l’adhésion à La fabrik ainsi qu’une carte L’Intégrale qui donne accès à tous les spectacles de la saison 2020/2021. Les réservations sont à effectuer auprès de la billetterie de La Manekine. ADULTES Encadré par Aude Léger, autrice, metteuse en scène et comédienne, + DE 18 ANS directrice de la compagnie Oui merci. LA MANEKINE - LE JEUDI HORAIRES 20h00 - 22h00 TARIFS Résidents CCPOH : 120 € Non résidents CCPOH : 150 € Le tarif est annuel et comprend un abonnement Trio La Manekine. Vous pourrez ainsi assister à trois spectacles au choix de la saison 2020/2021. Les réservations sont à effectuer auprès de la billetterie de La Manekine. 2 Danse hip-hop JEUNES L’atelier est encadré par Xavier Plutus, danseur et chorégraphe. -

Annonces 9 Mai 21
Dimanche MESSES EN SEMAINE : A l’église de Pont-Sainte-Maxence 9 mai 2021 Paroisse Sainte Maxence 6ème dimanche Lundi 10 (blanc) 18h00 Elodie BIOT, Monique ANGELLOTTI 2, rue du Moustier – 60700 Pont-Sainte-Maxence de Pâques Tel : 03 44 72 22 30 Mardi 11 (blanc) 9h00 Joël EGOT, Serge LEQUEUX Courriel : [email protected] Année B Mercredi 12 (blanc) 9h00 Annie RICHARD, Pascal VAUVERT site de la paroisse : www.paroissesaintemaxence.net Horaires des messes : https://messes.info Jeudi 13 (blanc ) 11h00 Ottilia et Livio UBER, Jean-Pierre DEMAISON, Jacques SAUMET, Ludovic RUTKOWSKI Vendredi 14 (rouge – saint Matthias) 9h00 Sully VERTUEUX, Danielle VAN POUCKE « Il n’y a pas de plus grand amour que 9H30 chapelet de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 9-17) Samedi 15 (blanc) 9H00 Nadine VATELER, Louis OLLIVIER, Denise MARCHAND MESSES DOMINICALES : 7ème dimanche de Pâques (quête impérée pour la communication ) Samedi 15 : 17h30 – Pontpoint : Patrick LESUEUR, les défunts de la famille de ROBERVAL Dimanche 16 : 9h30 – Les Ageux : / 11h00 – Pont-Sainte-Maxence : Ottilia et Livio UBER 11h00 – Monceaux : Paul ABRAHAM, Roland BALCAEN Intentions de messe du week-end : Samedi 17h30 – FLEURINES : Monique et jean GAUGUET, Maria LEOCATA Défunts de la semaine : Damien MARIÉ (28 ans) à Pont Dimanche 9h30 – RHUIS : Elisabeth GOYARD, les défunts de la famille de Isabelle BERNARD (88 ans) à Fleurines ROBERVAL Odette LEROY (93 ans) à Pont Dimanche 11h00 - PONT-SAINTE-MAXENCE : Ottilia et Livio UBER, Joséphine Eliane DESCAUCHEREUX (88 ans) à Pont MICHIELS, Claude NEYRAUD, Alfredo Augusto et Marie José OLIVEIRA Dimanche 11h00 – BRENOUILLE : / Baptêmes du week-end : Laura DUFOUR, Daniel DECOBECQ, Madison DECOBECQ, Wesley DECOBECQ et Nina RODRIGUES, le 9 mai à Pont MESSES DE L’ASCENSION - Mercredi 12 mai à 17h30 à Cinqueux RELAIS MENSUEL D’ADORATION - Jeudi 13 mai à 11h à Pont Le dimanche 9 mai, de 8h30 à 18h00, à l’oratoire. -

Canton De Pont-Sainte-Maxence Prospection Diachronique (2008)
ADLFI. Archéologie de la France - Informations une revue Gallia Hauts-de-France | 2008 Canton de Pont-Sainte-Maxence Prospection diachronique (2008) Jean-Marc Popineau Édition électronique URL : https://journals.openedition.org/adlfi/86440 ISSN : 2114-0502 Éditeur Ministère de la Culture Référence électronique Jean-Marc Popineau, « Canton de Pont-Sainte-Maxence » [notice archéologique], ADLFI. Archéologie de la France - Informations [En ligne], Hauts-de-France, mis en ligne le 06 juillet 2021, consulté le 07 juillet 2021. URL : http://journals.openedition.org/adlfi/86440 Ce document a été généré automatiquement le 7 juillet 2021. © ministère de la Culture et de la Communication, CNRS Canton de Pont-Sainte-Maxence 1 Canton de Pont-Sainte-Maxence Prospection diachronique (2008) Jean-Marc Popineau ADLFI. Archéologie de la France - Informations , Hauts-de-France Canton de Pont-Sainte-Maxence 2 1 Les 126 ha quadrillés tous les 10 m et les 3 195 artefacts antérieurs au XIXe s. récoltés cette année (dont 720 céramiques et 2 192 terres cuites architecturales) ont permis de préciser notre connaissance du territoire du canton de Pont-Sainte-Maxence aux époques antique et médiévale. 2 À la prospection systématique en labour ont été adjointes cette année la prospection à vue dans les caves. 3 La campagne 2008 s’est concentrée sur les communes de Brasseuse, Raray, Rhuis, Roberval et Villeneuve-sur-Verberie. Les sites étudiés sont de natures différentes : • trois villae gallo-romaines, l’une à Verberie, La Remise du Noyer Ruffin, associée à un riche mobilier (terra nigra, tegulae, marbre, huîtres, céramique commune), une deuxième à Villeneuve-sur-Verberie, La Couture, de la Protohistoire au IIIe s., une troisième à Villers- Saint-Frambourg, La Forêt d’Halatte, associée à des enduits peints et à du mobilier alto- médiéval ; • un vicus gallo-romain et village médiéval déserté (Roberval, L’Épinette ; Rhuis, La Plaine) ; • une fonderie médiévale (Roberval, Le Cornouiller) du XIIIe-XVe s. -

Communes Et EPCI Ayant Approuvé La Charte
Communes et EPCI ayant approuvé la charte Communes code insee partiellement incluse Département de l'Oise Apremont 60022 Auger-Saint-Vincent 60027 Aumont-en-Halatte 60028 Avilly-Saint-Léonard 60033 Barbery 60045 Beaurepaire 60056 Boran-sur-Oise 60086 Borest 60087 Brasseuse 60100 Chantilly 60141 La Chapelle-en-Serval 60142 Courteuil 60170 Coye-la-Forêt 60172 Creil 60175 partiellement incluse Ermenonville 60213 Fleurines 60238 Fontaine-Chaalis 60241 Fresnoy-le-Luat 60261 Gouvieux 60282 Lamorlaye 60346 Montagny-Sainte-Félicité 60413 Montépilloy 60415 Mont-l’Evêque 60421 Montlognon 60422 Mortefontaine 60432 Nanteuil-le-Haudouin 60446 partiellement incluse Orry-la-Ville 60482 Plailly 60494 Pontarmé 60505 Pontpoint 60508 Pont-Sainte-Maxence 60509 Précy-sur-Oise 60513 Raray 60525 Rhuis 60536 Roberval 60541 Rully 60560 Saint-Maximin 60589 partiellement incluse Saint-Vaast-de-Longmont 60600 Senlis 60612 Thiers-sur-Thève 60631 Ver-sur-Launette 60666 Verneuil-en-Halatte 60670 partiellement incluse Villeneuve-sur-Verberie 60680 Villers-Saint-Frambourg-Ognon 60682 Vineuil-Saint-Firmin 60695 Département du Val d'Oise Asnières-sur-Oise 95026 Beaumont-sur-Oise 95052 partiellement incluse Communes et EPCI ayant approuvé la charte Bellefontaine 95055 Belloy-en-France 95056 Béthemont-la-Forêt 95061 Châtenay-en-France 95144 Chaumontel 95149 Chauvry 95151 Fosses 95250 partiellement incluse Jagny-sous-bois 95316 Lassy 95331 Luzarches 95352 Maffliers 95353 partiellement incluse Mareil-en-France 95365 Mours 95436 partiellement incluse Nointel 95452 Noisy-sur-Oise -

L'eau Et Le Milieu Aquatique
Le Porter à Connaissance 1 Eau et Milieu Aquatique Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte SCoT des Pays d’Oise et d’Halatte S'il ne s'agit pas de faire un « urbanisme de tuyaux », le Par ailleurs, il convient d'insister sur le coût des systèmes projet de développement durable d'un territoire ne peut être d'évacuation des eaux qui nécessitent des investissements dont envisagé sans que soit menée une réflexion, en concertation l'importance est comparable celle de la voirie. avec les services gestionnaires des réseaux, sur les besoins d'approvisionnement en eau de la population et sur la capacité Dans cette perspective, les études liées à l'élaboration des des réseaux existants, en matière d'évacuation des eaux de zonages d'assainissement visés à l'article L.2224-10 du code ruissellement et des eaux usées, à supporter les nouveaux général des collectivités territoriales prennent toute leur développements projetés. importance. En pratique, et au-delà du choix des secteurs d'extension de Enfin, il faut souligner la dimension le plus souvent l'urbanisation en fonction de l'état des réseaux, le coefficient intercommunale de la question de l'eau. En particulier, les d'occupation des sols est un outil réglementaire particulièrement communes doivent tenir compte dans leur programmation adapté à la définition de droits à construire adaptés à la capacité relative aux réseaux d'adduction d'eau ou d'assainissement des des équipements existants ou programmés. orientations, quand ils existent ou sont en cours d'élaboration, des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE) ou des schémas d'aménagement ou de gestion de l'eau (SAGE). -

Annonces 27 Juin 21
Dimanche MESSES EN SEMAINE : A l’église de Pont-Sainte-Maxence 27 juin 2021 ème Lundi 28 (blanc – sainte Thérèse de Lisieux) Paroisse Sainte Maxence 13 dimanche 10h30 2, rue du Moustier – 60700 Pont-Sainte-Maxence du temps ordinaire Tel : 03 44 72 22 30 Année B 18h30 Jacques CABORDEL, action de grâce pour Frédéric et Maëva Courriel : [email protected] site de la paroisse : www.paroissesaintemaxence.net Mardi 29 (rouge – saints Pierre et Paul) Horaires des messes : https://messes.info 9h00 Josselyne MARLANGE, action de grâce pour Sylvia AJAX 19H30 Mercredi 30 (blanc – sainte Thérèse de Lisieux) « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » (Mc 5, 21-43) 11h00 Jeanne DREVILLE Jeudi 1er (blanc – sainte Thérèse de Lisieux ) 9h00 Gilles MAURICE 18h30 Vendredi 2 (vert) 9h00 9H30 chapelet Samedi 3 (rouge – saint Thomas) 9H00 Jérôme PERDIGUERO MESSES DOMINICALES : 14 e dimanche du temps ordinaire Samedi 3 : 18h30 – Pontpoint: les défunts de la famille de ROBERVAL, Joseph DELEMOTTE Intentions de messe du week-end : Dimanche 4 : Samedi 18h30 – FLEURINES : / 9h30 – Sarron : Pierre VIALATTE, Isabelle MAURY-VIALATTE Dimanche 9h30 – SAINT-MARTIN-LONGUEAU : / 11h00 – Pont-Sainte-Maxence : Ottilia et Livio UBER, Philippe Armand, Micheline Dimanche 11h00 - PONT-SAINTE-MAXENCE : Ottilia et Livio UBER, Jérôme CAPIAUX, Tatienne NTSIKATIA-BANZOUZI PERDIGUERO, André FONTAINE, Prosper-Amédée et Jeanne-Nina (1 an) 11h00 – Sacy-le-Grand : Bruno BOURSIER, Jeanne DREVILLE, Lucette LAFITTE DHANPAUL, action de grâce pour Frédéric et Maëva Dimanche 11h00 -
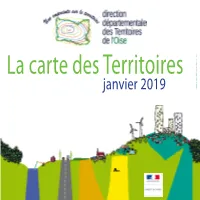
Conception Graphique : DDT60
La carte des Territoires janvier 2019 / Février 2019 - IPNS Conception graphique : DDT60 - Direction Abancourt, Abbecourt, Abbeville-Saint-Lucien, Achy, Allonne, Amblainville, Andeville, Angy, Ansauvillers, Auchy-la-Montagne, Agnetz, Airion, Amy, Angivillers, Ansacq, Antheuil-Portes, Appilly, Armancourt, Arsy, Attichy, Autrêches, Avrechy, Avricourt, Auneuil, Auteuil, Aux MaraisBachivillers, Bacouël, Bailleul-sur-Thérain, Balagny-sur-Thérain, Bazancourt, Beaudéduit, Avrigny, Baboeuf, Bailleul-le-Soc, Bailly, Baugy, Beaugies-sous-Bois, Beaulieu-les-Fontaines, Beaurains-lès-Noyon, Béhéri- Beauvais, Beauvoir, Belle-Eglise, Berneuil-en-Bray, Berthecourt, Blacourt, Blaincourt-lès-Precy, Blancfossé, Blargies, Blicourt, court, Belloy, Berlancourt, Berneuil-sur-Aisne, Béthisy-Saint-Martin, Béthisy-Saint-Pierre, Bienville, Biermont, Bitry, Blincourt, Bonlier, Bonneuil-les-Eaux, Bonnières, Bonvillers, Boran-sur-Oise, Bornel, Boubiers, Bouconvillers, Boutencourt, Bouvresse, Boulogne-la-Grasse, Braisnes, Brétigny, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Brunvillers-la-Motte, Bulles, Bury, Bussy, Caisnes, Cam- Bresles, Breteuil, Briot, Brombos, Broquiers, Broyes, Bucamps, Buicourt, Campeaux, Campremy, Canny-sur-Thérain, Catheux, bronne-lès-Ribécourt, Cambronne-lès-Clermont, Campagne, Candor, Canly, Cannectancourt, Canny-sur-Matz, Carlepont, Cauvigny, Cempuis, Chambly, Chambors, Chaumont-en-Vexin, Chavençon, Chepoix, Choqueuse-les-Bénards, Cires-lès- Catenoy, Catigny, Catillon-Fumechon, Cernoy, Chelles, Chevincourt, Chevrières, Chiry-Ourscamps, Choisy-au-Bac, -

La Promenade Découverte N°4 : Pont-Sainte-Maxence/Roberval/Rhuis
L - L’église Saint Gervais et Saint Protais de Rhuis Construite en deux étapes (milieu et fin du XIe siècle) et bâtie selon un plan très simple et dans un style roman sobre, c’est La Promenade l’une des églises les plus anciennes du département. De plus, la voûte du croisillon sud est une des premières voûtes d’ogive en découverte n°4 France. Elle a été restaurée de 1964 à 1970 grâce au Baron Bich. Sur deux modillons soutenant la corniche, côté nord et côté sud de la nef, un petit bonhomme Bic sculpté lui Ville de Pont-Sainte-Maxence rend hommage. Continuez Grande Rue. Tournez ensuite à gauche, Route de l’Oise. A l’intersection avec la D123, garez- vous prudemment. Au milieu du Pont-Sainte-Maxence, champ situé en face à droite, se trouve la Demoiselle de Rhuis (visible à pied sauf en période de culture de maïs). Pontpoint, Roberval et Rhuis M - La Demoiselle de Rhuis À vélo ou en voiture Dernière rescapée d’un ensemble mégalithique connu sous le nom de Le plan du parcours Demoiselles de Rhuis, cette pierre levée en grès mesure 3 mètres de haut, 2,30 mètres de large et 50 centimètres d’épaisseur. Il y aurait eu plusieurs menhirs à l’origine. Prenez la D123 vers la gauche et Pont-Sainte-MaxenceRéalisation Ville de Crédit Marie-Thérèse photos Blanchon retournez à Pont-Sainte-Maxence où l’Office de Tourisme vous attend pour vous proposer d’autres balades. Office de Tourisme 18 rue Louis Boilet - 60721 PONT-SAINTE-MAXENCE En espérant vous avoir fait passer un agréable moment ! Tél : 03 44 72 35 90 - Courriel : [email protected] www.pontsaintemaxence-tourisme.fr Horaires d’ouverture : Documentation et brochures Lundi : 14 h 00 - 17 h 30 Mardi au vendredi : • Les Promenades découvertes de la Ville de 10 h 00 - 12 h 00 Commune de Pontpoint Pont-Sainte-Maxence et 14 h 00 - 17 h 30 • Les brochures du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France. -

Relais Assistants Maternels
Pour tout renseignement, contactez les animatrices du RAM. Les temps collectifs Les permanences administratives Relais Les ateliers d’éveil Les sorties Les animatrices du relais vous accueillent sur rendez-vous Assistants Les animatrices du relais as- Elles sont organisées ponctuel- lors de permanences administratives au Pôle services sistants maternels organisent lement et permettent à chacun intercommunal. chaque mois des ateliers d’éveil. (familles, professionnels) de Maternels créer des liens. Elles peuvent également vous recevoir sur les lieux de ateliers 1 place Le Châtelier - BP 40256 - 60722 Pont-Sainte-Maxence Ils sont à destination des profes- d’éveil, de 9h00 à 11h00 (le planning est disponible sur le site de sionnels de l’accueil individuel Ferme pédagogique, visite de la la CCPOH). Tél. : 03 44 29 48 80 - Mail : [email protected] du territoire, des enfants, des caserne des pompiers, matinée Service gratuit d’information des familles et des professionnels parents employeurs. sportive, rando-poussette, ces Horaires du Pôle services intercommunal : de l’accueil individuel sorties contribuent également au du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h00 à 18h00 Gratuits et sans inscription, ils développement social, éducatif Sacy-le-Petit ont lieu le matin, sur différentes et pédagogique des enfants. Sacy-le-Grand Saint-Martin- communes. Le planning est dis- Longueau ponible sur le site internet de la Bazicourt CCPOH. Monceaux Pont-Sainte- Les Ageux Maxence (Rive droite) Angicourt Cinqueux Ce sont des temps d’éveil et de Rhuis Brenouille socialisation complémentaires Rieux Pontpoint Beaurepaire aux activités proposées au do- Roberval Pont-Sainte- Maxence micile des professionnels.