La Salamandre Et Le Milieu Du Monde
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
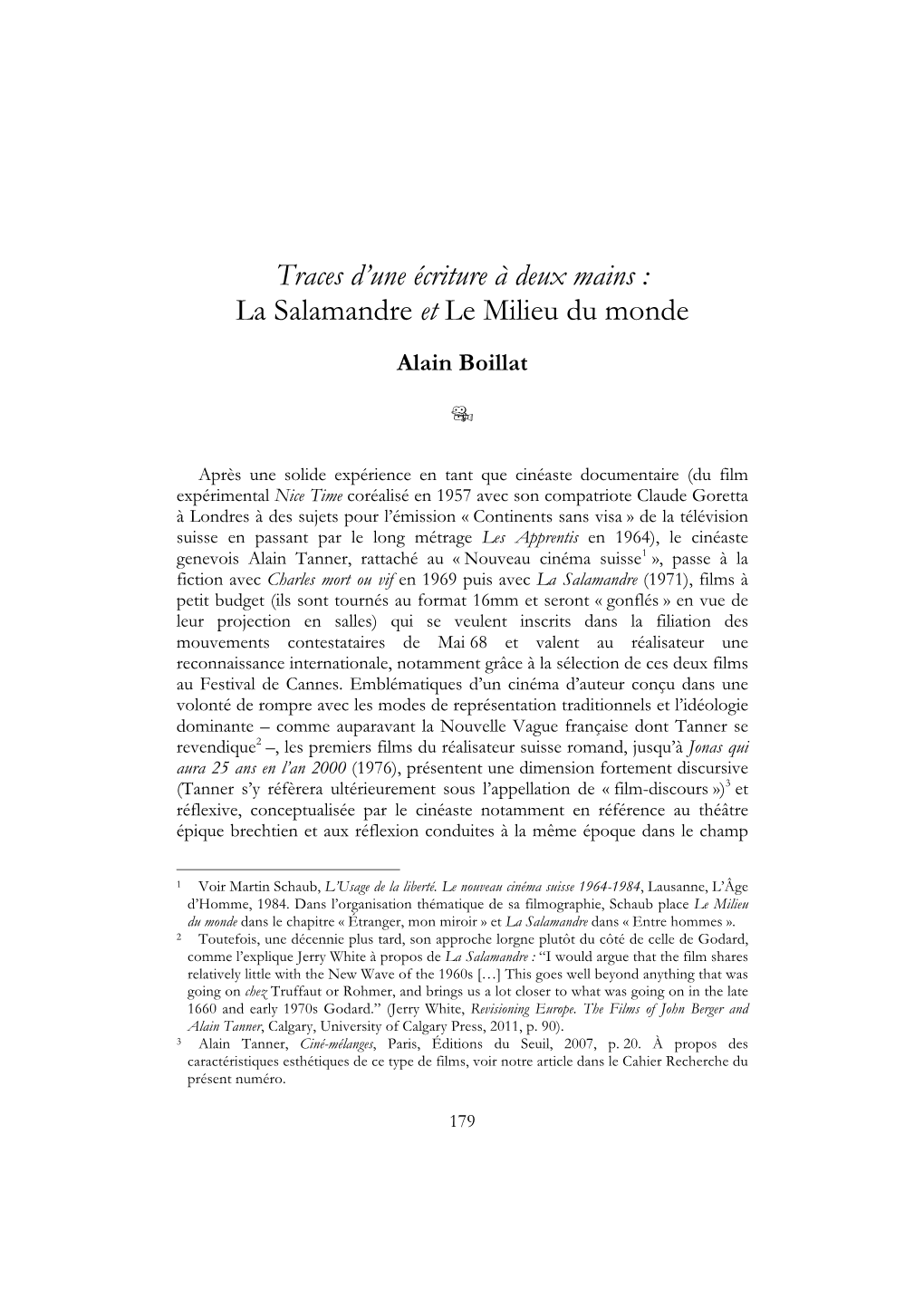
Load more
Recommended publications
-

Alain Tanner Филм ÑÐ ¿Ð¸ÑÑ ŠÐº (ФилмографиÑ)
Alain Tanner Филм ÑÐ ¿Ð¸ÑÑ ŠÐº (ФилмографиÑ) Light Years Away https://bg.listvote.com/lists/film/movies/light-years-away-1402542/actors The Woman from Rose Hill https://bg.listvote.com/lists/film/movies/the-woman-from-rose-hill-18542955/actors The Diary of Lady M https://bg.listvote.com/lists/film/movies/the-diary-of-lady-m-18604474/actors https://bg.listvote.com/lists/film/movies/la-vall%C3%A9e-fant%C3%B4me- La vallée fantôme 21647262/actors The Man Who Lost His Shadow https://bg.listvote.com/lists/film/movies/the-man-who-lost-his-shadow-24938017/actors A Flame in My Heart https://bg.listvote.com/lists/film/movies/a-flame-in-my-heart-27666257/actors The Salamander https://bg.listvote.com/lists/film/movies/the-salamander-3212693/actors The Middle of the World https://bg.listvote.com/lists/film/movies/the-middle-of-the-world-3224550/actors No Man's Land https://bg.listvote.com/lists/film/movies/no-man%27s-land-3342426/actors Nice Time https://bg.listvote.com/lists/film/movies/nice-time-3382446/actors Charles, Dead or Alive https://bg.listvote.com/lists/film/movies/charles%2C-dead-or-alive-384776/actors Fleurs de sang https://bg.listvote.com/lists/film/movies/fleurs-de-sang-48746792/actors Les hommes du port https://bg.listvote.com/lists/film/movies/les-hommes-du-port-50184103/actors Messidor https://bg.listvote.com/lists/film/movies/messidor-512192/actors Fourbi https://bg.listvote.com/lists/film/movies/fourbi-5475762/actors Requiem https://bg.listvote.com/lists/film/movies/requiem-56306217/actors The Apprentices https://bg.listvote.com/lists/film/movies/the-apprentices-64732218/actors Jonah Who Will Be 25 in the Year https://bg.listvote.com/lists/film/movies/jonah-who-will-be-25-in-the-year-2000- 2000 670633/actors In the White City https://bg.listvote.com/lists/film/movies/in-the-white-city-679684/actors Rousseau chez Alain Tanner https://bg.listvote.com/lists/film/movies/rousseau-chez-alain-tanner-90159411/actors. -

111714906.Pdf
1 4 Films by Alain Tanner Screening at the Wooden Shoe, 704 South St., Philadelphia. Zine published in collaboration with Shooting Wall. Friday November 2 7PM La Salamandre (The Salamander) 1971 124min. Starring Bulle Ogier, Jean-Luc Bideau, & Jacques Denis Saturday November 3 7 PM Le Milieu du monde (The Middle of the World ) 1974 115min. Starring Olimpia Carlisi, Philippe Léotard, & Juliet Berto Friday November 9 7 PM Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000 (Jonah Who Will Be 25 in the Year 2000) 1976 116min. Starring Jean-Luc Bideau, Myriam Boyer, Raymond Bussiéres, Jacques Denis, Roger Jendly, Dominique Labourier, Myriam Mé- ziéres, Miou-Miou, Rufus Saturday November 10 7PM Messidor 1979 123min. Starring Clémentine Amouroux & Catherine Rétouré Contents About Alain Tanner & Resources 3 A Long Introduction 4 Ben Webster Le Milieu du monde 16 Ross Wilbanks Investigating Reality: Character, Idealism, & 19 Political Ideology in Alain Tanner‟s La Salamandre Josh Martin Don‟t Fuck the Boss! 22 Ben Webster 2 About Alain Tanner (courtesy Wikipedia) Alain Tanner (born 6 December 1929, Geneva) is a Swiss film director. Tanner found work at the British Film Institute in 1955, subtitling, translating, and organizing the archive. His first film, Nice Time (1957), a short documen- tary film about Piccadilly Circus during weekend evenings, was made with Claude Goretta. Produced by the British Film Institute Experimental Film Fund, it was first shown as part of the third Free Cinema programme at the Na- tional Film Theatre in May 1957. The debut film won a prize at the film festival in Venice and much critical praise. -

The Regents of the University of California, Berkeley – UC Berkeley Art Museum & Pacific Film Archive (BAMPFA)
Recordings at Risk Sample Proposal (Fourth Call) Applicant: The Regents of the University of California, Berkeley – UC Berkeley Art Museum & Pacific Film Archive (BAMPFA) Project: Saving Film Exhibition History: Digitizing Recordings of Guest Speakers at the Pacific Film Archive, 1976 to 1986 Portions of this successful proposal have been provided for the benefit of future Recordings at Risk applicants. Members of CLIR’s independent review panel were particularly impressed by these aspects of the proposal: • The broad scholarly and public appeal of the included filmmakers; • Well-articulated statements of significance and impact; • Strong letters of support from scholars; and, • A plan to interpret rights in a way to maximize access. Please direct any questions to program staff at [email protected] Application: 0000000148 Recordings at Risk Summary ID: 0000000148 Last submitted: Jun 28 2018 05:14 PM (EDT) Application Form Completed - Jun 28 2018 Form for "Application Form" Section 1: Project Summary Applicant Institution (Legal Name) The Regents of the University of California, Berkeley Applicant Institution (Colloquial Name) UC Berkeley Art Museum & Pacific Film Archive (BAMPFA) Project Title (max. 50 words) Saving Film Exhibition History: Digitizing Recordings of Guest Speakers at the Pacific Film Archive, 1976 to 1986 Project Summary (max. 150 words) In conjunction with its world-renowned film exhibition program established in 1971, the UC Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive (BAMPFA) began regularly recording guest speakers in its film theater in 1976. The first ten years of these recordings (1976-86) document what has become a hallmark of BAMPFA’s programming: in-person presentations by acclaimed directors, including luminaries of global cinema, groundbreaking independent filmmakers, documentarians, avant-garde artists, and leaders in academic and popular film criticism. -

And the Ship Sails On
And The Ship Sails On by Serge Toubiana at the occasion of the end of his term as Director-General of the Cinémathèque française. Within just a few days, I shall come to the end of my term as Director-General of the Cinémathèque française. As of February 1st, 2016, Frédéric Bonnaud will take up the reins and assume full responsibility for this great institution. We shall have spent a great deal of time in each other's company over the past month, with a view to inducting Frédéric into the way the place works. He has been able to learn the range of our activities, meet the teams and discover all our on-going projects. This friendly transition from one director-general to the next is designed to allow Frédéric to function at full-steam from day one. The handover will have been, both in reality and in the perception, a peaceful moment in the life of the Cinémathèque, perhaps the first easy handover in its long and sometimes turbulent history. That's the way we want it - we being Costa-Gavras, chairman of our board, and the regulatory authority, represented by Fleur Pellerin, Minister of Culture and Communication, and Frédérique Bredin, Chairperson of the CNC, France's National Centre for Cinema and Animation. The peaceful nature of this handover offers further proof that the Cinémathèque has entered into a period of maturity and is now sufficiently grounded and self-confident to start out on the next chapter without trepidation. But let me step back in time. Since moving into the Frank Gehry building at 51 rue de Bercy, at the behest of the Ministry of Culture, the Cinémathèque française has undergone a profound transformation. -

Like Someone in Love
1 MK2 & Eurospace present A film by Abbas Kiarostami INTERNATIONAL PRESS INTERNATIONAL SALES Vanessa Jerrom & Claire Vorger MK2 11 rue du Marché Saint-Honoré - 75001 Paris (France) 55 rue Traversière - 75012 Paris (France) Email: [email protected] Juliette Schrameck - [email protected] Cell: +33 6 14 83 88 82 (Vanessa Jerrom) Dorothée Pfistner - [email protected] Cell: +33 6 20 10 40 56 (Claire Vorger) Victoire Thevenin - [email protected] In Cannes : Five Hotel 1 rue Notre-Dame - 06400 Cannes France Photos and presskit can be downloaded on www.mk2pro.com 2 3 synopsis An old man and a young woman meet in Tokyo. She knows nothing about him, he thinks he knows her. He welcomes her into his home, she offers him her body. But the web that is woven between them in the space of twenty-four hours bears no relation to the circumstances of their encounter. 4 5 new awakening Without doubt, there was an underlying sense of gnawing depravity that surfaced in Certified Copy and took me by surprise. I was sure that I already had a good understanding of the work of this film-maker that I have been lucky enough to come across so often in the past 25 years. So I was not expecting his latest film to outstrip the already high opinion I have of his work. Some people like to feel that they can describe and pigeonhole his films as ‘pseudo-simplistic modernism’. But Abbas’ films have never failed to surprise and now here, not for the first time, is a new wake-up call, for me, and I am sure many others. -

American Auteur Cinema: the Last – Or First – Great Picture Show 37 Thomas Elsaesser
For many lovers of film, American cinema of the late 1960s and early 1970s – dubbed the New Hollywood – has remained a Golden Age. AND KING HORWATH PICTURE SHOW ELSAESSER, AMERICAN GREAT THE LAST As the old studio system gave way to a new gen- FILMFILM FFILMILM eration of American auteurs, directors such as Monte Hellman, Peter Bogdanovich, Bob Rafel- CULTURE CULTURE son, Martin Scorsese, but also Robert Altman, IN TRANSITION IN TRANSITION James Toback, Terrence Malick and Barbara Loden helped create an independent cinema that gave America a different voice in the world and a dif- ferent vision to itself. The protests against the Vietnam War, the Civil Rights movement and feminism saw the emergence of an entirely dif- ferent political culture, reflected in movies that may not always have been successful with the mass public, but were soon recognized as audacious, creative and off-beat by the critics. Many of the films TheThe have subsequently become classics. The Last Great Picture Show brings together essays by scholars and writers who chart the changing evaluations of this American cinema of the 1970s, some- LaLastst Great Great times referred to as the decade of the lost generation, but now more and more also recognised as the first of several ‘New Hollywoods’, without which the cin- American ema of Francis Coppola, Steven Spiel- American berg, Robert Zemeckis, Tim Burton or Quentin Tarantino could not have come into being. PPictureicture NEWNEW HOLLYWOODHOLLYWOOD ISBN 90-5356-631-7 CINEMACINEMA ININ ShowShow EDITEDEDITED BY BY THETHE -

MEDIA STUDY/BUFFALO Januarywmay, 1984
MEDIA STUDY/BUFFALO JanuarywMay, 1984 Supported by the New York State Council on the Arts and the National Endowment for the Arts Schedule Staff BUSINESS MANAGER - Timothy J. McCann DATE TIME/PM PLACE Timothy McCann is a graduate of Niagara County Com- munity College and is continuing his education at the University of Buffalo School of Management. He is also JANVARY a member of the American Management Association. 27 (Friday) 8:30 MSIB YOSHIKO CHUMA - Independent Filmmakers FILM PROGRAMMER - Bruce Jenklns FEBRUARY Bruce Jenkins received a doctorate in Film from 2 (Thursday) 8:00 MS/B FESTIVAL PROGRAM 1 - Journey Across Three Continents Northwestern University where he served as an 3 (Friday) 8:00 MS/B FESTIVAL PROGRAM II -Journey Across Three Contents editor of Film Reader. He is project director of The 4 (Saturday) 8:00 HS PEARL BOWSER Presents Body and Soul - "Lost Films" American New Wave (1958-67) touring film series of the 1983 Robert Flaherty 8 (Wednesday) 8:00 MS/B BARBARA BUCKNER Video/Electronic Arts and was co-programmer 10 (Friday) 8:00 MSIB LIZZIE BORDEN - Independent Filmmakers Film Seminar. 11 (Saturday) 10:00 AM- VIDEO/ELECTRONIC ARTS CURATOR ~ AND MUSIC 5:00 PM THE ELECTRONIC NARRATIVE - A Daylong "Exploration" PROGRAMMER - John Minkowsky - VideolElectronic Arts - MS/B John Minkowsky did his graduate work at the Center for 11 (Saturday) 8:00 MS/B `BLUE' GENE TYRANNY - New Music Media Study at the State University of New York at Buf- 11 (Saturday) 8:00 HS UNKNOWN CHAPLIN - "Lost Films" falo and is currently editing a collection of essays, 15 (Wednesday) 8:00 MSIB SUSAN and ALAN RAYMOND - Video/Electronic Arts Design/Electronic Arts. -

Revisioning Europe: the Films of John Berger and Alain Tanner
University of Calgary PRISM: University of Calgary's Digital Repository University of Calgary Press University of Calgary Press Open Access Books 2011 Revisioning Europe: the films of John Berger and Alain Tanner White, Jerry University of Calgary Press White, Jerry. "Revisioning Europe: the films of John Berger and Alain Tanner". Series: Cinemas off centre series; 3, University of Calgary Press, Calgary, Alberta, 2011. http://hdl.handle.net/1880/48867 book http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Attribution Non-Commercial No Derivatives 3.0 Unported Downloaded from PRISM: https://prism.ucalgary.ca University of Calgary Press www.uofcpress.com REVISIONING EUROPE: THE FILMS OF JOHN BERGER AND ALAIN TANNER by Jerry White ISBN 978-1-55238-552-4 THIS BOOK IS AN OPEN ACCESS E-BOOK. It is an electronic version of a book that can be purchased in physical form through any bookseller or on-line retailer, or from our distributors. Please support this open access publication by requesting that your university purchase a print copy of this book, or by purchasing a copy yourself. If you have any questions, please contact us at [email protected] Cover Art: The artwork on the cover of this book is not open access and falls under traditional copyright provisions; it cannot be reproduced in any way without written permission of the artists and their agents. The cover can be displayed as a complete cover image for the purposes of publicizing this work, but the artwork cannot be extracted from the context of the cover of this specific work without breaching the artist’s copyright. -

The Films of John Berger and Alain Tanner
University of Calgary PRISM: University of Calgary's Digital Repository University of Calgary Press University of Calgary Press Open Access Books 2011 Revisioning Europe: the films of John Berger and Alain Tanner White, Jerry University of Calgary Press White, Jerry. "Revisioning Europe: the films of John Berger and Alain Tanner". Series: Cinemas off centre series; 3, University of Calgary Press, Calgary, Alberta, 2011. http://hdl.handle.net/1880/48867 book http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Attribution Non-Commercial No Derivatives 3.0 Unported Downloaded from PRISM: https://prism.ucalgary.ca University of Calgary Press www.uofcpress.com REVISIONING EUROPE: THE FILMS OF JOHN BERGER AND ALAIN TANNER by Jerry White ISBN 978-1-55238-552-4 THIS BOOK IS AN OPEN ACCESS E-BOOK. It is an electronic version of a book that can be purchased in physical form through any bookseller or on-line retailer, or from our distributors. Please support this open access publication by requesting that your university purchase a print copy of this book, or by purchasing a copy yourself. If you have any questions, please contact us at [email protected] Cover Art: The artwork on the cover of this book is not open access and falls under traditional copyright provisions; it cannot be reproduced in any way without written permission of the artists and their agents. The cover can be displayed as a complete cover image for the purposes of publicizing this work, but the artwork cannot be extracted from the context of the cover of this specific work without breaching the artist’s copyright. -

Identities in Motion: Asian American Film and Video
Identities in Motion: Asian American Film and Video By Peter X. Feng Durham and London: Duke University Press, 2003. ISBN 0-82232-983-2. 44 illustrations, 304 pp. £16.95 Kung Fu Cult Masters: From Bruce Lee to Crouching Dragon By Leon Hunt & The Remasculinization of Korean Cinema By Kyung Hyun Kim & In the Realm of the Senses By Joan Mellen Kung Fu Cult Masters: From Bruce Lee to Crouching Dragon By Leon Hunt London and New York: Wallflower Press, 2003. ISBN 1-90336-463-9. 12 illustrations, 224pp. £15.99 The Remasculinization of Korean Cinema By Kyung Hyun Kim Durham and London: Duke University Press, 2004. ISBN 0-82233-267-1. 66 illustrations, 368pp. £10.80 In the Realm of the Senses By Joan Mellen London: BFI, 2004. ISBN: 1 84457 034 7. 69 illustrations, 87pp. £8.99 A review by Brian Curtin, Chulalongkorn University, Thailand In 1995 the cultural critic and novelist Lawrence Chua wrote "The canon of Asian Pacific American filmmaking in this country is a library of victimization and self-deprecation". Writing of "dewy-eyed invocation of racial community", "the innocent construction of an essential Asian subject" and, with the example of Ang Lee's The Wedding Banquet (1993), the family and the nation as purportedly the only redemptive models of resistance being articulated, he provided a particularly savage indictment of how 'Asians' in the US represent and are represented ('The Postmodern Ethnic Brunch: Devouring Difference', Nayland Blake, Lawrence Rinder and Amy Scholder (eds.), In A Different Light: Visual Culture, Sexual Identity, Queer Practice, City Lights Books, 1995: 62). -

Ciné-Portrait Ursula Meier
Ciné-Portrait URSULA MEIER © Claude Dussex Ciné-Portraits – a monograph series published by the promotion agency SWISS FILMS. When using the texts or excerpts thereof, the source must be cited. Update: 2013 / Original version: French, 2006 www.swissfilms.ch BIOGRAPHY Born in Besançon (France) in 1971, part Swiss part French, from 1990 to 1994 Ursula Meier studied film-making at the Institut des Arts de Diffusion (IAD) in Belgium, graduating URSULA with “Great Distinction”. The MEIER success of Le songe d’Isaac, her end-of-course project, then of Des heures sans sommeil, enabled her to pursue an inde- pendent career, while at the same time working as assistant director on two films by Alain Pushing back the boundaries Tanner (Fourbi and Jonas et Lila, à demain). rsula Meier already has six widely-acclaimed films to her Ursula Meier's films, awarded in many international festivals, U name: three short and three full-length features, fiction alternate between genre-blurring works of fiction (Tous à table and documentary, each of which packs a powerful punch and or Des épaules solides, a tele- vision film shot in video for the shows an amazing determination to break new ground. With their Arte series Masculin Féminin) and as strange and different sharply defined style and intuitive camera work, Meier’s films documentaries as Autour de Pinget, Pas les flics, pas les are both sensuous and cerebral. Her work has a built-in tension, noirs, pas les blancs). In 2008, Ursula Meier presented between rigour and fantasy, intuition and control, mind and body. her first fiction film for the cin- ema, Home, at the Cannes Film © Claude Dussex What is so distinctive about her? Boldness, a kind of stubborn- Festival Critics' Week. -

Repositório Da Universidade De Lisboa
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa Instituto de Geografia e Ordenamento do Território Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril Lisboa: Cidade turística no cinema Abordagem de narrativas fílmicas com imagética de relevo da cidade de Lisboa Nadine Patrícia Correia Francisco Dissertação de Mestrado do Curso de Turismo e Comunicação. 2017 Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa Instituto de Geografia e Ordenamento do Território Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril Lisboa: Cidade turística no cinema Abordagem de narrativas fílmicas com imagética de relevo da cidade de Lisboa Nadine Patrícia Correia Francisco Tese orientada pela Professora Doutora Adelaide Meira Serras, especialmente elaborada para a obtenção do grau de mestre em Turismo e Comunicação. (Dissertação) 2017 Agradecimentos A presente dissertação de mestrado contou com o apoio e os preciosos contributos de pessoas que tornaram possível a sua realização e a quem gostaria de expressar a minha sincera gratidão. À Professora Doutora Adelaide Meira Serras, pela sua orientação, pela disponibilidade demonstrada, pelas ideias, conselhos, incentivos e pela paciência perante as minhas dúvidas e inquietações. A Professora, a quem devo muito do saber adquirido, agradeço ainda todas as palavras de encorajamento que tiveram um valor inestimável. Ao Professor Doutor José Duarte, pela atenção e gentileza com que me auxiliou. As discussões iniciais sobre o tema e os materiais fornecidos revelaram-se essenciais para a estruturação e consequente elaboração do trabalho. Aos meus pais, por todo o carinho, dedicação, respeito e pelo amor e apoio incondicionais a que me habituaram. Primaram sempre pela minha educação e proporcionaram-me a oportunidade de estudar.