La Vallée De Joux
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
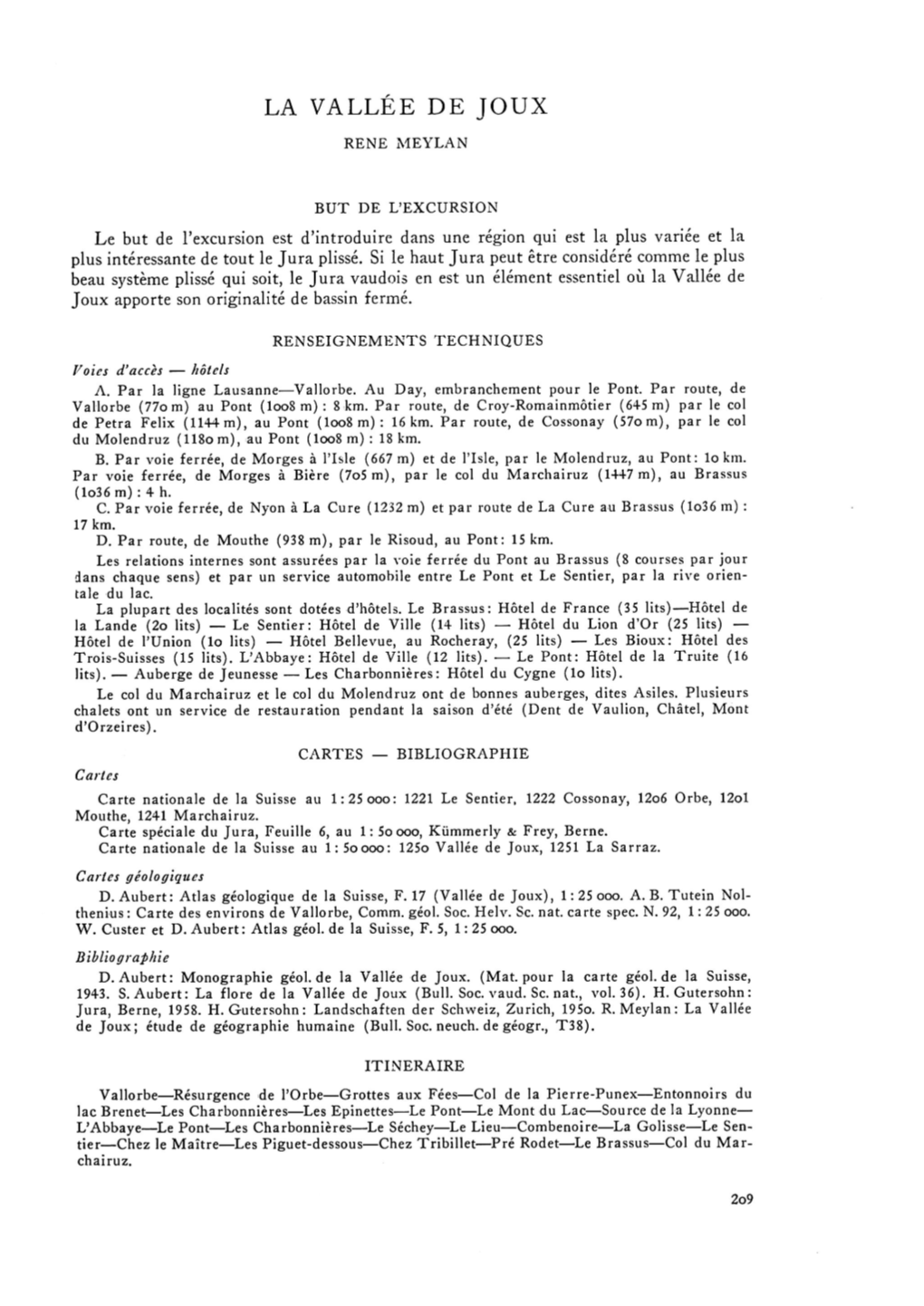
Load more
Recommended publications
-

Holiday Apartements and Guest Rooms VALLORBE-ORBE-ROMAINMÔTIER
List of accomodation "Yverdon-les-Bains Région" holiday apartements and guest rooms VALLORBE-ORBE-ROMAINMÔTIER Rapin Susanne Tel.: + 41 (0)24 441 62 20 Guest suite "La Belle Etoile" Mobile: + 41 (0)79 754 22 54 The opportunity to live like a lord in this castle dating from the XII century. The Rue du Château 7 e-mail [email protected] guest suite is spacious, luxurious and bright. Château de Montcherand www.lechateau.ch 1354 Montcherand Guest suite - 2 beds 5***** B&B max 4 pers From CHF 125.00 / pers / night Set within a prestigious 17th Century master house, this vast guest room, which Château de Mathod Tel.: +41 (0)79 873 88 60 has been entirely renovated and tastefully decorated, welcomes guests into a Route de Suscévaz 4 e-mail: [email protected] warm and relaxing atmosphere. The room has its own entrance and includes use 1438 Mathod www.chateaudemathod.ch of the garden “Jardin du Parterre” and access to the swimming pool. Guest suite - 2 beds 4****sup FST max 2 pers CHF 199.00 / 1 pers / night // CHF 229.00 / 2 pers / night Junod House is situated in the heart of the historical village of Romainmôtier, 50m Maison Junod Tel.: +41 (0)24 453 14 58 from the Abbey and the prior’s house. The authentic and warm interior decoration Rue du Bourg 19 e-mail: [email protected] is inspired by nature and the stone of the surrounding area. Each room has a 1323 Romainmôtier www.maisonjunod.ch/fr private bathroom. Breakfast is not included. -

Plan Directeur Forestier Des Vallons De L'orbe Et Du Nozon 3 Partie
Direction générale de l’environnement (DGE) Inspection cantonale des forêts Arrondissements 9 & 20 Plan directeur forestier des vallons de l’Orbe et du Nozon 3ème partie : Annexes Décembre 2015 PDF Vallons de l’Orbe et du Nozon – 3ème partie Direction Pascal Croisier, Inspecteur des forêts des 9ème et 20ème arrondissements Appui & Rédaction François Godi, ingénieur forestier EPFZ, GGConsulting Sàrl, Bercher PDF Vallons de l’Orbe et du Nozon – 3ème partie Table des matières Annexe A : Conditions cadres ................................................................................. 1 Annexe A.1 Le plan directeur cantonal .................................................................................. 1 Annexe A.2 La stratégie régionale d’aménagement du territoire ............................................ 3 Annexe A.3 La Politique forestière cantonale ........................................................................ 5 Annexe A.4 La Politique de conservation de la nature et du paysage .................................... 7 Annexe A.5 Le réseau écologique cantonal........................................................................... 9 Annexe A.6 Les inventaires fédéraux et cantonaux, les réserves naturelles .........................11 Annexe A.7 Le plan directeur des gravières .........................................................................17 Annexe A.8 Les dangers naturels .........................................................................................19 Annexe A.9 Parc naturel régional Jura Vaudois ...................................................................21 -

A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland
A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland Dr. Liliana Schönberger Contents Abstract .............................................................................................................................. 3 1 Introduction ............................................................................................................. 4 1.1 Light pollution ............................................................................................................. 4 1.1.1 The origins of artificial light ................................................................................ 4 1.1.2 Can light be “pollution”? ...................................................................................... 4 1.1.3 Impacts of light pollution on nature and human health .................................... 6 1.1.4 The efforts to minimize light pollution ............................................................... 7 1.2 Hypotheses .................................................................................................................. 8 2 Methods ................................................................................................................... 9 2.1 Literature review ......................................................................................................... 9 2.2 Spatial analyses ........................................................................................................ 10 3 Results ....................................................................................................................11 -

En Feuilletant Les Manuaux D'orbe : Quelques Glanes Médicales Et Autres
En feuilletant les manuaux d'Orbe : quelques glanes médicales et autres Autor(en): Rochaz, J. Objekttyp: Article Zeitschrift: Revue historique vaudoise Band (Jahr): 42 (1934) Heft 1 PDF erstellt am: 27.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-32639 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch En feuilletant les manuaux d'Orbe: Quelques glanes medicales et autres. Au cours de recherches que j'ai ete sollicitee de faire dans le but de retrouver les noms des medecins et chirurgiens qui pratiquerent ä Orbe vers la fin du XVIIme et au XVIlIme siecle, j'ai pu feuilleter les manuaux cle la \ il le d'Orbe et y glaner, outre les renseignements desires, une foule de faits interessants, grands ou petits, et souvent amusants. -

District Liste Des Lots Par District Et Par Commune
Liste des lots par district et par commune District Aigle Commune ID OFS Aigle 3 5401 10 Rhône 11 Grande Eau 15 Gryonne-Avançon Bex 24 5402 10 Rhône 11 Grande Eau 15 Gryonne-Avançon Chessel 76 5403 10 Rhône Corbeyrier 90 5404 7 Sarine 9 Vevey - Riviera 11 Grande Eau Gryon 171 5405 15 Gryonne-Avançon Lavey-Morcles 185 5406 10 Rhône 15 Gryonne-Avançon Leysin 195 5407 7 Sarine 9 Vevey - Riviera 11 Grande Eau Noville 241 5408 9 Vevey - Riviera 10 Rhône Ollon 245 5409 10 Rhône 11 Grande Eau 15 Gryonne-Avançon Ormont-Dessous 250 5410 7 Sarine 11 Grande Eau 15 Gryonne-Avançon Ormont-Dessus 251 5411 11 Grande Eau 11 Grande Eau 15 Gryonne-Avançon Rennaz 285 5412 9 Vevey - Riviera 10 Rhône Roche 289 5413 9 Vevey - Riviera 10 Rhône 11 Grande Eau Villeneuve 361 5414 7 Sarine 9 Vevey - Riviera Yvorne 376 5415 9 Vevey - Riviera 10 Rhône 11 Grande Eau Page 1 sur 11 Liste des lots par district et par commune District Broye–Vully Commune ID OFS Commune ID OFS Commune ID OFS Avenches 11 5451 Hermenches 173 5673 Vucherens 365 5692 6 Basse Broye 8 Haute Broye 8 Haute Broye Bellerive 18 5452 Lovatens 200 5674 Vulliens 371 5803 6 Basse Broye 8 Haute Broye 8 Haute Broye Brenles 39 5662 Lucens 201 5675 8 Haute Broye 8 Haute Broye Bussy-sur-Moudon 50 5663 Marnand 210 5820 8 Haute Broye 6 Basse Broye Carrouge 51 5782 6 Basse Broye 8 Haute Broye Missy 218 5821 Cerniaz 52 5811 6 Basse Broye 6 Basse Broye Montmagny 228 5459 6 Basse Broye 6 Basse Broye Chabrey 53 5453 Moudon 235 5678 6 Basse Broye 8 Haute Broye Champtauroz 56 5812 Mur 236 5460 6 Basse Broye 6 Basse -

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION Vom 25. März 1997 Zur Aufstellung
1997D0252 — DE — 09.03.2001 — 009.001 — 1 Dieses Dokument ist lediglich eine Dokumentationsquelle, für deren Richtigkeit die Organe der Gemeinschaften keine Gewähr übernehmen " B ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION vom 25. März 1997 zur Aufstellung der vorläufigen Listen der Drittlandsbetriebe, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr zum Verzehr bestimmter Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis zulassen (Text von Bedeutung für den EWR) (97/252/EG) (ABl. L 101 vom 18.4.1997, S. 46) Geändert durch: Amtsblatt Nr. Seite Datum "M1 Entscheidung 97/480/EG der Kommission vom 1. Juli 1997 L 207 1 1.8.1997 "M2 Entscheidung 97/598/EG der Kommission vom 25. Juli 1997 L 240 8 2.9.1997 "M3 Entscheidung 97/617/EG der Kommission vom 29. Juli 1997 L 250 15 13.9.1997 "M4 Entscheidung 97/666/EG der Kommission vom 17. September L 283 1 15.10.1997 1997 "M5 Entscheidung 98/71/EG der Kommission vom 7. Januar 1998 L 11 39 17.1.1998 "M6 Entscheidung 98/87/EG der Kommission vom 15. Januar 1998 L 17 28 22.1.1998 "M7 Entscheidung 98/88/EG der Kommission vom 15. Januar 1998 L 17 31 22.1.1998 "M8 Entscheidung 98/89/EG der Kommission vom 16. Januar 1998 L 17 33 22.1.1998 "M9 Entscheidung 98/394/EG der Kommission vom 29. Mai 1998 L 176 28 20.6.1998 "M10 Entscheidung 1999/52/EG der Kommission vom 8. Januar 1999 L 17 51 22.1.1999 "M11 Entscheidung 2001/177/EG der Kommission vom 15. Februar L 68 1 9.3.2001 2001 1997D0252 — DE — 09.03.2001 — 009.001 — 2 !B ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION vom 25. -

Quelques Études Sur Les Lacs De Joux
Quelques études sur les Lacs de Joux Autor(en): Forel, F.-A. Objekttyp: Article Zeitschrift: Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles Band (Jahr): 33 (1897) Heft 124 PDF erstellt am: 04.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-265054 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch BULL. SOG. VAUD. SC NAT. XXXIII, 124. 79 QUELQUES ÉTUDES SUR LES LACS DE JOUX PAR F.-A. FOREL 1° La limnimétrie. — 2° Les crues des lacs. — 3° L'entonnoir de Bon- Port. — 4° Dates de la congélation des lacs. — 5° Fentes et fendues de la glace des lacs. -

Carte Estivale
Randonnée / Wandern / Hiking Randonnée / Wandern / Hiking La Grande Têpe La Roche Champion Vélo / Radtour / Cycling VTT / Mountainbike / Mountainbiking Le Lieu - L’Allemagne - Grande Tèpe - Le Brassus - La Thomassette - Refuge de Vélo / Radtour / Cycling Le Sentier du Mas L’Allemagne - La Frasse - la Réserve - Refuge de la Merminette - Le Col du Mollendruz Dent de Vaulion Bike des Grandes Roches Les Charbonnières 11.9 km 03:10 330 m 356 m Roche Champion - Refuge du Gy Louis - Le Pont - Mont du Lac - Pétra Félix - Vallorbe - Premier - Romainmôtier - Vaulion - Refuge de la Barre - Pré Derrière - VTT / Mountainbike / Mountainbiking Boucle en 8 autour du Refuge Apollo 2.5 km 01:00 60 m 60 m Col du Mollendruz 5.1 km 175 m 6 m Pétra Félix - Sagne Vuagnard - Vallorbe 34 km 1300 m 1300 m Mézery - Grandes Roches - Le Brassus 21.8 km 05:30 503 m 503 m La Croix de Châtel Restaurant - Buvette d’alpage / Restaurant - Alprestaurant Le Chalottet Pétra Félix - Buvette des Croisettes - Le Col du Marchairuz Grand Risoud Bike Restaurant - Mountain restaurant Le Pont - Les Charbonnières - Buvette de Châtel - Croix de Châtel - Le Sentier - Le Brassus - Col du Marchairuz 10.5 km 472 m 36 m Le Sentier - Le Rocheray - Le Lieu - Haut des Prés - Buvette Le Chalottet 3.8 km 01:00 195 m 6 m Col du Mollendruz - Pétra Félix 11.7 km 03:15 437 m 437 m Le Tour du Lac de Joux Les Charbonnières - Les Esserts - Chalet d’alpage - Vente de fromage / Alphütte - Käseverkauf Le Sentier - Tête du Lac - Le Rocheray - Le Vallon du Nozon Refuge Kennedy - Poste des Mines - Mountain -

Swiss Travel System Map 2021
ai160326587010_STS-GB-Pass-S-21.pdf 1 21.10.20 09:37 Kruth Strasbourg | Paris Karlsruhe | Frankfurt | Dortmund | Hamburg | Berlin Stuttgart Ulm | München München Swiss Travel System 2021 Stockach Swiss Travel Pass Blumberg-Zollhaus Engen Swiss Travel Pass Youth | Swiss Travel Pass Flex Bargen Opfertshofen Überlingen Area of validity Seebrugg Beggingen Singen Ravensburg DEUTSCHLAND Radolfzell Schleitheim Hemmental Lines for unlimited travel (tunnel) Mulhouse Thayngen Mainau Geltungsbereich Meersburg Schaffhausen Ramsen Linien für unbegrenzte Fahrten (Tunnel) Zell (Wiesental) Wangen (Allgäu) Erzingen Oster- Neuhausen Stein a.R. Konstanz fingen Version/Stand/Etat/Stato:12.2020 (Baden) Rheinau Kreuzlingen Friedrichshafen Waldshut Due to lack of space not all lines are indicated. Subject to change. Marthalen Basel Weil a.R. Aus Platzgründen sind nicht alle Linien angegeben. Änderungen vorbehalten. Bad Zurzach Weinfelden Lines with reductions (50%, 1 25%) No reductions EuroAirport Riehen Koblenz Eglisau Frauenfeld Romanshorn Lindau Basel St.Johann Basel Möhlin Laufenburg Immenstadt Linien mit Vergünstigungen (50%, 1 25%) Keine Ermässigung Bad Bf Nieder- Stein-Säckingen Bülach Sulgen Arbon Basel Rheinfelden weningen Braunau Sonthofen Delle Pratteln Turgi Rorschach Bregenz Boncourt Ettingen Frick Brugg Zürich Bischofszell Rheineck Bonfol Liestal Baden Flughafen Winterthur Wil Rodersdorf Dornach Oberglatt Heiden St.Margrethen Aesch Gelterkinden Kloten Turbenthal St.Gallen Walzenhausen Roggenburg Wettingen Also valid for local public transport -

5/1/2021 Page 1 Powered by Territorial Extension Of
10/1/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links SVIZZERA / Vaud / Province of District du Jura-Nord vaudois / Le Chenit Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH SVIZZERA Municipalities Powered by Page 2 Agiez Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Ependes (VD) AdminstatArnex-sur-Orbe logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Fiez Ballaigues SVIZZERA Fontaines- Baulmes sur-Grandson Bavois Giez Belmont- Grandevent sur-Yverdon Grandson Bioley-Magnoux Juriens Bofflens L'Abbaye Bonvillars L'Abergement Bretonnières La Praz Bullet Chamblon Le Chenit Champagne Le Lieu Champvent Les Clées Chavannes- Lignerolle le-Chêne Mathod Chavornay Mauborget Chêne-Pâquier Molondin Cheseaux- Montagny- Noréaz près-Yverdon Concise Montcherand Corcelles- Mutrux près-Concise Novalles Cronay Onnens (VD) Croy Orbe Cuarny Orges Démoret Orzens Donneloye Pomy Premier Provence Rances Romainmôtier-Envy Rovray Sainte-Croix Sergey Powered by Page 3 Suchy L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Provinces Suscévaz Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Tévenon SVIZZERADISTRICT Treycovagnes D'AIGLE Ursins DISTRICT DE Valeyres- L'OUEST sous-Montagny LAUSANNOIS Valeyres- DISTRICT DE LA sous-Rances BROYE-VULLY Valeyres- DISTRICT DE LA sous-Ursins RIVIERA- PAYS-D'ENHAUT Vallorbe DISTRICT DE Vaulion LAUSANNE Villars-Epeney -
Vallorbe – Cité Du Fer
Vallorbe – Cité du Fer www.yverdonlesbainsregion.ch Sommaire Une région, des énergies 3 Idéalement placée au carrefour de plusieurs itinéraires culturels et proche des grandes agglomérations, la Région, qui englobe Les sites de la Région 5 Grandson, Orbe, Romainmôtier, Sainte-Croix / Les Rasses, Vallorbe, Yverdon-les-Bains et Yvonand, offre un terroir Accès 6 authentique où la diversité des activités invite le visiteur à la dé- tente et au ressourcement, en toute simplicité. Vallorbe, terre secrète 7 Ideal gelegen, an mehreren Kulturwegen und unweit grösserer Les plus grandes grottes de Suisse 8 Städte, bietet die Region, zu der Grandson, Orbe, Romainmô- Fort Pré-Giroud 1939 -1945 9 tier, Sainte-Croix / Les Rasses, Vallorbe, Yverdon-les-Bains Festival des couteliers 10 und Yvonand gehören, viel Authentizität und unterschiedlichste Musée du fer et du chemin de fer 11 Aktivitäten, die in aller Einfachheit zu Entspannung und Erholung einladen. Juraparc 12 L’Auberge pour Tous et camping en saison 13 Ideally placed at the crossroads of several heritage routes and close Des activités pour tous 14 to large conurbations the Region including Grandson, Orbe, La destination idéale pour les sorties en groupe 15 Romainmôtier, Sainte-Croix / Les Rasses, Vallorbe, Yverdon- Escapade en Terre Secrète 16 les-Bains and Yvonand, provides an authentic setting where a Vallée de Joux à 5 km de Vallorbe 17 diverse range of activities are on offer for visitors to unwind and Gorges de l’Orbe 18 rejuvenate. SuisseMobile 19 Balades 20 Manifestations 22 © Claude Jaccard / www.vaud-photos.ch Infos pratiques 24 Welcome Plan 30 Hôtels Yverdon-les-Bains et région 32 Infos pratiques 36 Hôtels et infos pratiques Vallée de Joux 46 Willkommen Numéros utiles – Sponsor 50 Sponsors 51 Contact 60 Bienvenue L’illustration des pages de couverture des brochures d’Yverdon-les-Bains Région, édition 2017-2019, est due à l’artiste bien connu, Denis Perret-Gentil. -

NATURALISATION QCM Officiel De La Commune De Vallorbe
NATURALISATION QCM officiel de la Commune de Vallorbe GEOGRAPHIE 1) Dans quel district se situe la commune ? ☐ District de la Broye-Vully ☐ District d'Orbe ☒ District du Jura-Nord Vaudois ☐ District d'Yverdon 2) Quelles sont les lignes de trains principales partant de la gare de Vallorbe ? ☒ Vallorbe-Paris / Vallorbe-Lausanne / Vallorbe-Le Brassus ☐ Vallorbe-Pontarlier / Vallorbe-Lausanne / Vallorbe-Yverdon ☐ Vallorbe-Orbe / Vallorbe-Lausanne / Vallorbe-Le Brassus ☐ Vallorbe-Lausanne / Vallorbe-Ballaigues / Vallorbe-Le Brassus 3) Quelle est la superficie de la commune ? ☐ 27,0957 kilomètres carrés ☐ 25,0957 kilomètres carrés ☐ 29,0957 kilomètres carrés ☒ 23,0957 kilomètres carrés 4) Quelles sont les communes vaudoises voisines ? ☐ L'Abergement, Lignerolle, Ballaigues, Bretonnières ☐ Jougne, Ballaigues, Premier, Le Lieu ☒ Ballaigues, Vaulion, Le Lieu, l'Abbaye, Premier, Les Clées ☐ L'Abbaye, Ballaigues, Romainmôtier-Envy, Bretonnières 5) Que sont les hameaux intégrés à la commune ? ☐ Le Creux, La Dernier ☒ Le Day, Le Creux, La Dernier ☐ Le Mont d'Orzeires, Le Day ☐ Le Creux, Le Day, Le Mont d'Orzeires 6) A quelle altitude se trouve le centre du village ? ☒ 750 m ☐ 1482 m ☐ 621 m ☐ 920 m 7) Quels sommets de montagnes entourent la commune ? ☐ La Dent-de-Vaulion et le Chasseron ☒ La Dent-de-Vaulion et le Mont d'Or ☐ Les Aiguilles de Baulmes et le Mont d'Or ☐ Le Chasseron et le Mont d'Or Commune de Vallorbe – Naturalisation – QCF officiel de la Commune de Vallorbe / FM-21.06.2018 1 / 5 8) A part l'Orbe, quelle rivière coule à Vallorbe ? ☐