Dossier De Presse
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
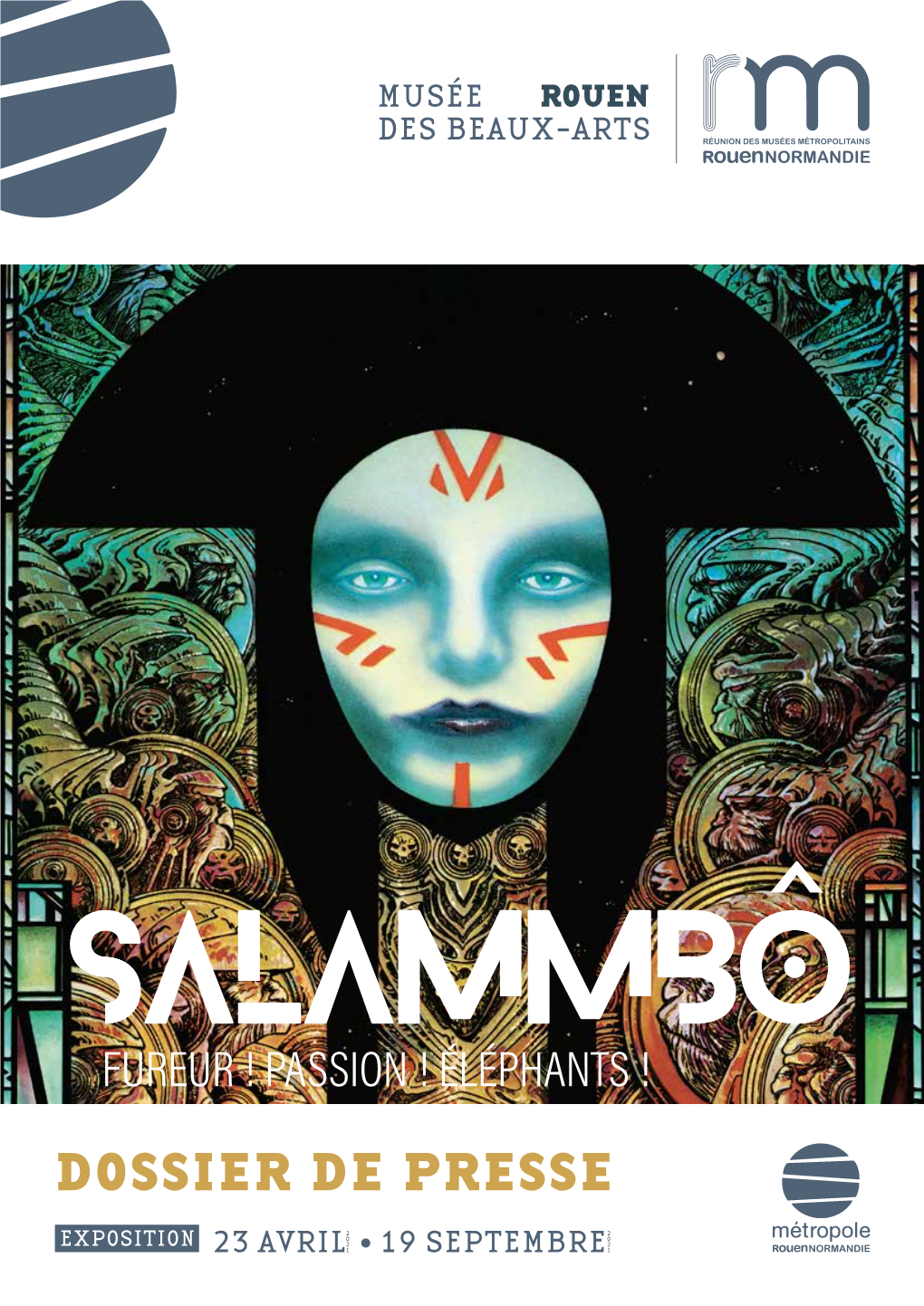
Load more
Recommended publications
-

Musical Times Publications Ltd
Musical Times Publications Ltd. Review Source: The Musical Times and Singing Class Circular, Vol. 27, No. 517 (Mar. 1, 1886), p. 166 Published by: Musical Times Publications Ltd. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3365196 Accessed: 18-10-2015 06:03 UTC Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/ info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Musical Times Publications Ltd. is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The Musical Times and Singing Class Circular. http://www.jstor.org This content downloaded from 134.121.47.100 on Sun, 18 Oct 2015 06:03:48 UTC All use subject to JSTOR Terms and Conditions I66 THE MUSICAL TIMES. MARCHI, I886. Notturnein B flcrt. For the Pianoforte. Composed by M. AmbroiseThomas, the composerof " Mignon" and G. J. Rubini. [E. Ascherberger and Co.] of "Hamlet," is engaged upon a new operatic work entitled " Miranda,"which is to be brought out at the WHATEVERpraise is due for writing a melodious and Paris Opera. The libretto is from the pen of M. Jules easily playable little Sketch for the pianoforte, has certainly Barbier,and the suject is borrowedfrom Shakespeare's been earned by the composer of this graceful Notturne. -

Allusions and Historical Models in Gaston Leroux's the Phantom of the Opera
Ouachita Baptist University Scholarly Commons @ Ouachita Honors Theses Carl Goodson Honors Program 2004 Allusions and Historical Models in Gaston Leroux's The Phantom of the Opera Joy A. Mills Ouachita Baptist University Follow this and additional works at: https://scholarlycommons.obu.edu/honors_theses Part of the French and Francophone Literature Commons, Other Theatre and Performance Studies Commons, and the Translation Studies Commons Recommended Citation Mills, Joy A., "Allusions and Historical Models in Gaston Leroux's The Phantom of the Opera" (2004). Honors Theses. 83. https://scholarlycommons.obu.edu/honors_theses/83 This Thesis is brought to you for free and open access by the Carl Goodson Honors Program at Scholarly Commons @ Ouachita. It has been accepted for inclusion in Honors Theses by an authorized administrator of Scholarly Commons @ Ouachita. For more information, please contact [email protected]. Gaston Leroux's 1911 novel, The Phantom of the Opera, has a considerable number of allusions, some of which are accessible to modern American audiences, like references to Romeo and Juilet. Many of the references, however, are very specific to the operatic world or to other somewhat obscure fields. Knowledge of these allusions would greatly enhance the experience of readers of the novel, and would also contribute to their ability to interpret it. Thus my thesis aims to be helpful to those who read The Phantom of the Opera by providing a set of notes, as it were, to explain the allusions, with an emphasis on the extended allusion of the Palais Garnier and the historical models for the heroine, Christine Daae. Notes on Translations At the time of this writing, three English translations are commercially available of The Phantom of the Opera. -

Ernest Guiraud: a Biography and Catalogue of Works
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1990 Ernest Guiraud: A Biography and Catalogue of Works. Daniel O. Weilbaecher Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses Recommended Citation Weilbaecher, Daniel O., "Ernest Guiraud: A Biography and Catalogue of Works." (1990). LSU Historical Dissertations and Theses. 4959. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/4959 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Historical Dissertations and Theses by an authorized administrator of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. INFORMATION TO USERS The most advanced technology has been used to photograph and reproduce this manuscript from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. -

New Production Fund at the Jewish Community Foundation
Media Release For immediate release: March 9, 2016 Contact: Edward Wilensky, Director of Media Relations [email protected] 619.232.7636 Cast Change Announcement Mezzo-soprano Kate Aldrich to sing the role of Arden Scott in the West Coast Premiere of Great Scott San Diego, CA – Mezzo-soprano Kate Aldrich will sing the role of Arden Scott in the West Coast premiere of Jake Heggie and Terrence McNally’s new opera, Great Scott, directed by Jack O’Brien. Kate Aldrich replaces mezzo-soprano Isabel Leonard who withdrew, after having decided to not add the role to her repertory at this point in time. Ms. Aldrich made her Company debut in 2008 as Elizabeth in Donizetti’s Maria Stuarda. Great Scott opens on Saturday, May 7, 2016 and tells the story of Arden Scott, a modern day woman and opera diva. Arden returns to her hometown for the first time since becoming an international opera star, to help save her home opera company run by her mentor. The struggle of a make-or-break opera premiere is juxtaposed with the thriving Grizzlies, the home football team appearing in the Super Bowl, both happening on the same evening. Arden Scott must face the demons she left behind and the ones she lives with daily. Does disaster await her or perhaps there is hope and success on the horizon? About Kate Aldrich Hailed by the San Francisco Sentinel as “the Carmen of this Generation” after her debut with the San Francisco Opera in 2006, American mezzo-soprano Kate Aldrich has also performed the title role of Bizet’s opera to much critical acclaim in theatres such as the Bavarian State Opera Munich, Deutsche Oper Berlin, Arena di Verona and many others. -

Parola Scenica: Towards Realism in Italian Opera Etdhendrik Johannes Paulus Du Plessis
Parola Scenica: Towards Realism in Italian Opera ETDHendrik Johannes Paulus du Plessis A thesis submitted to the Faculty of Arts, University of the Witwatersrand, Johannesburg, in fulfilment of the requirements for the degree of PhD by Thesis Abstract This thesis attempts to describe the emergence of a realistic writing style in nine- teenth-century Italian opera of which Giuseppe Verdi was the primary architect. Frequently reinforced by a realistic musico-linguistic device that Verdi would call parola scenica, the object of this realism is a musical syntax in which nei- ther the dramatic intent of the text nor the purely musical intent overwhelms the other. For Verdi the dramatically effective depiction of a ‘slice of a particular life’—a realist theatrical notion—is more important than the mere mimetic description of the words in musical terms—a romantic theatrical notion in line with opera seria. Besides studying the device of parola scenica in Verdi’s work, I also attempt to cast light on its impact on the output of his peers and successors. Likewise, this study investigates how the device, by definition texted, impacts on the orchestra as a means of realist narrative. My work is directed at explaining how these changes in mood of thought were instrumental in effecting the gradual replacement of the bel canto singing style typical of the opera seria of Rossini, Donizetti, and Bellini, by the school of thought of verismo, as exemplified by Verdi’s experiments. Besides the work of Verdi and the early nineteenth-cen- tury Italian operatic Romanticists, I touch also briefly on the œuvres of Puccini, ETDGiordano and the other veristi. -

Félicien David
Bulletin of the Transilvania University of Braşov – Special Issue Series VIII: Performing Arts • Vol. 11 (60) No. 2 – 2018 An Image of the Exotic in the Works of Ernest Reyer: from Le Sélam to Salammbô Noémi KARÁCSONY1 Abstract: The aim of this paper is to present the outstanding figure of the French composer Ernest Reyer. Despite the fact that his works did not receive proper attention, nonetheless his contribution to the evolution of 19th century French music is important. An ardent admirer of Hector Berlioz and Richard Wagner, the music of Reyer distinguishes itself due to the sincerity with which the composer strives to musically represent the true meaning behind words, ideas, emotions. Although unjustly criticized for imitating Félicien David’s “Le Désert” in his symphony “Le Sélam”, the oriental colouring of Reyer’s works was influenced by his prolonged sojourn in Algeria, where his spirit could immerse in the subtle and exotic atmosphere of the Orient. Composer and music critic, through his compositions as well as through his written works Reyer strived to elevate art and raise the quality of the musical compositions of his time, especially those belonging to the genre of opera. Even though he had to wait for his talent to be acknowledged, Reyer was forbearing and chose not to make any compromises with respect to his musical works, staying true to his high and noble ideals. The evolution of the composer from “Le Sélam” to his last opera “Salammbô” is presented, with the purpose of unveiling a vivid portait of Reyer. Keywords: Reyer, exotic, colour, oriental, truthfulness 1. -

Ernest Reyer : Biographie Critique
•in • co a> CM -CM -^ ;o iS !llfrtC ML 4-10 R388jg cop.2 V LES MUSICIENS CÉLÈBRES ERNEST REYER LES MUSICIENS CÉLÈBRES COLLECTION d'eN SE IG N EM EN T ET DE VULGARISATION Placée sous le Haut Patronage DE L'ADMINISTRATION DES BEAUX-ARTS Parus : Berlioz, par Arthur Coquard. Boieldieu, par Lucien Auge de Lassus. Chopin, par Elie Poirée. Félicien David, par René Brancour. Gluck, par Jean d'Udine. Gounod, par P.-L. Hillemaciier. Grétry, par Henri de Curzon. Hérold, par Arthur Pougin. Liszt, par M.-D. Calvocoressi. Mendelssohn, par P. de Stœcklin. Mozart, par Camille Bellaigue. Paganini, par J.-G. Prod'homxie. Rameau, par Lionel de la Laurencie. Rossini, par Lionel Dauriac. Schubert, par L.-A. Bourgault-Ducoudray. Schumann, par Camille Mauclair. Weber, par Georges Serviéres. En préparation : Wagner. — Auber. — Beethoven, eic. Par MM. Louis de Fourcaud; Char|£s>rAjLti£&Be; Vincent dTNDY ; etc. LES MUSICIENS CÉLÈBRES ERNEST REYER ADOLPHE JULLIEN BIOGRAPHIE CRITIQUE ILLUSTRÉE DE DOUZE REPRODUCTIONS HORS TEXTE rr PARIS LIBRAIRIE RENOUARD HENRI LAURENS, ÉDITEUR 6, RUE DE TOURNON (vi") Tous droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays. ML 4/0 ERNESÏ REYER I LA CARRIÈRE LA VIE ET ^ « Les Italiens et les Allemands aiment la musique, a dit Reyer; les Français ne la détestent pas. » Et quelle autre pens»''e aurait pu venir à l'esprit d'un compositeur qui avait dû tellement attendre avant de rallier les suffrages de ses compatriotes? En effet, la carrière active de Reyer peut se diviser en trois périodes bien distinctes : deux de travail et de production assez régu- lière; une autre, intermédiaire, de far-niente forcé, qui ne fut pas la moins longue et pendant laciuelle il voyagea beaucoup pour tromper son impatience, car, en ce temps-là, comme il l'écrivait si plaisamment, en ce temps-là plus que jamais, les musiciens avaient des loisirs, pour faire autre cliose que de la musique. -

The Critical Writings of Henri Blanchard on the Beethoven String Quartets
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Digital Repository at the University of Maryland ABSTRACT Title of Thesis: THE CRITICAL WRITINGS OF HENRI BLANCHARD ON THE BEETHOVEN STRING QUARTETS Vashti Diane Gray, Master of Arts, Music History and Literature, 2004 Thesis Directed By: Professor H. Robert Cohen, Musicology Henri -Louis Blanchard (1791-1858) was the most prolific critic for the Revue et Gazette Musicale de Paris , the most significant French music periodical of the nineteenth century. His writings covered a wide variety of subjects including opera, chamber music, piano virtuosi, music education, vocal music, as well as biographical notices on many musical figures. Viewed by his contemporaries as an important and influential critic, his extensive output in this journal indicates that his writings represent a great deal of what the Parisian public was reading about music at this time. This study examines Blanchard’s writings on the music of Ludwig van Beethoven. Blanchard wrote on Beethoven throughout his career, thus allowing us to observe the evolution of Blanchard’s ae sthetic. THE CRITICAL WRITINGS OF HENRI BLANCHARD ON THE BEETHOVEN STRING QUARTETS By Vashti Diane Gray Thesis or Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland, College Park, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts 2004 Advisory Committee: Professor H. Robert Cohen, Chair Professor Robert C. Provine Dr. Richard Kitson © Co pyright by Vashti Diane Gray 2004 Table of Contents Table of Contents ii Chapter 1: Henri Blanchard: An Introduction 1 Chapter 2: Blanchard on Beethoven’s Early and Middle Period 15 Chapter 3: Blanchard on Beethoven’s Late Period 21 Conclusion 26 ii Chapter 1: Henri Blanchard: An Introduction Henri -Louis Blanchard was born in April 1791 in Bordeaux. -

Brochure Opéra Et Odéon Saison 2021/2022 (.Pdf)
Après de longs mois de confinement et un quotidien profondément bouleversé, le rideau peut enfin se lever sur une nouvelle saison artistique ! Depuis plus d’un an, la municipalité s’est tenue aux côtés des artistes et des acteurs culturels, durement touchés par la crise. L’Opéra et le Théâtre de l’Odéon ont ainsi adapté leur activité à la crise sanitaire, permettant à de nombreux professionnels de travailler, aux artistes de continuer à répéter et à créer, aux publics d’accéder aux œuvres au travers de captations vidéo. Leur résistance et leur vitalité ont été exemplaires. La réouverture des lieux de culture, tant attendue par les publics comme par les artistes, est un moment de joie et de soulagement qui nous rassemble, Marseillaises et Marseillais, autour des établissements culturels chers à notre cœur. Retourner à l’Opéra et au Théâtre de l’Odéon, c’est pouvoir à nouveau se questionner, se divertir, s’émouvoir ensemble. Un grand bravo aux équipes de l’Opéra et de l’Odéon qui ont su réunir une très belle programmation, malgré l’incertitude et les contraintes. Nous souhaitons à toutes et tous une saison sereine, vivante, joyeuse, dans une situation sanitaire enfin maîtrisée. La culture est essentielle, elle nous fait vivre et grandir, comprendre le monde et rencontrer l’autre. Elle nous relie à notre passé commun et nous invite à penser ensemble notre avenir. Elle œuvre à la fabrique collective du présent. Que cette nouvelle saison soit plus que jamais l’occasion de le démontrer ! Benoît PAYAN, Maire de Marseille 1 Depuis le 28 octobre 2020, l’Opéra de Marseille et le Théâtre municipal de l’Odéon ont dû fermer à nouveau leurs portes au public, à l’instar de tous les autres lieux de spectacle et de culture. -

COMPOSITORES OLVIDADOS. ERNEST REYER AUTOR: Xavier Nicolás
WAGNERIANA CASTELLANA Nº 26 AÑO 1997 TEMA 8: OTROS COMPOSITORES – 8.2: WAGNERIANOS DEL RESTO DE EUROPA TÍTULO: COMPOSITORES OLVIDADOS. ERNEST REYER AUTOR: Xavier Nicolás El compositor que nos ocupa, Ernest Reyer, es un casi absoluto desconocido en el mundo de la música, pese a que a principios de siglo, y en los años 20 y 30 era muy representado, especialmente sus dos grandes joyas operísticas, “Sigurd” y “Salammbô”. Fuera de esto, y fuera de su país, Francia, hoy en día está absolutamente ignorado como otros compositores de la órbita romántica que hemos ido tratando en estas páginas. Su verdadero nombre era Louis Etienne Ernest Rey, hijo de Marsella, y nacido en 1823. Sus padres, cuando el joven quería decantarse por las labores musicales, lo enviaron a Argelia, con un tío suyo, para que se despistara de tamañas ocupaciones fútiles. Pero fue en vano, pues ya en la veintena, empezó a escribir rudimentarias piezas musicales, culminando con una misa que fuera cantada en la catedral de Alger en 1847. Finalmente, y después de una agobiada existencia en Argelia, y contra la voluntad de sus padres, embarca hacia París, donde entra de lleno en el mundillo musical y artístico, apadrinado por una tía suya, célebre pianista y compositora. Estudia con ella música a marchas forzadas, componiendo varias piezas musicales. El clímax llegaría con el estreno de su oda sinfónica “Sélam”, que tuvo cierto éxito de público y crítica. Corría el año 1850, y Reyer contaba con 27 años. Vendría seguidamente, una ópera cómica, de nombre muy sugestivo, “El Maestro Wolfram”, aunque de tema ligerito, en 1854; y luego, otra de tema oriental, como su anterior gran trabajo, “Sélam”, la obrita “Sacountalà” de tema hindú. -

Inventaire Provisoire Des Archives Du Pavillon Flaubert À Crois
Inventaire des Archives du Pavillon Flaubert (Croisset, Seine-Maritime) Catherine Hubbard Bibliothèque municipale de Rouen – 2008 Archives du Pavillon Flaubert Inventaire Dates extrêmes : 1708 – 1968 La collecte de ce fonds a été entreprise par Georges Auguste Le Roy (1863-1925), secrétaire du Comité des Amis de Flaubert, puis conservateur du Pavillon Flaubert. Fils du docteur Auguste M. Le Roy (1822-1905) - médecin et ami de Louis Bouilhet - G. A. Le Roy connut dès sa jeunesse la propriété de Croisset et investit sa carrière dans la transmission de la mémoire du grand écrivain. Un premier inventaire du fonds a été tenu de 1906 à 1973 de façon discontinue (voir cote Flaubert B4-1). Ces archives comportent tous types de supports et notamment de nombreuses reproductions photographiques réalisées en amateur par G. A. Le Roy lui-même dans les années 1920, à partir de documents appartenant au Musée Flaubert ou provenant de sources extérieures. Chronologie : 1904 : Constitution de l’association du « Comité pour le rachat du Pavillon Flaubert », à l’initiative de Paul Toutain (dit Jean Revel) et de proches de Flaubert (C. Lapierre, J.M. de Hérédia, C. Commanville…). 17/06/1906 : Inauguration du Pavillon-Musée Flaubert. 25/10/1907 : Donation du Pavillon à la Ville Rouen. 14/01/1914 : L’association, en charge de la gestion du Musée, est renommée « Comité des Amis de Flaubert ». Juin 1919 : Georges Auguste le Roy, secrétaire de l’association du « Comité des Amis de Flaubert », est nommé conservateur du Musée Flaubert par la Ville de Rouen. 1948 : L’association est rebaptisée « Les Amis de Flaubert » et dissociée de la gestion du Musée qui est reprise par la Direction des bibliothèques de Rouen. -

Louis-Etienne-Ernest Reyer (Eigtl. Rey) Zu Leben Und Werk
Louis-Etienne-Ernest Reyer (eigtl. Rey) (1. Dezember 1823 in Marseille – 15. Januar 1909 in Le Lavandou) Zu Leben und Werk: https://de.wikipedia.org/wiki/Ernest_Reyer Reyer war als Komponist Autodidakt. Umso erstaunlicher, dass er vor allem im Genre der Oper kom- ponierte. Die Skizze zur Oper „Sigurd“ hatte Reyer bereits 1867 angefertigt, die Komposition zog sich bis 1883 hin. Textliche Grundlage bildete das Nibelungenlied, die Edda und die Völsungasaga. Dass die Uraufführung des „Sigurd“ (1884) erst nach der Gesamtaufführung von Wagners „Ring“ in Bay- reuth (1876) stattfand, lag daran, dass Reyer keine Bühne fand, die sich des Projekts angenommen hatte. Sie wurde zunächst ein großer Erfolg und wurde noch bis ins 20. Jahrhundert aufgeführt. [GG; Oktober 2020] Sigurd, Oper in vier Akten; Libretto: Camille du Locle und Alfred Blau nach dem Nibelungenlied; UA: 7. Januar 1884, Brüssel, Théâtre de la Monnaie Zum Inhalt der Oper vgl. Heinz Wagner: Das große Handbuch der Oper. Zweite, stark vermehrte Auflage. Hamburg 1994. S. 594. „Personen: Sigurd – Tenor; Brunehilde – Sopran; Gunther, König der Burgunder – Bariton; Hilda, seine Schwester – Sopran; Ufa, ihre Vertraute – Alt; Hagen – Baß; Rudiger, Irnfried, Hawart und Ramung, Attilas Gesandte – Tenor, Baß; Odins Oberpriester-- Baß; Priester, Barden, Burgunder, Isländer, Krieger, Nomen, Geister und Irrlichter, Dienerschaft. Am Rhein und auf Island, Sagenzeit. 1. AKT: Das burgundische Volk feiert König Gunthers Sieg. Dessen Schwester Hilda erzählt ihrer Vertrauten von Sigurd, den sie liebt, weil er sie aus großer Gefahr gerettet hat. Seinetwegen hat sie bis jetzt jede Werbung des Hunnenkönigs Attila ausgeschlagen. Uta verspricht, ihr zu helfen und dem Helden einen Liebestrank zu bereiten.