Diagnostic Cayrac
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
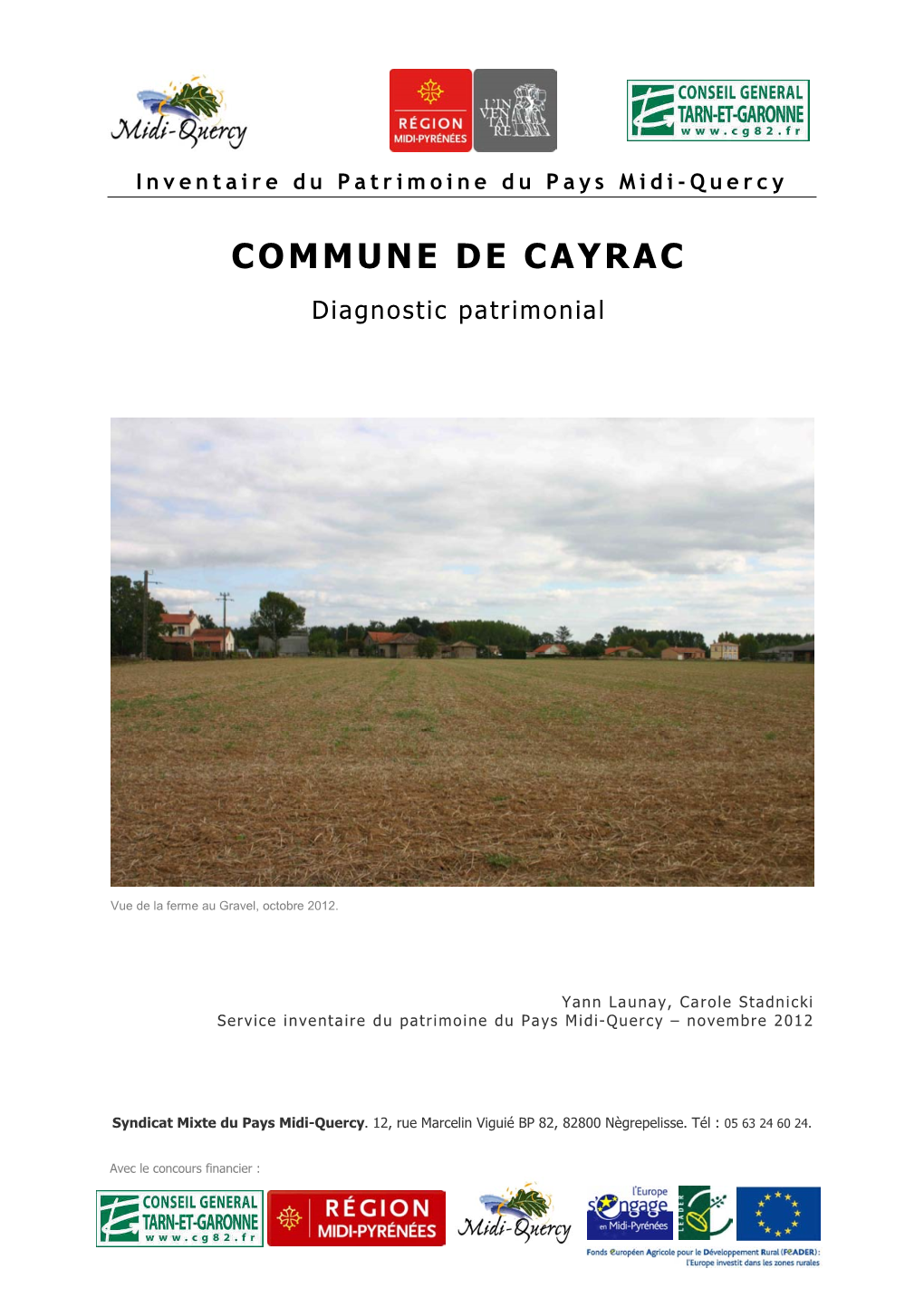
Load more
Recommended publications
-

Espace Numérique De Travail (ENT)
Implantation des services : Espace Numérique de Travail (ENT) VALEILLES SAINT BEAUZEIL MONTAIGU DE QUERCY BELVEZE SAINT ROQUECOR AMANS DU PECH SAINT PROJET BOULOC PUYLAGARDE SAINTE LACOUR JULIETTE LABASTIDE LOZE TOUFAILLES DE PENNE MOUILLAC LAUZERTE TREJOULS SAUVETERRE LACAPELLE CASTANET BOURG PARISOT FAUROUX LIVRON DE MONTAGUDET VISA PUYLAROQUE CAYLUS MIRAMONT MONTPEZAT DE QUERCY DE SAINT AMANS MONTFERMIER LAPENCHE SAINT BRASSAC QUERCY DE PELLAGAL CAZES GEORGES CAYRIECH GINALS SAINT MONTBARLAT MONDENARD MONTALZAT MONTJOI NAZAIRE DE LABARTHE LAVAURETTE VALENTANE DURFORT MOLIERES PERVILLE LACAPELETTE VAZERAC AUTY ESPINAS CASTELSAGRAT MONTESQUIEU VERFEIL SEPTFONDS MONTEILS SAINT VINCENT D’AUTEJAC LAGUEPIE GASQUES SAINT SAINT PUYCORNET SAINT ANTONIN NOBLE VAL CLAIR VAREN PAUL D’ESPIS MIRABEL CAUSSADE SAINT CIRQ LAMAGISTERE LA FRANCAISE St VINCENT FENEYROLS VALENCE LESPINASSE MOISSAC REALVILLE D’AGEN L’HONOR DE COS CAZALS GOUDOURVILLE DONZAC GOLFECH LIZAC MEAUZAC BOUDOU MONTASTRUC POMMEVIC LES CAYRAC BIOULE MONTRICOUX SAINT PIQUECOS LAMOTHE DUNES MALAUSE BARTHES CAPDEVILLE LOUP LABASTIDE VILLEMADE ESPALAIS SAINT DU BARRY ALBIAS MERLES SAINT NICOLAS TEMPLE D’ISLEMADE DE LA GRAVE CIRICE AUVILLAR SISTELS NEGREPELISSE Montauban CASTELSARRASIN ALBEFEUILLE SAINT MICHEL LA VILLE DIEU LAGARDE SAINT ETIENNE BRUNIQUEL LE PIN DU TEMPLE DE BARDIGUES TULMONT VAISSAC SAINT ASQUES CAUMONT MONTAUBAN MANSOVILLE AIGNAN PUYGAILLARD CASTELMAYRAN SAINT CASTERA MONTBETON DE CASTELFERRUS PORQUIER BOUZET QUERCY SAINT SAINT ANGEVILLE LEOJAC JEAN LACOURT GENEBRIERES -

Producteurs Produits Type De Vente Précisions Adresse Code Postal Ville Tél
Producteurs Produits Type de vente Précisions Adresse Code postal Ville Tél. Email Légumes et Fruits, Pain bio, canards, poulets et Mercredi, vendredi et samedi de 16H à M LARROQUE FRANCIS A la ferme 116 CHEMIN DES AIGUILLONS 82000 MONTAUBAN 0635116562 [email protected] fromages 19H GAEC DE LA PLAINE Légumes A la ferme Suivre le chemin du ramierou 205 CHEMIN DE BARTETE 82000 MONTAUBAN 0612445185 M MAURY Fruits et légumes A la ferme 232 CHEMIN DE DELPECH 82000 MONTAUBAN 0611201108 [email protected] la ferme du ramier Fromages DRIVE 2250 ROUTE DE ST ETIENNE DE TULMONT 82000 MONTAUBAN www.lafermeduramier.fr M RAHMOUNI Œufs, poulets vivants ou préparés A la ferme Le Perrier 4090, route d'Auch 82001 MONTAUBAN 06 43 92 33 32 Thomas VERNAZ Légumes Bio A la ferme 548 chemin de laprade 82290 LACOURT ST PIERRE [email protected] AJC BIO ŒUFS ŒUFS BIO A la ferme / Livraison 784 ROUTE DE BOURRET 82700 ESCATALENS 0648566487 [email protected] M ANDREIS ERIC Boucherie A la ferme LIEU DIT MOUNET 82120 LAVIT 0688472072 [email protected] M. MEYNADIER Légumes bio A la ferme 3475 ROUTE DE MONTAUBAN 82130 LAFRANCAISE 0670306803 Mme CALVET bernadette Légumes Livraison 2668 ROUTE DE MOISSAC 82130 LAFRANCAISE 0761051263 [email protected] Mme REY Jacqueline Canards A la ferme / Livraison 535 CHEMIN DE COULEAU 82130 L HONOR DE COS 0617141137 [email protected] M PICILI PASCAL Agneau, veau, cochon A la ferme Producteur Bio LABOURIASSE 82140 ST ANTONIN NOBLE VAL 0682903547 [email protected] Daniel et -

Attendez-Vous À L'inattendu
Attendez-vous à l’inattendu... Manuel des Ventes 2020-2021 tourisme-tarnetgaronne.fr BESOIN D’AIDE POUR L’ORGANISATION DE VOTRE SORTIE, DE VOTRE ÉVÉNEMENT OU DE VOTRE SÉMINAIRE ? Notre service Groupe départemental, membre du Réseau Tourisme & Territoires met à votre disposition sa connaissance du territoire, son expérience et son savoir-faire pour vous aménager un programme sur-mesure au plus près de vos envies et de votre budget. SOMMAIRE • p. 4 à 9 ....................................... Sites et monuments • p. 10-11 ....................... Activités de pleine nature VOTRE INTERLOCUTRICE Fabienne Sinnig • p. 12 .............................................. Produits du terroir Tél. +33 (0)5 63 21 79 47 [email protected] • p. 13-14 .......... Restaurants et fermes auberges Pour vos séjours individuels • p. 15 à 17 ............... Hôtels et hôtels restaurants contactez notre service de réservation Tél. +33 (0)5 63 21 79 61 • p. 18 .......................................... Villages de vacances [email protected] tourisme-tarnetgaronne.fr • p. 19 .................................. Hébergements insolites • p. 20 à 22 ....................... Séminaires - Réceptions Retrouvez toutes nos actualités : www.tourisme-tarnetgaronne.fr • p. 23 .................................. Événements sur mesure • p. 24 ..................................... Carte du département Légende Handicap Vos envies, notre expertise Animaux acceptés pour un séjour réussi ! Climatisation Chambre non fumeur RestaurantS Ascenseur Garage Parking Tarn-et-Garonne Tourisme Piscine 100, Bd Hubert Gouze - CS 90534 - 82005 Montauban Cedex Tél. : 05 63 21 79 65 Fax : 05 63 66 80 36 [email protected] www.tourisme-tarnetgaronne.fr Accès internetS Immatriculation Atout France IM0082100004 - N° Siret : 300 984 804 000 41 - Code APE : 7990Z Assurance R.C pro GAN contrat n°964750003 - Garantie A.P.S. - 15, Avenue Carnot - 75017 Paris S Wifi S S Séminaire Les renseignements et les tarifs de ce manuel sont donnés à titre indicatif et peuvent connaître des changements en cours d’année. -

Recensement De La Population
Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 82 TARN-ET-GARONNE INSEE - décembre 2019 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 82 - TARN-ET-GARONNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 82-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 82-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 82-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 82-3 INSEE - décembre 2019 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires -

Tarn-Et-Garonne
Nom ou raison sociale Adresse de l'association CP Ville Montant ADEAR 16 RUE JACQUES CARTIER 82000 MONTAUBAN 2 000 € ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT 180 AV CHARLES DE GAULLE 82000 MONTAUBAN 2 000 € PUBLIC SOLIDAIRES ASS MEILLEURE INSERTION SOLAIRE MAISON DES ASSOCIATIONS - 10 82000 MONTAUBAN 1 500 € SOCIA RUE JEAN CARMET ASSOCIATION DES HABITANTS DE MAISON DE QUARTIER - 330 RUE 82000 MONTAUBAN 1 500 € SAPIAC LEO LAGRANDE ASSOCIATION LE PARI 23 RUE DE LA COMEDIE 82000 MONTAUBAN 2 000 € BOUGER POUR S'EN SORTIR 8 RUE GUTENBERG 82000 MONTAUBAN 2 500 € COMIT DEPART JEUNESSE AU PLEIN 65 AVENUE MARCEAU HAMECHER 82000 MONTAUBAN 2 000 € AIR CTRE INFO DROITS FEMMES 505 AVENUE DES MOURETS 82000 MONTAUBAN 1 000 € FAMILLES CULTURES DU CŒUR DU TARN ET 5 RUE DU FORT 82000 MONTAUBAN 2 000 € GARONNE CULTURES ET TRADITIONS 82 450 RUE FRANCOIS MAURIAC 82000 MONTAUBAN 1 000 € LA BOITE A MALICE 23 GR SAPIAC 82000 MONTAUBAN 1 000 € LE PONT DES SAVOIRS 11 RUE CALMETTE ET GUERIN 82000 MONTAUBAN 6 000 € LES BLOUSES ROSES ANIMATION 100 RUE LEON CLADEL 82000 MONTAUBAN 1 500 € LOISIRS A L'HOPITAL LES RESTAURANTS DU CŒURS 450 RUE DE CONPENHAGUE 82000 MONTAUBAN 2 000 € LIGUE ENSEIGNEMENT TARN 709 BD ALSACE LORRAINE BP 108 82000 MONTAUBAN 10 000 € GARONNE MOUVEMENT FRANCAIS PLANNING 505 AVENUE DES MOURETS 82000 MONTAUBAN 2 000 € FAMILIAL MFPF PRESENCE DE MANUEL AZANA 12 RUE NOTRE DAME - HTL 82000 MONTAUBAN 1 500 € MERCURE PROFESSION SPORT ANIMATION 10 RUE JEAN CARMET 82000 MONTAUBAN 2 000 € EMPLOI 82 SECOURS POPULAIRE Français 7 RUE PAUL RIQUET 82000 MONTAUBAN 4 000 -

Bassin Adour-Garonne : 5 0 / 2 2
. 8 1 0 2 / VALEILLES Bassin Adour-Garonne : 5 0 / 2 2 CA DU LOT : ORGANISMES UNIQUES PRÉLÈVEMENT e t MONTAIGU-DE-QUERCY a SAINT-BEAUZEIL D BELVEZE ROQUECOR SAINT-AMANS-DU-PECH BOULOC CA LOT-ET-GARONNE SAINT-PROJET PUYLAGARDE SAINTE-JULIETTE LACOUR LOZE TOUFFAILLES TREJOULS LABASTIDE-DE-PENNE MOUILLAC BOURG-DE-VISA LAUZERTE SAUVETERRE LACAPELLE-LIVRON FAUROUX PARISOT CASTANET MONTAGUDET PUYLAROQUE NE MONTPEZAT-DE-QUERCY CAYLUS ON MIRAMONT-DE-QUERCY EL GU MONTJOI BRASSAC AR MONTFERMIER SAINT-AMANS-DE-PELLAGAL A B E L LAPENCHE MONTBARLA IÈR RIV CAZES-MONDENARD CAYRIECHSAINT-GEORGES NE GINALS SÉOU SAINT-NAZAIRE-DE-VALENTANE LABARTHE E LA MONTALZAT IVIÈR R LAVAURETTE MOLIERES PERVILLE AUTY DURFORT-LACAPELETTE VAZERAC CASTELSAGRAT MONTESQUIEU ESPINAS S VERFEIL OULA LEMB SEPTFONDS RE LE RIVIÈ MONTEILS SAINT-CLAIR SAINT-VINCENT GASQUES PUYCORNET CAUSSADE LAGUEPIE SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL VAREN SAINT-PAUL-D'ESPIS LAMAGISTERE MIRABEL LAFRANCAISE CA DU TARN-ET-GARONNE FENEYROLS MOISSAC SAINT-CIRQ SAINT-VINCENT-LESPINASSE REALVILLE GOUDOURVILLE GOLFECH HONOR-DE-COS (L') CAZALS DONZAC VALENCE LIZAC R BOUDOU IV IÈ POMMEVIC MONTASTRUCPIQUECOS R MALAUSE CAYRAC E BIOULE MEAUZAC L MONTRICOUX DUNES SAINT-LOUP 'A S BARTHES (LES) LAMOTHE-CAPDEVILLE V T E Y A R R ESPALAIS LABASTIDE-DU-TEMPLE O R VILLEMADE ALBIAS N A R ' MERLES I L BARRY-D'ISLEMADE V SAINT-CIRICE SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE I E È R AUVILLAR R SISTELS È E I NEGREPELISSE L V R I E R I V CASTELSARRASIN ALBEFEUILLE-LAGARDE T SAINT-MICHEL A I BRUNIQUEL È R VILLE-DIEU-DU-TEMPLE (LA) R PIN (LE) N SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT -

Destia Coordonnées
Dispositif Maia 82 17/02/2021 OFFRE DE SERVICES ET DE PRESTATIONS Publique □ Privée □ Associative □ Mutualiste □ Dénomination de l’entité Destia Coordonnées Adresse : 1803 chemin de Matras Code postal : 82000 Ville : Montauban Téléphone : 05 62 80 65 90 / 07 57 48 99 83 Courriel : [email protected] Fax : Site internet : Direction/ Présidence Nom : Prénom : Fonction : Téléphone : Courriel : Personne à contacter pour des renseignements complémentaires (autre que la direction) Nom : Sounes Prénom : Mélissa Fonction : Responsable d’agence Téléphone : 07 57 48 99 83 Courriel : [email protected] Prestations et services proposés Maintien à domicile des personnes fragiles NB: Interventions 7j/7 et 24h/24 Portage de repas* Téléassistance* et Fourniture de matériel médical* Garde d’enfants à domicile* Ménage à domicile * Service spécifique, selon la zone géographique Public/ bénéficiaires Jours et heures d’ouverture Du Lundi au Vendredi de 9h - 12h30 & 13h30 - 17h En dehors de ces horaires, le service d’astreinte est joignable 24h/24 et 7j/7 pour assurer la continuité de services. Cellule Support : tel 02 38 22 31 85 Secteur géographique d’intervention Albefeuille Lagarde, Albias, Auty, Bessens, Bressols, Bioule, Campsas, Cayrac, Caussade, Corbarieu, Genebrières, La Salvetat Belmontet, Labastide Saint-Pierre, Lacourt Saint-Pierre, Lafrançaise, Lamothe Capdeville, Les Barthes, Léojac, Mas-Grenier, Meauzac, Mirabel, Molières, Montauban, Montbeton, Montfermier, Montbartier, Montalzat, Monclar-de-Quercy, Montpezat-de-Quercy, Maia 82 – 18 rue du chanoine Belloc - 82000 Montauban ☎ 05.63.66.49.10 / [email protected] Dispositif Maia 82 17/02/2021 Montricoux, Nohic, Orgueil, Piquecos, Réalville, Reyniès, Saint-Etienne De-Tulmont, Saint Nauphary, Saint-Vincent, Vaïssac, Vazerac, Verlhac-Tescou, Verdun-Sur-Garonne, Villebrumier, Villemade. -

Commune De Réalville (PDF 951
ARRETE PORTANT DEVIATION DE LA CIRCULATION POUR LA MANIFESTATION DES 700 ANS SUR LA COMMUNE DE REALVILLE ___ A.D. n° 2010-1022 Le Président du Conseil Général de Tarn-et-Garonne, Le Maire de Réalville, Le Maire de Cayrac, VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, complétée et modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; VU le Code de la Route et notamment ses articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-8, R 411-18 et R 411-25 à R 411-28 ; VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6 ; VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ; VU la demande présentée par l'Association « L'Entracte », en date du 11 mars 2010 ; CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la Fête des 700 ans de Réalville qui aura lieu du vendredi 18 juin 2010 au dimanche 20 juin 2010, il est nécessaire de réglementer temporairement le stationnement et la circulation dans les rues du village ; CONSIDERANT que les véhicules à qui s'applique cette interdiction peuvent emprunter les itinéraires de déviation définis au présent arrêté, A R R E T E N T : Article 1er : Le stationnement et la circulation des véhicules de toutes catégories seront interdits du vendredi 18 juin 2010, à 8 h 00, au dimanche 20 juin 2010, à 12 h 00 sur : − les places des Arcades, de l'Eglise, de la Réunion, − les rues de la Réunion, Saint Martin, Jean Delzars, de France, des Soubirous, du Puits, des Sabotiers, de l'Ancien Temple, Gabriel Goulinat et de l'Eglise. -

COMMUNE DE CAUSSADE Diagnostic Patrimonial
Inventaire du Patrimoine du PETR du Pays Midi - Q u e r c y COMMUNE DE CAUSSADE Diagnostic patrimonial Vue d’ensemble du hameau des Coudercs en 2016. Sandrine Ruefly, Carole Stadnicki -Leroyer Service inventaire du patrimoine du PETR du Pays Midi -Quercy – mai 2016 Pôle d’Équilibre Territorial Rural du Pays Midi-Quercy. 12, rue Marcelin Viguié BP 82, 82800 Nègrepelisse. SOMMAIRE : Préambule ..................................................................................... 2 Le cadre historique des constructions ................................. 5 De la préhistoire à l’époque gallo-romaine ............................... 5 Le territoire au Moyen Âge .......................................................... 7 Le bourg de Caussade ....................................................... 10 Des Temps modernes à nos jours ........................................... 12 Un XVIIIe siècle florissant .................................................. 13 Les bouleversements des XIXe-début XXe siècles ....... 18 La seconde moitié du XXe siècle ..................................... 23 Le cadre naturel ........................................................................ 25 Le relief et l’hydrographie .......................................................... 25 Sous-sols, paysages et matériaux ........................................... 27 1 L’habitat rural ............................................................................. 31 Observations générales ............................................................. 31 L’apparition d’un -

Commune De Saint-Vincent D'autéjac
Inventaire du Patrimoine du Pays Midi-Quercy COMMUNE DE SAINT-VINCENT D’AUTÉJAC Diagnostic patrimonial Détail de l’entrée dans la partie habitation d’une ferme, La Mouline, février 2013. Carole Stadnicki Service inventaire du patrimoine du Pays Midi-Quercy – mai 2013 Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy. 12, rue Marcelin Viguié BP 82, 82800 Nègrepelisse. Tél : 05 63 24 60 24. Avec le concours financier : SOMMAIRE : Préambule..................................................................................... 3 Historique de la commune ....................................................... 5 La constitution du territoire de l’Antiquité au Moyen Âge ....... 5 Des Temps modernes à nos jours ............................................. 9 Le cadre naturel ........................................................................ 14 Hydrographie, relief et paysage................................................ 14 Sols et matériaux de construction ............................................ 15 L’évolution des techniques de construction............................ 21 L’habitat rural............................................................................. 22 Observations générales ............................................................. 22 L’implantation du bâti.................................................................. 24 Les logis indépendants .............................................................. 26 1 Les logis des maçons Moncuquet............................................ 31 Les dépendances agricoles...................................................... -

CDC Melon Du Quercy
Sommaire 1°) Le demandeur ...............................................................................................................................................................3 2°) Le nom du produit.........................................................................................................................................................3 3°) Le type de produit agricole ...........................................................................................................................................3 4°) La description du Produit Agricole...............................................................................................................................3 4.1. – Type variétal : .......................................................................................................................................................3 4.2 – Caractéristiques physiques :...................................................................................................................................3 4.3 – Caractéristique chimique : .....................................................................................................................................3 4.4 – Présentation à la vente : .........................................................................................................................................3 5°) La délimitation de l'aire géographique..........................................................................................................................4 6°) Les éléments -

CC Du Quercy Caussadais (Siren : 248200057)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC du Quercy Caussadais (Siren : 248200057) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Caussade Arrondissement Montauban Département Tarn-et-Garonne Interdépartemental non Date de création Date de création 30/12/1996 Date d'effet 30/12/1996 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Guy ROUZIES Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège Chemin de Guillalmet Numéro et libellé dans la voie Zone Industrielle de Meaux Distribution spéciale Code postal - Ville 82300 CAUSSADE Téléphone 05 63 93 28 66 Fax 05 63 93 29 54 Courriel Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité additionnelle sans fiscalité professionnelle de zone et sans fiscalité professionnelle sur les éoliennes Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) oui Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non 1/4 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Population Population totale regroupée 20 870 Densité moyenne 53,06 Périmètre Nombre total de communes membres : 19 Dept Commune (N° SIREN) Population 82 Auty (218200079) 143 82 Caussade (218200376) 7 055 82 Cayrac (218200392) 574 82 Cayriech (218200400) 288 82 Labastide-de-Penne (218200780) 129 82 Lapenche (218200921) 285 82 Lavaurette (218200954) 230 82 Mirabel (218201101) 1 055 82 Molières (218201135) 1 208 82 Montalzat (218201192) 674 82 Monteils