Encyclopédie Berbère, 6 | 1989 Arzew (Arzeu) 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Integration of Multi Criteria Analysis Methods to a Spatio Temporal Decision Support System for Epidemiological Monitoring
Integration of Multi Criteria Analysis ICAASE'2014 Methods to a Spatio Temporal Decision Support System for Epidemiological Monitoring Integration of Multi Criteria Analysis Methods to a Spatio Temporal Decision Support System for Epidemiological Monitoring Farah Amina Zemri Djamila Hamdadou LIO Laboratory LIO Laboratory BP 1524 EL M’ Naouer, Oran University, Algeria BP 1524 EL M’ Naouer, Oran University, Algeria [email protected] [email protected] Abstract – The present study aims to integrate Multi Criteria Analysis Methods (MCAM) to a decision support system based on SOLAP technology, modeled and implemented in other work. The current research evaluates on the one part the benefits of SOLAP in detection and location of epidemics outbreaks and discovers on another part the advantages of multi criteria analysis methods in the assessment of health risk threatening the populations in the presence of the risk (presence of infectious cases) and the vulnerability of the population (density, socio-economic level, Habitat Type, climate...) all that, in one coherent and transparent integrated decision-making platform. We seek to provide further explanation of the real factors responsible for the spread of epidemics and its emergence or reemergence. In the end, our study will lead to the automatic generation of a risk map which gives a classification of epidemics outbreaks to facilitate intervention in order of priority. Keywords – Multi criteria Analysis Decision Support (MCAM), Spatial Data Mining (SDM), Spatial on Line Analysis Processing (SOLAP), Data warehouse (DW), Epidemiological Surveillance (SE). devoted to the PROMETHEE method tool used for the development of multi criteria decision 1. INTRODUCTION support system suggested. A real case study which is a first validation step of our proposed Epidemic prevention is a public health concern. -

22 ORAN.Xlsx
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE TABLEAU DE L'ORDRE NATIONAL DES EXPERTS‐COMPTABLES Année 2018 Wilaya d'ORAN N° N° D'ORD NOM PRENOM ADRESSE TEL FAX Adresse E‐mail D'INSCRIPTION 1 305 AISSAOUI MYRIAM MERIEM 05 B N° 03 RUE EMIR ABDELKADER SALIMA BETHIOUA ORAN 2 0042 BELHACHEMI MED ABDERRAHIM 11, BD DE LA SOUMMAM ‐ ORAN 0 41 29 15 16 0 41 29 10 97 [email protected] 3 0034 BENCHOUK GHAOUTI 03, RUE LAMARTINE ‐ ORAN 0 41 39 34 31 0 41 39 34 31 [email protected] 4 0314 BENICHOU MOUFFOK 102 LOGTS N° 25 ES‐SENIA ORAN 041 74 51 29 041 74 51 29 [email protected] 5 0045 BENMANSOUR MOHAMED EL BACHIR 26, RUE LAMARTINE ‐ ORAN 0 41 39 81 54 0 41 39 85 00 [email protected] 6 0239 BENSAHLI OMAR CHUKRI 13 BD KHEDIM MUSTAPHA 31017 ‐ ORAN 0 41 39 65 74 0 41 39 29 38 [email protected] 7 0316 BOUIZEM SIDI MOHAMED HAI FELAOUCENE N° 04 ILOT "LE PARC" ORAN [email protected] 8 0050 BOULAHDOUR CHAKIB BT B15, GRANDE TERRE ‐ ORAN 0 41 41 24 72 0 41 40 71 04 [email protected] 9 0057 BOULAHDOUR YASSINE 06, RUE BELHOCINE EX BEDEAU ‐ ORAN 0 41 41 10 87 0 41 41 43 01 [email protected] 10 0051 BOULARAS DJILALI CITE 287 LGTS HOSN EL DJIWAR 0 41 53 97 77 0 41 53 97 77 [email protected] LOT C USTO ‐ ORAN 11 0170 BOUMEDINE ‐ ZELLAT ABDELKADER 17 BD BENBADIS BOUSFER ‐ ORAN 0 41 26 23 05 / [email protected] 12 0069 CHOULI BELAID 04 ,RUE GRADWOHL ‐ ORAN 0 41 40 34 11 0 41 40 34 11 [email protected] 13 0074 DJELLOULI YOUCEF 11, BOULEVARD DE LA SOUMMAM ‐ ORAN 041 29 15 19 041 -

Liste Des Pharmacies Privees
LISTE DES PHARMACIES PRIVEES NOM PRENOM NOM_JFILLE ADR_PROFESSIONNELLE NUM_TEL COMMUNE ABASSI AMINA ABASSI Lotissement El hayette Lot n° 17 Es Sénia ABDELILAH LEILA KHADIDJA ABDELILAH 72 Bd EMIR Khaled Hai Mahieddine Oran ABDELMALEK FEWZIA ZONE USTO Ct DES PYRAMIDE 150 Logts Bloc N°06 RDC Bir El Djir ABDELOUAHAD DJILALI 19 RUE M'KAIDECHE CHERIF KOUIDER Boutlélis ABDRRAHIMI FOUZIA 85 AV EMIR KHALED (041)-34-36-19 Oran ABID HANA EL MEZOUAD cOOP iMMOB 19 jUIN N) 15 lOCAL N) 05 Es Sénia ABIDA SOUMIA ABIDA Hai Bouamama N° 55 Ilot B RDC Oran ABIDELAH MOHAMED lOT N) 33 lOTISSEMENT 73 St Remy Sidi Chami ABLA DAOUD Route de Sidi Benyebka n° 91 Hassi Mefsoukh ACHACHI NABIL Rue Akid Lotfi n° 03 0661-17-60-85 Es Sénia ACHACHI DALILA Hai Akid Abbes Route Nationale 189 B Ain El Turck ADDA DJELLOUL MOHAMED Hai Essabah Ct 338 Logts Bt L 04 n° 02 Sidi Chami ADDI FAIZA ADDI 19 Hai Salem Ilot n° 02 Tafraoui ADNANE AMINE 87 RUE BOUDJEMAA ABDELLAH ECKMUL (041)-36-64-61 Oran AGRED HADJER SAMIHA AGRED Hai El Yasmine Résidence El Nour 18 Bt D1 Local n° 02 et 04 Bir El Djir AINANA NADIA AINANA 83 Chemin de Wilaya Ct 192 Logts Ilot C Bloc 17 n° 67 Es Sénia AINOUCHE MALIK Ct yaghmourassen Hai Ain El Beida Bt B/19 N° 02 Oran AISSANI ZOHRA LAABID 09 ROUTE CANASTEL HAI KHEMISTI Bir El Djir AIT ALLAOUA SALEM Hai Cheikh Bouamama Ilot H5 Lotissement 188 Lots Lot n° 35 Ilot G Oran AIT TAYEB MAHFOUD ISHAK MOUNIR 06 Rue Khiat Bensalem Local n° 02 Hai Chouhadas Oran AKOUN FATIMA ZOHRA TAHRI HAI MAHEDDINE RUE MON SENIEUR KANTAL ANGIF RUE LIEGE N°12 Oran ALABDULRAHMEN SOUMIA -

Gestion De La Ressource En Eau Du Système
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’HYDRAULIQUE -ARBAOUI Abdellah- DEPARTEMENT D’HYDRAULIQUE URBAINE MEMOIRE DE MASTER Pour l’obtention du diplôme de Master en Hydraulique Option: ALIMENTATION EN EAU POTABLE THEME : GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU DU SYSTEME HYDRAULIQUE MAO - MACTA Présenté Par : BOUGHAZI Safaa Devant les membres du jury Nom et Prénoms Grade Qualité Mr RASSOUL Abdelaziz M.C.A Président Mr KAHLERRAS Djillali M.C.B Examinateur Mme AMMOUR Fadhila M.A.A Examinateur Mme SALHI Chahrazed M.A.A Examinateur Mr SALAH Boualem Professeur Promoteur Session Juin – 2018 REMERCIEMENTS Nous remercions tout d’abord, Dieu de nous avoir donné la puissance, la volonté et le courage pour établir ce modeste travail de recherche. Un hommage appuyé revient notre famille : parents, frères et sœurs pour leur soutien moral et matériel. Ces quelques lignes ne vont jamais exprimer à la juste valeur notre reconnaissance à l’égard de notre encadreur Mr SALAH Boualem, pour sa disponibilité, son professionnalisme et surtout, pour son savoir faire, générosité et l’ensemble de ses cours qui nous ont fait arriver à ce stade de réflexion. Toute gratitude à nos professeurs et enseignants qui nous ont guidés au cours de notre formation pour leurs soutiens, encouragements, et surtout pour l’effort qu’ils ont fournis pour notre bien être intellectuelle. Nos respects aux membres de jury qui nous feront l'honneur d'apprécier ce travail. Nous tenons également, à remercier tous le personnel de la SEOR pour leurs conseils et orientation et spécialement Mr KERROUM Youcef , Mr ABED Ilyes qui nous ont énormément aidé à trouver les touches exactes grâce auxquels plusieurs anomalies ont étaient corrigées d’où notre vision et l’application de travail est devenu plus facile. -
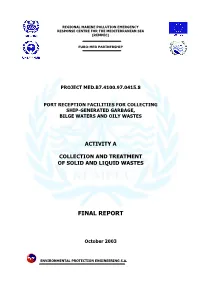
Activity a Final Report
REGIONAL MARINE POLLUTION EMERGENCY RESPONSE CENTRE FOR THE MEDITERRANEAN SEA (REMPEC) EURO-MED PARTNERSHIP PROJECT MED.B7.4100.97.0415.8 PORT RECEPTION FACILITIES FOR COLLECTING SHIP-GENERATED GARBAGE, BILGE WATERS AND OILY WASTES ACTIVITY A COLLECTION AND TREATMENT OF SOLID AND LIQUID WASTES FINAL REPORT October 2003 ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A. REGIONAL MARINE POLLUTION EMERGENCY RESPONSE CENTRE FOR THE MEDITERRANEAN SEA (REMPEC) EURO-MED PARTNERSHIP PROJECT MED.B7.4100.97.0415.8 PORT RECEPTION FACILITIES FOR COLLECTING SHIP-GENERATED GARBAGE, BILGE WATERS AND OILY WASTES ACTIVITY A COLLECTION AND TREATMENT OF SOLID AND LIQUID WASTES FINAL REPORT October 2003 ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A. The present document and related study have been produced with the financial assistance of the European Community. The views expressed herein are those of REMPEC and can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Community (EC). The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of EC, IMO, UNEP, MAP and REMPEC concerning the legal status of any State, Territory, city or area, or its authorities, or concerning the delimitation of their frontiers or boundaries. PROJECT MED.B7.4100.97.0415.8 PORT RECEPTION FACILITIES FOR COLLECTING SHIP-GENERATED GARBAGE, BILGE WATERS AND OILY WASTES ACTIVITY A COLLECTION AND TREATMENT OF SOLID AND LIQUID WASTES Within the framework of Euro-Mediterranean Partnership, the European Community (EC) and the International Maritime Organisation (IMO) on behalf of the Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea (REMPEC), have signed in December 2001 a Grant Agreement for the implementation of the operation entitled: Port reception facilities for collecting ship-generated garbage, bilge water and oily wastes (Project MED.B7.4100.97.0415.8). -
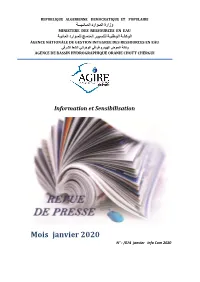
Mois Janvier 2020 N° : /074 Janvier Info Com 2020
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة المـوارد المـائـيـــة MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU الوكالـة الوطنيـة للتسييـر المدمـج للمـوارد المائيـة AGENCE NATIONALE DE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU وكالة الحوض الهيدروغرافي الوهراني الشط الشرقي AGENCE DE BASSIN HYDROGRAPHIQUE ORANIE CHOTT CHERGUI Information et Sensibilisation Mois janvier 2020 N° : /074 janvier info Com 2020 2 Revue de presse 02 janvier 2020 Page -05- 3 Revue de presse 03 janvier 2020 Page -05- 4 Revue de presse 03 janvier 2020 Page -07- 5 Revue de presse 05 janvier 2020 Page -07- 6 Revue de presse 05 janvier 2020 Page -08- 7 Revue de presse 06 janvier 2020 Page -07- 8 Revue de presse 07 janvier 2020 Page -07- 9 Revue de presse 07 janvier 2020 Page -07- 10 Revue de presse 07 janvier 2020 Page -08- 11 Revue de presse 07 janvier 2020 Page -05- 12 Revue de presse 11 janvier 2020 Page -07- 13 Revue de presse 18 janvier 2020 Page -04- 14 Revue de presse 18 janvier 2020 Page -09- 15 Revue de presse 19 janvier 2020 Page -09- 16 Revue de presse 21 janvier 2020 Page -07- 17 Revue de presse 21 janvier 2020 Page -09- 18 Revue de presse 22 janvier 2020 Page -10- 19 Revue de presse 16 janvier 2020 Page -06- 20 Revue de presse 19 janvier 2020 Page -09- 21 Revue de presse 23 janvier 2020 Page -08- 22 Revue de presse 24 janvier 2020 Page -09- 23 Revue de presse 24 janvier 2020 Page -08- 24 Revue de presse 29 janvier 2020 Page -10- 25 Revue de presse 29 janvier 2020 Page -11- 26 Revue de presse 30 janvier 2020 Page -11- 27 Revue de presse 01 janvier 2020 Page -07- -

Print This Article
Genetics and Biodiversity Journal Journal homepage: http://ojs.univ-tlemcen.dz/index.php/GABJ Original Research Paper Geometrical morphology characterization and taxa identification of land Snail populationsin Algeria Bouchiba I. Metahri R. Ameur Ameur A. Gaouar S. B. S. Laboratory Pathophysiology and Biochemistry of Nutrition (PpBioNut), Department of Biology, Faculty of Nature and Life Sciences, University of Tlemcen. 2Department of Agronomic, University of Tlemcen, Algeria Corresponding Author: Dr. AMEUR AMEUR. Abdelkader, Universityof Tlecmen. Email: [email protected]. Abstract In the context of the evaluation of animal genetic resources in general and the diversity of land snails in particular, we contributed to a morphometric and phenotypic study of this animal groupes 14 districts whose, they are recognized by their snail production. To achieve the objective measurements with geometrical approaches were collected from 751 individuals. Four parameters related to the body of each animal as the height of the shell (HC), the length of shells (LC),shell width (LGC) and the weight (P) and two phenotypic characters flesh color (CCH) and shell color (CC). The ANOVA test show a significant differences on body measurements between districts andspecies. In fact, the obtained results show that the Otala punctate is the most common species in Algeria; otherwise, there is significant phenotype variability betweenindividuals, which confirms that snails exhibit a large polymorphism. An Independence test was carried out on the phenotypic characteristics revealing that the regions influence the qualitative characteristics.This study it one of very few research undertaken in this field especially in Algeria. It is an important approach to be taken into consideration during conservation and improvement programs for this endangered species because of illegalpickup. -

The Mineral Industry of Algeria in 2011
2011 Minerals Yearbook ALGERIA U.S. Department of the Interior September 2013 U.S. Geological Survey THE MINERAL INDUSTRY OF ALGERIA By Mowafa Taib In 2011, Algeria ranked first and third in Africa in natural gas Ordinance No. 06–10 of July 29, 2006, which regulates production and crude oil output, respectively. Algeria ranked natural gas and petroleum operations, is a supplement to law fourth in the world in terms of the volume of natural gas exports No. 05–07 of April 28, 2005. The law grants Sonatrach S.p.A. and accounted for 2.4% and 1.9% of the world’s natural gas and 51% ownership of all hydrocarbon projects in the country. crude oil output, respectively. The country held 4.5 trillion cubic Environmental laws applicable to the mineral industry include meters of proved natural gas reserves, which was 2.2% of the law No. 03–10 of July 19, 2003, and associated decrees, and world’s total proven reserves, and 12.2 billion barrels of proven law No. 05–12 of September 4, 2005. Ordinance No. 07–02 of crude oil reserves, which was 0.7% of the world’s total reserves March 1, 2007, amends and supplements the Mining Law. The (BP p.l.c., 2012, p. 6, 8, 20, 22). Mining Law guarantees parity for all investors; allows separate In addition to hydrocarbons, Algeria produced barite, surface and underground mine tenure; ensures that disputes bentonite and other clays, cement, crushed stone, diatomite, can be appealed to international arbitrators; gives incentives dolomite, gold, gravel, gypsum, helium, iron ore, lime, marble, for importing equipment for mining operations; and provides nitrogen fertilizer, phosphate rock, pozzolan, quartz, salt, custom-tariff exemptions and rebates on mineral extraction sand, silver, and steel. -

RPP Ministère De L'intérieur, Des Collectivités Locales Et De L
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire Rapport sur les priorités et la planification Année 2021 Volume 2 Novembre / 2020 Table des matières Contenu Section 1. Message du ministre .......................................................................................1 1.1 Message du ministre ...................................................................................................1 1.2 Déclaration du Secrétaire Général ..............................................................................2 Section 2. Au sujet du portefeuille...................................................................................3 2.1 La mission ...................................................................................................................3 2.2 Le ministère ................................................................................................................3 2.3 Fiche Portefeuille ........................................................................................................5 2.4 Planification des activités pour l’année 2021 .............................................................8 Section 3. Planification détaillée du programme 01 ........................................................9 3.1 Présentation du programme ........................................................................................9 3.1.1 Programme 1 : Aménagement et développement du territoire .......................9 3.2 Fiches - -

Praticiens Paramédicaux
LISTE NOMINATIVE DES INFIRMIERS INSTALLES A TITRE PRIVE Noms et Prénoms Adresse Commune Tél MEFLAH MOHAMED COOP EL WIDAD TRANCHE N° 106 BIR EL DJIR BEZZEGHOUL HOUARI 24 RUE CHEIRAT ALI CHERIF Oran KADRI NORA COOP BD GALLIENI LES INVALIDES 25 RUE YAGOUB A.E.K Oran ISRI BENYEBKA RUE BAHI BACHIR BETHIOUA Oran EL ERIAK NASSIMA CITE AKID LOT N° 510 LOGTS EL WAFAA BLOC N° 08 Oran YAKOUBI TAHAR CITE ZHUN BT B1 USTO Oran BORSLA Leila Ct des Chalets n° 13 Es Sénia LISTE NOMINATIVE DES KINESITHERAPEUTES INSTALLES A TITRE PRIVE Noms et Prénoms Adresse Commune N° Tél ROSTANE NAWEL 01 Rue Province Angle Route Nationale Ain El Turck CHIKH BLED YASMINA ZONE 04 A Z8 (01 RUE DE PROVENCE) AIN EL TURCK YOUSSEF AISSA REDA 11 ILOT 42 ES-SENIA HAI EL AMIR RUE BOUDJELLAL AHMED BATIMENT 17 1er ETAGE BENBERNOUS LISA ORAN PORTE D1 DAMERDJI BADIS 03 RUE L’ARTILLERIE ORAN DIB FETHI 02 RUE DE L’ARTILLERIE ORAN DJELLIL SAMY 09 BD DE LA SOUMMAM ORAN MAZOUZI CHEIKH 03 RUE DU 08 MARS ST HUBERT ORAN 20 RUE HAMMAMOUCHE ABED (EX GENERAL NIVELLE) ZELMAT ABDELKRIM ORAN CHOUPOT NADJAR NABIL 05 AVENUE ST EUGENE ESCALONNE ORAN GUENDOUZ MELIANI Hai El Emir Rue Mahioou n° 03 Oran Hai El Badr 72 Bd Fares El Houari angle Rue Ahmed Bey MAZOUZI SOFIANE ORAN (Transfert) BOUZINA Med Amine 01 Rue CDT Tarek Hai Mahieddine Oran LOUATI Med Lotfi Coop hassni Benyahia n° 21 Ilot A Canastel Oran KHELADI MED AMINE 48 COOP HARKET MED CITE DJAMEL Sidi Chami LISTE NOMINATIVE DES OPTICIENS LUNETTIERS INSTALLES A TITRE PRIVE Noms et Prénoms Adresse Commune N° Tél MOHAMED BELARBI VILLAGE SONATRACH -

L'index Des Rues Et Des Places D'oran
INDEX DES RUES ET PLACES D’ORAN La réalisation de cet index des rues et places (qui fera l’objet d’une publication sous forme de « Guide d’Oran ») a été rendu nécessaire par l’absence de mises à jour des plans et guide précédents. La tâche se complique quand on sait que chaque rue ou place dispose d’une ancienne et d’une nouvelle appellation. Par ailleurs, beaucoup de rues ne disposent plus de plaques. Les jeunes guides se sont attelés à ce travail avec enthousiasme, ce qui leur a permis une meilleure connaissance de la ville. L’urgence de cet index s’est faite sentir aussi avec l’afflux régulier de touristes à Oran. Les guides de l’association ont travaillé sous la responsabilité de M. Hadj Hassene Habib, ancien chef de service à la mairie d’Oran, et mémoire vivante de notre ville. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé à ce travail : Superviseur Hadj Hassan Habib Coordinateur Kouider Metair Vérificateur technique Adel Taleb Abdesslam Abdelhak et Adel Taleb quartier de Gambetta Khadija.Belabdi et Leïla Boukhatemi Centre ville Merine Rihane et Kahina Metair Saint Eugène, Delmonte Sabrina Belhadj et Jamil Mesli Saint Pierre Chafik.kellala et Ilhem Mahrougrass Choupot, Maraval, Sananes Benaissa Yassine Hamri et Medioni Rachid Megharfi Plateaux, Chollet Djaber Mohamed Eckmühl Sarah Aboura et Mehdi Attou M’dina J’dida, Sant Antoine Kouider Metair Derb, Sidi el Houari, Planteurs et Cité Petit LES QUARTIERS D’ORAN Ancienne appellation Nouvelle appellation Ancienne appellation Nouvelle appellation Les Abattoirs Hai Noussair -

List of Refugee Deaths
List of 36 570 documented deaths of refugees and migrants due to the restrictive policies of "Fortress Europe" Documentation by UNITED as of 1 April 2019 Death by Policy - Time for Change! Campaign information: Facebook - UNITED Against Refugee Deaths, UnitedAgainstRefugeeDeaths.eu, [email protected], Twitter: @UNITED__Network #AgainstRefugeeDeaths UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees Amsterdam secretariat: Postbus 413, NL-1000 AK Amsterdam, Netherlands, tel +31-6-48808808, [email protected], www.unitedagainstracism.org The UNITED List of Deaths can be freely re-used, translated and re-distributed, provided UNITED is informed in advance and source (UnitedAgainstRefugeeDeaths.eu) is mentioned. Researchers can obtain this list with more data in xls format from UNITED. found name, gender, age region of origin cause of death source dead number 28/03/19 2 N.N. (men) unknown drowned, bodies recovered off coast of Chios (GR), 36 rescued HelCoastG/IOM 27/03/19 1 Ali (boy, 18) Afghanistan suicide in shelter for unaccompanied minor asylum seekers in Geneva (CH), bad housing conditions Vivre/RTS/Le Courrier/TribuneGeneve 26/03/19 1 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, found in advanced state of decomposition on beach near Tetouan, south of the Strait of Gibraltar (MA) El Pueblo de Ceuta/IOM 26/03/19 1 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, found dead on beach in Azla (MA), presumably while trying to reach Spain FaroCeuta 26/03/19 1 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, found floating in advanced state of decomposition in sea in Tarajal area of Ceuta (ES) FaroCeuta/Ceutaaldia/El Pueblo de Ceuta/IOM 26/03/19 4 N.N.