Dossier De Presse Candide 2012
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ciné-Parvis 65 Argeles-Gazost
CINÉ-PARVIS 65 ARGELES-GAZOST CINÉMA LE CASINO TEL. : 05 62 97 29 65 -*°*- PIRATES DES CARAÏBES, JUSQU'AU BOUT DU MONDE (2007 - 2H20 - USA - V.F.) SORTIE NATIONALE Film de Gore Verbinski avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley MERCREDI 23 MAI - 17H & 21H DIMANCHE 27 MAI - 17H & 21H ----------------------------------------------------------------------- LES CHANSONS D'AMOUR (2007 - 1H40 - France) Sélection Officielle Cannes 2007 SORTIE NATIONALE Film de Christophe Honoré avec Louis Garrel, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme JEUDI 24 MAI - 21H ----------------------------------------------------------------------- CINÉ-SÉNIORS ENSEMBLE, C'EST TOUT (2007 - 1H37 - France) Film de Claude Berri avec Audrey Tautou, Guillaume Canet, Laurent Stocker, Françoise Bertin VENDREDI 25 MAI - 14H30 ----------------------------------------------------------------------- GOODBYE BAFANA (2007 - 1H58 - Grande-Bretagne - V.O.) Sélection officielle - Festival de Berlin 2007 Un film de Bille August avec Dennis Haysbert, Joseph Fiennes, Diane Kruger VENDREDI 25 MAI - 21H ----------------------------------------------------------------------- 300 (2007 - 1H55 - USA - V.F. - Interdit aux moins de 12 ans) Film de Zack Snyder avec Gerard Butler, Lena Headey, Rodrigo Santoro, David Wenham MARDI 29 MAI - 21H ----------------------------------------------------------------------- CINÉ-PARVIS 65 ARRENS-MARSOUS « MAISON DU VAL D’AZUN » TEL. : 05 62 97 49 49 -*°*- SPIDER-MAN 3 (2007 - 2H36 - USA - V.F.) Film de Sam Raimi avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James -

Catalogue-2018 Web W Covers.Pdf
A LOOK TO THE FUTURE 22 years in Hollywood… The COLCOA French Film this year. The French NeWave 2.0 lineup on Saturday is Festival has become a reference for many and a composed of first films written and directed by women. landmark with a non-stop growing popularity year after The Focus on a Filmmaker day will be offered to writer, year. This longevity has several reasons: the continued director, actor Mélanie Laurent and one of our panels will support of its creator, the Franco-American Cultural address the role of women in the French film industry. Fund (a unique partnership between DGA, MPA, SACEM and WGA West); the faithfulness of our audience and The future is also about new talent highlighted at sponsors; the interest of professionals (American and the festival. A large number of filmmakers invited to French filmmakers, distributors, producers, agents, COLCOA this year are newcomers. The popular compe- journalists); our unique location – the Directors Guild of tition dedicated to short films is back with a record 23 America in Hollywood – and, of course, the involvement films selected, and first films represent a significant part of a dedicated team. of the cinema selection. As in 2017, you will also be able to discover the work of new talent through our Television, Now, because of the continuing digital (r)evolution in Digital Series and Virtual Reality selections. the film and television series industry, the life of a film or series depends on people who spread the word and The future is, ultimately, about a new generation of foreign create a buzz. -
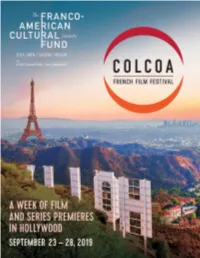
Here Was Obviously No Way to Imagine the Event Taking Place Anywhere Else
New theatre, new dates, new profile, new partners: WELCOME TO THE 23rd AND REVAMPED VERSION OF COLCOA! COLCOA’s first edition took place in April 1997, eight Finally, the high profile and exclusive 23rd program, years after the DGA theaters were inaugurated. For 22 including North American and U.S Premieres of films years we have had the privilege to premiere French from the recent Cannes and Venice Film Festivals, is films in the most prestigious theater complex in proof that COLCOA has become a major event for Hollywood. professionals in France and in Hollywood. When the Directors Guild of America (co-creator This year, our schedule has been improved in order to of COLCOA with the MPA, La Sacem and the WGA see more films during the day and have more choices West) decided to upgrade both sound and projection between different films offered in our three theatres. As systems in their main theater last year, the FACF board an example, evening screenings in the Renoir theater made the logical decision to postpone the event from will start earlier and give you the opportunity to attend April to September. The DGA building has become part screenings in other theatres after 10:00 p.m. of the festival’s DNA and there was obviously no way to imagine the event taking place anywhere else. All our popular series are back (Film Noir Series, French NeWave 2.0, After 10, World Cinema, documentaries Today, your patience is fully rewarded. First, you will and classics, Focus on a filmmaker and on a composer, rediscover your favorite festival in a very unique and TV series) as well as our educational program, exclusive way: You will be the very first audience to supported by ELMA and offered to 3,000 high school enjoy the most optimal theatrical viewing experience in students. -

Anne-Sophie Girard 13€ Au Lieu De 20€ …………………………………………………………………………………………….……
RENTREE 2016 (JANV - AVRIL) Demandez Alexandra DUGOT au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure Tarif partenaire 13€ AU LIEU DE 20€ ORNELLA…………………………………………………………………………………………….…….. FLEURY LES DIMANCHES et LUNDI à 19h Ornella fait partie de la nouvelle génération de comédiens qui sait mélanger les genres entre théâtre, cinéma et web. Elle ne recule devant rien: parodies (Zahia et Melanie Laurent), cinéma (Supercondriaque et Camping 3) et stand up. Le stand-up, elle le pratique au Point Virgule dans sa pure tradition anglo- saxonne, c'est à dire sans aucun artifice. Pendant une heure, elle nous livre un humour sans filtre et incisif avec beaucoup de féminité. Ornella c'est la copine moderne qui s'aventure enfin à dire tout haut ce qu'on ose seulement se raconter après quelques verres... Oreilles sensibles s'abstenir. Vous pouvez aussi la retrouver actuellement au théâtre de la Madeleine dans la pièce "Tout A Refaire" avec Philippe Lellouche et Gérard Darmon. Métro Hôtel de Ville Demandez Alexandra DUGOT au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure Tarif partenaire 13€ AU LIEU DE 20€ …………………………………………………………………………………………….……..BEATRICE FACQUER EXCEPTIONNELLES le 1er, 8, 15, 22 et 29 mars à 20h Béatrice Facquer enfile de jolis gants mais n'en prendra pas ! Elle livre sans complexe des personnages complètement décomplexés : Un cambrioleur amoureux fou de son petit oiseau Une féministe plus macho qu'un macho Une mère plus cancérigène qu'une clope Une chanteuse du Dimanche égarée dans l'Humanitaire un "Papa ours" qui se laisse -

La Comédie Continue ! Grille Semaine 4 – Du 20 Au 26 Avril 2020 (Sous Réserve De Modifications)
La Comédie continue ! Grille semaine 4 – du 20 au 26 avril 2020 (sous réserve de modifications) DU LUNDI AU DIMANCHE des programmes originaux LUNDI 20 AVRIL crées pour La Comédie continue ! Speakerine du jour Élissa Alloula 16h00 Le 4h de Ragueneau – 5 minutes de poésie lue 18h30 École d’acteur Stéphane Varupenne par un comédien Entretien mené par Olivier Barrot Capté au Studio-Théâtre en novembre 2016 16h05 Durée 1h20 EN SEMAINE programmation scolaire 20h30 Vania d’après Oncle Vania d’Anton Tchekhov, Les comédiens repassent le bac français – un comédien traduction Tonia Galievsky et Bruno Sermonne – mise lit un passage d’un des textes programmés au bac et en scène Julie Deliquet en livre un commentaire d’acteur : « ce que les profs avec Florence Viala, Laurent Stocker, Hervé Pierre, ne disent jamais » Stéphane Varupenne, Noam Morgensztern, Anna Où suis-je, qu’ai-je fait, que dois-je faire encore ? Cervinka, Dominique Blanc Entretien avec un professionnel du théâtre Capté au Théâtre du Vieux-Colombier en novembre 2016 LE WEEK-END Durée 1h40 Et qu’en dit la servante ? masterclasse avec un comédien L’Académie réplique – lecture illustrée d’extraits de MARDI 21 AVRIL pièces par les académiciens de la Comédie-Française Speakerin du jour Clément Bresson 17h00 Les acteurs parlent aux enfants – un conte 18h30 Grenier des maîtres Yannis Kokkos pour enfant lu par un comédien Entretien mené par Carmelo Agnello Capté à la Coupole, Salle Richelieu en novembre 2019 18h00 Le foyer des comédiens Durée 1h20 • Mon alexandrin préféré • L’enfance de l’art -

NOTRE DAME DE PARIS De Victor Hugo
ADG Europe presente TNT Théâtre dans NOTRE DAME DE PARIS de Victor Hugo ADAPTION DE PAUL STEBBINGS MISE EN SCÈNE DE GASPARD LEGENDRE MUSIQUE DE JOHN KENNY CHORÉGRAPHIES D'ERIC TESSIER-LAVIGNE PRODUIT PAR GRANTLY MARSHALL ADG Europe présente TNT Theatre dans NOTRE-DAME DE PARIS de Victor Hugo Adaptation de Paul Stebbings Traduction et mise en scène de Gaspard Legendre En alternance Caroline Aïn Esmeralda, la Femme, une Nanou Harry Gargouille Aude Lepape Fleur de Lys, la Femme Aveugle, Morwenna Spagnol le Bourreau, la Prostituée, un Garde Royal, une Gargouille Aurélien Mallard Quasimodo, le Soldat, le Alix Kuentz Tortionnaire Laurent Paolini Frollo, le Juge, un Soldat, une Julien Prevost Gargouille Cyrille Thouvenin Phoebus, le Roi des Mendiants, Gaspard Legendre l'Official, une Gargouille 2 Mise en scène Gaspard Legendre Direction musicale Helen Beauchamp & John Kenny Création des costumes Morwenna Spagnol Création des masques Louise Legendre Décors Gaspard Legendre & Joerg Besser Chorégraphies Eric Tessier Lavigne Accessoires Monika Verity Production ADGE Grantly Marshall Assistants de production Christian Werner Martha Werner Stefani Hidajat Promotion Angelika Martin Direction artistique Paul Stebbings Musical Director, John Kenny Assistant Musical Director, Helen Beauchamp Score by John Kenny, performed and directed by the Scot Free Ensemble, directed by John Kenny: Emily White, sakbuts and baroque violin Belinda Sykes, voice, shawm, recorders, mea, frame drum Pascal Lefeuvre, vielle a roue Nafee Mohmmed, oud & voice John Kenny, sackbuts, Carnyx, recorders, percussion and synthesiser Peter Vilk, percussion Recorded by Jim Brook at All Saints Church, Stroud, Gloucestershire Edited and mastered by Jim Brook and John Kenny 3 Gaspard Legendre est comédien, metteur en scène et voix au théâtre, comme au cinéma, en France et à Londres. -

Dominique Blanc
CHEZ VOUS ! DOSSIER DE PRESSE MAI 2020 « Plus que jamais actuellement, nous mesurons l’importance de la culture comme bien essentiel à nos vies. Dans cette période compliquée pour tous, nous avons souhaité maintenir Culturissimo, et avec sa programmation de qualité, montrer qu’en France l’offre culturelle peut s’adresser à chacun et être partagée par tous. Avec les adhérents du réseau, nous sommes chaque année ravis de proposer ces spectacles gratuits souvent inédits et de permettre la rencontre d’un texte ou d’un répertoire, d’un comédien ou d’un chanteur, et du public de nos villes et de nos régions. Par cette édition en ligne, avec la complicité d’artistes talentueux qui nous sont fidèles, nous sommes heureux de pouvoir continuer à promouvoir ce lien. » Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique E.Leclerc 7e ÉDITION DU FESTIVAL DES ESPACES CULTURELS E.LECLERC 15 MAI – 12 JUIN 2020 CULTURISSIMO CHEZ VOUS ! SUR WWW.CULTURE.LECLERC, DES LECTURES ET DES CONCERTS PARTAGÉS PAR TOUS En cette période de crise sanitaire, les événements gratuits de la Philippe Ricci, Yann Collette et la chanteuse Olivia Ruiz pour une 7e édition du festival Culturissimo, initialement prévus dans 75 théâtres lecture de son premier roman La commode aux tiroirs de couleur. et lieux culturels des villes dans lesquelles les Espaces Culturels Dans des vidéos d’une dizaine de minutes, postées tous les deux jours E.Leclerc sont implantés, seront programmés « en ligne » sur le site sur www.culture.leclerc, les comédiens liront les premières pages des www.culture.leclerc. derniers textes de Sylvain Tesson, Leïla Slimani, Jean-Paul Dubois, Depuis 1995, dans les Espaces Culturels E.Leclerc, les adhérents du Sylvain Prudhomme (lauréat du prix Landerneau des lecteurs – Espaces mouvement E.Leclerc relaient l’engagement de l’enseigne pour la lecture, culturels E.Leclerc), Patrick Modiano, Pierre Lemaitre, Nina Bouraoui, la musique et la diffusion de la culture. -

No Vember/De Cember 20 18
NOV/DEC 2018 NOVEMBER/DECEMBER 2018 NOVEMBER/DECEMBER Christmas atCINEMASTERS: GFT BILLY WILDER PETERLOO | WIDOWS | NAE PASARAN SUSPIRIA | SHOPLIFTERS | OUTLAW KING FRENCH FILM FESTIVAL | AFRICA IN MOTION THE OLD MAN AND THE GUN | UTØYA | SQIFF GLASGOWFILM.ORG | 0141 332 6535 12 ROSE STREET, GLASGOW, G3 6RB CONTENTS 3 Days in Quiberon 23 Possum + Q&A 21 White Christmas 17 Access Film Club: Blindspotting 28 Science Fair 21 CINEMASTERS: BILLY WILDER Scottish Animation: Access Film Club: Home Alone 28 7 The Apartment 15 Stories Brought to Life Anna and the Apocalypse + short 23 Double Indemnity 15 Shoplifters 22 Archive Film, Propaganda and The Private Life of Sherlock Holmes - 5 15 Spanish Civil War Sorry to Bother You 23 35mm Bad Reputation 20 Super November + Q&A 7 Some Like It Hot 15 Becoming Animal + Q&A 6 Suspiria 22 Sunset Boulevard 15 Been So Long + Q&A 6 Three Identical Strangers 23 COMEDY GENIUS Blue Black Permanent 24 Utøya - July 22 20 9 to 5 25 Blueprint: Scottish Independent Shorts 8 Visible Cinema: It’s A Wonderful Life 28 Shaun of the Dead 25 Calibre + Q&A 5 Visible Cinema: RCS Curates: Widows 28 South Park Sing-a-long - 35mm 25 21 Disobedience 23 Widows DID YOU MISS 22 The Wild Pear Tree 23 Distant Voices, Still Lives Black 47 25 20 Wildlife 22 Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot BlacKkKlansman 25 6 A Woman Captured + Q&A 5 Evelyn + Discussion C’est la vie 25 20 The Workshop 22 An Evening with Beverley Luff Linn Cold War 25 @glasgowfilm 24 Worlds of Ursula K Le Guin 7 The Evil Dead ESTONIA NOW Fahrenheit 11/9 20 AFRICA -

Éditorial Le Titre D’Un Spectacle Est En Quelque Sorte Sa Porte D’Entrée, L’Exercice De L’Éditorial Est Celle D’Une Programmation
Éditorial Le titre d’un spectacle est en quelque sorte sa porte d’entrée, l’exercice de l’éditorial est celle d’une programmation. Comment alors vous inviter à rentrer, dans cette grande et belle saison que sera celle du Théâtre de Chartres ? En vous parlant de ses espaces uniques, ceux que vous connaissez bien comme notre salle à l’italienne (Grande salle) ou bien ceux que vous trouverez quelque peu transformés comme notre Foyer qui deviendra à partir de cette année notre « Petit Théâtre » ou notre bar qui s’animera d’une « programmation œnologique ». Mais surtout en vous parlant de notre façon dont nous avons décidé de « l’habiter ». Grâce au soutien sans faille de la Ville de Chartres et de la Région Centre-Val de Loire, nous vous permettrons d’accéder à des œuvres dans toute leur diversité thématique, esthétique et artistique avec 36 pièces de Théâtre (classique, contemporain, humour, théâtre visuel et ma- rionnettes), 7 de Danse (classique, contemporaine, hip-hop) et 7 concerts (musique classique, chanson française, jazz, humour musical), toutes représentatives de l’actualité de la création du spectacle vivant. Nous avons aussi pensé notre saison pour qu’elle soit la vôtre. Alors au-delà des spectacles, nous continuerons évidemment de vous accueillir sur une dizaine de temps de rencontres et de lectures gratuites, ou nouveauté de cette année, lors d’une résidence d’auteur en partenariat avec la librairie L’Esperluète et avec le soutien bienveillant et financier de CICLIC (j’en profite pour les remercier chaleureusement). Elle sera ponctuée d’ateliers d’écriture, de lectures et de rencontres, détaillées pages 131 à 133. -

4 Modern Shakespeare Festivals
UNIVERSIDAD DE MURCIA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO Festival Shakespeare: Celebrating the Plays on the Stage Festival Shakespeare: Celebrando las Obras en la Escena Dª Isabel Guerrero Llorente 2017 Page intentionally left blank. 2 Agradecimientos / Acknoledgements / Remerciments Estas páginas han sido escritas en lugares muy diversos: la sala becarios en la Universidad de Murcia, la British Library de Londres, el centro de investigación IRLC en Montpellier, los archivos de la National Library of Scotland, la Maison Jean Vilar de Aviñón, la biblioteca del Graduate Center de la City University of New York –justo al pie del Empire State–, mi habitación en Torre Pacheco en casa de mis padres, habitaciones que compartí con Luis en Madrid, Londres y Murcia, trenes con destinos varios, hoteles en Canadá, cafeterías en Harlem, algún retazo corregido en un avión y salas de espera. Ellas son la causa y el fruto de múltiples idas y venidas durante cuatro años, ayudándome a aunar las que son mis tres grandes pasiones: viajar, el estudio y el teatro.1 Si bien los lugares han sido esenciales para definir lo que aquí se recoge, aún más primordial han sido mis compañeros en este viaje, a los que hoy, por fin, toca darles las gracias. Mis primeras gracias son para mi directora de tesis, Clara Calvo. Gracias, Clara, por la confianza depositada en mí estos años. Gracias por propulsar tantos viajes intelectuales. Gracias también a Ángel-Luis Pujante y Vicente Cervera, quienes leyeron una versión preliminar de algunos capítulos y cuyos consejos han sido fundamentales para su mejora. Juanfra Cerdá fue uno de los primeros lectores de la propuesta primigenia y consejero excepcional en todo este proceso. -

Celebrating Forty Years of Films Worth Talking About
2 NOV 18 6 DEC 18 1 | 2 NOV 18 - 6 DEC 18 88 LOTHIAN ROAD | FILMHOUSEcinema.COM CELEBRATING FORTY YEARS OF FILMS WORTH TALKING ABOUT Move over, Braveheart! Last month saw the culmination of our 40th anniversary celebrations here at Filmhouse, and it has been hugely interesting time (for me at any rate!) comparing the us of now with the us of then. I’ve thoroughly enjoyed spending time talking to Filmhouse’s first Artistic Director, Jim Hickey, and finding out in more detail than I knew what myriad ways the business of running Filmhouse has stayed the same and the as many ways it has not (one of these days I’ll write it all down and you can find out how interesting it is for yourselves!). UK film distribution itself has changed immeasurably – the dawn of the multiplex in the latter half of the 1980s saw to that. Back in 1978, Filmhouse itself was part of a sort of movement that saw the birth of a number of similar venues around the UK whose aim was to show a kind of cinema (predominantly foreign language) that simply was not catered for within mainstream film exhibition. Despite 40 years having passed and much having changed, the notion of an audience-driven, ‘curated’ cinema like Filmhouse remains something of a film exhibition anomaly; and something Jim Hickey wrote 30+ years ago rings just as true today as it did then: “But best of all, the new cinemas are being run by those who care about audiences as well as the films that they have paid to watch.” Now, we’ve got a bit of a first for you in November, for we have metaphorically got into bed with Netflix to give one of their films a hugely deserved, exclusive, short run in a cinema – namely David Mackenzie’s splendidly entertaining Robert the Bruce epic, Outlaw King. -

Programme La Critique De L'école Des Femmes 10/11
La Critique de l’École des femmes Studio -Théâtre Les Nouveaux Cahiers de la Comédie-Française Cahier n°1Bernard-Marie KOLTÈS | Cahier n°2 BEAUMARCHAIS | Cahier n°3 Ödön von HORVÁTH | Cahier n°4 Alfred de MUSSET | Cahier n°5 Alfred JARRY | Cahier n°6 Dario FO | Cahier n°7 Georges FEYDEAU. Ces publications sont disponibles en librairie ou dans les boutiques de la Comédie-Française. Prix de vente 10 €. Les Éditions L’avant-scène théâtre présentent deux nouveaux volumes de la collection Anthologie de L’avant-scène théâtre Le théâtre français Le théâtre français du XVIIe siècle du XVIIIe siècle direction Christian Biet direction Pierre Frantz, Sophie Marchand Disponibles en librairie ! et toujours Le théâtre français du XIXe siècle L’essentiel du théâtre par siècle Les auteurs, les œuvres, les courants présentés et commentés par des spécialistes reconnus et les grands metteurs en scène d’aujourd’hui En première de couverture : Elsa Lepoivre, Serge Bagdassarian, Clotilde de Bayser, Georgia Scalliet, Christian Hecq . Ci-dessus : Loïc Corbery, Jérémy Lopez, Clotilde de Bayser. En quatrième de couverture : Georgia Scalliet, Serge Bagdassarian, Jérémy Lopez, Christian Hecq, Clotilde de Bayser, www.avant-scene-theatre.com Elsa Lepoivre, Loïc Corbery. © Brigitte Enguérand La Critique de l’École des femmes de Molière Nouvelle mise en scène Nouvelle mise en scène DU 27 JANVIER AU 6 MARS 2011 durée environ 1 heure Mise en scène de Clément Hervieu-Léger Scénographie Éric RUF I Lumières Bertrand COUDERC I Costumes Caroline DE VIVAISE I Réalisation sonore Jean-Luc RISTORD I Arrangements musicaux Pascal SANGLA d’après l’étude op.