Campus Veterinaire De Lyon
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gastrointestinal Helminthic Parasites of Habituated Wild Chimpanzees
Aus dem Institut für Parasitologie und Tropenveterinärmedizin des Fachbereichs Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin Gastrointestinal helminthic parasites of habituated wild chimpanzees (Pan troglodytes verus) in the Taï NP, Côte d’Ivoire − including characterization of cultured helminth developmental stages using genetic markers Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Veterinärmedizin an der Freien Universität Berlin vorgelegt von Sonja Metzger Tierärztin aus München Berlin 2014 Journal-Nr.: 3727 Gedruckt mit Genehmigung des Fachbereichs Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin Dekan: Univ.-Prof. Dr. Jürgen Zentek Erster Gutachter: Univ.-Prof. Dr. Georg von Samson-Himmelstjerna Zweiter Gutachter: Univ.-Prof. Dr. Heribert Hofer Dritter Gutachter: Univ.-Prof. Dr. Achim Gruber Deskriptoren (nach CAB-Thesaurus): chimpanzees, helminths, host parasite relationships, fecal examination, characterization, developmental stages, ribosomal RNA, mitochondrial DNA Tag der Promotion: 10.06.2015 Contents I INTRODUCTION ---------------------------------------------------- 1- 4 I.1 Background 1- 3 I.2 Study objectives 4 II LITERATURE OVERVIEW --------------------------------------- 5- 37 II.1 Taï National Park 5- 7 II.1.1 Location and climate 5- 6 II.1.2 Vegetation and fauna 6 II.1.3 Human pressure and impact on the park 7 II.2 Chimpanzees 7- 12 II.2.1 Status 7 II.2.2 Group sizes and composition 7- 9 II.2.3 Territories and ranging behavior 9 II.2.4 Diet and hunting behavior 9- 10 II.2.5 Contact with humans 10 II.2.6 -

ISSN: 2320-5407 Int. J. Adv. Res. 5(3), 972-999 REVIEW ARTICLE ……………………………………………………
ISSN: 2320-5407 Int. J. Adv. Res. 5(3), 972-999 Journal Homepage: - www.journalijar.com Article DOI: 10.21474/IJAR01/3597 DOI URL: http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/3597 REVIEW ARTICLE HAEMONCHUS CONTORTUS AND OVINE HOST: A RETROSPECTIVE REVIEW. *Saeed El-Ashram1,2, Ibrahim Al Nasr3,4, Rashid mehmood5,6, Min Hu7, Li He7, *Xun Suo1 1. National Animal Protozoa Laboratory, College of Veterinary Medicine, China Agricultural University, Beijing 100193, China. 2. Faculty of Science, Kafr El-Sheikh University, Kafr El-Sheikh, Egypt. 3. College of Science and Arts in Unaizah, Qassim University, Unaizah, Saudi Arabia. 4. College of Applied Health Sciences in Ar Rass, Qassim University, Ar Rass 51921, Saudi Arabia. 5. College of information science and technology, Beijing normal university, Beijing, china. 6. Department of Computer Science and Information Technology, University of Management Sciences and Information Technology, Kotli Azad Kashmir, 11100, Pakistan 7. State Key Laboratory of Agricultural Microbiology, Key Laboratory of Development of Veterinary Products, Ministry of Agriculture, College of Veterinary Medicine, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, Hubei,China. …………………………………………………………………………………………………….... Manuscript Info Abstract ……………………. ……………………………………………………………… Manuscript History Gastrointestinal (GI) parasitic infections are a world-wide problem for Received: 05 January 2017 both small- and large-scale farmers. Infection by GI parasites in Final Accepted: 09 February 2017 ruminants, including sheep and goat can result in harsh economic losses Published: March 2017 in a variety of ways: reproductive inefficiency, decreased work capacity, involuntary culling, diminished food intake, poor animal growth rates and lower weight gains, treatment and management costs, Key words:- Gastrointestinal (GI) parasitic infections; and mortality in heavily parasitized animals. -

Anthelmintic Resistance of Ostertagia Ostertagi and Cooperia Oncophora to Macrocyclic Lactones in Cattle from the Western United States
Veterinary Parasitology 170 (2010) 224–229 Contents lists available at ScienceDirect Veterinary Parasitology journal homepage: www.elsevier.com/locate/vetpar Anthelmintic resistance of Ostertagia ostertagi and Cooperia oncophora to macrocyclic lactones in cattle from the western United States M.D. Edmonds, E.G. Johnson, J.D. Edmonds ∗ Johnson Research LLC, 24007 Highway 20-26, Parma, ID, 83660, USA article info abstract Article history: In June 2008, 122 yearling heifers with a history of anthelmintic resistance were obtained Received 15 October 2009 from pastures in northern California and transported to a dry lot facility in southwest- Received in revised form 28 January 2010 ern Idaho, USA. Fifty heifers with the highest fecal egg counts were selected for study Accepted 24 February 2010 enrollment. Candidates were equally randomized to treatment with either injectable iver- mectin (Ivomec®, Merial, 0.2 mg kg−1 BW), injectable moxidectin (Cydectin®, Fort Dodge, Keywords: 0.2 mg kg−1 BW), oral fenbendazole (Safe-Guard®, Intervet, 5.0 mg kg−1 BW), oral oxfenda- Anthelmintic resistance zole (Synanthic®, Fort Dodge, 4.5 mg kg−1 BW), or saline. At 14 days post-treatment, Cattle Bovine nematodes were recovered from the abomasum, small intestine, and large intestine. Par- Nematodes asitism was confirmed in the control group when 10/10 animals were infected with Efficacy adult Ostertagia ostertagi and 9/10 animals with both developing and early L4 stages of Cooperia O. ostertagi. Similarly, 9/10 animals were parasitized with adult Cooperia spp. Fenbenda- Ostertagia zole and oxfendazole efficacy verses controls were >90% against adult Cooperia spp., while moxidectin caused an 88% parasite reduction post-treatment (P < 0.05). -
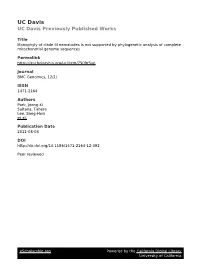
Monophyly of Clade III Nematodes Is Not Supported by Phylogenetic Analysis of Complete Mitochondrial Genome Sequences
UC Davis UC Davis Previously Published Works Title Monophyly of clade III nematodes is not supported by phylogenetic analysis of complete mitochondrial genome sequences Permalink https://escholarship.org/uc/item/7509r5vp Journal BMC Genomics, 12(1) ISSN 1471-2164 Authors Park, Joong-Ki Sultana, Tahera Lee, Sang-Hwa et al. Publication Date 2011-08-03 DOI http://dx.doi.org/10.1186/1471-2164-12-392 Peer reviewed eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California Park et al. BMC Genomics 2011, 12:392 http://www.biomedcentral.com/1471-2164/12/392 RESEARCHARTICLE Open Access Monophyly of clade III nematodes is not supported by phylogenetic analysis of complete mitochondrial genome sequences Joong-Ki Park1*, Tahera Sultana2, Sang-Hwa Lee3, Seokha Kang4, Hyong Kyu Kim5, Gi-Sik Min2, Keeseon S Eom6 and Steven A Nadler7 Abstract Background: The orders Ascaridida, Oxyurida, and Spirurida represent major components of zooparasitic nematode diversity, including many species of veterinary and medical importance. Phylum-wide nematode phylogenetic hypotheses have mainly been based on nuclear rDNA sequences, but more recently complete mitochondrial (mtDNA) gene sequences have provided another source of molecular information to evaluate relationships. Although there is much agreement between nuclear rDNA and mtDNA phylogenies, relationships among certain major clades are different. In this study we report that mtDNA sequences do not support the monophyly of Ascaridida, Oxyurida and Spirurida (clade III) in contrast to results for nuclear rDNA. Results from mtDNA genomes show promise as an additional independently evolving genome for developing phylogenetic hypotheses for nematodes, although substantially increased taxon sampling is needed for enhanced comparative value with nuclear rDNA. -

Nematodirus Spathiger of Small Ruminants Guang-Hui Zhao1*†, Yan-Qing Jia1†, Wen-Yu Cheng1, Wen Zhao1, Qing-Qing Bian1 and Guo-Hua Liu2*
Zhao et al. Parasites & Vectors 2014, 7:319 http://www.parasitesandvectors.com/content/7/1/319 RESEARCH Open Access Characterization of the complete mitochondrial genomes of Nematodirus oiratianus and Nematodirus spathiger of small ruminants Guang-Hui Zhao1*†, Yan-Qing Jia1†, Wen-Yu Cheng1, Wen Zhao1, Qing-Qing Bian1 and Guo-Hua Liu2* Abstract Background: Nematodirus spp. are among the most common nematodes of ruminants worldwide. N. oiratianus and N. spathiger are distributed worldwide as highly prevalent gastrointestinal nematodes, which cause emerging health problems and economic losses. Accurate identification of Nematodirus species is essential to develop effective control strategies for Nematodirus infection in ruminants. Mitochondrial DNA (mtDNA) could provide powerful genetic markers for identifying these closely related species and resolving phylogenetic relationships at different taxonomic levels. Methods: In the present study, the complete mitochondrial (mt) genomes of N. oiratianus and N. spathiger from small ruminants in China were obtained using Long-range PCR and sequencing. Results: The complete mt genomes of N. oiratianus and N. spathiger were 13,765 bp and 13,519 bp in length, respectively. Both mt genomes were circular and consisted of 36 genes, including 12 genes encoding proteins, 2 genes encoding rRNA, and 22 genes encoding tRNA. Phylogenetic analyses based on the concatenated amino acid sequence data of all 12 protein-coding genes by Bayesian inference (BI), Maximum likelihood (ML) and Maximum parsimony (MP) showed that the two Nematodirus species (Molineidae) were closely related to Dictyocaulidae. Conclusions: The availability of the complete mtDNA sequences of N. oiratianus and N. spathiger not only provides new mtDNA sources for a better understanding of nematode mt genomics and phylogeny, but also provides novel and useful genetic markers for studying diagnosis, population genetics and molecular epidemiology of Nematodirus spp. -

Molecular Characterization of Β-Tubulin Isotype-1 Gene of Bunostomum Trigonocephalum
Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2018) 7(7): 3351-3358 International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences ISSN: 2319-7706 Volume 7 Number 07 (2018) Journal homepage: http://www.ijcmas.com Original Research Article https://doi.org/10.20546/ijcmas.2018.707.390 Molecular Characterization of β-Tubulin Isotype-1 Gene of Bunostomum trigonocephalum Ravi Kumar Khare1, A. Dixit3, G. Das4, A. Kumar1, K. Rinesh3, D.S. Khare4, D. Bhinsara1, Mohar Singh2, B.C. Parthasarathi2, P. Dipali2, M. Shakya5, J. Jayraw5, D. Chandra2 and M. Sankar1* 1Division of Temperate Animal Husbandry, ICAR- IVRI, Mukteswar, India 2IVRI, Izatnagar, India 3College of Veterinary Science and A.H., Rewa, India 4College of Veterinary Sciences and A.H., Jabalpur, India 5College of Veterinary Sciences and A.H., Mhow, India *Corresponding author ABSTRACT The mechanism of benzimidazoles resistance is linked to single nucleotide polymorphisms (SNPs) on beta -tubulin isotype-1 gene. The three known SNPs responsible for BZ K e yw or ds resistance are F200Y, F167Y and E198A on the beta-tubulin isotype-1. The present study was aimed to characterize beta-tubulin isotype-1 gene of Bunostomum trigonocephalum, Benzimidazole for identifying variations on possible mutation sites. The adult parasites were collected resistance, Beta from Mukteswar, Uttarakhand. The parasites were thoroughly examined morphologically tubulin, and male parasites were subjected for RNA isolation. Complementary DNA (cDNA) was Bunostomum synthesised from total RNA using OdT. The PCR was performed using cDNA and self trigonocephalum, Small ruminants designed degenerative primers. The purified PCR amplicons were cloned into pGEMT easy vector and custom sequenced. The obtained sequences were analysed using DNA Article Info STAR, MEGA7.0 and Gene tool software. -

The Mitochondrial Genome of the Soybean Cyst Nematode, Heterodera Glycines
565 The mitochondrial genome of the soybean cyst nematode, Heterodera glycines Tracey Gibson, Daniel Farrugia, Jeff Barrett, David J. Chitwood, Janet Rowe, Sergei Subbotin, and Mark Dowton Abstract: We sequenced the entire coding region of the mitochondrial genome of Heterodera glycines. The sequence ob- tained comprised 14.9 kb, with PCR evidence indicating that the entire genome comprised a single, circular molecule of ap- proximately 21–22 kb. The genome is the most T-rich nematode mitochondrial genome reported to date, with T representing over half of all nucleotides on the coding strand. The genome also contains the highest number of poly(T) tracts so far reported (to our knowledge), with 60 poly(T) tracts ≥ 12 Ts. All genes are transcribed from the same mitochon- drial strand. The organization of the mitochondrial genome of H. glycines shows a number of similarities compared with Ra- dopholus similis, but fewer similarities when compared with Meloidogyne javanica. Very few gene boundaries are shared with Globodera pallida or Globodera rostochiensis. Partial mitochondrial genome sequences were also obtained for Hetero- dera cardiolata (5.3 kb) and Punctodera chalcoensis (6.8 kb), and these had identical organizations compared with H. gly- cines. We found PCR evidence of a minicircular mitochondrial genome in P. chalcoensis, but at low levels and lacking a noncoding region. Such circularised genome fragments may be present at low levels in a range of nematodes, with multipar- tite mitochondrial genomes representing a shift to a condition in which these subgenomic circles predominate. Key words: mitochondrial, nematode, gene rearrangement, Punctodera, Punctoderinae, Heteroderidae, Heterodera cardio- lata. -

Ostertagia Ostertagi: Population Dynamics Under Pasture and Confinement Conditions with Particular Reference to the Inhibition Phenomenon
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1989 Ostertagia Ostertagi: Population Dynamics Under Pasture and Confinement Conditions With Particular Reference to the Inhibition Phenomenon. Carlos Solomon Eddi Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses Recommended Citation Eddi, Carlos Solomon, "Ostertagia Ostertagi: Population Dynamics Under Pasture and Confinement Conditions With Particular Reference to the Inhibition Phenomenon." (1989). LSU Historical Dissertations and Theses. 4712. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/4712 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Historical Dissertations and Theses by an authorized administrator of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. INFORMATION TO USERS The most advanced technology has been used to photo graph and reproduce this manuscript from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are re produced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. -

Testing the Hypothesis of Recent Population Expansions in Nematode Parasites of Human-Associated Hosts
Heredity (2005) 94, 426–434 & 2005 Nature Publishing Group All rights reserved 0018-067X/05 $30.00 www.nature.com/hdy Testing the hypothesis of recent population expansions in nematode parasites of human-associated hosts DA Morrison and J Ho¨glund Department of Parasitology (SWEPAR), National Veterinary Institute and Swedish University of Agricultural Sciences, 751 89 Uppsala, Sweden It has been predicted that parasites of human-associated prediction. However, it is likely that the situation is more organisms (eg humans, domestic pets, farm animals, complicated than the simple hypothesis test suggests, and agricultural and silvicultural plants) are more likely to show those species that do not fit the predicted general pattern rapid recent population expansions than are parasites of provide interesting insights into other evolutionary processes other hosts. Here, we directly test the generality of this that influence the historical population genetics of host– demographic prediction for species of parasitic nematodes parasite relationships. These processes include the effects of that currently have mitochondrial sequence data available in postglacial migrations, evolutionary relationships and possi- the literature or the public-access genetic databases. Of the bly life-history characteristics. Furthermore, the analysis 23 host/parasite combinations analysed, there are seven highlights the limitations of this form of bioinformatic data- human-associated parasite species with expanding popula- mining, in comparison to controlled experimental -

Impact of Gastrointestinal Parasitic Nematodes of Sheep, and the Role Of
Roeber et al. Parasites & Vectors 2013, 6:153 http://www.parasitesandvectors.com/content/6/1/153 REVIEW Open Access Impact of gastrointestinal parasitic nematodes of sheep, and the role of advanced molecular tools for exploring epidemiology and drug resistance - an Australian perspective Florian Roeber*, Aaron R Jex and Robin B Gasser Abstract Parasitic nematodes (roundworms) of small ruminants and other livestock have major economic impacts worldwide. Despite the impact of the diseases caused by these nematodes and the discovery of new therapeutic agents (anthelmintics), there has been relatively limited progress in the development of practical molecular tools to study the epidemiology of these nematodes. Specific diagnosis underpins parasite control, and the detection and monitoring of anthelmintic resistance in livestock parasites, presently a major concern around the world. The purpose of the present article is to provide a concise account of the biology and knowledge of the epidemiology of the gastrointestinal nematodes (order Strongylida), from an Australian perspective, and to emphasize the importance of utilizing advanced molecular tools for the specific diagnosis of nematode infections for refined investigations of parasite epidemiology and drug resistance detection in combination with conventional methods. It also gives a perspective on the possibility of harnessing genetic, genomic and bioinformatic technologies to better understand parasites and control parasitic diseases. Keywords: Australia, Gastrointestinal nematodes, Strongylida, Small ruminants (including sheep and goats), Molecular methods, Epidemiology, Drug resistance Review timed, strategic treatments, this type of control is expen- Introduction sive and, in most cases, only partially effective. In Parasites of livestock cause diseases of major socio- addition, the excessive and frequent use of anthelmintics economic importance worldwide. -

Proceedings of the Helminthological Society of Washington 13(1) 1946
VOLUME 13 JANUARY, 1946 NUMBER 1 PROCEEDINGS of The Helminthological Society of Washington Supported in part by the Brayton H. Ransom Memorial Trust Fund EDITORIAL COMMITTEE JESSE R. CHRISTIE, Editor U. S. Bureau of Plant Industry, Soils, and Agricultural Engineering EMMETT W. PRICE U. S. Bureau of Animal Industry GILBERT F . OTTO Johns Hopkins University HENRY E. EWING U. S. Bureau of Entomology and Plant Quarantine THEODOR VON BRAND The Catholic University of America Subscription $1 .00 a Volume; Foreign, $1.25 Published by THE HELMINTHOLOGICAL SOCIETY OF WASHINGTON VOLUME 13 JANUARY, 1946 NUMBER 1 THE HELMINTHOLOGICAL SOCIETY OF WASHINGTON The Helminthological Society of Washington meets monthly from October to May for the presentation and discussion of papers . Persons interested in any branch of parasitology or related science are invited to attend the meetings and participate in the programs and are eligible for membership . Candidates, upon suitable application, are nominated for membership by the Executive Committee and elected by the Society. The annual dues for resident and nonresident members, including subscription to the Society's journal and privilege of publishing therein at reduced rates, are five dollars . Officers of the Society for 1945 President : THEODOR VON BRAND Vice president : GEORGE W. HUNTER, III Corresponding Secretary-Treasurer : EDNA M . BUHRER Recording Secretary : MARION M. FARR PROCEEDINGS OF THE SOCIETY The Proceedings of the Helminthological Society of Washington is a medium for the publication of notes and papers presented at the Society's meetings . How- ever, it is not a prerequisite for publication in the Proceedings that a paper be presented before the Society, and papers by persons who are not members may be accepted provided the author will contribute toward the cost of publication. -

Evaluation of Some Vulval Appendages in Nematode Taxonomy
Comp. Parasitol. 76(2), 2009, pp. 191–209 Evaluation of Some Vulval Appendages in Nematode Taxonomy 1,5 1 2 3 4 LYNN K. CARTA, ZAFAR A. HANDOO, ERIC P. HOBERG, ERIC F. ERBE, AND WILLIAM P. WERGIN 1 Nematology Laboratory, United States Department of Agriculture–Agricultural Research Service, Beltsville, Maryland 20705, U.S.A. (e-mail: [email protected], [email protected]) and 2 United States National Parasite Collection, and Animal Parasitic Diseases Laboratory, United States Department of Agriculture–Agricultural Research Service, Beltsville, Maryland 20705, U.S.A. (e-mail: [email protected]) ABSTRACT: A survey of the nature and phylogenetic distribution of nematode vulval appendages revealed 3 major classes based on composition, position, and orientation that included membranes, flaps, and epiptygmata. Minor classes included cuticular inflations, protruding vulvar appendages of extruded gonadal tissues, vulval ridges, and peri-vulval pits. Vulval membranes were found in Mermithida, Triplonchida, Chromadorida, Rhabditidae, Panagrolaimidae, Tylenchida, and Trichostrongylidae. Vulval flaps were found in Desmodoroidea, Mermithida, Oxyuroidea, Tylenchida, Rhabditida, and Trichostrongyloidea. Epiptygmata were present within Aphelenchida, Tylenchida, Rhabditida, including the diverged Steinernematidae, and Enoplida. Within the Rhabditida, vulval ridges occurred in Cervidellus, peri-vulval pits in Strongyloides, cuticular inflations in Trichostrongylidae, and vulval cuticular sacs in Myolaimus and Deleyia. Vulval membranes have been confused with persistent copulatory sacs deposited by males, and some putative appendages may be artifactual. Vulval appendages occurred almost exclusively in commensal or parasitic nematode taxa. Appendages were discussed based on their relative taxonomic reliability, ecological associations, and distribution in the context of recent 18S ribosomal DNA molecular phylogenetic trees for the nematodes.