Performance-Audiovisuelle-Et-Pratique-Du-Vjing.Web.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Working with Digital Video
Working with digital video By admin Published: 10/04/2007 - 08:35 Peter Westenberg , October 2007 Working with digital video is part of many artistic disciplines. Besides single screen narratives, video productions can range from animation, multiple screen installation to interactive work. Still, many aspects of digital video can be traced back to the history of film. The interface of a timeline editing software such as Cinelerra [1] shows a multitrack timeline, a viewing monitor, a bin for clips; echoing the setup of a flatbed table for editing celluloid. A dual head set up Cinelerra work station The physical materiality of film and video are fundamentaly different: celluloid versus pixels, chemicals versus algorhytms, but the relationship between film and video has mutually matured. As outlined by Matt Hanson [1b] , video expands cinematographic traditions in new directions, filmmakers can benefit from digitisation by reclaiming the central position of creativity in the film process, as pointed out by Samira Makhmalbaf. [1c] 1 / 28 An 'Old Delft Cinemonta' 16mm editing table in use at the Filmwerkplaats in Rotterdam Digital video also roots in artistic practices of the sixties and seventies. [1a] Artists started using video to capture temporary performances (Joan Jonas [2] , Vito Acconci [3] ), they integrated video monitors in installations (Nam June Paik [4] ), experimented with filters and mixing in video paintings (Peter Campus [5] ). Compared to film cameras, video cameras had a strong feature: it became possible connect a monitor and view directly what the camera recorded. Today, artists can use softwares such as Lives [5] , Jahshaka [6] , Zone Minder [7] or Pure Data [8] and Linux distributions aimed at audio and visual creation such as Dyne:bolic [9] Apodio [10] and Ubuntu Studio [11] to further explore the possibilities of real time video, multiple camera input and live interaction. -

Two UCSD Students Injured in Car Accident
[ . Elsewhere Gon Clubbin' News Flash! GI ibermania Employ... The Division III National 'Star Wars: Episode /' is onLy The 'Third Annual Live Arr.. ed for Drugs Championships get off to slow a movie - pLease adjust your Gleib Show' went off with BERKELEY - Two start in Massachusetts pathetic Lives accordingLy out a hitch last Thursday employees of the Blue Heaven drugstore on Sports, page 16 Opinion, page 4 Hiatus, page 8 Telegraph Avenue were arrested last Friday, accused of selling an over-the-counter , H E c 5 D drug with the knowledge that u their customers intended to use it to make methampheta mine. The suspects allegedly sold 98,000 pseudoephedrine pills to undercover agents. Officials said that up to nine pounds of methamphetamine could be produced from the amount of pseudoephedrine that was purchased by the UC SAN DIEGO THURSDAY, MAY 20,1999 VOLUME 97, ISSUE 16 agents. The pair will appear in federal court in Oakland on May 28. If found guilty, they could face up to 20 RETURN OF THE FORCE A.S. Council years in prison, as well as fines of up to $250,000. - The Daily Californian Approves UnIversity, NFL Team New Budget to .... Staclum SEATI1..E, Wash. - The FINANCE: Members University of Washington decided last night how to and the Seattle Seahawks have reached an agreement spend student fees next year to share the Husky Stadium By VIncent Gragnanl . for the 2000 and 200 I sea Senior Staff Writer sons, pending approval by The A.S. Council spent almost two the UW Board of Regents. -

Painting with Light
Painting With Light Weekend VJ Workshop Using Resolume v2.3 Fremantle, July 2006 Presented by VJzoo.com - Kat Black and Jasper Cook Handbook copyright Kat Black and Jasper Cook, 2006 Thanks to the following supporters: • TDK Australia • Film and Television Institute • ScreenWest • Lotterywest • Microcinema International • Plaza Digital • ArtsWA • The Government of Western Australia • The Fly By Night Club • Resolume See website VJzoo.com for more info. 1 Copyright Kat Black + Jasper Cook, 2006. VJzoo.com Table of Contents Technical 2 • Choosing your format 2 • What size to make one’s clips? 2 • Which Codec to use? 2 • How many Keyframes? 3 • Other technical blah 3 Ethical 4 • Is it legal to use clips cut from movies, TV, downloaded from the web? 4 • So where CAN I get legal content? 4 • How can I protect my own material? 4 • Is it legal to film anything I like in a public place and use the content in my work? 4 Shooting Tips 5 VJ Tips 5 VJ Equipment 6 • Software-based VJs 6 • Hardware-based VJs 6 • Most simple live VJ setup 6 • Typical live single-VJ setup 6 • VJzoo’s usual 2-VJ Gig Rig setup 7 • Minimum PC Specs 7 Hands On 8 • Installing the Essentials 8 • Installing the Codecs 8 • Installing Exsate DV Capture 9 • Installing Virtual Dub 9 • Installing Resolume 10 • Installing Freeframes 10 • Summary of Process 11 • Capturing using Exsate DV Capture 12 • Editing clips using Virtual Dub 14 • Editing from DVD 19 • Setting your Second Screen for Output 20 • Introduction to Resolume 22 • Getting Started in Resolume 22 • Changing Resolume’s Interface Font 23 • Screen Setup in Resolume 23 • Resolume Decks 24 • Loading a Deck 24 • Deck Sections 24 • Active Layer 25 • Effects 25 • Adjusting an Effect 27 • Relationships between Layers 29 • How can we save these settings? 31 • Don’t do this while we’re watching 31 • Audio Triggering 31 Extra things you might want to know 32 • Using stills 32 • Chaos mode 32 • Direct camera input 32 • Video Feedback 32 • Using midi devices with Resolume 32 2 Copyright Kat Black + Jasper Cook, 2006. -
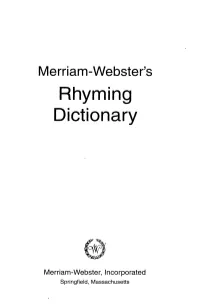
Rhyming Dictionary
Merriam-Webster's Rhyming Dictionary Merriam-Webster, Incorporated Springfield, Massachusetts A GENUINE MERRIAM-WEBSTER The name Webster alone is no guarantee of excellence. It is used by a number of publishers and may serve mainly to mislead an unwary buyer. Merriam-Webster™ is the name you should look for when you consider the purchase of dictionaries or other fine reference books. It carries the reputation of a company that has been publishing since 1831 and is your assurance of quality and authority. Copyright © 2002 by Merriam-Webster, Incorporated Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Merriam-Webster's rhyming dictionary, p. cm. ISBN 0-87779-632-7 1. English language-Rhyme-Dictionaries. I. Title: Rhyming dictionary. II. Merriam-Webster, Inc. PE1519 .M47 2002 423'.l-dc21 2001052192 All rights reserved. No part of this book covered by the copyrights hereon may be reproduced or copied in any form or by any means—graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, taping, or information storage and retrieval systems—without written permission of the publisher. Printed and bound in the United States of America 234RRD/H05040302 Explanatory Notes MERRIAM-WEBSTER's RHYMING DICTIONARY is a listing of words grouped according to the way they rhyme. The words are drawn from Merriam- Webster's Collegiate Dictionary. Though many uncommon words can be found here, many highly technical or obscure words have been omitted, as have words whose only meanings are vulgar or offensive. Rhyming sound Words in this book are gathered into entries on the basis of their rhyming sound. The rhyming sound is the last part of the word, from the vowel sound in the last stressed syllable to the end of the word. -

Lives Video Editor
GABRIEL FINCH LiVES: LiVES is a Video Editing System RECIFE-PE – JULHO/2013. UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA APLICADA LiVES: LiVES is a Video Editing System Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada como exigência parcial à obtenção do título de Mestre. Área de Concentração: Engenharia de Software Orientador: Prof. Dr. Giordano Ribeiro Eulalio Cabral RECIFE-PE – JULHO/2013. Ficha Catalográfica F492L Finch, Gabriel LiVES: LiVES is a video editing system / Gabriel Finch. -- Recife, 2013. 132 f. Orientador (a): Giordano Cabral. Dissertação (Mestrado em Informática Aplicada) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Estatísticas e Informática, Recife, 2013. Inclui referências e apêndice. 1. Software - Desenvolvimento 2. Prototipagem 3. Multimídia 4. Usuários de computador 5. Vídeo digital I. Cabral, Giordano, orientador II. Título CDD 005.1 ACKNOWLEDGEMENTS The author would like to thank: The staff and students at UFRPE. All the LiVES users and contributors. My family. and the following, who have helped along the way: Niels Elburg, Denis "Jaromil" Rojo, Tom Schouten, Andraz Tori, Silvano "Kysucix" Galliani, Kentaro Fukuchi, Dr. Jun Iio, Oyvind Kolas, Carlo Prelz, Yves Degoyon, Lady Xname, timesup.org, LinuxFund, VJ Pixel, estudiolivre, mediasana, Felipe Machado, elphel.com. RESUMO Relativamente pouca pesquisa científica tem sido executado até à data atinente aos requisitos dos usuários de aplicativos de processamento de vídeo. Nesta dissertação, apresentamos um novo termo "Experimental VJ", e examinamos os requisitos de software para essa classe de usuário, derivados de uma variedade de fontes. Por meios desses requisitos, definimos os atributos que seria necessário um programa criado para satisfazer essas demandas possuir. -
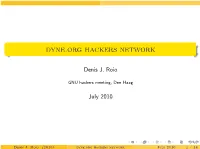
Dyne.Org Hackers Network
dyne.org hackers network Denis J. Roio GNU hackers meeting, Den Haag July 2010 Denis J. Roio (2010) dyne.org hackers network July 2010 1 / 14 Dyne.org hackers network Free Software Movement Started in 1984 by Richard Stallman, with help by Eben Moglen, drafting the GNU General Public License, granting users the rights to: Run for any purpose Study and adapt Redistribute Distribute modifications Denis J. Roio (2010) dyne.org hackers network July 2010 2 / 14 Dyne.org hackers network So why yet another org? Started in 2000 publishing low-consumption software creations for broadcasting and freedom of speech, granting users with the rights to: Promote ideas and practices of knowledge sharing Democratize access to on-line and on-site communities Foster use of free software in artistic creativity Support free software development also when non-profitable Grounded as an EU Foundation in NL (Dutch Stichting) in 2005 with support by NIMk.nl, Servus.at, UNESCO and more institutions and individuals. Denis J. Roio (2010) dyne.org hackers network July 2010 3 / 14 Dyne.org hackers network Theoretical background Collaboration instead of competition No strings attached to marketed products Ownership of production means Global knowledge for local economies Denis J. Roio (2010) dyne.org hackers network July 2010 4 / 14 Dyne.org hackers network Dyne Operating System The dyne:bolic GNU/Linux liveCD multimedia operating system, developed from scratch (LFS) since 2001 as a nomadic OS, focusing on: Ease of use, non invasive installation that co-exists with other systems Recycling of existing infrastructure, support for game consoles Oriented to production and not only fruition of media Enforcing privacy of users and independent distribution of information Self contained: the full set of tools for development are on the CD 100% Free as in Market (and for real!) Denis J. -

Full Circle Magazine #57 Full Circle Magazine Is Neither Affiliated Wit1h, Nor Endorsed By, Canonical Ltd
Full Circle THE INDEPENDENT MAGAZINE FOR THE UBUNTU LINUX COMMUNITY ISSUE #57 - January 2012 EENNLLIIGGHHTTEENNMMEENNTT 1177 DDIISSTTRROOSS TTOO TTRRYY FFOORR EE1177 full circle magazine #57 full circle magazine is neither affiliated wit1h, nor endorsed by, Canonical Ltd. contents ^ HowTo Full Circle Opinions THE INDEPENDENT MAGAZINE FOR THE UBUNTU LINUX COMMUNITY Try Enlightenment p.07 My Story p.27 Linux News p.04 My Desktop p.53 LibreOffice Pt11 p.10 My Opinion p.28 Columns Backup Strategy Pt5 p.12 Command & Conquer p.05 Ubuntu Games p.49 I Think... p.29 Encrypted USB Stick p.14 Linux Labs p.21 Q&A p.43 Review p.34 Varnish Web Cache p.16 Ubuntu Women p.46 Closing Windows p.25 Letters p.39 The articles contained in this magazine are released under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. This means you can adapt, copy, distribute and transmit the articles but only under the following conditions: You must attribute the work to the original author in some way (at least a name, email or URL) and to this magazine by name ('full circle magazine') and the URL www.fullcirclemagazine.org (but not attribute the article(s) in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). If you alter, transform, or build upon this work, you must distribute the resulting work under the same, similar or a compatible license. Full Circle magazine is entirely independent of Canonical, the sponsor of the Ubuntu projects, and the views and opinions in the magazine should in no way be assumed tfoulhl acivrecleCamnaognaiczainlee#nd5o7rseme2nt. -
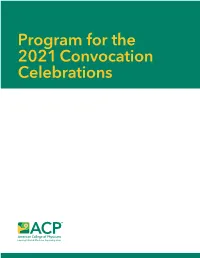
Program for the 2021 Convocation Celebrations PROGRAM
Program for the 2021 Convocation Celebrations PROGRAM Due to the COVID-19 pandemic, the Convocation Though this is a remote celebration, the accomplish- Ceremony has been converted into three Convocation ments of the individuals named in this Convocation celebrations. The 2021 Fellowship Convocation cele- Program are worthy of highest esteem and honor. The bration recognizes the achievements of recipients of American College of Physicians celebrates their achieve- Fellowship since 2017 who have not yet participated ments and contributions to ACP and internal medicine. in a Convocation Ceremony. The 2021 Mastership and Honorary Fellowship Convocation celebration recognizes recipients of Mastership in the 2019-20 and 2020-21 awards cycles as well as recipients of __________________________________________________ Honorary Fellowship and global dignitaries invited as Special Representatives. The 2021 National and Chapter * The American College of Physicians thanks the Awards Convocation celebration recognizes recipients endowers and sponsors of several awards: the James of ACP national awards in the 2019-20 and 2020-21 Bruce family, the Ralph O. Claypoole Jr. family, the awards cycles as well as recipients of ACP Chapter Feinstein family, and the Samuel Eichold family with awards in 2019 and 2020. the Alabama Chapter. TABLE OF CONTENTS ACP Leadership .................................................. 1 About Convocation, the President’s Badge, the Special Representatives ......................................3 Caduceus, and the Mace ................................90 -

The Terminal Experiment
The Terminal Experiment by Robert J. Sawyer In the last analysis, it is our conception of death which decides our answers to all the questions life puts to us. —Dag Hammarskjold (1905-1961) United Nations Secretary General PROLOGUE DECEMBER 2011 What room is Detective Philo in?" asked Peter Hobson, a tall, thin man of forty-two, with hair an equal mixture of black and gray. The squat nurse behind the desk had been absorbed in whatever she'd been reading. She looked up. "Pardon?" "Detective Sandra Philo," said Peter. "What room is she in?" "Four-twelve," said the nurse. "But her doctor has ordered that only immediate family members should visit." Peter began down the corridor. The nurse came around from behind the desk and gave chase. "You can't go in there," she said firmly. Peter turned briefly to look at her. "I have to see her." The nurse maneuvered in front of him. "She's in critical condition." "I'm Peter Hobson. I'm a doctor." "I know who you are, Mr. Hobson. I also know you're not a medical doctor." "I'm on the Board of Directors of North York General." "Fine. Go over there and bully someone, then. You're not raising havoc on my ward." Peter exhaled noisily. "Look, it's a matter of life and death that I see Ms. Philo." "Everything in the ICU is a matter of life and death, Mr. Hobson. Ms. Philo is sleeping, and I'll not have her disturbed." Peter pushed ahead. "I'll call security," said the nurse, trying to keep her voice low so as not to alarm the patients. -

Apollo Solo Manual
Thunderbolt 3-Powered Audio Interface Apollo Solo Manual UAD Software Version 9 Manual Version 201029 www.uaudio.com Tip: Click any section or page number Table Of Contents to jump directly to that page. A Letter from Bill Putnam Jr. ................................................................. 8 Introducing Apollo Solo ......................................................................... 9 Apollo Solo Software Features ........................................................................... 12 UAD Powered Plug-In Features ......................................................................... 14 About Apollo Solo Documentation ..................................................................... 15 Technical Support ............................................................................................ 16 Getting Started ................................................................................... 17 Overview ......................................................................................................... 17 Apollo Solo System Requirements ..................................................................... 17 Hardware Setup ............................................................................................... 18 Software Setup ................................................................................................ 20 Windows Setup ................................................................................................ 21 Audio Setup ................................................................................................... -

Linux Applications for Internet Broadcasters
Linux Applications For Internet Broadcasters Written By David Childers www.ScenicRadio.Com Relaxing Entertainment for the World www.BroadcastingWorld.Com Global Broadcast Information Portal Creative Common License This body of work is released under the Attribution-ShareAlike version 3.0, Creative Common License. The work may be freely distributed or modified for commercial or non commercial purposes. If this work is modified, compliance with the Attribution-ShareAlike version 3.0, Creative Common License is required. These requirements include: - Any derivatives of this work must be attributed to David Childers. - Any derivatives of this work must reference any additional sources that may be used. - Alterations, transforming, or building upon this work requires distributing the resulting work only under the same, similar or a compatible license. For the complete legal code, please refer here: www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode Cover graphic – Server Linux Box. www.clker.com/clipart-1907.html Cover graphic – Penguin. www.clker.com/clipart-penguin-14.html Foreword graphic - Still Life with a Skull and a Writing Quill. en.m.wikipedia.org/wiki/File:Pieter_Claeszoon_-_Still_Life_with_a_Skull_and_a_Writing_Quill.JPG About The Author David Childers is the Content Manager for the Global Broadcasting portal www.BroadcastingWorld.com. He is very active in the Internet broadcast industry and has written numerous guides and a book about this growing technological field. He is also the webmaster of www.ScenicRadio.com, the global -
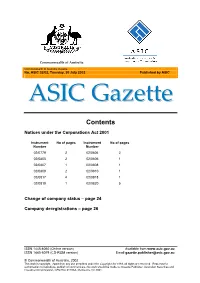
Commonwealth of Australia Gazette ASIC 32/02 Dated 30 July 2002
Commonwealth of Australia Commonwealth of Australia Gazette No. ASIC 32/02, Tuesday, 30 July 2002 Published by ASIC AASSIICC GGaazzeettttee Contents Notices under the Corporations Act 2001 Instrument No of pages Instrument No of pages Number Number 02/0779 2 02/0804 2 02/0805 2 02/0806 1 02/0807 1 02/0808 1 02/0809 2 02/0810 1 02/0817 4 02/0818 1 02/0819 1 02/0820 5 Change of company status – page 24 Company deregistrations – page 26 ISSN 1445-6060 (Online version) Available from www.asic.gov.au ISSN 1445-6079 (CD-ROM version) Email [email protected] © Commonwealth of Australia, 2002 This work is copyright. Apart from any use permitted under the Copyright Act 1968, all rights are reserved. Requests for authorisation to reproduce, publish or communicate this work should be made to: Gazette Publisher, Australian Securities and Investment Commission, GPO Box 5179AA, Melbourne Vic 3001 Commonwealth of Australia Gazette ASIC Gazette ASIC 32/02, Tuesday, 30 July 2002 Change of company status Page 24 Corporations Act 2001 Subsection 164(3) Notice is hereby given that the ASIC will alter the registration details of the following companies 1 month after the publication of this notice, unless an order by a court or Administration Appeals Tribunal prevents it from doing so. AMBERTECH PTY LIMITED AUSTCORP GROUP PTY LIMITED ACN 079 080 158 will change to a public ACN 011 042 318 will change to a public company limited by shares. The new name will company limited by shares. The new name will be AMBERTECH LIMITED ACN 079 080 158.