Tissemsilt), Algerie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Study of the Interannual Rainfall Variability in Northern Algeria Etude De La Variabilite Inter-Annuelle Des Pluies De L'algerie Septentrionale
Revue scientifique et technique. LJEE N°23. Décembre 2013 STUDY OF THE INTERANNUAL RAINFALL VARIABILITY IN NORTHERN ALGERIA ETUDE DE LA VARIABILITE INTER-ANNUELLE DES PLUIES DE L'ALGERIE SEPTENTRIONALE Mohamed MEDDI. École Nationale Supérieure d’Hydraulique, Blida, LGEE. [email protected] Samir TOUMI . École Nationale Supérieure d’Hydraulique, Blida, LGEE. ABSTRACT : The work presented here focuses on the inter-annual variability of annual rainfall in Northern Algeria. This work is carried out by using the coefficient of variation (the ratio between the standard deviation and the average). We will try to show areas of low, medium and high variations in Northern Algeria. In order to do this, we use 333 rainfall stations spread over the entire study area, with a measurement period of 37 years (1968/2004). The contrast of rainfall spatial and temporal distribution has been demonstrated by studying the sixteen basins, as adopted by the National Agency of Water Resources. The high spatial variability characterizes the basins of the High Plateaus of Constantine and Chot El Hodna. Keywords: Northern Algeria - annual Rainfall - inter-annual variability - coefficient of variation RESUME : Nous présentons dans cet article une étude de la variabilité interannuelle des pluies annuelles en Algérie septentrionale. Ce travail a été réalisé en utilisant le coefficient de variation (le rapport entre l'écart-type et la moyenne). Nous essayerons de montrer les zones à faible, moyenne et forte variations dans le Nord de l'Algérie. Pour se faire, nous avons utilisé 333 postes pluviométriques réparties sur l'ensemble de la zone d'étude avec une période de mesure de 37 ans (1968/2004). -

Novitates PUBLISHED by the AMERICAN MUSEUM of NATURAL HISTORY CENTRAL PARK WEST at 79TH STREET, NEW YORK, N.Y
AMERICAN MUSEUM Novitates PUBLISHED BY THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY CENTRAL PARK WEST AT 79TH STREET, NEW YORK, N.Y. 10024 Number 2764, pp. 1-18, figs. 1-49, tables 1-3 June 23, 1983 Eppelsheimius: Revision, Distribution, Sister Group Relationship (Staphylinidae, Oxytelinae) LEE H. HERMAN' ABSTRACT Eppelsheimius is a small genus of beetles that pirazzolii and E. miricollis, that are distinguished occurs in arid regions from northern Africa to by many characters. Both species are variable. The southwestern Asia. The species share characters genus and species are described and illustrated and with Planeustomus, Manda, and Bledius. Evi- their distributions described. One species, E. per- dence is presented that Bledius and Eppelsheimius sicus, is newly synonymized with E. pirazzolii. are sister groups. The genus has two species, E. INTRODUCTION The present paper was stimulated by a in a forthcoming paper on Bledius (Herman, search for the sister group ofBledius. Earlier, in prep.). Ultimately, several rearrangements but without supporting characters, Herman in the classification of the Oxytelinae will be (1970, p. 354) presented two groups ofgenera required. as the sister group of Bledius. One of these Eppelsheim (1885) described pirazzolii in groups, the Carpelimus lineage, includes Oncophorus. A second species, miricollis, was Carpelimus, Apocellagria, Trogactus, Thi- added by Fauvel (1898); both were from Tu- nodromus, Xerophygus, Ochthephilus, nisia. In 1915, Oncophorus was discovered Mimopaederus, Teropalpus, Pareiobledius to be a homonym of a genus of Mal- and Blediotrogus; the other, the Thinobius lophaga and a genus of "worms" of indeter- lineage, includes Thinobius, Sciotrogus, and minate placement. Bernhauer (1915) pub- Neoxus. -

El Sector Del Agua En Argelia 2007
EL SECTOR DEL AGUA EN ARGELIA ABRIL 2007 El sector del agua en Argelia Estudios de Mercado 1 EL SECTOR DEL AGUA EN ARGELIA ABRIL 2007 El sector del agua en Argelia Estudio realizado por Javier Sanz Álv arez , Ismael Castelos Maceiras y Jesús Sánchez Marco bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel Estudios de Mercado 2 Mayo 2007 EL SECTOR DEL AGUA EN ARGELIA ABRIL 2007 INDICE INTRODUCCIÓN 4 1. PLAN DE APOYO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO 5 2. DIAGNÓSTICO 7 3. LOS RECURSOS HÍDRICOS 9 4. CUENCAS HIDROGRÁFICAS 11 5. AGUA SUBTERRÁNEA 13 6. AGUAS SUPERFICIALES 15 7. EXTRACCIÓN DE AGUA 16 8. CONSUMO DE AGUA 17 i) AGRICULTURA 17 Grandes perímetros irrigados (GPI) 18 Pequeña y mediana hidráulica (PMH) 21 ii) ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 23 9. PRECIO DEL AGUA 26 10. EMBALSES Y TRASVASES 28 11. PROYECTOS HIDRÁULICOS 33 12. DESALACIÓN 36 13. DEPURACIÓN Y RECICLAJE DE AGUA 41 14. ESTUDIO IMPORT-EXPORT EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO 43 15. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS 51 16. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN 55 17. ORGANISMOS PÚBLICOS EN MATERIA DE AGUA 56 i).- AGENCIA NACIONAL DES RECURSOS HIDRAULICOS (ANRH) 56 ii).- AGENCIA NACIONAL DE PRESAS Y TRANSFERENCIAS (ANBT) 58 iii).- ARGELINA DE AGUAS (Algérienne des Eaux - ADE) 60 iv).- OFICINA NACIONAL DE TRATAMIENTO (ONA) 61 v).- OFICINA NACIONAL DE LA IRRIGACION Y EL DRENAJE: (ONID) 63 vi).- OFICINAS DE PERIMETROS DE IRRIGACION (OPI) 64 vii).- LAS AGENCIAS DE CUENCAS HIDROGRAFICAS (ABH) 66 viii).- DIRECCIONES DE LA HIDRAULICA DE LAS WILAYAS 68 18. -

Prédétermination Et Prévision Des Étiages Des Oueds De L'algérie
UNIVERSITE DE KASDI MERBAH OUARGLA FACULTE DES SCIENCES PRATIQUE DEPARTEMENT D'HYDRAULIQUE ET GENIE CIVIL MEMOIRE EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLOME DE MAGISTERE Spécialté : Hydraulique Option : Aménagement hydraulique en zones arides Présenté par : MEKHLOUFI Nabil THEME Prédétermination et Prévision des étiages Des Oueds de l’Algérie Septentrionale Soutenais le : 18/12/2014 Devant le jury d'examen : Président : KRIKER A Professeur Université de Kasdi Merbah Ouargla Examinateur : SAKER M.L Professeur Université de Kasdi Merbah Ouargla Examinateur : BOUBEKRI A Professeur Université de Kasdi Merbah Ouargla Promoteur : BOUTOUTAOU D Professeur Université de Kasdi Merbah Ouargla Promotion : 2014 Prédétermination et Prévision des étiages Des Oueds de l’Algérie Septentrionale RESUME : L’estimation des débits des rivières et, en particulier, l’estimation des débits d’apports minimaux (les étiages) au quel il est possible de s’attendre au cours d’une période donnée, est un facteur important pour la planification et la modélisation des ressources, Actuellement, la prédétermination et/ou la prévision des débits d’étiage se fait uniquement sur la base de données de mesures ou de l’analogie hydrologique. Malheureusement le réseau hydrographique de l’Algérie n’est pas bien équipé par des stations hydrométriques ce qui engendre d’énormes problèmes pour la prédétermination et la prévision des débits d’étiages. Une analyse hydrologique détaillée de quelques cours d’eau équipés des stations hydrométriques nous a permis la prédétermination et la prévision des débits d’étiage. Sur la base de cette importante information, un modèle de prévision de débit d’étiage à été établi. Ce modèle permet le calcul de ces débits dans n’importe quel Oued non équipé de station de mesures en présence de Peu de données. -

Contribution a Une Analyse De La Dynamique De La Vegetation Des Parcours Steppiques Dans La Region De Biskra Au Sud-Est Algerien
European Scientific Journal November 2015 edition vol.11, No.32 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431 CONTRIBUTION A UNE ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DE LA VEGETATION DES PARCOURS STEPPIQUES DANS LA REGION DE BISKRA AU SUD-EST ALGERIEN. Bazri Kamel-eddine, Docteur, MC. Ouahrani Ghania Université des frères Mentouri Constantine1/Faculté S.N.V, Algérie Abstract An ecological analysis is conducted in three sites (EL-Haouche, Zribet El-Oued and Khanguet Sidi Nadji) in a steppes halophytes in the Biskra region (south-east of Algeria). Our analysis shows that the degradation of this steppe and a regressive dynamic of vegetation is very important. The soil is completely stripped and covered with a whitish crust over large areas which results from the rise and deposition of salts on the surface, particularly in Khanguet Sidi Naji. The current situation of these courses is alarming; it requires a serious rational management. Keywords: Vegetation dynamics, halophytes steppe, Ecosystem, Degradation, Biskra, South-east of Algeria Résumé Un diagnostic écologique est réalisé dans trois zones pastorales à halophytes (EL Haouche, Zribet El Oued et Khanguet Sidi Nadji) dans la région de Biskra (sud-est algérien). Notre analyse montre une dynamique régressive et un stade de dégradation très avancée dans ces parcours steppiques, où le sol est totalement nu et couvert d’une croute blanchâtre sur de grandes superficies notamment à Khanguet Sidi Nadji, résultante de la remontée des sels. La situation actuelle de ces zones est alarmante ; elle nécessite une sérieuse gestion rationnelle. Mots clés : Steppe halophytes, Ecosystèmes, Dégradation des cosystèmes, Biskra, Sud algérien 203 European Scientific Journal November 2015 edition vol.11, No.32 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431 Introduction La désertification est une problématique environnementale majeure pour le 21ème siècle (World Bank, 2002). -

Catalogue Theses Memoires
Catalogue des Thèses Mémoires Format papier Ministère de l’Industrie et des Mines Agence du Service Géologique de l’Algérie Division Géo-information – Département Documentation CATALOGUE DES THESES MEMOIRES Géologie de l’Algérie Bibliothèque des Sciences de la Terre ASGA/BST Page 0 Mémoires Format papier Catalogue des Thèses Mémoires Format papier THM.001. CLARCQ P. (1951) - Etude géologique de la région de Tikjda et du Massif d’Akouker -Thaltatt dans le Djurdjura central. THM.002. PAYAN J. (1951) - Etude des régions de Bou-El-Ma, Goulmine et Kouriet dans le Djurdjura Central. THM.003. PLASSAIS R. (1951) - Etude de l’extrémité orientale du Djurdjura entre Acif El Hammam et Chellata. THM.004. MAHROUR M. (1967) - Le versant méridional des Monts des Ouled Naïl (Etude morphologique) du Djebel AZREG au Djebel Bou-Kahil. TH.005. CHABANI A. (1968) - Les phosphates de chaux sédimentaires. Recherche par les méthodes conjointes de la géologie et de la géophysique – Application au Bassin de Gafsa. THM.006. ZEKRI A. (1968) - Creusement du TB Jacquet. Exploitation du filon GRAY. THM.007. BENACHENHOU F. et MAACHE M. (1969) - Traitement pneumatique du phosphate brut. Lavage du phosphate calciné à l’eau douce, à l’eau de mer. THM.008. HADI SAID B. (1969) - Possibilités de détection de gisements filoniens de Plomb Zinc par l’action combinée de la géologie, de la géochimie et de la géophysique. THM.009. SENOUSSIT T. (1969) - Etude d’ensemble des travaux pour la mise en marche du souterrain de Chatoura. THM.010. BAKIR M. (1987) - La dynamique sédimentaire dans la baie d’El- Djemila (Baie de Bou-Ismaïl). -

A New Regionalization of Rainfall Patterns Based on Wavelet Transform Information and Hierarchical Cluster Analysis in Northeastern Algeria
A new regionalization of rainfall patterns based on wavelet transform information and hierarchical cluster analysis in northeastern Algeria Bilel Zerouali ( [email protected] ) Universite Hassiba Benbouali de Chlef https://orcid.org/0000-0003-4735-9750 Mohamed Chettih Zaki Abda Mohamed Mesbah Celso Augusto Guimarães santos Reginaldo Moura Brasil Neto Research Article Keywords: cluster analysis, regionalization, rainfall, continuous wavelet analysis, drought, water resources, Algeria Posted Date: May 26th, 2021 DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-559269/v1 License: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Read Full License A new regionalization of rainfall patterns based on wavelet transform information and hierarchical cluster analysis in northeastern Algeria 1 Bilel Zerouali, 2 Mohamed Chettih, 2 Zaki Abda, 3 Mohamed Mesbah, 4 Celso Augusto Guimarães Santos and 4 Reginaldo Moura Brasil Neto (1) Plant Chemistry-Water-Energy Laboratory, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Hassiba Benbouali, University of Chlef, B.P. 78C, Ouled Fares, 02180, Chlef, Algeria., (2) Research Laboratory of Water Resources, Soil and Environment, Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Amar Telidji University, P. O. Box 37.G, Laghouat 03000, Algeria (3) Earth Sciences Faculty, University of Science and Technology Houari Boumediene, BP 32, 16311 Bab Ezzouar, Algeria (4) Department of Civil Engineering and Environmental Engineering, Federal University of Paraíba, -

PGS Newsletter
PGS Newsletter http://www.pittsburghgeologicalsociety.org/ Vol. LXVII, No. 1 Robert Botterman, Editor September, 2014 Wednesday, September 17, 2014 The Pittsburgh Geological Society presents THE ROLE OF BASEMENT INFLUENCE ON CHANGING STRUCTURAL STYLES IN THE APPALACHIAN PLATEAU PROVINCE Craig A. Eckert EQT Production Co., Pittsburgh, PA Structural development of folds in the Appalachian plateau province can be shown to be directly or indirectly linked to the re-activation of pre-existing faults in the Precambrian. The majority of these faults can be linked to a fabric emplaced during Proterozoic tectonism associated with early collisional events responsible for the formation and eventual destruction of Rodinia and Pangea. Some folds are the result of a single phase of basement influenced contraction, while others are result of multiple phases of activity spanning multiple orogenies. A continuum of thick to thin skin tectonics is evident for the plateau and was affected by both the presence of salt and geometric relationship between Acadian depositional strike and predominant Iapetan fault orientation. Additionally, continual reactivation of basement faults controlled the distribution of Silurian evaporates, determined where fault initiation planes were to occur, established planes of weakness, and eventually aided in the amplification and development of the fold belts as they exist today throughout the plateau province. The influence of a developing foreland basin during Acadian time created sufficient dip on the surface of the Silurian decollement, allowing for a gravity sliding event preceding Alleghenian deformation. The importance of the Silurian incompetent units on overlying structural development increases northward into Pennsylvania where it reaches a maximum, then wanes northeastward as the depositional strike of the Acadian clastic wedge and the predominant trend of the Iapetan faults diverge. -

Assessment of Aquifer Mixing and Salinity Intrusion in the North-Western Sahara Aquifer System: a Hydrogeochemical Analysis- Algeria, Tunisia
Assessment of Aquifer Mixing and Salinity Intrusion in the North-Western Sahara Aquifer System: a Hydrogeochemical Analysis- Algeria, Tunisia By David F. Meyer B.S., Kansas State University, 2011 Submitted to the graduate degree program in the Department of Geology and Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Science Advisory Committee ________________________________ Randy Stotler (Chair) ________________________________ G. L. Macpherson (Co-Chair) ________________________________ J.F. Devlin ________________________________ W.C. Johnson Date Defended: October 27, 2016 The Thesis committee for David Meyer certifies that this is the approved version of the following thesis: Assessment of Aquifer Mixing and Salinity Intrusion in the North-Western Sahara Aquifer System: a Hydrogeochemical Analysis- Algeria, Tunisia ________________________________ Randy Stotler (Chair) ________________________________ G. L. Macpherson (Co-Chair) Date Approved: December 7, 2016 ii Abstract The North-Western Sahara Aquifer System is a complex multilayer leaky aquifer system providing water to Algeria, Tunisia, and Libya. Changing the hydrologic equilibrium through pumping can cause previously isolated saline water to mix with the fresh water in the pumped aquifers, resulting in increased salinity over time and, creating the potential for water-related conflict. The objective of this study is to identify areas where salinity intrusion is occurring now and could worsen in the future. To accomplish this, fourteen existing datasets were analyzed, yielding new insights into regional and local occurrences of salinity intrusion. Major ion chemistry and ratios of Br/Cl indicate that the source of salinity in the saline aquifers of the system, which intrude into the freshwater, is the dissolution of evaporates in the aquifer matrix. -
The Status of Soil Survey in Albania and Some of Its Major Environmental Findings
The Status of Soil Survey in Albania and some of its Major Environmental Findings Pandi Zdruli1 and Sherif Lushaj2 Introduction Over the last thirty years, a valuable experience has been accumulated in Albania, regarding soil survey and its applications. Initially it was the Soil Science Department of the Agricultural Univer- sity of Tirana who carried out soil activities, and then the Soil Science Institute (SSI) of Tirana, created in 1971 took the lead in all related ac- tivities. The latter is under the Ministry of Agri- culture and Food and it is the only one in the country specialised in soil science. Until the early 90s the Soil Science Institute, was very well organised, operating throughout the coun- try, by carrying out pedological surveys and fer- tility tests all over the agricultural land of Al- bania. Other activities included drainage and irri- gation research, soil microbiology, erosion con- trol, and topographic survey. There were 26 dis- tricts at the time in the country, each of them having their own soil laboratory and a specialised staff, among them one pedologist and one soil chem- ist. The Institute provided only scientific and technical guidelines for the “district soil of- fices”, since their management was handled by local administration. In twenty years period, detailed soil maps from 1: 10,000 to 1:50,000 scale, along with soil reports were prepared for each former agriculture co- 1 CIHEAM-Mediterranean Agronomic Institute of Bari. 2 Soil Science Institute, Instituti i Studimit të Tokave, Ti- rana, Albania. 69 Options Méditerranéennes, Série B, vol. 34 The Status of Soil Survey in Albania and some of its Major Environmental Findings operative, state farm and district. -
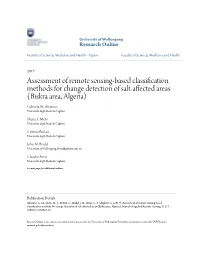
Assessment of Remote Sensing-Based Classification Methods for Change Detection of Salt-Affected Areas (Biskra Area, Algeria) Gabriela M
University of Wollongong Research Online Faculty of Science, Medicine and Health - Papers Faculty of Science, Medicine and Health 2017 Assessment of remote sensing-based classification methods for change detection of salt-affected areas (Biskra area, Algeria) Gabriela M. Afrasinei Universita degli Studi di Cagliari Maria T. Melis Universita degli Studi di Cagliari Cristina Buttau Universita degli Studi di Cagliari John M. Bradd University of Wollongong, [email protected] Claudio Arras Universita degli Studi di Cagliari See next page for additional authors Publication Details Afrasinei, G. M., Melis, M. T., Buttau, C., Bradd, J. M., Arras, C. & Ghiglieri, G. (2017). Assessment of remote sensing-based classification methods for change detection of salt-affected areas (Biskra area, Algeria). Journal of Applied Remote Sensing, 11 (1), 016025-1-016025-28. Research Online is the open access institutional repository for the University of Wollongong. For further information contact the UOW Library: [email protected] Assessment of remote sensing-based classification methods for change detection of salt-affected areas (Biskra area, Algeria) Abstract In the Wadi Biskra arid and semiarid areas, sustainable development is restricted by land degradation processes such as secondary salinization of soils. Being an important highquality date production region of Algeria, this area needs continuous monitoring of desertification indicators, hence highly exposed to climate- related risks. Given the limited access to field data, appropriate methods were assessed for the identification and change detection of salt-affected areas, involving image interpretation and automated classifications employing Landsat imagery, ancillary and multisource ground truth data. First, a visual photointerpretation study of the land cover and land use classes was undergone according to acknowledged methodologies. -

Democratic and Popular Republic Of
DEMOCRATIC AND POPULAR REPUBLIC OF BY Clifford J. Mugnier, CP, CMS, FASPRS G 8 u 08Majorca The Grids & Datums column has completed an exploration of a Tyrrhenian Sea ío Tagus R d ia na Valencia BALEARIC Sardinia Albacete Càgliari Lisbon Badajoz Ibiza ISLANDS (ITALY) Setúbal (SPAIN) Palermo Mediterranean Sea Trapani every country on the Earth. For those who did not get to enjoy this SPAIN Alicante Sicily PORTUGAL Murcia Córdoba Bordj Bou Strait of (ITALY) Arréridj Constantine Bizerte Sicily Sevilla Granada Cartagena Boumerdas Faro Huelva Tizi Skikda Annaba Tunis world tour the first time,PE&RS is reprinting prior articles from Algiers Ouzou Bejaïa Jijel Béja Isola di Jendouba Pantelleria Cadiz Málaga Almería Nabeul (ITALY) 36 Bouira El Kef 36 Strait of Gibraltar Gibraltar (U.K.) Mostaganem Chlef Blida Sétif Souk Ahras Sousse Tangier Ceuta (SP.) Arzew Médéa Kairouan NORTH Tétouan Melilla (SP.) Oran Oum el Bouaghi the column. This month’s article on the Democratic and Popular ’Aïn Relizane Batna Temouchent Mascara ATLANTIC Al Hoceïma Tébessa Kasserine Tiaret Chott el OCEAN Tlemcen Sidi Bel Bou Hodna O Oujda Saâda TUNISIA Sfax ue Abbès Saïda Biskra Chott Republic of Algeria was originally printed in 2001 but contains Rabat d Taza Djelfa Melrhir Kenitra Fès Gafsa Gabès S Chott ech Casablanca e a b Meknès y Chergui o u Tozeur El Jadida u o Medenine l Laghouat - u Zuwarah Tripoli Oued o Naama El Bayadh Chott el M El Oued updates to their coordinate system since then. Zem Oued Touggourt Jerid Tataouine Az Safi Zawiyah- MOROCCO Bou Arfa Aïn Sefra Figuig Ghardaïa Marrakech Er Rachidia -- Beni Ounif Hassi Messaoud Nalut Ouargla Kenadsa Béchar he area of Northern Africa currently known Ouarzazate Abadla El Golea Zagora - Tata d Drâa Ghadamis as Algeria was brought under Roman rule O ue Timimoun LIBYA during the Second Punic War (218 – 201 28 Bordj Omar Driss I-n-Amenas 28 Tindouf Adrar T I-n-Salah B.C.).