Lettres & Manuscrits Autographes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Download (7MB)
British Technologies and Polish Economic Development 1815-1863 Simon Niziol Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy London School of Economics and Political Science University of London December 1995 UMI Number: U084454 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U084454 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 "Theses . F 9555 . 12586 2-5 Abstract After the restoration of peace in 1815, several European countries sought to transform their economies by the direct borrowing of British technologies. One of these was the semi- autonomous Kingdom of Poland. The Kingdom's technology transfer initiatives have been largely ignored by foreign researchers, while Polish historians have failed to place developments in the Kingdom within a wider context of European followership. The varying fortunes of Polish transfer initiatives offer valuable insights into the mechanisms and constraints of the transfer process. A close study of attempts to introduce British technologies in mechanical engineering, metallurgy, railway construction, textile production and agriculture contradicts most Polish scholarship by establishing that most of the transfer initiatives were either misplaced or at least premature. -
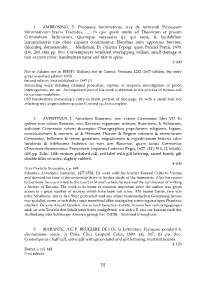
1 AMBROSINO, T. Processus Informativus, Sive De Formandi Processum Informativum Brevis Tractatus, ...In Quo Quam Multa Ad
1 AMBROSINO, T. Processus Informativus, sive de formandi Processum Informativum brevis Tractatus, ..... In quo quam multa ad Theoricam et praxim Criminalium Iudiciorum, Quamque necessaria ijs, qui rectè, & laudabiliter latrunculatoris nus obire cupiunt contineantur, Elenchus infra appositus breviter, dilucideq; demonstrabit ..... Mediolani, Ex Officina Typogr. quon Pacifici Pontii, 1600. (16), 240, (44) pp. 8vo. Contemporary wrinkled overlapping vellum, small damage at foot of front cover, handwritten name and title to spine. € 900 Not in Adams; not in BMSTC (Italian); not in Camus; Vinciana 1232 (1667 edition, the entry gives as earliest edition 1605). Second edition, first published in 1597 (?) Interesting work detailing criminal procedure: capture of suspects, investigation of proof, interrogations, etc. etc. An important part of the work is devoted to the practise of torture and its various modalities. Old handwritten ownership’s entry in blank portion of title-page, F6 with a small hole not affecting text, pagenumbering quire G mixed up, but complete. 2 AVENTINUS, J. Annalium Boiorum, sive veteris Germaniae libri VII. In quibus non solum Boiariae, sive Bavariae regionum, urbium, fluminum, & Syluarum, sedetiam Germaniae veteris descriptio Chorographica populorum, religionis, legum, constitutionum & morum, ut & Heroum, Ducum & Regum veterum & recentiorum Germaniae, bellorum & rerum gestarum, migrationum & expeditionum historia adeo luculenta & fidelissima habetur, ut non tam Bavariae, quam totius Germaniae Chronicon dicimereatur. Francoforti, impensis Ludovici Regis, 1627. (24), 514, (2, blank), (40) pp. Folio. 18th-century polished calf, red label with gilt lettering, raised bands, gilt double fillet on sides, slightly rubbed. € 600 Neue Deutsche Biographie , i, p. 469. Johannes Aventinus, historian, 1477-1534. He went with his teacher Konrad Celtis to Vienna and devoted his time at the university there to further study of the humanists. -
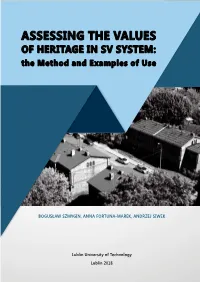
Assessing the Values of Heritage in Sv System
IWEK S . A AREK, M ASSESSING THE VALUES OF HERITAGE IN SV SYSTEM: . FORTUNA- A the Method and Examples of Use ZMYGIN, S B. SE U F ES O ES L XAMP E ETHOD AND AND ETHOD M YSTEM: THE THE YSTEM: S V V S ERITAGE IN IN ERITAGE H F UES O UES L ISBN 978-83-7947-290-1 BOGUSŁAW SZMYGIN, ANNA FORTUNA-MAREK, ANDRZEJ SIWEK SSESSING THE VA THE SSESSING A Lublin University of Technology Lublin 2018 ISBN 978-83-7947-290-1 ACADEMIC REVIEWERS: Marcin Gawlicki, Professor of Architecture Robert Hirsch, Professor of Architecture EDITOR: Katarzyna Choroś TRANSLATION: Arkadiusz Mikrut Agata Osińska GRAPHIC DESIGN: Aleksandra Laskowska PUBLISHER: Lublin University of Technology Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin PRINTED BY: Drukarnia Alf-Graf Abramowicka 6, 20-442 Lublin This monograph has been published as part of the project entitled: Smart Values – Scientific modern analysis of research topic; Values and valuation as the key factors in the protection, conservation and future modern utilization of the heritage – collaborative research of European cultural heritage. The project is co-financed by National Science Centre; Grant no.: DEC-2013/11/Z/HS2/00001 (UMO-2013/10/Z/HS2/00804) Special thanks to: Barbara Olejarz – Head of Ignacy Łukasiewicz Museum of Oil and Gas Industry in Bóbrka Maria Badeńska-Stapp – Municipal Historic Preservation Officer in Żyrardów Maciej Szymczyk, Ph.D. – Head of the Museum of Papermaking in Duszniki-Zdrój Bogusław szmygin, anna Fortuna-marek, andrzej siwek Lublin university of technology Politechnika Lubelska Lublin 2018 Lublin 2017 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS DETerminanTS, ASSUMPTIONS, HERITage valUE ASSESSMENT WITH SMART VALUE METHODOLOGY......................................................................................................... -
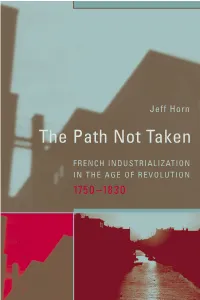
FRENCH INDUSTRIALIZATION in the AGE of REVOLUTION 175 0 –18 3 0 the Path Not Taken Transformations: Studies in the History of Science and Technology Jed Z
Jeff Horn The Path Not Taken FRENCH INDUSTRIALIZATION IN THE AGE OF REVOLUTION 175 0 –18 3 0 The Path Not Taken Transformations: Studies in the History of Science and Technology Jed Z. Buchwald, general editor Mordechai Feingold, editor, Jesuit Science and the Republic of Letters Sungook Hong, Wireless: From Marconi’s Black-Box to the Audion Jeff Horn, The Path Not Taken: French Industrialization in the Age of Revolution, 1750–1830 Myles Jackson, Spectrum of Belief: Joseph von Fraunhofer and the Craft of Precision Optics Mi Gyung Kim, Affinity, That Elusive Dream: A Genealogy of the Chemical Revolution John Krige, American Hegemony and the Postwar Reconstruction of Science in Europe Janis Langins, Conserving the Enlightenment: French Military Engineering from Vauban to the Revolution Wolfgang Lefèvre, editor, Picturing Machines 1400–1700 William R. Newman and Anthony Grafton, editors, Secrets of Nature: Astrology and Alchemy in Early Modern Europe Gianna Pomata and Nancy Siraisi, editors, Historia: Empiricism and Erudition in Early Modern Europe Alan J. Rocke, Nationalizing Science: Adolphe Wurtz and the Battle for French Chemistry The Path Not Taken French Industrialization in the Age of Revolution, 1750–1830 Jeff Horn The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England © 2006 Massachusetts Institute of Technology All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or information storage and retrieval) without permission in writing from the publisher. For information on quantity discounts, email special_sales@mit press.mit.edu. Set in Sabon by SPI Publisher Services. Printed and bound in the United States of America. -

IÉSEG Passport Is Very Complementary to the “Student Guide”
Summary IÉSEG School of Management Dean’s Message ........................................................................................................................................... p. 5 Associate Dean’s Message ....................................................................................................................... p. 6 About the school ......................................................................................................................................... p. 11 Application process Exchange Students ..................................................................................................................................... p. 17 Degree Seeking Students ......................................................................................................................... p. 22 Administrative formalities Registration .................................................................................................................................................... p. 24 Academic Life ................................................................................................................................................ p. 26 Learn French .................................................................................................................................................. p. 35 Establishing the residence permit .......................................................................................................... p. 37 Visits abroad and re-entry ...................................................................................................................... -

2012 British Scholar Conference
University of Dundee The Thread of Migration Bensimon, Fabrice; Whatley, Christopher Published in: Journal of Migration History DOI: 10.1163/23519924-00201005 Publication date: 2016 Document Version Peer reviewed version Link to publication in Discovery Research Portal Citation for published version (APA): Bensimon, F., & Whatley, C. (2016). The Thread of Migration: A Scottish-French Linen and Jute Works and its Workers in France, c. 1845–c. 1870 . Journal of Migration History, 2(1), 120-147. https://doi.org/10.1163/23519924-00201005 General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in Discovery Research Portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from Discovery Research Portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain. • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 27. Sep. 2021 “The thread of migration: a Scottish-French linen and jute works and its workers in France, c. 1845-c.1870”1 Fabrice Bensimon and Christopher A. Whatley Keywords: France; Scotland; Britain; Dundee; Jute; Linen; Spinning; Migration Short abstract: After 1815, European manufacturers in several sectors sought to reap the benefits of British technical superiority through the acquisition of British machinery and the workers who could operate this. -

Springer Handbookoƒ Computational Intelligence Kacprzyk Pedrycz Editors
Springer Handbookoƒ Computational Intelligence Kacprzyk Pedrycz Editors 123 Springer Handbook of Computational Intelligence Springer Handbooks provide a concise compilation of approved key information on methods of research, general principles, and functional relationships in physical and applied sciences. The world’s leading experts in the fields of physics and engineering will be as- signed by one or several renowned editors to write the chapters com- prising each volume. The content is selected by these experts from Springer sources (books, journals, online content) and other systematic and approved recent publications of scientific and technical information. The volumes are designed to be useful as readable desk reference book to give a fast and comprehen- sive overview and easy retrieval of essential reliable key information, including tables, graphs, and bibli- ographies. References to extensive sources are provided. HandbookSpringer of Computational Intelligence Janusz Kacprzyk, Witold Pedrycz (Eds.) With 534 Figures and 115 Tables K H Editors Janusz Kacprzyk Polish Academy of Sciences Systems Research Inst. ul. Newelska 6 01-447 Warsaw, Poland [email protected] Witold Pedrycz University of Alberta Dep. Electrical and Computer Engineering 116 Street 9107 T6J 2V4, Edmonton, Alberta, Canada [email protected] ISBN: 978-3-662-43504-5 e-ISBN: 978-3-662-43505-2 DOI 10.1007/978-3-662-43505-2 Springer Dordrecht Heidelberg London New York Library of Congress Control Number: 2015936335 © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015 This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilm or in any other way, and storage in data banks. -

Supplement Du Catalogue Officiel
SUPPLEMENT DU CATALOGUE OFFICIEL SUPPLEMENT TO THE OFFICIAL CATALOGUE A-Z PARTICIPANTS A Coll Judith SOTA LA PALMERA Convelbo Oriana ATMO LIVE Agnel Idriss LABEL ANDALOU Copelli Justin FACE B Albert Béatrice CONSERVATOIRE DARIUS Costes Julie COORDINACION OCCITANIA MILHAUD MUSICALA Aliou Doumbouya Mamadou AICHA MASSIATA Coulange Christine SISYGAMBIS / LES 7 DIT AICHA KONE PORTES Amir Danon Malki JERUSALEM SACRED Coumes Marie SIRVENTES MUSIC FESTIVAL Aniorte Paz Gil RADIO BABEL MARSEILLE D Atlan Françoise YEMAYA Attal Denis MCE PRODUCTIONS [Ensemble Dacheux Isabelle EIFEL Multitudes & L’Eolienne] Dahan Lionel THEATRE DU GYMNASE Aubry Maïwenn CAFÉ PLÙM Dambreville Jean-Philippe CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD B De Block Francois CIE DU TIRE-LAINE Derdák András FESTIVALUE Bachner Diane MAIRIE DE BOUC BEL AIR / d’Hauthuille Pauline BALLET PRELJOCAJ - SERVICE CULTURE PAVILLON NOIR Barreault Benoit CHAINON FNTAV Diaby Mohamed AICHA MASSIATA DIT AICHA Bazin Jean-Paul SPEDIDAM KONE Becker Dominique FCM Diouf Coumba Ndoffène ZENITH Berkani Kamilia RASM / CNRS PRODUCTIONS Bertrand Béatrice INSTITUT FRANÇAIS DE Djouma Bah Mamadou AICHA MASSIATA DIT PARTICIPANTS LYBIE AICHA KONE Besson François SACEM Dramé Seydou BEMA Bureau Export de la Bieuzent Yann LE PÔLE DE COOPERATION Musique Africaine CROSS REFERENCE POUR LES MUSIQUES ACTUELLES EN PAYS Drancey Céline PIRATES PRODUCTION DE LA LOIRE Duverger Martine FUTURS COMPOSES Blay Maria LIZARDQUEEN MUSIC Boer Caroline UNISSON PRODUCTION E Bouquet Gregoire BOA VIAGEM MUSIC Bouton Rémi BOUTON RÉMI Eitan. S MUSIC