Com- Ment S'en Sor- Tir Fémi- #1 Nismes Noirs
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Modemagazine in Japan
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Saitama University Cyber Repository of Academic Resources Fȱውɨ ዄĞ༳ʧૡዅȱۀÏŹƂʧ͗ Modemagazine in Japan Lars Bertramb Modemagazine sind neben der Vermittlung von Trends auch ein Gradmesser für die kulturelle Entwicklung einer Gesellschaft, da sich die individuelle Freiheit in der modischen Ausdrucksform widerspiegelt. Diese setzte erst gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts allmählich ein. In dieser Zeit wurden auch die heute noch führenden westlichen Modezeitschriften wie die amerikanische Harper`s BAZAAR (1867) oder die Vouge (1893) herausgebracht. Die Bandbreite der japanischen Modezeitschriften wird neben den großen Standardtiteln von vielen Trendmagazinen beherrscht, die nicht selten mit einer zoku (Ŧ) bzw. Subkultur in Verbindung stehen wie z. B. an-an oder non-no. Daneben gibt es Zeitschriften, die lediglich als roter Faden durch den Markenwald führen und den Kunden über neue Geschäfte, Produkte oder Modenschauen auf dem Laufenden halten. Die wichtigsten Magazine Als erste Modezeitschrift in Japan wurde 1936 von der Modeschule Bunka das Magazin Sōen herausgegeben, das die neueste Mode aus dem Westen vorstellte. Das Konzept war (ˎٍ) jedoch nur auf eine modeinteressierte weibliche Kundschaft ausgerichtet und diente mit ausführlichen Schnittmusterbögen hauptsächlich als Anleitungsheft zum Schneidern. Die ersten reinen Männermagazine kamen erst in den fünfziger Jahren mit Danshisenka (ɵʖ̞ Ŕ) und Men´s Club an die Kioske. Unter den anspruchsvolleren Magazinen, die neben Mode auch Kunst und japanische Tradition vorstellen, hat die 1958 gegründete Zeitschrift Kateigahō (˥°ɹî) Pionierarbeit geleistet. Das eigentliche Zeitalter der Modemagazine begann jedoch in den siebziger Jahren, als die auch heute noch beliebten und führenden Frauenmagazine wie non-no und an-an herauskamen. -

Media Industries and Related Research/ Japan
Department of Communication University of Helsinki Mapping Media and Communication Research: Japan Communication Research Center, University of Helsinki Department of Communication, Research Reports 4/2007 Dr. Katja Valaskivi Publisher: Type of publication: Communication Research Center, Department of Research report Communication; University of Helsinki Helsingin Sanomat Foundation Researchers: ISBN 978-952-10-4044-3 (nid.) Dr. Katja Valaskivi ISBN 978-952-10-4045-0 (PDF) Research assistant Hiromi Tsuji Research Project: Number of pages: 98 Mapping Media and Communication Research in Seven Countries Communication Research Center CRC Language: Director: Dr. Juha Herkman English Title of Report: Mapping Media and Communication Research: Japan Abstract: The objective of the report is to provide a general overview of media and communication research in Japan. The project maps the main institutions and organizations, approaches and national characteristics of the media and communication research in Japan. The gathering and analysis of the data has been carried out during the spring of 2007. The sample consists of secondary data in the form of previous studies and existing statistics, as well as primary data such as interviews of key persons in media and communication research branches and media industry. The report examines the media and communication research conducted at the most prominent research universities, the research published by academic associations, and those conducted by the largest public and private research institutes and think tanks with affiliations to some of the largest Japanese media companies. It also gives a general outline of the historical development and the current situation of the Japanese media industry and market, including reference to current content and user trends. -

El Colegio De México IDENTIDADES JUVENILES DE HARAJUKU Y SU
El Colegio de México IDENTIDADES JUVENILES DE HARAJUKU Y SU REPRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA EN LA REVISTA FRUiTS Tesis presentada por ITZEL VALLE PADILLA en conformidad con los requisitos establecidos para recibir el grado de MAESTRA EN ESTUDIOS DE ASIA Y ÁFRICA ESPECIALIDAD EN JAPÓN Centro de Estudios de Asia y África 2009 Índice 1. Introducción............................................................................................................ 2 2. Difusión de modelos identitarios a través de la imagen 2.1 Imagen, industria cultural y medios de comunicación en Japón........................... 8 2.2 Vendiendo FRUiTS al mundo: Aoki Shōichi …………………………………….11 3. Conformación de identidades juveniles en Harajuku 3.1 Harajuku: espacio de identidad y consumo............................................................ 16 3.2 Identidades urbanas y juveniles de Tokio............................................................... 25 4. Representación fotográfica y construcción de identidades híbridas 4.1 La imagen fotográfica............................................................................................. 33 4.2 La representación y el retrato................................................................................. 36 4.3 Identidades híbridas de Harajuku.......................................................................... 40 4.4 Análisis de imágenes de la revista FRUiTS……………………………………… 53 5. Conclusión............................................................................................................... 60 6. Fuentes -

Bibliography
Bibliography Art Exhibits, Film, Music, Performances, and Television Sources Ai no Koriida (In the realm of the senses). Film directed by Kshima Nagisa, 1976. “Burando (Brand).”Serialized television drama produced and directed by Wada Kk. Japan, 2000. Frank Chickens. “We Are Ninja (Not Geisha).” LP Record Album. Produced by Kaz Records, 1984. Heaven 17.“Geisha Boys and Temple Girls.”Album title: Pavement Side. Produced by Virgin Records, 1981. Ippai no kakesoba (A bowl of buckwheat noodles). Film directed by Nishikawa Katsumi, 1992. Jitsuroku Abe Sada (The true story of Abe Sada). Film directed by Tanaka Noboru, 1975. Lynn, Vera. Lynn, Vera Singer, 2004 [cited 26 April]. Available from Ͻhttp://www.lyricsxp. com/lyrics/w/we_ll_meet_again_vera_lynn.htmlϾ Nagasaki University Database of Old Photographs of the Bakumatsu-Meiji Period. Online at Ͻhttp://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/unive/Ͼ “New Cosmos of Photography” (Shashin shin-seiki) sponsored by Canon, 1995 Gallery Exhibition Report. Online at Ͻhttp://www.canon.com/scsa/newcosmos/gallery/1995/Ͼ Parker, Ross and Hughie Charles. We’ll Meet Again, 2004 [cited 26 April]. Available from Ͻhttp://ingeb.org/songs/wellmeet.htmlϾ Revolutionary Girl Utena (Shkjo kakumei Utena). Animation. Japanese TV series April 2–December 24, 1997; movie, 1999. Sunayama, Norico. “English invitation for entering her installation, ‘Suffocating World.’ ” Art Tower Mito, 1999. Women in Japan: Memories of the Past, Dreams for the Future. Documentary film produced and directed by Joanne Hershfield and Jan Bardsley, 2002. Manga, Magazine, Newspaper, and Websites (no author given) “Abe Sada-Sakaguchi Ango taidan (Dialogue: Abe Sada-Sakaguchi Ango).” Zadan 1, no. 1 (1947): 30–35. -

SKU Product Issues Years Price 45532 10 Magazine (UK) 4 1
SKU Product Issues Years Price 45532 10 Magazine (UK) 4 1 $99.00 45533 10 Men (UK) 4 1 $99.00 45535 18 Karati (Italy) 6 1 $159.00 48210 25Ans (Japan) 12 1 $259.00 51800 2nd (Japan) 12 1 $259.00 45179 4TH D Wellbeing 12 1 $60.00 51633 5280 (Denver) Magazine 12 2 $12.00 51634 5280 Home 6 2 $9.00 45761 Abitare (Italy) 11 1 $259.00 51635 Accent West 12 2 $17.98 3158 Acoustic Guitar 6 3 $40.00 63158 Acoustic Guitar - Digital 6 3 $40.00 44101 Acres USA 12 2 $39.00 1108 Action Comics 12 1 $29.99 4446 ADDitude 4 1 $19.95 48361 Adventist Review 12 1 $36.95 61653 Adweek - Print + Digital 33 1 $149.00 51905 Aero 12 1 $29.99 45834 Aesthetica (UK) 6 1 $99.00 45222 AFAR 6 3 $14.00 45334 Affordable Housing Finance 6 1 $119.00 42696 African American Golfers Digest 4 3 $48.00 61636 African Voices (2 print + 1 digital issue) 3 1 $22.50 40031 Against the Current 6 2 $30.00 51879 AgPro 12 1 $45.00 4779 Ahora 6 1 $34.95 313 Alaska 10 2 $24.00 2 Alfred Hitchcock's Mystery 6 1 $34.97 4772 Allons-y! 6 1 $34.95 40151 Alpinist 4 2 $49.95 48481 Alter Ego 6 1 $69.00 40984 Alternative Medicine 6 1 $19.95 1066 Amazing Spider-Man 12 1 $29.99 3366 America The Jesuit Review 14 1 $58.00 51415 American Bungalow 4 2 $34.95 61145 American Cake Decorating - Digital 6 2 $29.00 42678 American Conservative 6 1 $59.95 62678 American Conservative - Digital 6 1 $24.95 47005 American Craft 6 2 $50.00 48451 American Digger 6 2 $37.95 4922 American Farmhouse Style 6 2 $29.95 44517 American Fly Fishing 6 1 $29.95 61480 American Football Monthly - Digital 6 1 $20.00 4919 American Frontiersman -

Intellectual Capital for Communities - Fourth Edition
HOW TO IMPLEMENT THE KNOWLEDGE ECONOMY PRINCIPLES ~Japanese perspective~ Keita Nishiyama METI, Japan May, 2008 World Conference on Intellectual Capital for Communities - Fourth Edition - 1 22-23 May 2008 -Background -What’s missing in financial information? -Elements of Intellectual Assets based Management -Experiences in Japan -Efforts in the World -Next Step & WICI 22-23 May 2008 World Conference on Intellectual Capital for Communities 2 - Fourth Edition - Era of Differentiation & Intellectual Assets (IAs) Aging economy with Global competition Knowledge Economy less population → Emerging economies →Intangible →Smaller domestic are more cost-competitive market assets became more valuable Creating values/profits by making products or services different from others is essential for business. IA based management which realizes the differentiation through utilizing company’s unique IAs for sustainable profits has become more critical. note:IAs include human resources, organizational capabilities, technology, and relational capital. 22-23 May 2008 World Conference on Intellectual Capital for Communities 3 - Fourth Edition - Elements of IA Financial Assets Intellectual Assets Corporate Assets Classification of Intellectual Assets Human Boundary of company Cliental Financial Capital/Assets Money NW Organi zation Human Assets Facilities Intellectual Capital/Assets Technology/IP Brand/ reputation Relational Assets Organizational Creation for Value / Profit Assets 22-23 May 2008 World Conference on Intellectual Capital for Communities 4 - Fourth -

Tokyo Ribelle: Processi Di Formazione Delle Subculture Giovanili Di Shibuya E Harajuku
Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa Mediterranea Tesi di Laurea Tokyo Ribelle: Processi di formazione delle subculture giovanili di Shibuya e Harajuku Relatore Prof.ssa Roberta Novielli Correlatore Prof.ssa Paola Scrolavezza Laureando Federica Zaghini Matricola 827802 Anno Accademico 2014/ 2015 要旨 本論文の目的は東京におけるユースサブカルチャー(若者文化)を分析するため、その 原因と素因を検討することである。特に、渋谷の「ギャル」サブカルチャーと原宿の「ロ リータ」と「デコラ」サブカルチャーを代表とした若者文化の特徴を考慮することにした。 日本の若者文化を分析した理由は、渋谷や原宿から生まれた若者文化はパンク(punk)や ゴス(goth)など西洋の若者文化と比べると、唯一の特性を持ち、現在では自分のアイデ ンティティーを確立するための手段として世界中の若者たちに影響を与えるからである。 本論の講成については次の通りである。 はじめに、序論でユースサブカルチャーについて基本的な概念を紹介する。第一章でメ インカルチャーとサブカルチャーの違いを説明した上で、ヘブディジ氏の作品による「象 徴」の概念も紹介する。次に、日本の戦争後の社会的な状態を解析し、若者文化の発生の 原因にさかのぼる。これまでの研究では、サブカルチャーは社会、景気、また価値の危機 状況から発生する現象であると言われており、危機状況に直面してしまう若者たちはどの ように反応するか、またそれに対し社会はどのように変化するかについて詳しく分析して いく。 続いて、第二章ではユースサブカルチャーに影響を与えた基本要素を検討する。日本社 会では「世間体」という概念は重要だと考えられている。しかし、若者文化といえば、普 通とは異なる外見であろう。このことについて、第一の基本要素と考えられる日本社会に おける「一様性」を考慮していく。次に、調査された若者文化は女性のほうが優位である ため、「かわいい文化」や「少女文化」などの女性文化はどのような影響を与えたか、そ してなぜ「かわいい」という概念は反抗的な性質があるといえるかなどを分析する。 また、80年代の半ば、ポケベルをはじめ、PHS、携帯電話など新しい通信が開発され ると共に、人間関係も変化を示している。従って、「ギャル文字」や「ポケ言葉」など若 者たち以外に分からない暗語が生み出され、サブカルチャーのコミュニケーション方法を 感化したのである。さらに、以上述べたように、若者文化の外見は特異であるし、サブカ ルチャーの異様なファッションはコスプレと誤解することがよくある。異様なスタイルに もかかわらず、サブカルチャーのファッションはただの遊びではなく、自分のアイデン 2 ティティーを確立する方法だといえる。 そこで、第三章では若者たちはどのようにして東京の場所と関係を作るようになること について考慮してく。サブカルチャーの種類は場所によって異なるため、難波功士氏の研 究による「族」と「系」という種類の違いを詳しく検討する。 最後に、第四章では第三章までに検討された基本要素を通じ、サブカルチャーについて さらに分析していく。まず第一に、「ギャル」サブカルチャーを中心にしてその起源、反 -

Fall 2013 Newsletter
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA BARBARA EAST ASIAN LANGUAGES & CULTURAL STUDIES Departmental Newsletter Words from the Chair Volume 6 The East Asian region is more and Fall 2013 more relevant in international Chair’s Letter 1 society and culture, and Mission Statement 2 developments there affect in Sabine Frühstück: 2 significant ways also our lives in The Uses of Popular Culture for Sex and Violence the US. Economic developments, political events, international Chinese Corner 3 conflicts and cooperation, and Japanese Corner 5 cultural activities receive wide Center for Taiwan Studies (CTS) 6 coverage in the international News and Events, 2012-13 Fabio Rambelli - Chair media. The Department of East Recent Activities and Publications 8 Asian Languages and Cultural – EALCS Faculty Recent Activities and Publications 16 Studies serves as an important hub for research, education, – Lecturers Recent Activities and Publications 16 and cultural awareness on East Asian matters at the University – Graduate Students of California, Santa Barbara and in the larger Santa Barbara Recent Activities and Publications 16 – Affiliates community. Our mission is to make the news more intelligible by providing linguistic, cultural, and historical contexts to Wada Atsuhiko: 18 How Books Reach Readers current developments, but also to challenge mainstream media coverage by offering our students deeper knowledge Graduate Student Profile: ChunHui Chang 19 and alternative visions of East Asian cultures in the present Corey Byrnes Interview 21 and in the past. This year, we welcome a new faculty member, Nathaniel Smith Farewell 20 professor Corey Byrnes, who will join us in fall 2013 to Shinto Chair & Department Conferences 22 teach courses related to classical Chinese literature and Japan Foundation Summer Institute 2013 24 Chinese cultural history. -
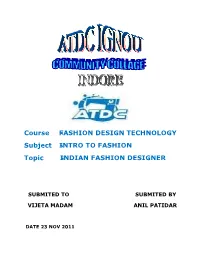
Course FASHION DESIGN TECHNOLOGY Subject INTRO TO
Course FASHION DESIGN TECHNOLOGY Subject INTRO TO FASHION Topic INDIAN FASHION DESIGNER SUBMITED TO SUBMITED BY VIJETA MADAM ANIL PATIDAR DATE 23 NOV 2011 This is a list of fashion magazines. Name Country Year Websites acne Paper Sweden 2005 www.acnepaper.com aneCan Japan 2007 www.anecan.tv CanCam Japan 1981 cancam.tv Classy Japan 1984 Complex United States 2002 www.complex.com c. Cosmode Japan www.cosmodeonline.com 2002 United Dazed & Confused 1992 www.dazeddigital.com Kingdom USA, Russia, DEPESHa 2007 www.depesha.com Germany DesignerzCentral Netherlands 2008 The Delineator United States 1873 (defunct) Egg Japan eggmgg.jp Eliza United States 2007 www.elizamagazine.com Elle 26 countries 1945 elle.com several Elle Girl 2001 ellegirl.elle.com countries United The Face (defunct) 1980 Kingdom Flawless Magazine International 2011 [1] Fashion Canada 1977 Fashion Central Pakistan 2007 www.fashioncentral.pk Fashion Forward Israel 2011 Flaunt United States 1998 FRUiTS Japan 1997 La Gazette du Bon France 1912 Ton (defunct) Happie Nuts Japan 2004 www.h-nuts.com Harper's Bazaar United States 1867 United i-D 1980 Kingdom InStyle United States 1993 United InStyle UK 2001 www.instyle.com Kingdom JJ Japan 1975 Jane (defunct) United States 1997 janemag.com Name Country Year Websites Koakuma ageha Japan 2005 United Look 2007 Kingdom Lucire New Zealand 1997 Lucky United States 2000 Magazine Café Sweden 1990 Manhattan Fashion United States 2009 manhattanfashionmagazine.com Magazine Mao Mag United States 2003 MenzMag United States 2009 nicola Japan 1997 Nifty -
Intellectual Capital for Communities in the Knowledge Economy Nations
HOW TO IMPLEMENT THE KNOWLEDGE ECONOMY PRINCIPLES ~Japanese perspective~ Keita Nishiyama METI, Japan May, 2008 World Conference on Intellectual Capital for Communities - Fourth Edition - 1 22-23 May 2008 -Background -What’s missing in financial information? -Elements of Intellectual Assets based Management -Experiences in Japan -Efforts in the World -Next Step & WICI 22-23 May 2008 World Conference on Intellectual Capital for Communities 2 - Fourth Edition - Era of Differentiation & Intellectual Assets (IAs) Aging economy with Global competition Knowledge Economy less population → Emerging economies →Intangible →Smaller domestic are more cost-competitive market assets became more valuable Creating values/profits by making products or services different from others is essential for business. IA based management which realizes the differentiation through utilizing company’s unique IAs for sustainable profits has become more critical. note:IAs include human resources, organizational capabilities, technology, and relational capital. 22-23 May 2008 World Conference on Intellectual Capital for Communities 3 - Fourth Edition - Elements of IA Financial Assets Intellectual Assets Corporate Assets Classification of Intellectual Assets Human Boundary of company Cliental Financial Capital/Assets Money NW Organi zation Human Assets Facilities Intellectual Capital/Assets Technology/IP Brand/ reputation Relational Assets Organizational Creation for Value / Profit Assets 22-23 May 2008 World Conference on Intellectual Capital for Communities 4 - Fourth -

New Aesthetics on Makeup for Overturning the Traditional Japanese Beauty
University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Masters Theses Dissertations and Theses July 2021 Beautiful "Looks" Created by Women: New Aesthetics on Makeup for Overturning the Traditional Japanese Beauty Yurina Yoshikawa University of Massachusetts Amherst Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/masters_theses_2 Part of the Japanese Studies Commons Recommended Citation Yoshikawa, Yurina, "Beautiful "Looks" Created by Women: New Aesthetics on Makeup for Overturning the Traditional Japanese Beauty" (2021). Masters Theses. 1082. https://doi.org/10.7275/22925461.0 https://scholarworks.umass.edu/masters_theses_2/1082 This Open Access Thesis is brought to you for free and open access by the Dissertations and Theses at ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Masters Theses by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. Beautiful “Looks” Created by Women: New Aesthetics on Makeup for Overturning Traditional Japanese Beauty A Thesis Presented by YURINA YOSHIKAWA Submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts Amherst in partial fulfillment Of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS May 2021 Japanese East Asian Languages and Cultures BEAUTIFUL “LOOKS” CREATED BY WOMEN: NEW AESTHETICS ON MAKEUP FOR OVERTURNING TRADITIONAL JAPANESE BEAUTY A Thesis Presented by YURINA YOSHIKAKWA Approved as to style and content by: _______________________________________ Amanda C. Seaman, Chair _______________________________________ Bruce Baird, Member _______________________________________ Sharon Domier, Member _______________________________________ Bruce Baird, Unit Director East Asian Languages and Cultures Program Department of Languages, Literatures and Cultures _______________________________________ Robert G. Sullivan, Chair Department of Languages, Literatures and Cultures ACKNOWLEDGEMENTS I would like to express my great appreciation of my advisor, Professor Amanda C. -

April 2008 and 2009
Milan/Salone, the world’s most prestigious furniture fair, said to be most difficult to participate in (April 2008 and 2009). These activities have generated numerous outcomes, such as contracting with overseas retailers and features by both national international media. METI will continue organizing Japan Fair exhibitions at well-known trade fairs as integrated efforts of public and private sectors, providing information to domestic business operators and supporting the expansion of sales channels before, during and after the fairs. (d) Efforts to strengthen design industry Japan established the Good Design Award to recognize designs with excellence in 1957 and recently promotes futuristic designs under the theme of “From the Demand Side in the Near Future.” The Good Design Award had traditionally focused on products sold in Japan but has been opened to products to be sold overseas since FY2005, increasing its reputation throughout the world. Efforts are currently taking place to raise awareness of the high quality of Japan’s designs by expanding this award in Asia and other countries. A collaboration system with a design award in Thailand was just established in 2008. In 2007, METI formulated the “Kansei Value Creation Initiative” to promote manufacturing that focuses on “Kansei (sensitivity or sense cultivated by national traditions and cultures),” which is an important element of design. METI held the Kansei-Japan Design Exhibition in Paris in December 2008 aiming to advocate the production of goods with values, refined skills of producers as well as history and culture that would appeal to the sense of users, intrigue them and arouse their emotions in addition to conventional values such as functionality and price.