Lionel Groulx Et La Révolution Tranquille Sylvie Beaudreau
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Good Fight Marcel Cadieux and Canadian Diplomacy
THE GOOD FIGHT MARCEL CADIEUX AND CANADIAN DIPLOMACY BRENDAN KELLY UBC PRESS © SAMPLE MATERIAL CONTENTS Foreword / ix Robert Bothwell and John English Preface / xii 1 The Birth of a French Canadian Nationalist, 1915–41 / 3 2 Premières Armes: Ottawa, London, Brussels, 1941–47 / 24 3 The Making of a Diplomat and Cold Warrior, 1947–55 / 55 4 A Versatile Diplomat, 1955–63 / 98 5 Departmental Tensions: Cadieux, Paul Martin Sr., and Canadian Foreign Policy, 1963–68 / 135 6 A Lonely Fight: Countering France and the Establishment of Quebec’s “International Personality,” 1963–67 / 181 7 The National Unity Crisis: Resisting Quebec and France at Home and in la Francophonie, 1967–70 / 228 UBC PRESS © SAMPLE MATERIAL CONTENTS 8 The Politician and the Civil Servant: Pierre Trudeau, Cadieux, and the DEA, 1968–70 / 260 9 Ambassadorial Woes: Washington, 1970–75 / 296 10 Final Assignments, 1975–81 / 337 Conclusion / 376 Acknowledgments / 380 List of Abbreviations / 382 Notes / 384 Bibliography / 445 Illustration Credits / 461 Index / 463 UBC PRESS ©viii SAMPLE MATERIAL 1 THE BIRTH OF A FRENCH CANADIAN NATIONALIST, 1915–41 n an old christening custom that is all but forgotten today, Joseph David Roméo Marcel Cadieux was marked from birth by a traditional IFrench Canadian Catholicism. As a boy, he was named after Saint Joseph. The Hebraic David was the first name of his godfather, his paternal grandfather, a Montreal plasterer. Marcel’s father, Roméo, joined the Royal Mail and married Berthe Patenaude in 1914. She was one of more than a dozen children of Arthur Patenaude, a “gentleman” landowner whose family had deep roots in what had once been the Seigneury of Longueuil, on the south shore of the St. -
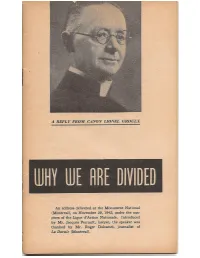
Lionel-Groulx-Why-We-Are-Divided.Pdf
TRANSLATOR'S FORWORD We humans like to believe what we want to believe. Unfortunately what we want to believe is not always true. One of the things which we want to believe is that other people are responsible for all that is wrong in the world. But of course it is at least possible that we have some faults ourselves. And if someone would only tell us what they are, it would be much easier for us to correct them than it is for us to correct the other fellow's faults. All is not well in Canada today. Out two great cultural groups, the French and the English, are not getting along together as well as they should. Whose fault is it? Before we can do anything about the situation we must be sure that we know exactly what the real causes of division are, — especially those for which our own group is responsible. Then we must try to remove these causes. It is easy for French-speaking people to hear what French speakers think about the question, and it is equally easy for English-speaking people to hear it discussed by English speakers. But it would be more profitable if each group could open-mindedly listen to those who best represent the other. And this does not mean listening carefully selected members of the other group whose views happen to be the same as ours, rather than the same as the majority of their own people. If we wish to know why most French Canadians do not like the National Resources Mobilization Act, for instance, we should ask one who voted “NO” in the plebiscite, rather than one of the small minority in Quebec who voted “YES”. -

History of Québec and Canada: 1840–1945
HST-4103-2 History of Québec and Canada: 1840–1945 History of Québec and Canada HST-4103-2 History of Québec and Canada, 1840-1945 HST-4103-2 History of Québec and Canada: 1840–1945 INTRODUCTION The History of Québec and Canada: 1840-1945 course contains two objects of study: the historical periods defined by key events in the history of Québec and Canada, and social phenomena related to human action in a given socio-historical context, chosen based on the association of the phenomena with major changes. By the end of the course, adult learners will be able to characterize and interpret particular features of the history of Québec and Canada from 1840 to 1945. The aim of the History of Québec and Canada: 1840-1945 course is to develop the two subject-specific competencies of the History of Québec and Canada program: 1. Characterizes a period in the history of Québec and Canada 2. Interprets a social phenomenon SUBJECT-SPECIFIC COMPETENCIES The following table lists, for each competency, the key features studied in this course. The manifestations of the key features are presented in Chapter 3. Table 9 – Key Features of Subject-Specific Competencies Competency 1 Competency 2 Characterizes a period in the Interprets a social history of Québec and Canada phenomenon . Establishes historical facts . Defines the object of interpretation . Establishes a chronology . Analyzes a social phenomenon . Considers geographical features . Ensures the validity of his/her interpretation Diversified Basic Education Program, History of Québec and Canada 3 HST-4103-2 History of Québec and Canada, 1840-1945 HISTORICAL METHOD In the history program, adult learners use the historical method when analyzing social phenomena. -

The Roots of French Canadian Nationalism and the Quebec Separatist Movement
Copyright 2013, The Concord Review, Inc., all rights reserved THE ROOTS OF FRENCH CANADIAN NATIONALISM AND THE QUEBEC SEPARATIST MOVEMENT Iris Robbins-Larrivee Abstract Since Canada’s colonial era, relations between its Fran- cophones and its Anglophones have often been fraught with high tension. This tension has for the most part arisen from French discontent with what some deem a history of religious, social, and economic subjugation by the English Canadian majority. At the time of Confederation (1867), the French and the English were of almost-equal population; however, due to English dominance within the political and economic spheres, many settlers were as- similated into the English culture. Over time, the Francophones became isolated in the province of Quebec, creating a densely French mass in the midst of a burgeoning English society—this led to a Francophone passion for a distinct identity and unrelent- ing resistance to English assimilation. The path to separatism was a direct and intuitive one; it allowed French Canadians to assert their cultural identities and divergences from the ways of the Eng- lish majority. A deeper split between French and English values was visible before the country’s industrialization: agriculture, Ca- Iris Robbins-Larrivee is a Senior at the King George Secondary School in Vancouver, British Columbia, where she wrote this as an independent study for Mr. Bruce Russell in the 2012/2013 academic year. 2 Iris Robbins-Larrivee tholicism, and larger families were marked differences in French communities, which emphasized tradition and antimaterialism. These values were at odds with the more individualist, capitalist leanings of English Canada. -

Le Xviir Siecle Canadien: Etudej. Montreal, Editions HMH, 1968. 387 Pp
GUY FREcAULT. - Le XVIIr Siecle canadien: etudej. Montreal, Editions HMH, 1968. 387 pp. A Canada Council grant facilitated the publication of this volume of articles and essays by Guy Fregault, deputy minister of Quebec's ministere des Afiaires culturelles since 1961, and French Canada's most eminent neo nationalist historian before that date. One item, "La Nouvelle-France, territoire et population", now appears in print for the first time. The .other six were originally published between 1956 and 1961 in various learned journals. Topically, they cover a broad range of subjects : finance, the fur trade, govern ment and politics, the Church, intercolonial rivalry. Thematically, they are visibly interconnected. Implicitly at least, Fregault's historical writing of the 1950s was a rebuttal of the interpretation which traditional nationalist historians, led by Lionel Groulx, had placed on the evolution of New France. Convinced that French Canada would survive only as long as it remained different from neighbouring North American societies, Groulx had used history to reinforce Quebec's particularism. He had claimed that before 1760, Roman Catholicism and agriculture had combined to mould a spiritual French Canadian civilization which it was the duty of his contemporaries to preserve. Fregault, on the other hand, was a product of the period which preceded the official beginning of the Quiet Revolution in 1960. One cannot help hut feel that, perhaps unconsciously, he was using history to legitimize the aspirations of modem Quebec. At a time when French Canada was being absorbed into the main stream of North American Life, Fregault argued the central thesis that even before the conquest there had been essential similarities - not differences - between New France and the English colonies which had not, however, eroded the French community's will to maintain a separate existence. -

Historical Writing and Social Change in Quebec
Ronald Rudin. Making History in Twentieth-Century Quebec. Toronto: University of Toronto Press, 1997. xiii +285 pp. $55.00, cloth, ISBN 978-0-8020-7838-4. Reviewed by Myron Momryk Published on H-Canada (March, 1999) Historical Writing and Social Change in Que‐ historical profession in Quebec. As an active bec member of the historical profession in Quebec, Prof. Ronald Rudin, a professor of history at Prof. Rudin provides an "insider" point of view. Concordia University in Montreal, has written an During his research, Prof. Rudin had access to impressive and controversial analysis of Quebec records of historical associations and private pa‐ historiography in the twentieth century. This pers of some Quebec historians. In this study, he study which has already been translated into deals almost exclusively with French-speaking French, is the subject of continuing debates with‐ historians in Quebec. in the Quebec historical community. He is the au‐ In his frst chapter, "Not Quite a Profession: thor of several historical studies in the 1970s and The Historical Community in Early-Twentieth- 1980s and in general adhered to the "Revisionist" Century Quebec", Prof. Rudin focuses on the life interpretation of Quebec history. Prof. Rudin and career of Abbe Lionel Groulx. Beginning as a states in the Preface that he was led to this study lecturer in Montreal during the First World War, through his interest in Irish history, which had Groulx followed in the tradition of other patriot- some of the same historiographical problems as priests in submerged Roman Catholic societies Quebec history. In the Introduction, Prof. Rudin such as Ireland and Poland and sought to teach claims that his intention was to examine the rela‐ history as means to defend his nationality and re‐ tionship between historical writing and social ligion by promoting patriotism and nationalism. -

Pan-Americanism Re-Invented in Uncle Sam's Backyard: Catholic and Latin Identity in French Canada and Mexico in the First Half of the 20™ Century
PAN-AMERICANISM RE-INVENTED IN UNCLE SAM'S BACKYARD: CATHOLIC AND LATIN IDENTITY IN FRENCH CANADA AND MEXICO IN THE FIRST HALF OF THE 20™ CENTURY MAURICE DEMERS A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY GRADUATE PROGRAM IN HISTORY YORK UNIVERSITY, TORONTO, ONTARIO FEBRUARY 2010 Library and Archives Biblioth&que et 1*1 Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de I'Sdition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre reference ISBN: 978-0-494-64869-8 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-64869-8 NOTICE: AVIS: The author has granted a non- L'auteur a accorde une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant a la Bibliotheque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par telecommunication ou par I'lnternet, preter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des theses partout dans le loan, distribute and sell theses monde, a des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non- support microforme, papier, electronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protege cette these. Ni thesis. Neither the thesis nor la these ni des extraits substantiels de celle-ci substantial extracts from it may be ne doivent etre imprimes ou autrement printed or otherwise reproduced reproduits sans son autorisation. -

Historic Roots and Socio-Economic Consequences of the Separatist Movement in Quebec
Historic Roots and Socio-economic Consequences of the Separatist Movement in Quebec Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades einer Doktorin der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien eingereicht bei Erster Betreuer: Ord.Univ.Prof. Dr. Hugh D. Purcell Zweiter Betreuer: Ord.Univ.Prof. Dr. Herbert Matis Fachgebiete: Englisch, Wirtschaftsgeschichte, Internationale Politökonomie von Mag. Karin R. Kollenz MBA Wien, im Mai 2000 Karin R. Kollenz: Historic Roots and Socio-economic Consequences of Separatism I Table of Contents 1. Introduction .......................................................................................................................... 1 2. The Historic Roots of the Separatist Movement in Quebec ............................................. 3 2.1 The British Conquest – a Clash of Two Nations.............................................................. 3 2.2 The Consequences of the Conquest.................................................................................. 6 2.3 Assimilation or Acceptance.............................................................................................. 9 2.4 The Mount of Political Unrest and Ethical Conflict....................................................... 12 2.5 Towards a New Constitution.......................................................................................... 15 2.6 The Foundation of the Canadian Confederation ............................................................ 16 2.7 The Métis Conflict ........................................................................................................ -

This Thesis Has Been Submitted in Fulfilment of the Requirements for a Postgraduate Degree (E.G
This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. VETERA NOVIS AUGERE NATIONALISM, NEO- THOMISM AND HISTORIOGRAPHY IN QUEBEC AND FLANDERS 1900-1945 PhD Canadian Studies University of Edinburgh 2017 Kasper Swerts Signed Declaration I declare that this thesis was composed by myself, that the work contained herein is my own except where explicitly stated otherwise in the text, and that this work has not been submitted for any other degree or professional qualification except as specified. Parts of this work have been published in Dutch Crossing: Journal of Low Countries Studies as “A Flemish Nozdormu? Teleology and Philosophy of History in the Writings of Hendrik Jozef Elias”. Kas Swerts June 10, 2018 i ‘You know, a dissertation is largely comprised of other dissertations,’ Kolibril explained. ‘A new dissertation is always some sort of orgy from preceding dissertations which, uhm…, fecundate each other to bring forward something new, that did not exist before.’ Professor Kolibril, Rumo & de Wonderen in het donker, pp.156. -

Reflections on Antisemitism in French Canada
90 Ira Robinson / Reflections on Antisemitism in French Canada Ira Robinson Reflections on Antisemitism in French Canada Canadian Jewish Studies / Études juives canadiennes, vol. 21, 2013 [2014] 91 Et, pour vrai dire, what more political is there to say after you have said : À bas les maudits Juifs! A. M. Klein1 Introduction It is more than appropriate that we are gathered together at this conference to hon- our Gerald Tulchinsky for his work that has served to shape the contours of Canadian Jewish history in the past two decades in which Canadian Jewish studies has arguably become a field of its own.2 He represents the transition from the community-based historiography of Cana- dian Jewry, as represented by the work of B.G. Sack, Louis Rosenberg, and David Rome, to take three distinguished examples, to that of university-trained and based academics. It is telling that in his survey of the historiography of the Jews of Canada in his initial 1992 history, Taking Root: the origins of the Canadian Jewish Community, Tulchinsky acknowledges only three academic predecessors, all of whose works had preceded his own book by less than a decade: Bernard Vigod (1984), Michael Brown (1986), and Irving Abella (1990).3 Of these three, it is evident that Brown’s book made the most impression on him, as the other two books are described in a sentence apiece, whereas Brown’s Jew or Juif is given four meaty sentences which conclude with the statement that the book “will remain an important point of departure for students in this field for years to come.”4 This presentation will look at one of the theses of Michael Brown’s book that im- pressed Tulchinsky: “the rejection of Catholic Québec as a major conditioning factor in the Canadian Jewish experience”. -
Parti Pris, the Front De Libération Du Québec, and the Catholicity of Québécois Anticlericalism, 1963-1970
PARTIPRIESTS and FRÈREQUISTES? Parti Pris, the Front de libération du Québec, and the Catholicity of Québécois Anticlericalism, 1963-1970 by Carly Lynn Ciufo A thesis submitted to the Department of History in fulfillment of the requirements of the degree of Master of Arts Queen’s University Kingston, ON Canada September 2012 Copyright © Carly Lynn Ciufo 2012 ABSTRACT On March 7 1963, some bombs exploded at a few military barracks in Québec. These blasts announced the start of a campaign mounted by the Front de libération du Québec (FLQ). The founders of Parti Pris responded in intellectual solidarity with the FLQ’s motives by publishing their first issue in October. By 1968, Parti Pris ceased publication. After the October Crisis in 1970, the FLQ was widely discredited. Although many Partipristes and Felquistes dispersed into more generalized circles of local activism and party politics, they defined, informed, and mobilized a new generation of Québécois towards national liberation between 1963 and 1970. During their time of influence, Partipristes and Felquistes consistently pointed to a Catholic morality in Québec that revered passivity as a root cause and symptom of their colonial oppression. Some historians have suggested they were aberrant apostles of rupture with Québec’s history and traditions. This sort of reading finds some basis in declamations of the radicals themselves. But this thesis argues that both Parti Pris and the FLQ were developments of, and not definitive breaks with, Québec’s Catholic tradition. By analyzing the writings of Partipristes Paul Chamberland, André Major, and Pierre Maheu alongside those of Felquistes Pierre Vallières and Francis Simard, it claims that no historical appreciation of their lives and generation can sidestep the Catholicism that shaped them as individuals and the social milieu to which they responded. -

Bourassa's Anniversary Speech Touched on Many of the Criticisms Directed at Him Over the Last Five Months
Bourassa’s War: Henri Bourassa and the First World War by Geoff Keelan A thesis presented to the University of Waterloo in fulfilment of the thesis requirement for the degree of Doctor of Philosophy in History Waterloo, Ontario, Canada, 2015 © Geoff Keelan 2015 Author’s Declaration I hereby declare that I am the sole author of this thesis. This is a true copy of the thesis, including any required final revisions, as accepted by my examiners. I understand that my thesis may be made electronically available to the public. ii Abstract This dissertation examines the perspective of French Canadian nationalist Henri Bourassa during the First World War from 1914-1918. Bourassa was one of the best-known voices rejecting the war’s purpose and value in Canada. He consistently offered detailed and in-depth analytical critiques of the war. He first accepted Canadian participation from August 1914 to January 1916, but his position gradually shifted from cautious support to outright rejection. This dissertation argues that Henri Bourassa has traditionally been understood as a domestic commentator in Canada, but during the war years he wrote in the pages of his newspaper Le Devoir to address a wide variety of international issues. He was one of a few Canadians who looked out to the world and interpreted global events for his readers. Historians have already recounted in detail his thoughts about the Ontario bilingual schools crisis, conscription, the December 1917 election, and the Easter Riots of 1918. This work examines Bourassa’s thoughts on diplomacy between the belligerent nations and that of Pope Benedict XV, international events like the Easter Rising in Ireland and the American entry into the war.