L'autoportrait Textuel Par Claude Cahun
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Claude Cahun
# 81 Concorde Claude Cahun 24 May – 25 September 2011 Autoportrait, c.1926 Autoportrait, 1928 / Jersey Heritage Collection IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat © Jersey Heritage Claude Cahun (1894-1954) has something of self-representation and the poetry of objects, approaching cult status in today’s art world. However, has been an important influence for many her work was almost unknown until the early 1980s, contemporary artists. when it was championed by the research of François Leperlier, after which exhibitions at the Musée des Metamorphoses of identity Beaux-Arts in Nantes (1994) and the Musée d’Art and the subversion of gender (I) Moderne de la Ville de Paris (1995) brought it to public This set of photographs, going from 1913 to the attention. Her life and work (both literary and artistic) end of the 1920s, includes some of Cahun’s major bespeak an extraordinary libertarian personality works, in which she staged her own persona, who defied sexual, social and ethical conventions in emphasising disguise and masks, and working what was an age of avant-garde and moral upheaval. through variations on gender: feminine, masculine, Among her many photographs, it is undoubtedly her androgyne, undifferentiated. Sexual ambiguity self-portraits that have aroused the greatest interest in is consciously cultivated and calls into question recent years. Throughout her life, Cahun used her own established norms and conventions. In 1928, she image to dismantle the clichés surrounding ideas of even represented herself with her head shaved, identity. She reinvented herself through photography, wearing a singlet, in profile, or with her hands posing for the lens with a keen sense of performance against her face, or wearing a loose man’s jacket. -
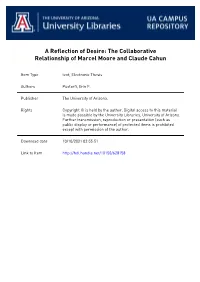
The Collaborative Relationship of Marcel Moore and Claude Cahun
A Reflection of Desire: The Collaborative Relationship of Marcel Moore and Claude Cahun Item Type text; Electronic Thesis Authors Pustarfi, Erin F. Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 10/10/2021 02:55:51 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/628158 A REFLECTION OF DESIRE: THE COLLABORATIVE RELATIONSHIP OF MARCEL MOORE AND CLAUDE CAHUN by Erin Frances Pustarfi _________________________________________ Copyright © Erin Frances Pustarfi 2018 A Thesis Submitted to the Faculty of the SCHOOL OF ART In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of MASTER OF ARTS WITH A MAJOR IN ART HISTORY In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 2018 STATEMENTBYAUTHOR The Thesis titled A Reflectionof Desire: The Collaborative Relationship ofMarcel Moore and Claude Cahunprepared by Erin Frances Pustaifihas been submitted in partialfu1fillment of requirements for a master's degree at the University of Arizonaand is deposited in the University Library to be made available to borrowers under rules of the Library. Brief quotations from this thesis are allowable without special permission, provided that an accurate acknowledgement of the source is made. Requests for permission for extended quotation from or reproduction of this manuscript in whole or in part may be granted by the copyright holder. SIGNED: Erin Frances Pustaifi -- APPROVAL BY THESIS DIRECTOR This thesis has been approved on the date shown below: - S-/10/fEi. -

Papers of Surrealism, Issue 8, Spring 2010 1
© Lizzie Thynne, 2010 Indirect Action: Politics and the Subversion of Identity in Claude Cahun and Marcel Moore’s Resistance to the Occupation of Jersey Lizzie Thynne Abstract This article explores how Claude Cahun and Marcel Moore translated the strategies of their artistic practice and pre-war involvement with the Surrealists and revolutionary politics into an ingenious counter-propaganda campaign against the German Occupation. Unlike some of their contemporaries such as Tristan Tzara and Louis Aragon who embraced Communist orthodoxy, the women refused to relinquish the radical relativism of their approach to gender, meaning and identity in resisting totalitarianism. Their campaign built on Cahun’s theorization of the concept of ‘indirect action’ in her 1934 essay, Place your Bets (Les paris sont ouvert), which defended surrealism in opposition to both the instrumentalization of art and myths of transcendence. An examination of Cahun’s post-war letters and the extant leaflets the women distributed in Jersey reveal how they appropriated and inverted Nazi discourse to promote defeatism through carnivalesque montage, black humour and the ludic voice of their adopted persona, the ‘Soldier without a Name.’ It is far from my intention to reproach those who left France at the time of the Occupation. But one must point out that Surrealism was entirely absent from the preoccupations of those who remained because it was no help whatsoever on an emotional or practical level in their struggles against the Nazis.1 Former dadaist and surrealist and close collaborator of André Breton, Tristan Tzara thus dismisses the idea that surrealism had any value in opposing Nazi domination. -

Surrealism and Feminism from France to Mexico, 1914-1972
Elizabethtown College JayScholar History: Student Scholarship & Creative Work History Spring 2019 Surrealism and Feminism from France to Mexico, 1914-1972 Emily Wieder Elizabethtown College, [email protected] Follow this and additional works at: https://jayscholar.etown.edu/hisstu Part of the History Commons Recommended Citation Wieder, Emily, "Surrealism and Feminism from France to Mexico, 1914-1972" (2019). History: Student Scholarship & Creative Work. 5. https://jayscholar.etown.edu/hisstu/5 This Student Research Paper is brought to you for free and open access by the History at JayScholar. It has been accepted for inclusion in History: Student Scholarship & Creative Work by an authorized administrator of JayScholar. For more information, please contact [email protected]. Wieder 1 Contents Introduction ..................................................................................................................................... 2 Chapter I. 1919-1929: Founding the Movement............................................................................. 7 Chapter II. 1930-1939: Engaging for the Proletariat .................................................................... 12 Chapter III. 1940-1949: Resisting Intrusion ................................................................................. 26 Conclusion .................................................................................................................................... 36 Bibliography ................................................................................................................................ -

Les Jeux Spéculaires De Cahun-Moore Andrea Oberhuber
Document generated on 10/03/2021 2:25 p.m. Intermédialités Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques Intermediality History and Theory of the Arts, Literature and Technologies Aimer, s’aimer à s’y perdre? Les jeux spéculaires de Cahun-Moore Andrea Oberhuber Aimer Article abstract Loving How can we reflect upon a young artist who multiplies the images of herself, Number 4, Fall 2004 portraying herself as Medusa or as an oriental beauty, as a Buddha, as a weightlifter or as a Gretchen? And how can we theorize her renowned URI: https://id.erudit.org/iderudit/1005478ar fragmented self-portrait, self-portrait in “checkers,” which echoes the portrait DOI: https://doi.org/10.7202/1005478ar of another woman “in stripes,” a portrait which is equally divided? And how can we decode the photomontages — each more enigmatic than the next — conceived in collaboration with this same woman “in stripes,” and dispersed See table of contents throughout the text entitled Aveux non avenus? What does it mean to “love,” when the object of our affection is our own alter ego? Can this love story between the self and the projection of self avoid falling into the abyss? This Publisher(s) article reflects upon the notion of “loving” as it is elaborated by Claude Cahun: first, it will explore the issue of narcissism which is present in most of her Centre de recherche sur l'intermédialité self-portraits, her autobiography and her photomontages; it will then consider lesbian desire, stigmatized at the time as a “false mask,” despite the moral ISSN liberty reigning in the salon culture of the Left Bank. -

The Blend of Poetry and Document in the Photographical Artist's Book the Road Is Wider Than Long by Roland Penrose
Interfaces Image Texte Language 43 | 2020 Création/Destruction The blend of poetry and document in the photographical artist’s book The Road is Wider than Long by Roland Penrose (1939) Anne Reverseau Electronic version URL: http://journals.openedition.org/interfaces/810 DOI: 10.4000/interfaces.810 ISSN: 2647-6754 Publisher: Université de Bourgogne, Université de Paris, College of the Holy Cross Printed version Date of publication: 15 July 2020 Number of pages: 125-141 ISSN: 1164-6225 Electronic reference Anne Reverseau, « The blend of poetry and document in the photographical artist’s book The Road is Wider than Long by Roland Penrose (1939) », Interfaces [Online], 43 | 2020, Online since 15 July 2020, connection on 31 December 2020. URL : http://journals.openedition.org/interfaces/810 ; DOI : https:// doi.org/10.4000/interfaces.810 Les contenus de la revue Interfaces sont mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International. THE BLEND OF POETRY AND DOCUMENT IN THE PHOTOGRAPHICAL ARTIST’S BOOK THE ROAD IS WIDER THAN LONG BY ROLAND PENROSE (1939) Anne Reverseau (FNRS) Université Catholique de Louvain Abstract: The Road is Wider than Long is a paradoxical artist’s book created by Roland Penrose in 1939. At the same time documentary and poetic, a travel report and a lyrical production, it comprises free verse, typographic poetry, “papiers collés”, and photographs. This heterogeneous nature allows to explore the contrasts and contradictions between but also the coming together of avant-garde poetry and photography. First, this article shows how The Road is Wider than Long draws from amateur practices by focusing on Penrose’s method of handling the pictures. -

Les Jeux Spéculaires De Cahun-Moore
Oberhuber, Andrea, « Aimer, s’aimer à s’y perdre ? Les jeux spéculaires de Cahun-Moore », Intermédialités : histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques / Intermediality : History and Theory of the Arts, Literature and Technologies, n° 4, 2004, p. 87-114. Aimer, s’aimer à s’y perdre ? Les jeux spéculaires de Cahun-Moore A NDREA OBERHUBER 87 tonnant paradoxe que celui de Claude Cahun — auteure, photographe, É actrice de théâtre et essayiste — qui, après avoir été présente sur la scène culturelle de son époque, se retrouve après sa mort parmi les « oubliés » de l’historiographie littéraire et artistique1. Il a fallu attendre les années 1980, le renouveau de l’intérêt pour le surréalisme, notamment pour le rôle des femmes dans les avant-gardes de l’entre-deux-guerres, attendre surtout les débats autour du gender pour voir ressusciter Claude Cahun, née Lucy Schwob en 1894, fille de l’éditeur Maurice Schwob et nièce du poète symboliste Marcel Schwob. Ce n’est toutefois pas un hasard si Cahun a été redécouverte il y a une vingtaine d’années dans le cadre des gender studies nord-américaines pour, instantané- ment, en devenir l’un des enfants chéris. Surtout pour les historiennes de l’art 1. Les raisons de sa marginalisation passée et de son succès présent sont multiples : François Leperlier, biographe et « redécouvreur » de Claude Cahun, en trouve l’expli- cation dans son « propos de troubler les indices, de se soustraire aux identifications sommaires » et dans son jeu avec la « plus intime étrangeté » (François Leperlier, Claude Cahun : l’écart et la métamorphose, Paris, Jean-Michel Place, 1992, p. -
Tarsila Do Amaral's Abaporu
© Michele Greet, 2015 Devouring Surrealism: Tarsila do Amaral’s Abaporu Michele Greet Various scholars have suggested a contiguity or affinity between Brazilian artist Tarsila do Amaral’s iconic painting Abaporu (1928) and surrealism; none have engaged in an in-depth analysis of her actual relationship with surrealism, however. This close reading of Abaporu will demonstrate that Amaral deliberately and systematically engaged with the tenets and formal languages of surrealism. Her engagement was not one of pure emulation; instead she turned the surrealists’ penchant for satire and desire to disrupt hierarchical schema back on itself, parodying the images and ideas put forth by the movement to create a counter modernism. Amaral’s sardonic appropriation of surrealism’s formal languages and subversive strategies was the very factor that made Abaporu the catalyst of the anthropophagite Movement. On 11 January 1928 the Brazilian artist Tarsila do Amaral presented a painting to her husband, the writer and intellectual Oswald de Andrade, for his birthday. Amaral described the painting, which Andrade would later entitle Abaporu (Fig. 1), or ‘person who eats,’ as: ‘a monstrous figure, with enormous feet planted on the Brazilian earth next to a cactus.’1 Scholars have long acknowledged Abaporu as a crucial work in Amaral’s career as well as an icon of early twentieth-century Latin American art. The painting marked the beginning of her anthropophagite phase, a period from about 1928 until 1930 during which Amaral departed from the densely packed compositions of urban São Paulo and the Brazilian countryside that characterized her Pau-Brazil period to paint scenes of one or two isolated figures in lush tropical dreamscapes.2 Despite the dream-like quality of these pictures, Amaral’s engagement with surrealism in Abaporu (and the other paintings of the period), while occasionally acknowledged, has not been fully interrogated. -

Mise En Page 1
GALATEAU PASTAUD MARDI 21 FÉVRIER 2017 EXPERT SALLE VV ROSSINI - PARIS CLAUDE OTERELO GALATEAU PASTAUD Maison de ventes aux enchères MARDI 21 FÉVRIER 2017 À 14H15 SALLE VV 3 rue Rossini - 75009 Paris (métro Richelieu-Drouot) COLLECTION HENRY TROUVÉ deuxième et dernière partie et à divers EDITIONS ORIGINALES LIVRES ILLUSTRÉS - REVUES LETTRES AUTOGRAPHES - MANUSCRITS PHOTOGRAPHIES DESSINS ET TABLEAUX DU XX E SIÈCLE CLAUDE OTERELO Expert Membre de la Chambre Nationale des Experts Spécialisés 5, rue La Boétie - 75008 Paris Tél. : 06 84 36 35 39 [email protected] Expositions publiques : Salle VV - 3 rue Rossini 75009 Paris Lundi 20 février de 11h à 18h Mardi 21 février de 11h à 12h Téléphone pendant l’exposition 01 42 46 78 44 GALATEAU PASTAUD Agrément n°2002–322 du 11.07.2002 20 Boulevard Edgar Quinet - 75014 Paris 5 rue Cruche d’Or - 87000 Limoges Tél : 06 23 404 406 – 06 50 614 608 Email : [email protected] - www.interencheres.com 2 1 1 ALECHINSKY Pierre. MAQUETTE ORIGINALE DU NUMÉRO 1 DE LA REVUE PHASES. 13 feuillets in-4 sous couverture légendée au crayon. 2 000/3 000 € MAQUETTE ENTIÈREMENT RÉALISÉE PAR ALECHINSKY AU CRAYON ET ÀL’ENCRE COMPORTANT 6 DESSINS ORIGINAUX ÀL’ENCRE DESTINÉS À ÊTRE CONTRECOLLÉS DANS LA MAQUETTE . Note autographe au crayon d’Alechinsky citant Edouard Jaguer comme directeur, les correspondants à l’étranger et lui-même pour la mise en page. LE DOCUMENT AUTOGRAPHE EST AGRÉMENTÉ D’UN DESSIN ORIGINAL AU CRAYON D’A LECHINSKY . 3 2 ALEXANDRE Maxime. LES DESSEINS DE LA LIBERTÉ. Paris, Chez L’Auteur, 1927. -

Mise En Page 1
ITINÉRAIRE D’UN COLLECTIONNEUR DANS LA SOCIÉTÉ DU SPECTACLE EXPERT CLAUDE OTERELO MARDI 8 NOVEMBRE 2016 HÔTEL DROUOT - SALLE 15 COLLECTION ANDRÉ CAMPANA et à divers ITINÉRAIRE D’UN COLLECTIONNEUR DANS LA SOCIÉTÉ DU SPECTACLE ÉDITIONS ORIGINALES DU XIXE ET DU XXE SIÈCLE LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES - PHOTOGRAPHIES DESSINS - TABLEAUX PEINTRES DE LA BANDE DESSINÉE - GROUPE BAZOOKA TRÉSORS OU BABIOLES MARDI 8 NOVEMBRE 2016 À 14H DROUOT RICHELIEU, SALLE 15 9, rue Drouot - 75009 Paris EXPERT Claude Oterelo Membre de la Chambre Nationale des Experts Spécialisés 5, rue La Boétie - 75008 Paris Tél. : 06 84 36 35 39 - [email protected] CONTACT ÉTUDE Simon Meynen Tél. : 01 40 06 06 08 - [email protected] EXPOSITION PUBLIQUE À L’HÔTEL DROUOT Lundi 7 novembre de 11h à 18h Mardi 8 novembre de 11h à 12h Catalogue visible sur internet www.AuctionArtParis.com 9, rue de Duras - 75008 Paris | tél. : +33 (0)1 40 06 06 08 | fax : +33 (0)1 42 66 14 92 SVV agrément N° 2008-650 - www.AuctionArtParis.com - [email protected] Rémy Le Fur & Olivier Valmier commissaires-priseurs habilités ITINÉRAIRE D UN COLLECTIONNEUR DANS LA SOCIÉTÉ DU SPECTACLE « Itinéraire d’un collectionneur dans la Société du Spectacle » : voilà un titre qui sonne juste ! Pour quelqu’un qui propose, dans le même mouvement, des éditions originales de Verlaine et de Rimbaud des ouvrages de surréalistes comme Dali, Man Ray, Ghérasim Luca, Marien, des photographies parmi les plus belles de Pierre Molinier, des impréecations d Druillet, le maitre de la Bande dessinée fantastique, des facéties érotiques de Varenne, des « moqueries » de Di Rosa ou des cruautés de Combas ; Et aussi, pour la première fois, des originaux significatifs du groupe Bazooka, les acteurs mythiques des années 80 – qui ont donné au mouvement français et international l’essentiel de sa ligne graphique – Olivia Clavel, Kiki et Loulou Picasso, Bernard Vidal, Romain Slocombe, entre autres. -

DORA MAAR 20 November 2019 – 15 March 2020
DORA MAAR 20 November 2019 – 15 March 2020 LARGE PRINT GUIDE Please return to the holder CONTENTS Room 1 ................................................................................2 Room 2 .............................................................................. 18 Room 3 ............................................................................. 49 Room 4 ..............................................................................75 Room 5 ..............................................................................87 Room 6 ............................................................................ 134 Room 7 ............................................................................ 150 Room 8 ............................................................................ 169 Room 9 ............................................................................ 188 Credits ............................................................................. 210 1 ROOM 1 THE INVENTION OF DORA MAAR THE INVENTION OF DORA MAAR Dora Maar’s career spanned mediums, techniques and much of the 20th century. Born Henriette Théodora Markovitch in 1907, during her childhood she preferred to be called Dora. Raised between Argentina and France, her mother owned a fashion boutique and her father was an architect. Initially she was educated in the applied arts and painting at Paris’s most progressive art schools. In her early twenties, encouraged by mentors who saw her talent, she decided to pursue photography. In 1932, a public bulletin announcing -

Shifting Eyes
Shifting Eyes : self-representation in words and images, re-reading Freud through the semiotics of C.S. Peirce, with particular reference to the work of poet H.D. and artist Claude Cahun Sharon Morris University College London Ph D. Thesis Shifting Eyes ProQuest Number: U642768 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest. ProQuest U642768 Published by ProQuest LLC(2015). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 Abstract Shifting Eyes, presents a re-reading of Freud’s structural theories of the self, through the semiotics of C.S. Peirce. In place of the self split between unconscious representations and the syntax of speech, Peirce’s general sign theory provides an evolutionary account of symbol development within a trichotomy of sign-object relations, icon, index and symbol, as opposed to interpretations of Freud using the linguistic sign which reify the split subject mid assimilate unconscious processes to the tropes of languie. Peirce’s sign-interpretant relation, is used to re-describe Freud’s account of the shift from narcissism to object relations, from the primary iconic dyad to the subject constructed through the symbol of sexual difference.