JACQUES LECARME René Vietto, Vingt Ans Après
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Louison Bobet (1925-1983), Champion Cycliste Des Premières Trente Glorieuses Dominique Lejeune
Louison Bobet (1925-1983), champion cycliste des premières Trente Glorieuses Dominique Lejeune To cite this version: Dominique Lejeune. Louison Bobet (1925-1983), champion cycliste des premières Trente Glorieuses. 2020. hal-01472975v3 HAL Id: hal-01472975 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01472975v3 Preprint submitted on 8 Apr 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0 International License D.LEJEUNE, LOUISON BOBET… 1 Louison Bobet (1925-1983), champion cycliste des premières Trente Glorieuses par Dominique Lejeune, Prof Dr Dr Le palmarès de Louis, dit Louison, Bobet (1925-1983), coureur cycliste professionnel de 1947 à 1961, est extrêmement riche, avec notamment 122 victoires en professionnel. Dans la France de la fin des années d’après-guerre et du début des Trente Glorieuses, il a joui d’une très grande popularité. Bobet est aussi le champion breton d’une France centralisée qui s’essaie à la régionalisation et d’une province qui se modernise à grands tours de roue. Ses origines familiales sont typiques de cette époque de l’histoire du sport et elles jouèrent un rôle non négligeable dans la construction de son image et de sa popularité. -

Darrigade. Le Lévrier Des Landes
DARRIGADE LE LEVRIER DES LANDES DU MEME AUTEUR — Il Hommes en Suède (Edition N° 1) — Anquetil (Edition N° 1) — Anquetil, l'homme des défis (Flammarion) — La légende de Louison Bobet (Flammarion) — Fausto Coppi, la tragédie de la gloire (PAC) — Hugo Koblet, le pédaleur de charme (PAC) — Bartali, Gino le Pieux (PAC) — Les grandes heures de la voile (PAC) — Les destins extraordinaires de l'aviation (PAC) — Dossiers secrets du cyclisme (Pygmalion) — La Coupe du monde de football (Pygmalion) — Les monstres sacrés de l'automobile (Pygmalion) — Les sports en France (PUB) — Stade rennais, football breton (Solar) — Bouttier, deux poings, une gloire (La Table Ronde) — Les joies de la bicyclette, en collaboration (Hachette) — Histoire du football breton (Picollec) — Histoire du cyclisme breton (Picollec) — Le Tour de France du Général (Julliard) — De Gaulle et la Bretagne (France-Empire). Jean-Paul Ollivier DARRIGADE LE LEVRIER DES LANDES SUR OUEST Ce livre est écrit à la mémoire de Jacques Anquetil et de Loui- son Bobet, amis d'André Darrigade. J.P. O. PREFACE Quand on dit que le lion est de Belfort et la victoire de Samoth- race, on n'y croit pas trop. Parce que des livres et des victoires, on en a vu ailleurs. Quand on essaie de nous faire croire que la bêtise est de Cambrai, on n'y croit pas du tout. Parce que la bêtise, on la voit partout. Mais lorsqu'on dit que Darrigade est de Dax, il faut croire. Il ne saurait être d'ailleurs, Darrigade. Où qu'il soit. Où qu'il aille : au Vel'd'Hiv', à Zandvoort, à Biar- ritz, au Club Méd et même à Dax, il est Darrigade de Dax. -

Louison Bobet (1925-1983), Champion Cycliste Des Premières Trente Glorieuses Dominique Lejeune
Louison Bobet (1925-1983), champion cycliste des premières Trente Glorieuses Dominique Lejeune To cite this version: Dominique Lejeune. Louison Bobet (1925-1983), champion cycliste des premières Trente Glorieuses. 2019. hal-01472975v2 HAL Id: hal-01472975 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01472975v2 Preprint submitted on 8 Mar 2019 (v2), last revised 8 Apr 2020 (v3) HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0 International License D.LEJEUNE, LOUISON BOBET… 1 Louison Bobet (1925-1983), champion cycliste des premières Trente Glorieuses par Dominique Lejeune, Prof Dr Dr Louis, dit Louison, Bobet (1925-1983) a été coureur cycliste professionnel de 1947 à 1961. Son palmarès est extrêmement riche, avec notamment 122 victoires en professionnel. Dans la France de la fin des années d’après-guerre et du début des Trente Glorieuses, il a joui d’une très grande popularité. Bobet est aussi le champion breton d’une France centralisée qui s’essaie à la régionalisation et d’une province qui se modernise. Ses origines familiales sont typiques de cette époque de l’histoire du sport et elles jouèrent un rôle non négligeable dans la construction de son image et de sa popularité. -

Jean-Noël Cloarec
Janvier 2004 Editorial N°18 L’année précédente, (nous nous réglons sur l’année scolaire !) était particulière avec deux productions exceptionnelles, Ne me fermez pas ! Le blount s’en chargera (édition des films du Caméra-club et du livre « Le lycée de Rennes dans l’histoire »). Il ne faut pas pour autant croire qu’après cette période euphorique nous allons tomber en léthargie ; visites et conférences continuent de plus belle…Les conférences se sont, du reste ouvertes à de nouveaux domaines. Le marathon entrepris – et réussi - par Bertrand Wolff, (quatre conférences sur l’électricité.) a donné lieu à une fructueuse collaboration avec l’Espace des Sciences, une publication devrait rapidement en résulter. Il est à signaler, et le mérite en revient à nos conférenciers, tous bénévoles de surcroît, que nous avons pu fournir longtemps à l’avance le programme de toute l’année. C’est quelque chose qui mérite d’être réitéré. La richesse de notre patrimoine, le travail des bénévoles font que l’Association commence à être bien connue «sur la place», il conviendrait d’utiliser ce capital de sympathie et d’augmenter le nombre de nos membres. Sans pour autant jouer les frères prêcheurs, (à quand les taolennou de l’Amélycor ? Après tout, le père Maunoir fut bien élève du Collège) nous devrions tous nous sentir impliqués et contribuer à renforcer notre audience. Jean-Noël Cloarec «Dragon volant» - Collections de Sciences Naturelles- Cl. J-N C A ssociation pour la M E moire du L Y cée et CO llège de R ennes C it é scolaire Emile Zola avenue Janvier BP 90607 35 006 RENNES Cédex Espace Sciences Naturelles Un mystère signé ! Crabe, homard, coquillages … le génie du lieu avait pourtant semé quelques indices… Mais vous, les visiteurs qui, le 17 mai 2003 à l’occasion du bicentenaire, êtes passés devant cette vitrine réalisée à la gloire de l’Histoire Naturelle, vous n’avez, bien sûr, rien soupçonné. -

Civilising Processes and Doping in Professional Cycling
CSI0010.1177/0011392115576765Current SociologyConnolly 576765research-article2015 Article CS Current Sociology 2015, Vol. 63(7) 1037 –1057 Civilising processes and doping © The Author(s) 2015 Reprints and permissions: in professional cycling sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0011392115576765 csi.sagepub.com John Connolly Dublin City University, Ireland Abstract This article contends that professional cyclists have undergone civilising processes in relation to doping within the sport. Drawing on the theoretical approach of Elias, the author argues that over time stronger shame feelings in relation to doping became part of the social habitus of professional cyclists and doping became increasingly ‘pushed behind the scenes’. Yet, contradictions and reversals persisted in attitudes and behaviour. These fractures and discontinuities occurred due to several interconnected processes: the role of suffering within the sport and the nature of mutual identification that developed around it, the specific structure of the figuration of professional cycle sport, and the slowness of a comprehensive and effective monopoly apparatus over the control of doping to emerge and the perceived legitimacy of this. Combined these processes generated a social habitus in which doping only very slowly came to be perceived as shameful and which varied across space and time. Despite this a civilising advance is evident. Keywords Civilising processes, doping, Elias, habitus, professional cycling Introduction In this article, drawing on the theoretical approach of Norbert Elias, I argue that over the course of the last 70 years professional cyclists have undergone civilising processes in relation to doping within the sport. It is not my contention that doping has declined amongst professional cyclists over that time period; that would be very difficult to empir- ically ascertain. -

Guide Historique 2015
GUIDE HISTORIQUE 2015 ENTRER Textes de Jacques Augendre GUIDE HISTORIQUE 2015 102e édition 4-26 JUILLET 2015 PRÉFACE L’ÉVÉNEMENT SPORTIF DES TEMPS MODERNES « Je ne connais pas de spectacle plus exaltant » écrivait Henri Des- HISTORIQUE « Le Tour a sans doute fait plus pour l’unité nationale de la France grange. De fait, ce spectacle offert au grand public a fasciné les gens de qu’aucun des grands événements dont elle a été le théâtre tout lettres et des générations de chroniqueurs, de Tristan Bernard à Antoine STATISTIQUES au long du XXe siècle ». Blondin, mais également les artistes, les vedettes du show-biz et bien entendu les cinéastes. « C’est une superproduction, s’exclama Orson Georges CONCHON Welles, invité de Jacques Goddet en 1950, mais le meilleur film pourrait- il traduire fidèlement son atmosphère et sa vérité ? ». Le Tour de France a fêté son centième anniversaire en 2003 et sa centième édition en 2013. Il doit son existence à Géo Lefèvre, un journa- Traduire fidèlement, c’est ce que nous nous sommes efforcés de liste passionné de cyclisme qui suggéra à Henri Desgrange, directeur de faire dans la réalisation de ce guide historique. L’Auto, de créer les Six Jours de la route, sous la forme d’une course par étapes reliant les principales villes de l’Hexagone. Le projet fut adopté en Une large place y est faite aux palmarès, aux chiffres et aux statis- novembre 1902, au cours d’un déjeuner de travail à la Taverne Zimmer, tiques mais le fait divers et l’anecdote n’en sont pas absents. -
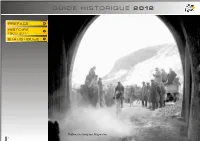
Guide Historique 2 012
GUIDE HISTORIQUE 2 012 PRÉFACE HISTOIRE 1903-2011 STATISTIQUES Textes de Jacques Augendre 1 GUIDE HISTORIQUE 2 012 PRÉFACE L’événement sPORTIF DES TEMPS MODERNES « Je ne connais pas de spectacle plus exaltant » écrivait HISTOIRE « Le Tour a sans doute fait plus pour l’unité nationale de la Henri Desgrange. De fait, ce spectacle offert au grand public a 1903-2010 France qu’aucun des grands événements dont elle a été le fasciné les gens de lettres et des générations de chroniqueurs, théâtre tout au long du XXe siècle ». de Tristan Bernard à Antoine Blondin, mais également les ar- STATISTIQUES tistes, les vedettes du show-biz et bien entendu les cinéastes. Georges CONCHON « C’est une superproduction, s’exclama Orson Welles, invité de Jacques Goddet en 1950, mais le meilleur film pourrait-il Le Tour de France avait fêté son centième anniversaire en traduire fidèlement son atmosphère et sa vérité ? ». 2003. Il doit son existence à Geo Lefèvre, un journaliste pas- sionné de cyclisme qui suggéra à Henri Desgrange, directeur Traduire fidèlement, c’est ce que nous nous sommes effor- de L’AUTO, de créer les Six Jours de la route, sous la forme cés de faire dans la réalisation de cet ouvrage. Le guide que d’une course par étapes reliant les principales villes de l’Hexa- nous vous proposons se veut précis, documenté, pratique et gone. Le projet fut adopté en novembre 1902, au cours d’un d’une lecture facile. déjeuner de travail à la Taverne Zimmer, rebaptisée le “Madrid” puis le “Friday’s”, où une plaque commémorait naguère la nais- Il fait une large place aux palmarès, aux chiffres et aux statis- sance de « la plus grande compétition sportive du monde ». -

La Belle Equipe, N°8, Page 9)
NUMÉR0 24 • DÉCEMBRE 2017 La belle «Les grandes équipes ne meurent jamais» Marchand de combat, SOMMAIRE Marchand d'âme GÉRARD ERNAULT HOMMAGE A JACQUES Quand je pense à Jacques Marchand, auquel de Jean-Max. Et c'est MARCHAND p. 2 à 18 une partie majeure de ce numéro de La Belle ce jour-là que, pour · « L’avocat du journalisme de sport » par Jacques Ferran Equipe est consacrée, je pense à un menu et je la première fois, pense à un déjeuner. Jacques Marchand · « Un maître à penser exigeant » par Jean-Philippe Leclaire Le menu est aussi copieux que la grille salariale s'ouvrit devant moi de la Convention collective des journalistes telle des difficultés à · « Un pont entre générations » par Gilles Van Kote que la donne à déguster je ne sais plus quel maintenir en vie le syndicat, ni pour quelle raison, aux élèves Mouvement qu'avec · « Soixante-quinze ans de sacerdoce » de première année de l'Ecole supérieure de Jacques Ferran, ils LE BILLET DU par Jacques Augendre PRÉSIDENT journalisme de Lille dont je viens d'être admis avaient initié, au début · « Un curé laïque en campagne » par Henri Garcia à fréquenter les cours en octobre 1965. A la des années 80, dans rubrique "rédacteur sportif", lanterne rouge la foulée du départ à la retraite de Jacques · « Une indispensable vigie » par Jean- Marie Leblanc de la grille, en-dessous donc de "rédacteur", Goddet. Et ni l'un ni l'autre ne se faisait à est à peu près réservé le plat du jour suivant : l'idée de sa disparition. -

Les Victoires De Poulidor
Extrait de la publication Les Victoires de Poulidor Extrait de la publication Yves Jean Les Victoires de Poulidor Extrait de la publication © Flammarion, Paris, 2013 87, quai Panhard-et-Levassor 75647 Paris cedex 13 Tous droits réservés ISBN : 978-2-0813-0425-3 Extrait de la publication Sommaire Prologue .............................................................. 9 1. Cent quatre-vingt-neuf ................................... 11 2. L’espoir numéro un ........................................ 19 3. Poulidor champion ! ...................................... 31 4. Le premier Tour de France ............................ 43 5. Au pédalier d’Anquetil .................................. 63 6. Premier mondial ............................................. 79 7. En attendant Poupou… .................................. 103 8. À marée haute ................................................ 115 9. Le printemps 68 ............................................. 127 10. Poulidor premier, suite… et fin ? .................. 139 11. Un bain de Jouvence ...................................... 155 12. Des vendanges tardives .................................. 165 13. Le quadragêneur ............................................ 187 14. Derniers bouquets, derniers podiums ............ 199 Épilogue ............................................................... 217 Annexe .................................................................. 219 Bibliographie ....................................................... 226 Remerciements .................................................... -

The Tour De France 1903–2003: a Century of Sporting Structures, Meanings and Values in the Same Series
Sport in the Global Society General Editor: J.A.Mangan THE TOUR DE FRANCE 1903–2003 SPORT IN THE GLOBAL SOCIETY General Editor: J.A.Mangan The interest in sports studies around the world is growing and will continue to do so. This unique series combines aspects of the expanding study of sport in the global society, providing comprehensiveness and comparison under one editorial umbrella. It is particularly timely, with studies in the cultural, economic, ethnographic, geographical, political, social, anthropological, sociological and aesthetic elements of sport proliferating in institutions of higher education. Eric Hobsbawm once called sport one of the most significant practices of the late nineteenth century. Its significance was even more marked in the late twentieth century and will continue to grow in importance into the new millennium as the world develops into a ‘global village’ sharing the English language, technology and sport. Other Titles in the Series Women, Sport and Society in Modern China Holding Up More than Half the Sky Dong Jinxia Sport in Latin American Society Past and Present Edited by J.A.Mangan and Lamartine P.DaCosta Sport in Australasian Society Past and Present Edited by J.A.Mangan and John Nauright Sporting Nationalisms Identity, Ethnicity, Immigration and Assimilation Edited by Mike Cronin and David Mayall Cricket and England A Cultural and Social History of the Inter-war Years Jack Williams The Future of Football Challenges for the Twenty-First Century Edited by Jon Garland, Dominic Malcolm and iii Michael Rowe