Cornélie Falcon : Une Interprète D'exception
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2012-2013 Season Is All About Passion...In More Than Music and Informal Conversation
Baroque Chamber 2012-2013 Orchestra Season FRANK NOWELL Harpsichordist-Artistic Director CYNTHIA MILLER FREIVOGEL Violinist-Leader Directors’ Concert CYNTHIA MILLER FREIVOGEL . .violin FRANK NOWELL . harpsichord WITH SANDRA MILLER . viola da gamba SUNDAY, AUGUST 19, 2012 AT 5:00 PM . Wellshire Presbyterian Church 2999 S. Colorado Blvd., Denver To launch our eighth season, BCOC’s artistic leaders present an evening of intimate Baroque Our 2012-2013 season is all about passion...in more than music and informal conversation. In an annual summer event that has become an audience favorite, Cynthia Miller Freivogel and Frank Nowell perform some of their favorite cham- one sense of the word! The composer Rameau asserted ber music – this year to include J.S. Bach’s Chromatic Fantasy and Fugue, solo fantasias that the purpose of music was “to arouse in us diverse pas- by Telemann, and sonatas by Bach and by Elizabeth Jacquet de la Guerre – one of the few sions.” Our season encompasses a wide range of human famous women composers in the Baroque era. experience - from lust, honor and justice in La Susanna; to illusion, humor and romance in Don Quixote. photo: Denver Post We are honored this season to share with Colorado audi- Freivogel draws a rich range of tonal colors from her violin and brings freshness, ences our own interpretation of J.S. Bach’s deeply mov- verve and a wonderfully natural sense of phrasing to her playing. It also helps that ing St. Matthew Passion. I am also thrilled to enter into a she seems so at home in this music.” Denver Post unique collaboration with Ballet Nouveau Colorado as we explore together the provocative emotional intersection between Baroque music and contemporary dance. -

HOWARD COLLEGE MUSIC FALL 2018 RECITAL Monday November 5, 2018 Hall Center for the Arts Linda Lindell, Accompanist
HOWARD COLLEGE MUSIC FALL 2018 RECITAL Monday November 5, 2018 Hall Center for the Arts Linda Lindell, Accompanist Makinsey Grant . Bb Clarinet Fantasy Piece No. 1 by Robert Schumann Fantasy Piece No. 1 by Robert Schumann (1810 – 1856) was written in 1849. It is the first movement of three pieces written to promote the creative notion of the performer. It allows the performer to be unrestricted with their imagination. Fantasy Piece No. 1 is written to be “Zart und mit Ausdruck” which translates to tenderly and expressively. It begins in the key of A minor to give the audience the sense of melancholy then ends in the key of A major to give resolution and leave the audience looking forward to the next movements. (M. Grant) Tony Lozano . Guitar Tu Lo Sai by Giuseppe Torelli (1650 – 1703) Tu lo sai (You Know It) This musical piece is emotionally fueled. Told from the perspective of someone who has confessed their love for someone only to find that they no longer feel the same way. The piece also ends on a sad note, when they find that they don’t feel the same way. “How much I do love you. Ah, cruel heart how well you know.” (T. Lozano) Ruth Sorenson . Mezzo Soprano Sure on this Shining Night by Samuel Barber Samuel Barber (1910 – 1981) was an American composer known for his choral, orchestral, and opera works. He was also well known for his adaptation of poetry into choral and vocal music. Considered to be one of the composers most famous pieces, “Sure on this shining night,” became one of the most frequently programmed songs in both the United States and Europe. -

Opera, Liberalism, and Antisemitism in Nineteenth-Century France the Politics of Halevy’S´ La Juive
Opera, Liberalism, and Antisemitism in Nineteenth-Century France The Politics of Halevy’s´ La Juive Diana R. Hallman published by the press syndicate of the university of cambridge The Pitt Building, Trumpington Street, Cambridge, United Kingdom cambridge university press The Edinburgh Building, Cambridge cb2 2ru,UK 40 West 20th Street, New York, ny 10011-4211, USA 477 Williamstown Road, Port Melbourne, vic 3207, Australia Ruiz de Alarcon´ 13, 28014 Madrid, Spain Dock House, The Waterfront, Cape Town 8001, South Africa http://www.cambridge.org C Diana R. Hallman 2002 This book is in copyright. Subject to statutory exception and to the provisions of relevant collective licensing agreements, no reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press. First published 2002 Printed in the United Kingdom at the University Press, Cambridge Typeface Dante MT 10.75/14 pt System LATEX 2ε [tb] A catalogue record for this book is available from the British Library Library of Congress Cataloguing in Publication data Hallman, Diana R. Opera, liberalism, and antisemitism in nineteenth-century France: the politics of Halevy’s´ La Juive / by Diana R. Hallman. p. cm. – (Cambridge studies in opera) Includes bibliographical references and index. isbn 0 521 65086 0 1. Halevy,´ F., 1799–1862. Juive. 2. Opera – France – 19th century. 3. Antisemitism – France – History – 19th century. 4. Liberalism – France – History – 19th century. i. Title. ii. Series. ml410.h17 h35 2002 782.1 –dc21 2001052446 isbn 0 521 65086 0 -

Stradella Amanti, Olà, Olà! Chi Resiste Al Dio Bendato
CHAN 0728 premiere recordings Stradella Amanti, olà, olà! Chi resiste al Dio bendato Alessandro Stradella Consort CHANDOS early music 61 Estevan Velardi CCHANHAN 00728728 BBooklet.inddooklet.indd 660-610-61 330/7/060/7/06 112:40:272:40:27 Alessandro Stradella (1639 – 1682) premiere recordings Amanti, olà, olà! Accademia d’Amore (Love’s Academy) A 5 voci Words by Gian. Pietro Monesio Edited by Estevan Velardi Bellezza (Beauty) ...............................................................Rosita Frisani soprano Cortesia (Courtesy) .......................................................Cristiana Presutti soprano Capriccio (Fancy) .......................................................Anna Chierichetti soprano Amore (Love) ...........................................................Gianluca Belfi ori Doro alto Rigore (Discipline) ..............................................................Mario Cecchetti tenor Accademico I (First Academician) .................................Makoto Sakurada tenor Accademico II (Second Academician) ........................... Riccardo Ristori bass Disinganno (Disenchantment) } Chi resiste al Dio bendato (Those who resist the blindfold God) Serenata a 3 voci Edited by Estevan Velardi Oil by G. D’Agostino, Naples, Conservatory of San Pietro a Majella Soprano I ...........................................................................Rosita Frisani soprano Alessandro Stradella Soprano II...................................................................Anna Chierichetti soprano Basso ...................................................................................Riccardo -

Developing the Young Dramatic Soprano Voice Ages 15-22 Is Approved in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Of
DEVELOPING THE YOUNG DRAMATIC SOPRANO VOICE AGES 15-22 By Monica Ariane Williams Bachelor of Arts – Vocal Arts University of Southern California 1993 Master of Music – Vocal Arts University of Southern California 1995 A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the Doctor of Musical Arts School of Music College of Fine Arts The Graduate College University of Nevada, Las Vegas December 2020 Copyright 2021 Monica Ariane Williams All Rights Reserved Dissertation Approval The Graduate College The University of Nevada, Las Vegas November 30, 2020 This dissertation prepared by Monica Ariane Williams entitled Developing the Young Dramatic Soprano Voice Ages 15-22 is approved in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts School of Music Alfonse Anderson, DMA. Kathryn Hausbeck Korgan, Ph.D. Examination Committee Chair Graduate College Dean Linda Lister, DMA. Examination Committee Member David Weiller, MM. Examination Committee Member Dean Gronemeier, DMA, JD. Examination Committee Member Joe Bynum, MFA. Graduate College Faculty Representative ii ABSTRACT This doctoral dissertation provides information on how to develop the young dramatic soprano, specifically through more concentrated focus on the breath. Proper breathing is considered the single most important skill a singer will learn, but its methodology continues to mystify multitudes of singers and voice teachers. Voice professionals often write treatises with a chapter or two devoted to breathing, whose explanations are extremely varied, complex or vague. Young dramatic sopranos, whose voices are unwieldy and take longer to develop are at a particular disadvantage for absorbing a solid vocal technique. First, a description, classification and brief history of the young dramatic soprano is discussed along with a retracing of breath methodologies relevant to the young dramatic soprano’s development. -
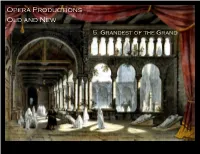
Opera Productions Old and New
Opera Productions Old and New 5. Grandest of the Grand Grand Opera Essentially a French phenomenon of the 1830s through 1850s, although many of its composers were foreign. Large-scale works in five acts (sometimes four), calling for many scene-changes and much theatrical spectacle. Subjects taken from history or historical myth, involving clear moral choices. Highly demanding vocal roles, requiring large ranges, agility, stamina, and power. Orchestra more than accompaniment, painting the scene, or commenting. Substantial use of the chorus, who typically open or close each act. Extended ballet sequences, in the second or third acts. Robert le diable at the Opéra Giacomo Meyerbeer (Jacob Liebmann Beer, 1791–1864) Germany, 1791 Italy, 1816 Paris, 1825 Grand Operas for PAris 1831, Robert le diable 1836, Les Huguenots 1849, Le prophète 1865, L’Africaine Premiere of Le prophète, 1849 The Characters in Robert le Diable ROBERT (tenor), Duke of Normandy, supposedly the offspring of his mother’s liaison with a demon. BERTRAM (bass), Robert’s mentor and friend, but actually his father, in thrall to the Devil. ISABELLE (coloratura soprano), Princess of Sicily, in love with Robert, though committed to marry the winner of an upcoming tournament. ALICE (lyric soprano), Robert’s foster-sister, the moral reference-point of the opera. Courbet: Louis Guéymard as Robert le diable Robert le diable, original design for Act One Robert le diable, Act One (Chantal Thomas, designer) Robert le diable, Act Two (Chantal Thomas, designer) Robert le diable, Act -

The Mezzo-Soprano Onstage and Offstage: a Cultural History of the Voice-Type, Singers and Roles in the French Third Republic (1870–1918)
The mezzo-soprano onstage and offstage: a cultural history of the voice-type, singers and roles in the French Third Republic (1870–1918) Emma Higgins Dissertation submitted to Maynooth University in fulfilment for the Degree of Doctor of Philosophy Maynooth University Music Department October 2015 Head of Department: Professor Christopher Morris Supervisor: Dr Laura Watson 1 TABLE OF CONTENTS Page number SUMMARY 3 ACKNOWLEDGEMENTS 4 LIST OF FIGURES 5 LIST OF TABLES 5 INTRODUCTION 6 CHAPTER ONE: THE MEZZO-SOPRANO AS A THIRD- 19 REPUBLIC PROFESSIONAL MUSICIAN 1.1: Techniques and training 19 1.2: Professional life in the Opéra and the Opéra-Comique 59 CHAPTER TWO: THE MEZZO-SOPRANO ROLE AND ITS 99 RELATIONSHIP WITH THIRD-REPUBLIC SOCIETY 2.1: Bizet’s Carmen and Third-Republic mores 102 2.2: Saint-Saëns’ Samson et Dalila, exoticism, Catholicism and patriotism 132 2.3: Massenet’s Werther, infidelity and maternity 160 CHAPTER THREE: THE MEZZO-SOPRANO AS MUSE 188 3.1: Introduction: the muse/musician concept 188 3.2: Célestine Galli-Marié and Georges Bizet 194 3.3: Marie Delna and Benjamin Godard 221 3.3.1: La Vivandière’s conception and premieres: 1893–95 221 3.3.2: La Vivandière in peace and war: 1895–2013 240 3.4: Lucy Arbell and Jules Massenet 252 3.4.1: Arbell the self-constructed Muse 252 3.4.2: Le procès de Mlle Lucy Arbell – the fight for Cléopâtre and Amadis 268 CONCLUSION 280 BIBLIOGRAPHY 287 APPENDICES 305 2 SUMMARY This dissertation discusses the mezzo-soprano singer and her repertoire in the Parisian Opéra and Opéra-Comique companies between 1870 and 1918. -

I Costumi Per Le Opere Di Gioachino Rossini Nelle Collezioni Milanesi
Corso di Laurea in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici ordinamento ex D.M. 270/2004 Tesi di Laurea I costumi per le opere di Gioachino Rossini nelle collezioni milanesi Relatore Ch.ma Prof. Maria Ida Biggi Correlatore Ch.ma Prof. Adriana Guarnieri Laureando Beatrice Carrer Matricola 836283 Anno Accademico 2016 / 2017 1. SOMMARIO 2. INTRODUZIONE 3 3. LA CULTURA EUROPEA DI INIZIO OTTOCENTO: TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 5 4. CENNI BIOGRAFICI DI GIOACHINO ROSSINI 9 5. LE OPERE 17 5.1 LA FARSA 17 5.2 L’OPERA BUFFA 20 5.3 L’OPERA SEMISERIA 28 3.4 L’OPERA SERIA 32 3.5 L’OPERA FRANCESE 52 6. LA SCENOGRAFIA E IL COSTUME A MILANO 57 6.1 LA CRITICA SETTECENTESCA 58 6.2 LA SCENOGRAFIA 61 6.3 I COSTUMI 65 7. BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE 69 7.1 RICCIARDO E ZORAIDE 70 7.2 OTELLO, OSSIA IL MORO DI VENEZIA 74 7.3 L’ITALIANA IN ALGERI 81 7.4 TANCREDI 82 7.5 SEMIRAMIDE 85 7.6 LA DONNA DEL LAGO 87 7.7 MATILDE DI SHABRAN 90 8. BIBLIOTECA DEL MUSEO TEATRALE ALLA SCALA 93 8.1 IL TURCO IN ITALIA 93 8.2 IL BARBIERE DI SIVIGLIA 93 8.3 OTELLO, OSSIA IL MORO DI VENEZIA 95 8.4 MATILDE DI SHABRAN 97 8.5 SEMIRAMIDE 97 8.6 LE SIEGE DE CORINTHE 100 8.7 MOSÈ 103 8.8 GUILLAUME TELL 107 9. CIVICA RACCOLTA DELLE STAMPE ACHILLE BERTARELLI 113 1 9.1 STAMPE DI ATTORI 113 9.2 RACCOLTA DI FIGURINI AD USO DEI TEATRI, GIUSTA IL COSTUME DI TUTTI I TEMPI E TUTTE LE NAZIONI 115 9.3 FIGURINI TEATRALI DI FAUSTO, BARBIERE DI SIVIGLIA, TUTTI IN MASCHERA 117 10. -

Counter-Tenor Damien Guillon Releases New Stradella Recording with His Ensemble Le Banquet Céleste Before Their UK Debut
Counter-tenor Damien Guillon releases new Stradella recording with his ensemble Le Banquet Céleste before their UK debut Friday 27 March Friday 22 May CD release (Alpha) St John’s Smith Square Stradella San Giovanni Battista London Festival of Baroque Music Friday 6 March – Saturday 11 April Damien Guillon tours with Masaaki Suzuki & Philippe Herreweghe Brussels, Budapest, Dublin, Düsseldorf, Essen, Gent, Hamburg Katowice, Köln, London, Lucerne, Lyon, Madrid, Milan, Paris Counter-tenor Damien Guillon and his French early music ensemble Le Banquet Céleste make their UK debut at St John’s Smith Square as part of the London Festival of Baroque Music on 22 May. Conducted by Damien Guillon, the group’s latest recording – Stradella’s San Giovanni Battista – is released on Alpha on 27 March. As counter- tenor, Guillon tours in the St. John Passion with Masaaki Suzuki and Bach Collegium Japan across Europe from 6 – 25 March, and the St. Matthew Passion with Philippe Herreweghe and Collegium Vocale Gent from 4 – 11 April. Le Banquet Céleste, which celebrated its 10th anniversary in 2019, has been in residence at the Opéra de Rennes since 2016, and regularly appears at major early music festivals across France and Europe. With in-demand counter-tenor and founder Damien Guillon at its centre, the ensemble focusses particularly on Baroque music for the counter-tenor voice, with works by Dowland, Bach, Frescobaldi, Pergolesi and Caldara forming part of its growing discography of repertoire released on Alpha and Glossa. The group appear at St John’s Smith Square as part of London Festival of Baroque Music on 22 May with a programme of some of Bach’s profoundest Cantatas, including the famous Ich habe genug, BWV 82 performed in its counter-tenor version by Damien Guillon. -

Musical Gazette (New York, 1854-1855)
Introduction to: Randi Trzesinski and Richard Kitson, The Musical Gazette (1854-1855) Copyright © 2007 RIPM Consortium Ltd Répertoire international de la presse musicale (www.ripm.org) The Musical Gazette (1854-1855) The Musical Gazette [MGA] was published weekly on Saturdays in New York City by the Mason Brothers from 11 November 1854 until 5 May 1855, and comprised twenty-six weekly numbers, the first two containing sixteen pages each, the remainder eight pages each. The issues are numbered from 1 through 26 and the pages are numbered consecutively from 1 through 208. In 1851 Daniel Gregory Mason (1820-1869) and his brother Lowell Mason (1823-1885)—sons of music educator and composer Lowell Mason—united with Henry W. Law to create the Mason & Law publishing firm. Daniel Gregory and Lowell Mason, Junior established in 1853 their own firm, the Mason Brothers, publishers of secular and religious music, school textbooks, histories, English and French dictionaries and music periodicals.1 In 1854 they undertook publication of The Choral Advocate and Singing-Class Journal, and began two new musical periodicals in November of that year, The Musical Gazette (edited by Lowell Mason, Junior) and The Musical Review. After 5 May 1855 MGA was absorbed into another music journal published by the Mason Brothers, The New-York Musical Review and Choral Advocate which was then renamed The New-York Musical Review and Gazette.2 The Mason Brothers’ principal goal for MGA was publication of a journal “devoted to the higher departments of musical literature and criticism; … Musical news from all parts of the world, where music is cultivated, will be promptly and regularly given.”3 Each page of MGA is printed in a two-column format and issues are organized in three main parts. -

April 1924) James Francis Cooke
Gardner-Webb University Digital Commons @ Gardner-Webb University The tudeE Magazine: 1883-1957 John R. Dover Memorial Library 4-1-1924 Volume 42, Number 04 (April 1924) James Francis Cooke Follow this and additional works at: https://digitalcommons.gardner-webb.edu/etude Part of the Composition Commons, Ethnomusicology Commons, Fine Arts Commons, History Commons, Liturgy and Worship Commons, Music Education Commons, Musicology Commons, Music Pedagogy Commons, Music Performance Commons, Music Practice Commons, and the Music Theory Commons Recommended Citation Cooke, James Francis. "Volume 42, Number 04 (April 1924)." , (1924). https://digitalcommons.gardner-webb.edu/etude/711 This Book is brought to you for free and open access by the John R. Dover Memorial Library at Digital Commons @ Gardner-Webb University. It has been accepted for inclusion in The tudeE Magazine: 1883-1957 by an authorized administrator of Digital Commons @ Gardner-Webb University. For more information, please contact [email protected]. MVSIC ETVDE MAG A ZINE Title Design Courtesy of "Woman’s Home Companion” $2.00 a Year price 25 cents APRIL, 1924 The Most Popular of all Modern ^ew Songs Instruction Works for the Pianoforte A Notable Group of Recently Published SCHOOL FOR THE PIANOFORTE Songs. A Glance will show that practically By THEO. PRESSER All the Leading Writers Are Represented in This Guide to The Best in New Song Offerings For Recital, Study and Church Needs SECULAR The World of Music S p, ,KOTo?SrRICHARD.a-g -40 1 :S8 .W.) .«• S —1™™,a ,o3 “=SS, ,o| X0205C^StJe.F-..H-..d-g 183X3%ERM^rROY..K-g -50 ^ BEGINNER’S BOOK lS548PKS°0Ei.DA^ .50 .00 SWfR¥.TOR^R .35 ^Kr,! iSS*£IIS! liSf 18 X7COOS&^A7oU.d-F .00 18925Wl8r...,-E .35 X^WhT^ .00 18743FLon^tagR,L.n0'LF. -
![Excerpt from Navidad Nuestra [Nah-Vee-THAD Nooayss-Trah]; Music by Ariel Ramírez [Ah-Reeell Rah-MEE-Rehth] and Text by F](https://docslib.b-cdn.net/cover/8962/excerpt-from-navidad-nuestra-nah-vee-thad-nooayss-trah-music-by-ariel-ram%C3%ADrez-ah-reeell-rah-mee-rehth-and-text-by-f-3038962.webp)
Excerpt from Navidad Nuestra [Nah-Vee-THAD Nooayss-Trah]; Music by Ariel Ramírez [Ah-Reeell Rah-MEE-Rehth] and Text by F
La anunciacion C La anunciación C lah ah-noon-theeah-theeAWN C (excerpt from Navidad nuestra [nah-vee-THAD nooAYSS-trah]; music by Ariel Ramírez [ah-reeELL rah-MEE-rehth] and text by F. Luna [(F.) LOO-nah]) La barca C lah BAR-kah C (The Boat) C (excerpt from the suite Impresiones intimas [eem- prayss-YO-nayss een-TEE-mahss] — Intimate Impressions — by Federico Mompou [feh- theh-REE-ko mawm-POOO]) La barcheta C lah bar-KAY-tah C (The Little Boat) C (composition by Hahn [HAHN]) La bas dans le limousin C Là-bas dans le Limousin C lah-bah dah6 luh lee-môô-zeh6 C (excerpt from Chants d'Auvergne [shah6 doh-vehrny’] — Songs of the Auvergne [o-vehrny’], French folk songs collected by Joseph Canteloube [zho-zeff kah6-t’lôôb]) La bas vers leglise C Là-bas, vers l'église C lah-bah, vehr lay-gleez C (excerpt from Cinq mélodies populaires grecques [seh6k may-law-dee paw-pü-lehr greck] — Five Popular Greek Melodies — by Maurice Ravel [mo-reess rah-vell]) La belle helene C La belle Hélène C lah bell ay-lenn C (The Fair Helen) C (an opera, with music by Jacques Offenbach [ZHACK AWF-funn-bahk]; libretto by Henri Meilhac [ah6-ree meh-yack] and Ludovic Halévy [lü-daw-veek ah-lay-vee]) La belle isabeau conte pendant lorage C La belle Isabeau (Conte pendant l’orage) C lah bell ee- zah-bo (kaw6t pah6-dah6 law-rahzh) C (The Lovely Isabeau (Tale During a Storm)) C (poem by Alexandre Dumas [ah-leck-sah6-dr’ dü-mah] set to music by Hector Berlioz [eck-tawr behr-leeawz]) La belle se sied au pied de la tour C lah bell s’-seeeh o peeeh duh lah tôôr C (The Fair Maid