La Communication Électronique: Enjeux De Langues
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Women, Old and Aware: Living As a Minority in Extended Care Institutions
WOMEN, OLD AND AWARE: LIVING AS A MINORITY IN EXTENDED CARE INSTITUTIONS by Linda-Mae Campbell B.A., The University of Alberta, 1982 B.S.W., The University of Victoria, 1990 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF SOCIAL WORK in THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES SCHOOL OF SOCIAL WORK We accept this thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA April 1998 © Linda-Mae Campbell, 1998 In presenting this thesis in partial fulfilment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and study. I further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the head of my department or by his or her representatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. 0 Department The University of British Columbia Vancouver, Canada DE-6 (2/88) Abstract Women Old And Aware: Living As A Minority In Extended Care Institutions The purpose of this phenomenological study was to describe the everyday lived experiences of old, cognitively intact women, residing in an integrated extended care facility among an overwhelming majority of confused elderly people. The research question was "From your perspective, what is the impact of living in an environment where the majority of residents, with whom you reside, are cognitively impaired?". A purposive sample of five older women participated in multiple in-depth interviews about their subjective experiences. -

Corporate Impersonation: the Possibilities of Personhood in American Literature, 1886-1917
Corporate Impersonation: The Possibilities of Personhood in American Literature, 1886-1917 by Nicolette Isabel Bruner A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (English Language and Literature) in the University of Michigan 2015 Doctoral Committee Professor Gregg D. Crane, Chair Professor Susanna L. Blumenthal, University of Minnesota Professor Jonathan L. Freedman Associate Professor Scott R. Lyons “Everything…that the community chooses to regard as such can become a subject—a potential center—of rights, whether a plant or an animal, a human being or an imagined spirit; and nothing, if the community does not choose to regard it so, will become a subject of rights, whether human being or anything else.” -Alexander Nékám, 1938 © Nicolette Isabel Bruner Olson 2015 For my family – past, present, and future. ii Acknowledgements This dissertation could not have been completed without the support of my committee: Gregg Crane, Jonathan Freedman, Scott Lyons, and Susanna Blumenthal. Gregg Crane has been a constant source of advice and encouragement whose intimate knowledge of law and literature scholarship has been invaluable to my own development as a scholar. Jonathan Freedman’s class on “Fictions of Finance” inspired much of the work in this dissertation, as did Susanna Blumenthal’s seminar on “The Concept of the Person” during my time at the University of Michigan Law School. Jonathan’s good humor, grace, and sympathetic yet critical eye have profoundly shaped my work. As I have expanded my research into animal studies, Scott Lyons guided me to new intellectual domains. Finally, ever since I began working with her during my first year of law school, Susanna has been a source of wisdom, encouragement, and generosity. -

Illegal Fencing on the Colorado Range
Illegal Fencing on the Colorado Range BY WILLIAM R. WHITE The end of the Civil War witnessed a boom in the cattle business in the western states. Because of the depletion of eastern herds during the war, a demand for cheap Texas beef in creased steadily during the late eighteen-sixties and the early eighteen-seventies. This beef also was in demand by those in dividuals who planned to take advantage of the free grass on the Great Plains, which had remained untouched prior to the war, except by the buffalo. Each year thousands of Texas cattle were driven north to stock the various ranges claimed by numerous cattlemen or would-be cattlemen. The usual practice of an aspir ing cattleman was to register a homestead claim along some stream where the ranch house and outbuildings were con structed. His cattle then were grazed chiefly upon the public lands where they "were merely on sufferance and not by right of any grant or permission from the government. " 1 The Homestead, Preemption, Timber Culture, and Desert Land acts had been enacted to enable persons to secure government land easily, but "the amount of acreage allowed was not even remotely enough to meet the needs of the western stockgrowers. " 2 Although the government land laws were not designed for cattlemen, they made extensive use of them. The statutes served the cattlemen, however, only as the cattlemen violated the spirit of the law. 3 During the sixties and the seventies cattlemen tended to respect the range claims of their neighbors and "the custom of priority-the idea of squatter sovereignty met the 1 Clifford P. -

Babel Underground
University of Texas at El Paso ScholarWorks@UTEP Open Access Theses & Dissertations 2017-01-01 Babel Underground Joyce Y. Butler University of Texas at El Paso, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.utep.edu/open_etd Part of the Creative Writing Commons Recommended Citation Butler, Joyce Y., "Babel Underground" (2017). Open Access Theses & Dissertations. 415. https://digitalcommons.utep.edu/open_etd/415 This is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UTEP. It has been accepted for inclusion in Open Access Theses & Dissertations by an authorized administrator of ScholarWorks@UTEP. For more information, please contact [email protected]. BABEL UNDERGROUND JOYCE Y. BUTLER MASTER’S PROGRAM IN CREATIVE WRITING APPROVED: ___________________________________ Jeffrey Sirkin, Ph.D., Chair ___________________________________ José de Piérola, Ph.D. ___________________________________ Marion Rohrleitner, Ph.D. ______________________________________ Charles H. Ambler, Ph.D. Dean of the Graduate School Copyright ©by Joyce Y. Butler BABEL UNDERGROUND BY JOYCE Y. BUTLER, B.A. THESIS Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at El Paso in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF FINE ARTS Creative Writing THE UNIVERSITY OF TEXAS AT EL PASO December 2017 TABLE OF CONTENTS Page TABLE OF CONTENTS…………………………………………………………………………iv CRITICAL INTRODUCTION……………………………………………………………………v BABEL UNDERGROUND………………………………………………………………………1 CURRICULUM VITA…………………………………………………………………………183 iv BABEL UNDERGROUND Critical Introduction Section I: Introduction During the last two years of undergrad, fall 2010 through spring 2012, I became aware that Americans of African descent were not the only people in the United States who struggle for a place in society. -

Bodies in Play: Female Athleticism in Nineteenth-Century Literature
University of South Carolina Scholar Commons Theses and Dissertations 2018 Bodies In Play: Female Athleticism In Nineteenth- Century Literature Jillian Weber University of South Carolina Follow this and additional works at: https://scholarcommons.sc.edu/etd Part of the English Language and Literature Commons Recommended Citation Weber, J.(2018). Bodies In Play: Female Athleticism In Nineteenth-Century Literature. (Doctoral dissertation). Retrieved from https://scholarcommons.sc.edu/etd/4786 This Open Access Dissertation is brought to you by Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. BODIES IN PLAY: FEMALE ATHLETICISM IN NINETEENTH-CENTURY LITERATURE by Jillian Weber Bachelor of Arts University of Illinois, 2009 Master of Arts University of South Carolina, 2013 Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Doctor of Philosophy in English College of Arts and Sciences University of South Carolina 2018 Accepted by: Leon Jackson, Major Professor Catherine Keyser, Major Professor Cynthia Davis, Committee Member Katherine Adams, Committee Member Cheryl L. Addy, Vice Provost and Dean of the Graduate School © Copyright by Jillian Weber, 2018 All Rights Reserved. ii ACKNOWLEDGEMENTS I am grateful to the University of South Carolina, the Institute for African American Research, and the Bilinski Educational Foundation for generously funding me through a Presidential Fellowship, a SPARC grant, an IAAR fellowship, and a Bilisnki Fellowship. This funding made it possible to complete my research and finish my dissertation. Without the generosity, patience, advice, and guidance, of Cat Keyser, Leon Jackson, Cynthia Davis, and Kate Adams, this dissertation would have never come to fruition. -
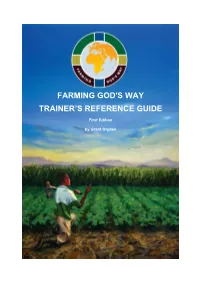
Trainer's Reference Guide
FARMING GOD'S WAY TRAINER’S REFERENCE GUIDE First Edition by Grant Dryden Reproduction Farming God’s Way Copyright © 2009 GW Dryden Farming God‟s Way is a resource given to the Copies of this publication can be downloaded wider body of Christ, to serve the poor and from www.farming-gods-way.org. deliver them from the yoke of poverty. Reproduction and dissemination of this publication in unaltered form for educational or Motto other non-commercial purposes are authorized Motivated by obedience, rooted in compassion without any prior written permission from the and delivered with love. copyright holder provided the source is fully acknowledged with the recommended citation Farming God’s Way Logo below. The new logo produced in 2009 was designed to fully capture the heart of Farming God's Reproduction of material in this publication for Way. The poor across the globe are central in resale or other commercial purposes is this theme and the orange glow depicts the permitted only with written permission of the promise of Isaiah 58 “Your light will break forth author, like the dawn”, starting with Africa as our core G.W. Dryden – [email protected]. focal point and extending to the remotest parts of the earth. The cross and bowl symbolise Recommended Citation Christ like humility and servanthood, where He Farming God‟s Way Trainer‟s Reference was prepared to give up His crown and glory to Guide. Dryden, G.W., 2009. serve the poor wholeheartedly. The horizontal portion of the cross is golden to represent Acknowledgements God‟s Blanket protecting and covering the This project was inspired by you the reader brown soil, which is such an important and potential Farming God's Way trainer, who inheritance to pass on through generations. -

Woman's Life in Colonial Days 1 Woman's Life in Colonial Days
Woman's Life in Colonial Days 1 Woman's Life in Colonial Days Project Gutenberg's Woman's Life in Colonial Days, by Carl Holliday This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net Title: Woman's Life in Colonial Days Author: Carl Holliday Release Date: March 28, 2005 [EBook #15488] Language: English Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK WOMAN'S LIFE IN COLONIAL DAYS *** Produced by Mark C. Orton, Karen Dalrymple and the Online Distributed Proofreading Team. [Transcriber's Note: In the original text, some footnotes were referenced more than once in the text. For clarity, these references have had a letter added to the number, for example, 26a.] WOMAN'S LIFE IN COLONIAL DAYS CARL HOLLIDAY Professor of English _San Jose State College, California_ AUTHOR OF THE WIT AND HUMOR OF COLONIAL DAYS, ENGLISH FICTION FROM THE FIFTH TO THE TWENTIETH CENTURY, A HISTORY OF SOUTHERN LITERATURE, THE WRITINGS OF COLONIAL VIRGINIA, THE CAVALIER POETS, THREE CENTURIES OF SOUTHERN POETRY, ETC. CORNER HOUSE PUBLISHERS WILLIAMSTOWN, MASSACHUSETTS _First Printed in 1922_ _Reprinted in 1968_ by CORNER HOUSE PUBLISHERS PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA PREFACE This book is an attempt to portray by means of the writings of colonial days the life of the women of that period,--how they lived, what their work and their play, what and how they thought and felt, their strength and their weakness, the joys and the sorrows of their everyday existence. -

British Newspapers and Films in the Interwar Period: a History and a Review
ORBIT-OnlineRepository ofBirkbeckInstitutionalTheses Enabling Open Access to Birkbeck’s Research Degree output The representation of London nights in British popu- lar press and film, 1919-1939 https://eprints.bbk.ac.uk/id/eprint/40490/ Version: Public Version Citation: Arts, Mara (2020) The representation of London nights in British popular press and film, 1919-1939. [Thesis] (Unpublished) c 2020 The Author(s) All material available through ORBIT is protected by intellectual property law, including copy- right law. Any use made of the contents should comply with the relevant law. Deposit Guide Contact: email The Representation of London Nights in British Popular Press and Film, 1919-1939 Candidate name: Mara Arts Submitted for the degree of Doctor of Philosophy Birkbeck, University of London 1 Declaration of original work I hereby confirm that the work presented in this thesis is my own. 2 Abstract This thesis explores the representation of night-time activities in the capital in popular British newspapers and films of the period. It argues that, whilst an increasingly democratised night allowed for more opportunities for previously marginalised groups, popular media of the period largely promoted adherence to the status quo. The thesis draws on extensive primary source material, including eighty British feature films and newspaper samples of the Daily Mail, Daily Express and Daily Mirror to systematically analyse the representation of London’s nightlife in the British interwar period. This period saw the consolidation of the popular daily newspaper industry and, after government intervention, an expansion of the domestic film industry. The interwar period also saw great social change with universal suffrage, technological developments and an economic crisis. -

'Gypsies' and 'Anarchists'
1 ‘Gypsies’ and ‘Anarchists’: Autonomy, solidarity, and sacrifice in Belgrade, Serbia Frederick Schulze Submitted to Central European University Department of Sociology and Social Anthropology In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Supervisor: Professor Don Kalb CEU eTD Collection External reader: Maple John Razsa Second reader: Violetta Zentai Budapest, Hungary 2017 2 Table of Contents Abstract.................................................................................................................................................3 Acknowledgments................................................................................................................................4 Introduction [i/A] Dissertation overview..................................................................................................................6 [i/B] Class and race..............................................................................................................................9 [i/C] Anarchism and the State.............................................................................................................24 [i/D] Methodology..............................................................................................................................37 Chapter I: InexFilm [I/A] Field site description..................................................................................................................44 [I/B] The sacred political....................................................................................................................48 -

Patriotic Support: the Girdle Pin-Up of World War Ii A
PATRIOTIC SUPPORT: THE GIRDLE PIN-UP OF WORLD WAR II A Thesis Presented to The Graduate Faculty of The University of Akron In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts Kathryn M. Brown December, 2010 PATRIOTIC SUPPORT: THE GIRDLE PIN-UP OF WORLD WAR II Kathryn M. Brown Thesis Approved: Accepted: ________________________________ _________________________________ Advisor Dean of the College Dr. Tracey Jean Boisseau Dr. Chand Midha ________________________________ _________________________________ Co-Advisor Dean of the Graduate School Dr. Shelley Baranowski Dr. George R. Newkome ________________________________ _________________________________ Department Chair Date Dr. Michael Sheng ii TABLE OF CONTENTS Page LIST OF FIGURES ................................................................................................................. v CHAPTER I. INTRODUCTION .......................................................................................................... 1 A Girl for Every Taste: Different Styles of Pin-Ups .............................................. 4 Artistic Conventions and Aesthetic Properties of the Pin-Up ............................... 6 II. IDENTITY EMBODIED ............................................................................................. 10 The Evolution of the Corset and Girdle ................................................................ 10 Controlling Wild Flesh: Girdles and Sexuality .................................................... 12 Girdles Go To War ................................................................................................ -

The World War and What Was Behind It the Story of the Map of Europe
The World War and What was Behind It The Story of the Map of Europe Louis P. Benezet Project Gutenberg's The World War and What was Behind It, by Louis P. Benezet This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net Title: The World War and What was Behind It The Story of the Map of Europe Author: Louis P. Benezet Release Date: February 20, 2004 [EBook #11200] Language: English Character set encoding: ASCII *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK THE WORLD WAR *** Produced by Distributed Proofreaders THE WORLD WAR AND WHAT WAS BEHIND IT or THE STORY OF THE MAP OF EUROPE By L. P. BENEZET SUPERINTENDENT OF SCHOOLS, EVANSVILLE, INDIANA [Illustration: The Peace Palace at the Hague] PREFACE This little volume is the result of the interest shown by pupils, teachers, and the general public in a series of talks on the causes of the great European war which were given by the author in the fall of 1914. The audiences were widely different in character. They included pupils of the sixth, seventh, and eighth grades, students in high school and normal school, teachers in the public schools, an association of business men, and a convention of boards of education. Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. In every case, the same sentiment was voiced: "If there were only some book which would give us these facts in simple language and illustrate them by maps and charts as you have done!" After searching the market for a book of this sort without success, the author determined to put the subject of his talks into manuscript form. -

The Early Christians in Their Own Words
E B E R H A R D A R N O L D THE EARLY I n t h e i r O w n w o r d s CHRISTIANS A SOURCE BOOK OF ORIGINAL WRITINGS INCLUD- ING TEXTS BY TERTULLIAN HERMAS IGNATIUS JUSTIN POLYCARP IRENAEUS ORIGEN CLEMENT OF ALEXANDRIA EXTRA-BIBLICAL SAYINGS OF JESUS THE EARLY CHRISTIANS In Their Own Words SELECTED AND EDITED BY EBERHARD ARNOLD Please share a link to this e-book with your friends. Feel free to post and share links to this e-book, or you may e-mail or print this book in its entirety or in part, but please do not alter it in any way, and please do not post or offer copies of this e-book for download on another website or through another Internet-based download service. If you wish to make multiple hard copies for wider distribution, or to reprint portions in a newsletter or periodical, please observe the following restrictions: • You may not reproduce it for commercial gain. • You must include this credit line: “Copyright 2011 by The Plough Publishing House. Used with permission.” This e-book is a publication of The Plough Publishing House, Rifton, NY 12471 USA (www.plough.com) and Robertsbridge, East Sussex, TN32 5DR, UK (www.ploughbooks.co.uk) Copyright © 2011 by Plough Publishing House Rifton, NY 12471 USA USING THIS BOOK ASIDE FROM CHAPTER I, which is an overview of the early Christian era by Eberhard Arnold, each chapter consists of passages by the early be lievers themselves, and by non-Christian contemporaries.