The Who. Getting in Tune
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Nawazuddin Siddiqui
lifestyle WEDNESDAY, APRIL 1, 2015 Music & Movies Nawazuddin Siddiqui, farmer’s son turned ‘Hindi indie’ star t is a story worthy of a Bollywood plot: The son of a selected for the Cannes Film Festival, he turned heads in cinema hall to watch his films. north Indian farmer, one of nine children, rising to crime thrillers “Kahaani” (Story) and “Talaash” (Search). He will appear again with Salman Khan in upcoming Ibecome the face of independent Hindi cinema. But He said his family are still surprised by how far he has romantic drama “Bajrangi Bhaijaan”, and with Shah Rukh Nawazuddin Siddiqui is still getting used to his success. come. “And you cannot blame them. I am a five-foot six- Khan in “Raees” (Rich Man), in which he plays a cop who “When someone is looking at me, I feel they are looking inch, dark, ordinary-looking man. People didn’t imagine is chasing Khan’s mafia character. Siddiqui says he at someone standing behind me, not at me,” the 40-year- that I would make it,” he said. “It is the mindset of our admires Bollywood megastars for their longevity- old confessed to AFP during an interview at a Mumbai country too, that people like (me) don’t become stars. ”they’re very well-maintained”-and he wouldn’t rule out hotel. Maybe it’s a result of 200 years of colonial rule.” doing a song-and-dance number himself, despite his “I have not got used to it and I won’t allow myself to Industry outsider reservations about Bollywood musicals. -
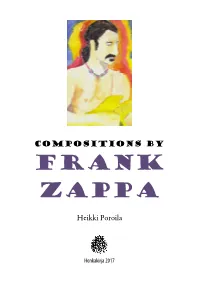
Compositions-By-Frank-Zappa.Pdf
Compositions by Frank Zappa Heikki Poroila Honkakirja 2017 Publisher Honkakirja, Helsinki 2017 Layout Heikki Poroila Front cover painting © Eevariitta Poroila 2017 Other original drawings © Marko Nakari 2017 Text © Heikki Poroila 2017 Version number 1.0 (October 28, 2017) Non-commercial use, copying and linking of this publication for free is fine, if the author and source are mentioned. I do not own the facts, I just made the studying and organizing. Thanks to all the other Zappa enthusiasts around the globe, especially ROMÁN GARCÍA ALBERTOS and his Information Is Not Knowledge at globalia.net/donlope/fz Corrections are warmly welcomed ([email protected]). The Finnish Library Foundation has kindly supported economically the compiling of this free version. 01.4 Poroila, Heikki Compositions by Frank Zappa / Heikki Poroila ; Front cover painting Eevariitta Poroila ; Other original drawings Marko Nakari. – Helsinki : Honkakirja, 2017. – 315 p. : ill. – ISBN 978-952-68711-2-7 (PDF) ISBN 978-952-68711-2-7 Compositions by Frank Zappa 2 To Olli Virtaperko the best living interpreter of Frank Zappa’s music Compositions by Frank Zappa 3 contents Arf! Arf! Arf! 5 Frank Zappa and a composer’s work catalog 7 Instructions 13 Printed sources 14 Used audiovisual publications 17 Zappa’s manuscripts and music publishing companies 21 Fonts 23 Dates and places 23 Compositions by Frank Zappa A 25 B 37 C 54 D 68 E 83 F 89 G 100 H 107 I 116 J 129 K 134 L 137 M 151 N 167 O 174 P 182 Q 196 R 197 S 207 T 229 U 246 V 250 W 254 X 270 Y 270 Z 275 1-600 278 Covers & other involvements 282 No index! 313 One night at Alte Oper 314 Compositions by Frank Zappa 4 Arf! Arf! Arf! You are reading an enhanced (corrected, enlarged and more detailed) PDF edition in English of my printed book Frank Zappan sävellykset (Suomen musiikkikirjastoyhdistys 2015, in Finnish). -

Popular Imperialism: the British Pop Music Industry 1950- 1975 Richard
Popular Imperialism: The British Pop Music Industry 1950- 1975 Richard Coopey Business History Unit, London School of Economics Abstract In this paper the general contours of the British popular music industry are outlined, charting the development of new technologies, new business forms and new market structures, which transformed the sector between 1950 and 1975. The paper then goes on to introduce some concepts and ideas related to the global impact of the business, including its relationship to the USA and wider markets, and specifically the role of London as a centre for production, but also as a key cultural idea in the pop world of the 1960s. Introduction The British popular music industry developed and transformed itself during the first decades following World War Two, becoming, alongside the USA, a major force in the global entertainment industry. This paper will outline the nature of this growth, examining its components and impact. The development of the pop music industry is a complex phenomenon. There has been much interest in recent years in the relationship between business and wider cultural and social dynamics. Scholars such as Ken Lipartito, Mick Rowlinson and Geoff Jones have been part of a ‘cultural turn’ in business history, examining the role of cultures, somehow defined, in influencing and shaping business strategy, trajectories and so on. With the pop music industry, however, we need to engage with a sector which trades in culture itself. An industry involved directly in the production of culture, and calling for analysis of an increasingly challenging nature. The pop music industry did not emerge de novo in the post war period. -

Turtle Rock Guitar Book 5.Pdf
Preface to the 5th Edition This book and the Guitar Club that went with it started because one of my old counsellors put a few guitar chords into the official camp song book. Those chords were the reason I learned to play. That summer, when we were last-year campers, regular activities were cancelled one day because of stormy weather. We all piled into the lodge, where we sat with Ryley and her guitar, singing all afternoon. It was the first time a lot of us had ever sung our favourite camp songs with a guitar. At the time, I'd never even heard recordings of most of them. (This is before Napster, kids.) I remain ever thankful that we didn't play Rainy Day Bingo that afternoon. At the end of the summer I started writing in chords for the rest of the song book, which gradually led to the first edition of The Mi-A-Kon-Da Guitar Book. Since then, this book's seen a few new places and met a lot of new songs. It seemed about time to give it a name that would bring everything and everyone together. Turtle Rock does just this. On Birch Island, it's where the whole camp meets after lights out on Mi-A-Kon-Da night to sing quiet songs by the fire, listen to the camp legend, and watch the full moon rise over the lake. It's also where we meet for special cook-outs, reflections, and early in the morning to watch that bittersweet Last Sunrise of the Summer. -

Gateway Theater 1820 E Sunrise Blvd Ft. Lauderdale FL 33304
ADMISSION: $5 Donation Suggested Festival Schedule Thursday, Nov. 5 6:30 p.m. Gala & Silent Auction ARTSERVE, Ft. Lauderdale 1350 East Sunrise Blvd. Friday, Nov. 6 1:00 p.m. Lipstick & Liquor (76 min) 2:30 p.m. Wisdom to Know the Difference Presented by Writers In Treatment, this multi-day event (114 min) celebrates film and creativity. The event showcases filmmakers who 4:45 p.m. Death of an Addict: The Tio Hardiman make honest films about addiction, alcoholism, behavioral disorders, treatment Story (60 min) and recovery. 6:00 p.m. Girl on the Edge (105 min) 8:00 p.m. The Other Side of Cannabis: Negative Effects of Marijuana on our Youth November 6 - 8, 2015 (72 min) 9:30 p.m. Paul Williams: Still Alive (84 min) Gateway Theater Saturday, Nov. 7 1820 E Sunrise Blvd 12:30 p.m. Art of Recovery (59 min) Ft. Lauderdale FL 33304 1:45 p.m. Who We Are When We Are Not Addicted: The Possible Human (59 min) 3:15 p.m. An American Epidemic (90 min) Amy - 128 min. How I Got Over - 87 min. 4:45 p.m. Lambert & Stamp (117 min) (2015) From BAFTA Award-winning director (2014) Fifteen formerly homeless or incarcer- 7:00 p.m. Amy (128 min) Asif Kapadia, AMY tells the incredible story of ated women craft an original play based on 9:30 p.m. Gridlock’d (91 min) six-time Grammy-winner Amy Winehouse - in their true-life stories. her own words. Featuring extensive unseen archival footage and previously unheard Sunday, Nov. -

Keith Moon Was Here
KEITH MOON WAS HERE by TOD DAVIES & ALEX COX FIRST DRAFT, January 2001 © 2001 2 BLACK SCREEN The opening bars of "BARBARA ANN," as played by THE BEACH BOYS, are heard. FADE IN -- EXT DREAM CALIFORNIA DAY A FANTASY VERSION of MALIBU BEACH in the EARLY SIXTIES. SURFERS, bikini-clad SURFER BABES, VOLLEYBALL, WOODIES, a SKINNY BESPECTACLED FELLOW getting SAND kicked in his face. A GANG OF SPECTACULAR FOXY BIKINI CHICKS is gathered in front of an improvised stage -- on which a band is playing an impromptu surfer music gig. The band is THE BEACH BOYS. The SONG is "BARBARA ANN." CAMERA PANS across our BEACH BOYS LOOKALIKES -- all is as it should be -- till we reach the DRUMMER. The YOUNG KEITH MOON. MOON does not thrash his kit, but plays an easygoing beat. For he is, in his fantasy, a BEACH BOY. And his drum kit is ELEVATED, at the FRONT and CENTRE of the stage. KEITH I should have been a BEACH BOY. No question. I loved that music above all others. That, and the Calfornia LIFESTYLE. Sun. Sand. Surf. And SENSUALITY. What more could a fifteen year old lad from Wembley want? But 'oo did I end up with? CUT TO -- INT SAN FRANCISCO CIVIC AUDITORIUM NIGHT REAR VIEW of a DRUMMER hammering the BIGGEST DRUM KIT anyone has ever seen, on a riser on stage. This is KEITH, at 25. It's 1971. The BAND, as KEITH's drums proudly state, is THE WHO. 3 The scene plays without dialogue. We'll hear the dialogue later. -

The British Invasion: Finding Traction in America by Piacentino Vona A
The British Invasion: Finding Traction in America by Piacentino Vona A thesis presented to the University Of Waterloo in fulfilment of the thesis requirement for the degree of Master of Arts in History Waterloo, Ontario, Canada, 2018 © Piacentino Vona 2018 Author’s Declaration I hereby declare that I am the sole author of this thesis. This is a true copy of the thesis, including any required final revisions, as accepted by my examiners. I understand that my thesis may be made electronically available to the public. ii Abstract As a period of American History, the 1960s has provided historians and academics with a wealth of material for research and scholarship. Presidents John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson and Richard Nixon, the Vietnam War, the hippie era, and the Civil Rights Movement, among other topics have received thorough historical discussion and debate. Music was another key aspect in understanding the social history of the 1960s. But unlike the people and events mentioned above, historians have devoted less attention to music in the historical landscape. The British Invasion was one such key event that impacted America in the 1960s. Bands such as the Beatles, the Rolling Stones, and the Who found their way into the United States and majorly impacted American society. Using secondary sources, newspaper articles, interviews and documentaries on these bands, this thesis explores the British Invasion and its influence in the context of 1960s America. This thesis explores multiple bands that came in the initial wave. It follows these bands from 1964-1969, and argues that the Beatles, the Rolling Stones, and the Who shared common multiple factors that allowed them to attain the traction to succeed and to maintain that success in the United States. -
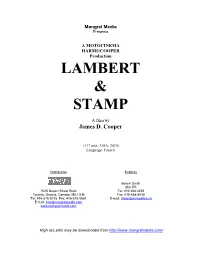
Lambert & Stamp
Mongrel Media Presents A MOTOCINEMA HARMS/COOPER Production LAMBERT & STAMP A film by James D. Cooper (117 min., USA, 2015) Language: French Distribution Publicity Bonne Smith Star PR 1028 Queen Street West Tel: 416-488-4436 Toronto, Ontario, Canada, M6J 1H6 Fax: 416-488-8438 Tel: 416-516-9775 Fax: 416-516-0651 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] www.mongrelmedia.com High res stills may be downloaded from http://www.mongrelmedia.com/ Starring Chris Stamp Kit Lambert ! Featuring ! Pete Townshend Roger Daltrey Terence Stamp Heather Daltrey Richard Barnes John Hemming Irish Jack Robert Fearnley-Whittingstall ! ! ! Edited by Christopher Tellefsen, A.C.E. Director of Photography - James D. Cooper Associate Producers - W. Wilder Knight II, Elizabeth Negrotto Sapnar Executive Producers - Loretta Harms, Mark Mullen Produced by Loretta Harms, Douglas Graves Produced and Directed by James D. Cooper ! ! ! ! ! LAMBERT & STAMP Director’s Statement ! ! ! Throughout time Youth has always struggled to find a place in a pre-existing world in which they feel they have little place. By risking new relations and creating a sense of identity which better reflects them, they can have the power to impact a changing world by what they bring into it, -through fearless self discovery. "Lambert & Stamp" tells this story. It's universal theme of self discovery through connection with others, along with an extraordinary (and highly entertaining) set of circumstances, is what I wanted to portray in the film. ! In postwar London, two men seeking to transcend the constraints of their respective circumstances: one, the bleak reality of the East End working class, the other, a daunting aristocratic legacy, -embrace the dynamics of an unlikely relationship to pursue a shared artistic dream. -

Mit Pete Townshend Und Roger Daltrey
The Who Die offizielle Bandgeschichte Ben Marshall mit Pete Townshend und Roger Daltrey The Who Die offizielle Bandgeschichte PRESTEL MÜNCHEN · LONDON · NEW YORK 6 Einführung 174 Amazing Journey von Bill Curbishley 1971 – 1975 8 It’s a Boy 208 Hooligans 1944 – 1955 1975 – 1978 16 Auftritt Roger Harry Daltrey 226 Narbengewebe 18 Auftritt John Alec Entwistle 20 Auftritt Peter Dennis Blandford Townshend 22 Auftritt Keith John Moon 230 Moon Beams 242 Die seltsame Story von Esso, Dave, Keith Moon 24 My Generation und den Freizeitpunks 1954 – 1958 40 Teddy Boys 244 Doctor Jimmy 1978 – 1979 266 Die Schlacht von Brighton Beach 44 Sparks 1958 – 1964 270 When You Do It Alone 1979 – 2000 58 Maximum R&B 1964 – 1965 98 Lambert und Stamp 276 The Ox 104 Wer sind die Mods? 286 The Seeker 110 The Who Sell Out 2006 1965 – 1969 144 Pop wird Kunst 292 What’s Next? 146 Tommy Can You Hear Me? 308 Diskographie 1969 – 1974 316 Register 170 Hippies 319 Bildnachweis Einführung Eine wirkliche Rockoper Jede gute Story hat einen Anfang, einen Verlauf und ein Hymnen, die auf eine Fragen stellende und desillusionierte Ende. Mein Anfang war im Dezember 1970, als ich auf Einla- Jugend abzielten. Neben ihnen ein musikalisches Multitalent, dung von Mike Shaw und Chris Stamp, zweier lebenslanger der Bassist John Entwistle, der so spielte, als sei er der Lead - Freunde, in die Plattenfirma Track Records eintrat. Als alten gitarrist, und Keith Moon, ein verrückter Drummer, der sich Schulfreunden und Mods lagen uns die Liebe zur Musik und an keine herkömmlichen Regeln hielt. -

Eq-Mag-Jan14-Web-Spreads.Pdf
ENGAGE, INNOVATE, DELIVER. Let’s get started Julie Meyer on egos, explosive growth and getting David and Goliath to dance INSIDE> COPING WITH GROWTH Follow our four golden rules PAGE 4 WINNING MARGINS Small changes for big business wins PAGE 18 PREMIER LEAGUE Introducing Equiniti Premier Services PAGE 26 FOREWORD CONTENTS WORDS FROM THE FRONT INSIDE THIS ISSUE of the 6best A time for transformation BUSINESS ENGAGE, INNOVATE, DELIVER. Let’s get EQUINITI MAGAZINE started Julie Meyer on egos, explosive growth and NUMBER 11 getting David and Stuart Ellen, Managing Director, TRANSFORMATIONS Goliath to dance INSIDE> Cover photograph COPING WITH GROWTH Follow our four golden rules PAGE 4 WINNING MARGINS by Tony French Small changes for big business wins PAGE 18 PREMIER LEAGUE Registration Services, Equiniti Introducing Equiniti A change is as good as a rest – or in the Premier Services PAGE 26 case of these companies, it’s even better. Radically transforming their offerings has Managing transformation is key to any enabled these businesses to keep ahead business that wishes to grow, develop and and continue making profits. REGULARS thrive. If you consider how our business has developed over the past six years, we have 6 Thinking aloud 22 Six steps Brian White and Jon Wilson How to successfully manage an IPO undergone a huge amount of change. One Tiffany’s on returning to the top of their game change that was announced towards the end 24 My Equiniti 3 From humble to high society, Tiffany’s Nicola Pattimore discusses the of last year was John Parker’s retirement from 20 Company has achieved one of the most extraordinary importance of Equiniti’s people his role as Managing Director, Shareholder business transformations of all time by Secretary profile Meet Tate & Lyle’s Solutions. -

The Who US Records, 1964-1973 Regular-Issue Singles
The Who US Records, 1964-1973 Regular-Issue Singles “I Can’t Explain”/ “Bald-Headed Woman” Decca 31725 First Appearance in Trade Magazines: December 19, 1964. Pink label promo (55dj) Promo (Duchess, “Townsend”) Promo single (Leeds 1) Promo (Leeds 2, “Townshend”) Gloversville Pinckneyville First copies misspell “Townshend.” Earliest copies from Gloversville show the B-side publisher as Duchess Music instead of Leeds Music. Corrected Gloversville Corrected Pinckneyville “Townshend” spelled properly 1967 Gloversville (no I) 1967 Gloversville (I) 1967 Pinckneyville B-side credit correctly reads Leeds Music. B-side Champion Music 1971 Pinckneyville B-side Leeds Music “Anyway Anyhow Anywhere”/ “Anytime You Want Me” Decca 31801 First mention in trade magazines: June 5, 1965. Pink label promo (55dj) Promo single Gloversville Pinckneyville 1967 Pinckneyville “My Generation”/ “Out in the Street” Decca 31877 First appearance in trade magazines: November 20, 1965. Pink label promo (55dj) Promo single Gloversville Pinckneyville 1967 Gloversville 1967 Pinckneyville The first pressing gives the subtitle to “Out in the Street” as “(You’re Going to Know Me).” 1971 Gloversville 1971 Pinckneyville “Substitute”/ “Waltz for a Pig” Atco 45-6409 White/Yellow Label with no address First pressing. April, 1966. Promo single (S) Promo single (P) Specialty Presswell Monarch “Substitute”/ “Waltz for a Pig” Atco 45-6509 White/Yellow Label with no address (PL), or with Broadway address (others) Reissue of the above single. August, 1967. Promo single (S) Promo single (P) ARP Specialty Presswell Monarch “The Kids are Alright”/ “A legal Matter” Decca 31988 First Appearance in Trade Magazines: July 16, 1966 Promo single (55dj) Gloversville Pinckneyville “I’m a Boy”/ “In the City” Decca 32058 First Appearance in Trade Magazines: January 21, 1967 Pink label promo (55xdj) Promo single Gloversville Pinckneyville “Happy Jack”/ “Happy Jack” Decca 34444 March 1967. -

Focus on TBA Musicians
Volume 30,Volume Number 30, Number 4 • 6December • February 2011 2010 • Shevat/Adar • Kislev/Tevet 5771 5771 Focus on TBA Musicians directory TEMPLE BETH ABRAHAM Services Schedule is proud to support the Conservative Movement by Services/ Time Location affiliating with The United Synagogue of Conservative Monday & Thursday Judaism. Morning Minyan Chapel 8:00 a.m. Friday Evening (Kabbalat Shabbat) Chapel 6:15 p.m. Advertising Policy: Anyone may sponsor an issue of The Omer and receive a dedication for their business or loved one. Contact us for details. We do Shabbat Morning Sanctuary 9:30 a.m. not accept outside or paid advertising. The Omer is published on paper that is 30% post-consumer fibers. Candle Lighting (Friday) The Omer (USPS 020299) is published monthly except July and August February 4 5:17 p.m. by Congregation Beth Abraham, 336 Euclid Avenue, Oakland, CA 94610. February 11 5:25 p.m. Periodicals Postage Paid at Oakland, CA. February 18 5:33 p.m. POSTMASTER: Send address changes to The Omer, c/o Temple Beth February 25 5:40 p.m. Abraham, 336 Euclid Avenue, Oakland, CA 94610-3232. © 2010. Temple Beth Abraham. The Omer is published by Temple Beth Abraham, a non-profit, located at Torah Portions (Saturday) 336 Euclid Avenue, Oakland, CA 94610; telephone 510-832-0936. It is February 5 Terumah published monthly except for the months of July and August for a total of February 12 Tetzaveh ten issues per annum. It is sent as a requester publication and there is no February 19 Ki Tissa paid distribution.