Moussey-DDAE V0
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Commune De Lusigny Sur Barse
République Française Département Aube Commune de Lusigny sur Barse SEANCE DU 23 Septembre 2016 Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 19 Présents : 13 Ayant pris part au vote : 19 Date de la Convocation : 16/09/2016 Date d’affichage : 16/09/2016 ORDRE DU JOUR : ••• Plan Particulier d'intervention (PPI) du barrage-réservoir Seine (lac d'Orient) - 2016/039 ••• ACCUEIL ENFANCE JEUNESSE - Mutualisation des services extrascolaires - 2016/040 ••• ACCUEIL ENFANCE JEUNESSE - Accueil extrascolaire des enfants de 13 à 17 ans - 2016/041 ••• ACCUEIL ENFANCE JEUNESSE - Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse de la CAF - 2016/042 ••• AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - projet d'harmonisation de la Signalisation d'Information Locale - 2016/043 ••• PERSONNEL COMMUNAL - chèques CADO - 2016/044 ••• PERSONNEL COMMUNAL - assurance statutaire ••• - 2016/045 ••• SPL X-DEMAT - Rapport de gestion du Conseil d'Administration et proposition d'augmentation du capital - 2016/046 L’an 2016 , le 23 Septembre à 19 heures , le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Christian BRANLE, Maire, Vice-Président du Conseil Départemental. PRESENTS : BRANLE Christian TRESSOU M.-Hélène ECHIVARD M.-Claude CARILLON Pascal FABRE Nathalie LEBLANC Michèle PESENTI Daniel CHARVOT Catherine GNAEGI Éric BORDELOT J.-Pierre DUVAL Francelise ETIENNE Eric ROGER Anne ABSENTS : LAUNOY Alain, excusé ayant donné pouvoir à TRESSOU Marie-Hélène FROBERT J.-Claude, excusé ayant donné pouvoir à CARILLON Pascal DURAND Jacqueline, -

Troyes > Chaumont C
Fiche Horaire c 14 Troyes > Chaumont 0 805 415 415 du 17 juillet au 11 décembre 2021 Mise à jour le : 02 juin 2021 Du lundi au vendredi Samedi Lun Sauf Mer Lun f f Les arrêts entre Vendeuvre et Bar-sur-Aube sont desservis à la demande 1 et à la descente uniquement. Troyes (Gare) 12.00 18.18 Troyes (Gare) 5.50 6.00 12.00 17.2 0 19.15 Troyes (Victor Hugo) 12.03 18.21 Troyes (Victor Hugo) | | 12.03 17. 2 3 19.18 Troyes (Boulevard du 14 Juillet) 12.08 18.26 Troyes (Boulevard du 14 Juillet) | | 12.08 17. 2 8 19.23 Troyes (Quennedey) 12.11 18.29 D En raison du marché le Samedi matin à Bar-sur-Aube, l’arrêt Hôtel de Troyes (Quennedey) | | 12.11 17. 31 19.26 St-Julien-les-Villas 12.16 18.34 Ville est déplacé à l’arrêt Ste-Thérèse Boulevard Gambetta pour la St-Julien-les-Villas | | 12.16 17. 3 6 19.31 Rouilly-St-Loup (Guérade) 12.21 18.39 descente et l’arrêt Place Mathaux Boulevard de la République pour la Rouilly-St-Loup (Guérade) | | 12.21 17. 41 19.36 Rouilly-St-Loup (D21) 12.24 18.42 montée. Rouilly-St-Loup (D21) | | 12.24 17. 4 4 19.39 Daudes 12.28 18.46 D Pour les parcours entre Ville-sous-la-Ferté et Chaumont, consultez la Daudes | | 12.28 17. 4 8 19.43 Montaulin (Mairie) 12.30 18.48 fiche horaire C 22. Montaulin (Mairie) | | 12.30 17. -

Région Territoire De Vie-Santé Commune Code Département Code
Code Code Région Territoire de vie-santé Commune département commune Grand-Est Rethel Acy-Romance 08 08001 Grand-Est Nouzonville Aiglemont 08 08003 Grand-Est Rethel Aire 08 08004 Grand-Est Rethel Alincourt 08 08005 Grand-Est Rethel Alland'Huy-et-Sausseuil 08 08006 Grand-Est Vouziers Les Alleux 08 08007 Grand-Est Rethel Amagne 08 08008 Grand-Est Carignan Amblimont 08 08009 Grand-Est Rethel Ambly-Fleury 08 08010 Grand-Est Revin Anchamps 08 08011 Grand-Est Sedan Angecourt 08 08013 Grand-Est Rethel Annelles 08 08014 Grand-Est Hirson Antheny 08 08015 Grand-Est Hirson Aouste 08 08016 Grand-Est Sainte-Menehould Apremont 08 08017 Grand-Est Vouziers Ardeuil-et-Montfauxelles 08 08018 Grand-Est Vouziers Les Grandes-Armoises 08 08019 Grand-Est Vouziers Les Petites-Armoises 08 08020 Grand-Est Rethel Arnicourt 08 08021 Grand-Est Charleville-Mézières Arreux 08 08022 Grand-Est Sedan Artaise-le-Vivier 08 08023 Grand-Est Rethel Asfeld 08 08024 Grand-Est Vouziers Attigny 08 08025 Grand-Est Charleville-Mézières Aubigny-les-Pothées 08 08026 Grand-Est Rethel Auboncourt-Vauzelles 08 08027 Grand-Est Givet Aubrives 08 08028 Grand-Est Carignan Auflance 08 08029 Grand-Est Hirson Auge 08 08030 Grand-Est Vouziers Aure 08 08031 Grand-Est Reims Aussonce 08 08032 Grand-Est Vouziers Authe 08 08033 Grand-Est Sedan Autrecourt-et-Pourron 08 08034 Grand-Est Vouziers Autruche 08 08035 Grand-Est Vouziers Autry 08 08036 Grand-Est Hirson Auvillers-les-Forges 08 08037 Grand-Est Rethel Avançon 08 08038 Grand-Est Rethel Avaux 08 08039 Grand-Est Charleville-Mézières Les Ayvelles -
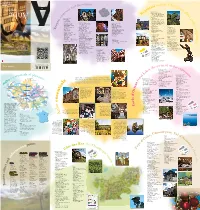
A Ube Essentials
ès Congr et ourisme T en Champagne en overies the isc nd Cha as d d is a mp en Champagne en an ta ag Aube s n n m e e u g Natural heritage p e o • Marnay-sur-Seine botanical garden l s N Chemin des Gougins - MARNAY-SUR-SEINE a u In 2 hectares, the remarkable diversity of the in plant world, via over 2,500 different species , m and varieties. Natural heritage • La Brisatte Garden p , • Pierre Pitois park Chemin de la Brisatte - MESNIL-SAINT-LOUP a s 54 rue Aristide Briand Mr and Mrs Bécard welcome you for free all LA CHAPELLE-SAINT-LUC r e Cultural heritage along the year to discover 440 vegetal species. 6.5 ha park with a zoo area, • La Motte-Tilly Chateau park and gardens k • Centre for Tools and Worker Thought Leisure and events y flower pavilion, insectarium. Magnificent 60 ha park with some s Hôtel de Mauroy • Gliding centre • Barberey-Saint-Sulpice chateau remarkable trees. o 7 rue de la Trinité - TROYES Barberey-Saint-Sulpice airport. Terroir park and gardens • Blancs Fossés dolmen a Important collection of tools of the • Carting in Creney and Saint Lyé. • Saint-Martin mill r 9 ha park – French gardens with MARCILLY-LE-HAYER n companions of the Tour de France. • The city in music 6 chemin de la Laiterie an old orchard. A Megalithic monument. • Museum of Modern Art From the end of June to the end of July. SAINT-MARTIN-DE-BOSSENAY T • Menois chateau park • Ile Olive park in Nogent-sur-Seine d Place Saint Pierre - TROYES • Troyes-Les Lacs and Troyes-Haute Seine Bar - Artisan beer tasting. -

Programme Des Animations/Visites À
AÉROPORT PARISVATRY CHALONS REIMS LILLE METZ JOURNÉES EUROPÉENNES MONTSUZAIN DU PATRIMOINE TROYES CHAMPAGNE AUBETERRE MÉTROPOLE VILLACERF FEUGES PAYNS MERGEY SAINTBENOIT SURSEINE VAILLY LE PAVILLON SAINTE JULIE SAINT LYÉ VILLELOUP SAINTE MAURE BARBEREY SAINTSULPICE NANCY SAINTDIZIER CRENEY PRÈS TROYES DIERREY SAINT PIERRE LAVAU PONT SAINTEMARIE LA CHAPELLE SAINTLUC BOURANTON VILLECHÉTIF MONTGUEUX LES NOËS TROYES PRÈSTROYES SAINTPARRES AUXTERTRES LAUBRESSEL THENNELIÈRES SAINTESAVINE MACEY FONTVANNES SAINTANDRÉ LA RIVIÈRE LESVERGERS SAINTJULIEN RUVIGNY DE CORPS LESVILLAS TORVILLIERS COURTERANGES BUCEY ESTISSAC ENOTHE SAINT MESSON GERMAIN ROUILY SAINT LOUP SENS PARIS ROSIÈRES BRÉVIANDES LUSIGNY PRÈS TROYES SUR BARSE L’ART MONTAULIN MON AGENDA MESNIL SAINT PÈRE DU SAINTLÉGER CHAUMONT PARTAGE PRUGNY PRÈSTROYES JEP 2018 Voirs détails et conditions au dos et sur VERRIÈRES MONTREUIL https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr SURBARSE 15 & 16 BUCHÈRES LAINES AUX BOIS MONTIÉRAMEY SEPTEMBRE SAMEDI DIMANCHE SAINT POUANGE 2018 MOUSSEY 15/09 16/09 VALLÉE DE LA HAUTE SEINE VAUCHASSIS ISLE AUMONT CLÉREY BARBEREY-SAINT-SULPICE LA CHAPELLE SAINT-LUC FRESNOY PAYNS VILLEMEREUIL LE CHÂTEAU SAINT PONT-SAINTE-MARIE THIBAULT SOULIGNY SAINT-BENOIT-SUR-SEINE RONCENAY BOUILLY ROUTE DES LACS LÉGENDE VILLY BOURANTON LE MARÉCHAL LES BORDES DIJON AUMONT CLÉREY ASSENAY MONTREUIL-SUR-BARSE VILLERY RUVIGNY SAINT ÉGLISE ACCESSIBILITÉ TOTALE JEAN DE BONNEVAL CORMOST SAINT PARRES AUX TERTRES THENNELIÈRES SOMMEVAL VILLY LE BOIS JAVERNANT VERRIÈRES VISITE LIBRE LIREY -

PRAIRIES DE MONTAULIN (Identifiant National : 210008917)
Date d'édition : 05/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210008917 PRAIRIES DE MONTAULIN (Identifiant national : 210008917) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 00000238) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .- 210008917, PRAIRIES DE MONTAULIN . - INPN, SPN- MNHN Paris, 15P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210008917.pdf Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne Rédacteur(s) :MORGAN, G.R.E.F.F.E. Centroïde calculé : 739663°-2364512° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 08/08/2001 Date actuelle d'avis CSRPN : 08/08/2001 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 04/10/2010 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 3 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 4 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 5 7. ESPECES ...................................................................................................................................... -

Communes Concernées ZAR 31.08.18
COMMUNES DONT AU MOINS 1 PARCELLE EST CONCERNEE PAR LES ZAR DE L'AUBE 6° P.A.R. NITRATES 31/08/2018 - CA10 Communes concernées Nom de la ZAR Type Communes concernées Nom de la ZAR Type Assencières Creney près Troyes PPE du captage « Creney forage » Saint Oulph Finage de la commune Méry sur Seine Aubeterre Montsuzain AAC du captage « nouveau forage F2 » Méry sur Seine Finage de la commune Avant lès Ramerupt Montsuzain AAC du captage « nouveau forage F2 » Bouy-Luxembourg AAC du captage « puits Le Marais » Bercenay le Hayer Pouy sur Vannes PPE du captage Creney près Troyes PPE du captage « Creney forage » Mesnil-Sellières Bouilly Roncenay PPE du captage Dosches Finage de la commune Bouranton Creney près Troyes PPE du captage « Creney forage » Montsuzain AAC du captage « nouveau forage F2 » Bouy-Luxembourg AAC du captage « puits Le Marais » Montaulin Rouilly Saint Loup Finage de la commune Bouy-Luxembourg Montsuzain AAC du captage « nouveau forage F2 » Montpothier Villenauxe la Grande AAC des captages « forages les Prieurés » Bréviandes Rouilly Saint Loup Finage de la commune Montsuzain Montsuzain AAC du captage « nouveau forage F2 » Buchères Saint Léger près Troyes Finage de la commune Neuville sur Vanne Neuville sur Vanne AAC du captage Chapelle-Vallon Chapelle-Vallon PPE du captage Onjon Montsuzain AAC du captage « nouveau forage F2 » Charmont sous Barbuise Montsuzain AAC du captage « nouveau forage F2 » Origny le sec Origny le sec Finage de la commune Charny le Bachot Méry sur Seine Finage de la commune Orvilliers Saint Julien Orvilliers -

LES PRAIRIES HUMIDES DE COURTERANGES : Un Patrimoine Dont L’’Intérêt Écologique Est Attesté Par La Création D’Une Réserve Naturelle Régionale
* ESCARBOUCLE pierre précieuse et figure héraldique ornant le bouclier à 8 rais des Chevaliers du Temple BULLETIN LES AMIS TRIMESTRIEL DU PARC D’INFORMATION NATUREL RÉGIONAL 18 juin 2010 DE LA FORÊT N° 79 D’ORIENT ÉDITORIAL Photo : Claude OBLED C’EST FAIT ! Cette fois-ci c’est fait : après l’avoir perdu pendant plus d’un an, le Pnr Forêt d’Orient vient de recouvrer son label. MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT Décret no 2010-659 du 11 juin 2010 portant classement du parc naturel régional de la Forêt d’Orient (Champagne-Ardenne) NOR : DEVN0925048D Le Premier ministre…. Décrète : Art. 1er - Sont classés en parc naturel régional jusqu’au 2 avril 2021, sous la dénomination de parc nature régional de la Forêt d’Orient, les territoires des communes suivantes, situées dans le département de l’Aube : SOMMAIRE Amance, Argançon, Assencières, Blaincourt-sur-Aube, Bossancourt, Bouranton, Bouy- Luxembourg, Brévonnes,Briel-sur-Barse, Brienne-la-Vieille, Brienne-le-Château, Champ-sur- • C’est fait ! ...............................................................................p. 1 Barse, Chauffour-lès-Bailly, Courteranges, Dienville, Dolancourt, Dosches, Épagne, Géraudot, Hampigny, Jessains, Juvanzé, La Loge-aux-Chèvres, La Villeneuve-au-Chêne, Lassicourt, • Les prairies humides Laubressel, Lesmont, Lusigny-sur-Barse, Luyères, Magny-Fouchard, Maison-des-Champs, de Courteranges................................................p. 2-3 Maizières-lès-Brienne, Mathaux, Mesnil-Saint-Père, Mesnil-Sellières, Molins-sur-Aube, Montiéramey, Montreuil-sur-Barse, Onjon, Pel-et-Der, Piney, Précy-Notre-Dame, Précy-Saint- • La musaraigne aquatique ...........................p. 3 Martin, Puits-et-Nuisement, Radonvilliers, Rosnay-l’Hôpital, Rouilly-Sacey, Saint-Christophe- • Piney, mon village ..............................................p. -

Lac-Réservoir SEINE Lac D’ORIENT
LAC-RÉSERVOIR SEINE LAc D’ORIENT 2 300 208 5,7 2 380 hectares millions de m3 km km2 Superficie totale Capacité Digues en terre Bassin versant de l’ouvrage de remplissage d’une hauteur contrôlé à la cote normale maximale de Impression : Escourbiac • Imprimé sur papier certifié d’exploitation 25 mètres Conception : www.kazoar.fr - 01 53 06 32 22 06 32 53 - 01 Conception : www.kazoar.fr / Dir com JF Magnien, Flavie Sauve Photos : EPTB Seine Grands Lacs • Juillet 2015 Chiffres-clés Tour de restitution 220 millions de m3 18 m3/s 35 m3/s Capacité de remplissage à la cote Débit moyen Capacité maximale maximale d’exploitation (protection de restitution en de restitution contre les crues) soutien d’étiage 180 m3/s 14 millions de kWh/an Capacité de prélèvement lors Production annuelle de l’usine de fortes crues (200 m3/s en prenant en hydroélectrique EDF de la Morge compte les apports intermédiaires propres au bassin versant du canal d’amenée) LAC-RÉSERVOIR Pont-Ste-Marie Dosches AUBE St-Parres- Champigny Géraudot PARC NATUREL RÉGIONAL aux-Tertres Laubressel DE LA FORÊT D’ORIENT . Thennelières S.N.C.F Maison du Parc Troyes Baires Saint-Julien- CANAL les-Villas DE Déversoirs Déversoir Digue de Droits en “V” BAIRES Ruvigny Géraudot Menois LA MORGE Ouvrage A LAC-RÉSERVOIR L de Partage Digue de SAINT-JU LIE N Chavaudon L E A D N E A D C CANAL Usine EDF SEINE M Jet Creux Rouilly- Courteranges O R Maison St-Loup G Digue de des Lacs Bréviandes S.N.C.F. -

PADD Saint-Aubin
Département de : l’AUBE 5D Commune de : SAINT-MESMIN PLAN LOCAL D’URBANISME Classement des voies sonores Vu pour être annexé Cachet de la Mairie et à la délibération signature du Maire : du 07 Novembre 2016 arrêtant le projet du Plan Local d’Urbanisme POS approuvé le 4 juillet 1986 Révision du POS approuvée le 27 octobre 1992 Modification du POS approuvée le 13 décembre 2010 Prescription du PLU le 30 mars 2015 Dossier du PLU réalisé par : PERSPECTIVES 2 rue de la Gare 10 150 CHARMONT s/B. Tél : 03.25.40.05.90. Fax : 03.25.40.05.89. Mail : [email protected] PREFECTURE DE L'AUBE A R R E T E N° Portant classement des infrastructures de transports terrestres du département de l'Aube et déterminant l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit à proximité des Routes Départementales. Le Préfet de l'Aube Chevalier de l'Ordre National du Mérite Vu le code de l'environnement et notamment l'article L 571-10, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R 111-4-1, Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment l'article 14, Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de décentralisation, Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pis pour l'application de l'article L 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitations et de leurs équipements, Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement au classement -

Vous Ŷésente
www.lusigny-sur-barse.fr Le P’tit s vœux Lusignien51 eur JANVIER 2015 n° s meill Vous Ŷ ésente se Joyeuses Fêtes é Excellente année di à toutes et à tous to Madame, Monsieur, En cette fin d’année, je veux vous dire le plaisir qui est le mien de travailler, depuis les élections municipales du mois de mars, avec une équipe dynamique et impliquée et qui mesure désormais la dimension d’une gestion communale. Christian BRANLE Maire, Vice Président du Nous le savons tous, les temps financièrement difficiles, les dotations de l’Etat Conseil Général, en diminution et les coûts de fonctionnement en augmentation, sans oublier la Président du PNRFO réglementation en constante évolution, vont plus que jamais contraindre les collectivités à prioriser leurs actions, afin d’assurer un équilibre financier, sans toutefois alourdir la pression fiscale des familles et des entreprises, déjà significative. Le budget communal 2015 devra tenir compte de toutes ces données et nous permettre, malgré tout, de continuer à structurer notre village. Plus que jamais, les actions collectives sont essentielles et le travail en partenariat est désormais incontournable si nous voulons maintenir et développer le lien social et la qualité de vie, fondamentaux dans nos communes. C’est pourquoi, je tiens à remercier et féliciter toutes celles et ceux qui ont contribué au déroulement de nombreux évènements de ces derniers mois : UÊ la réforme des rythmes scolaires et la mise en œuvre des Nouvelles Activités Périscolaires, UÊ l’organisation, cette année encore, du Forum des Associations, -

Identifiant National : 210000142)
Date d'édition : 27/10/2020 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000142 PRAIRIES DES VALLEES DE LA BARSE ET DE LA BODERONNE ENTRE COURTERANGES ET MAROLLES-LES-BAILLY (Identifiant national : 210000142) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 00000048) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .- 210000142, PRAIRIES DES VALLEES DE LA BARSE ET DE LA BODERONNE ENTRE COURTERANGES ET MAROLLES-LES-BAILLY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 47P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000142.pdf Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne Rédacteur(s) :MORGAN, G.R.E.F.F.E. Centroïde calculé : 745615°-2361355° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 24/06/2003 Date actuelle d'avis CSRPN : 23/09/2020 Date de première diffusion INPN : 23/10/2020 Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 5 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 5 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 6 6. HABITATS .....................................................................................................................................