Mulhouse- -MULLHEIM
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
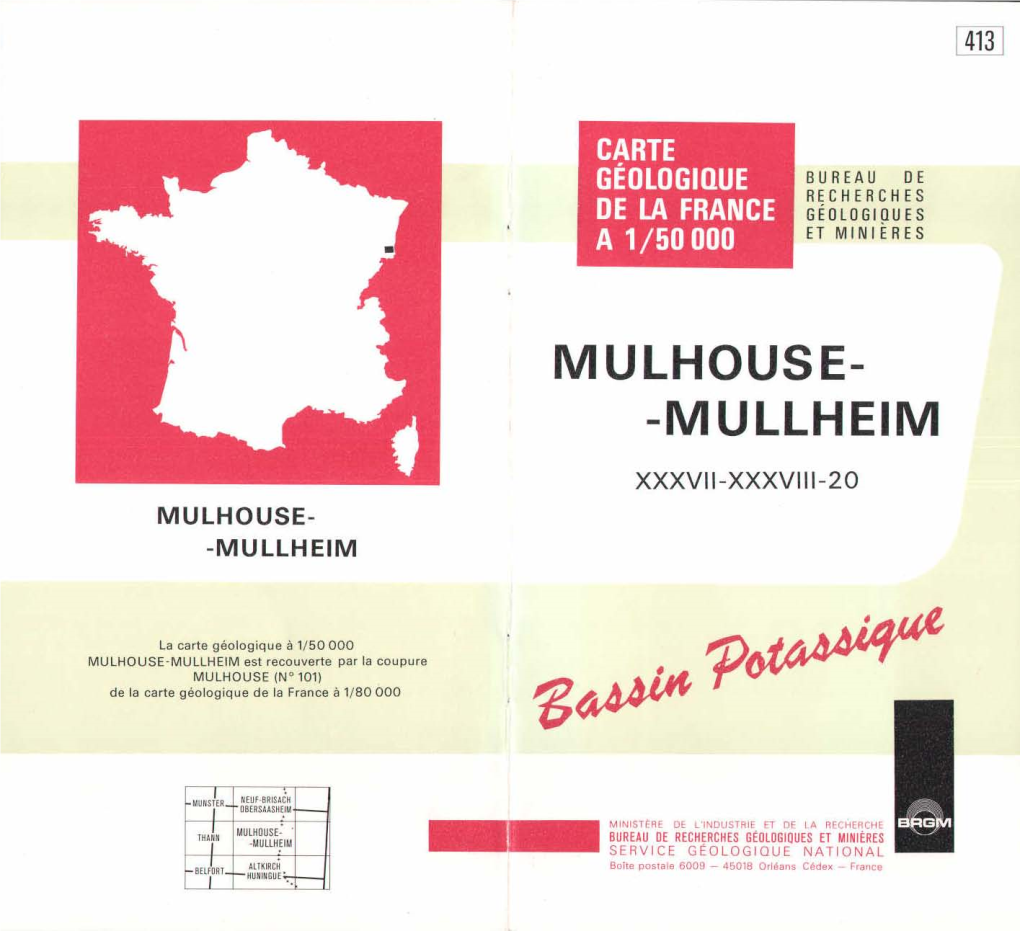
Load more
Recommended publications
-

Arrête Cadre Sécheresse Interdépartemental 2012
Annexe 1 : Représentation cartographique des zones d'alerte Annexe 2 : Répartition des communes par zones d'alerte : 1. pour leur alimentation en eau potable (par type d'alimentation et zone d’alerte de provenance) 2. pour leurs eaux superficielles Répartition des communes par type d'alimentation en eau potable et zone d’alerte de provenance NB : Cette répartition est susceptible d'évoluer suivant les interconnexions effectuées par les communes ou le changement de leur type d'approvisionnement. · Zone d’Alerte Ill Amont Communes alimentées par forage ! ! " " # ""$ "" "" !" " "" ! " "" #%" # " Communes avec alimentation mixte # ! ! ! Communes alimentées par des sources ! " ! % ! ! ! !! " ! # · Zone d’Alerte Doller Amont – Fecht – Weiss – Lauch Communes alimentées par forage "" "" ! "" % "" ! " "" "" "" "" ! "" "" Communes avec alimentation mixte "" " ! ! ""# & ! ! #% ! "" ""# Communes alimentées par des sources ! ! " "" ! ! ""# ! # "$ "$ #% " ! "" " " " " ! · Zone d’Alerte Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette Pour le Bas -Rhin Communes alimentées -

STAFFELFELDEN Concentrations Dans L'air
STAFFELFELDEN Données synthétiques Située au nord-ouest de l’agglomération mulhousienne, STAFFELFELDEN compte environ 1,5% de la Population 3 553 hab. Superficie 742 ha. population de la zone SIVOM sur 2% de la superficie. Part du Bâti sur la commune 24 % Ratio kg/hab. kg/ha. En l’absence de tissu industriel, les principales sources Emissions de pollution sont locales et essentiellement dues au Polluants STAFFELFELDEN SIVOM STAFFELFELDEN SIVOM caractère résidentiel de la commune (chauffage SO2 23925 NOx 6 14 29 111 domestique au bois). Le transport routier n’est pas COVNM 12 29 55 230 important sur le ban de la commune avec moins d’un Concentrations maximales - 2001 NO2 Benzène 3 kilomètre de voirie dépassant 10000 véhicules/jour. en µg/m 20,0 1,5 Station(s) de référence : aucune Néanmoins, la zone de bâti s’appuie sur 2 axes routiers d’importance (D2 et D450) extérieur à la commune. Concentrations dans l’air Les niveaux de pollution sur la commune de STAFFELFELDEN ont été évalués en 2001 dans le cadre d’une campagne de mesure des principaux indicateurs de pollution atmosphérique due au transport routier (dioxyde d’azote et benzène) conduite sur l’ensemble de l’agglomération mulhousienne. Trois points de mesure ont été instrumentés : o Site 2 - dans la zone urbaine (U), rue du moulin n°49-53 (dioxyde d’azote et benzène). Concentrations observées durant la campagne de mesure en o Site 5 - en zone urbaine (U) au croisement rue 2001 en référence à des sites types. du bon tabac /rue de Merlin l’enchanteur (dioxyde d’azote - données insuffisantes dioxyde Période de mesure : benzène <75%). -

Glissements De Terrain Effondrements Ou Affaissements Chutes De Blocs ALTKIRCH NEUF-BRISACH ALTKIRCH WEGSCHEID AMMERSCHWIHR AMME
Glissements de terrain Effondrements ou affaissements Chutes de blocs ALTKIRCH NEUF-BRISACH ALTKIRCH WEGSCHEID AMMERSCHWIHR AMMERSCHWIHR NIEDERMORSCHWIHR BALDERSHEIM WINTZENHEIM BENNWIHR AUBURE ODEREN BALLERSDORF WITTELSHEIM BERGHEIM BEBLENHEIM ORBEY BELLEMAGNY WOLFERSDORF BITSCHWILLER-LES-THANN BENNWIHR PFETTERHOUSE BERGHEIM WUENHEIM BRUNSTATT BERGHEIM RANSPACH BISEL BUHL BRETTEN RETZWILLER BOLLWILLER EGUISHEIM ESCHBACH-AU-VAL RIBEAUVILLE BRUEBACH FELLERING ETEIMBES RIQUEWIHR CERNAY FERRETTE FOLGENSBOURG RODEREN DURLINSDORF GUEBERSCHWIHR FRELAND ROMBACH-LE-FRANC FORTSCHWIHR HEIDWILLER FULLEREN SAINTE-CROIX-AUX-MINES FRANKEN HUSSEREN-WESSERLING GEISHOUSE SAINT-HIPPOLYTE HARTMANNSWILLER KIENTZHEIM GRIESBACH-AU-VAL SAINTE-MARIE-AUX-MINES HEIDWILLER LEYMEN GUEBERSCHWIHR SEPPOIS-LE-BAS HIRSINGUE LIEPVRE GUEWENHEIM SIGOLSHEIM HOHROD MALMERSPACH HAGENTHAL-LE-BAS SONDERNACH HUNDSBACH METZERAL HAGENTHAL-LE-HAUT SOPPE-LE-BAS JUNGHOLTZ ODEREN HEIDWILLER SOPPE-LE-HAUT KAPPELEN ORBEY HIRSINGUE SOULTZ-HAUT-RHIN KRUTH RIBEAUVILLE HIRTZBACH SOULTZEREN LEYMEN SOULTZEREN HOHROD SOULTZMATT LUTTERBACH STOSSWIHR HUNINGUE STERNENBERG MANSPACH THANN JUNGHOLTZ STORCKENSOHN MULHOUSE THANNENKIRCH KIRCHBERG STOSSWIHR PFASTATT TURCKHEIM LAPOUTROIE STRUETH REININGUE UEBERSTRASS LIEPVRE THANN RICHWILLER URBES LINSDORF THANNENKIRCH ROMBACH-LE-FRANC VIEUX-THANN LUEMSCHWILLER TRAUBACH-LE-HAUT RUELISHEIM WEGSCHEID MALMERSPACH TURCKHEIM SCHWOBEN WILDENSTEIN MITTELWIHR UEBERSTRASS STAFFELFELDEN MITTLACH UFFHOLTZ STEINBACH MITZACH WASSERBOURG TAGOLSHEIM MUESPACH WATTWILLER -

Haut-Rhin Est Limité" Au IV
DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIQUE DK LA FRANCE COMPRENANT LES NOMS DE LIEU ANCIENS ET MODERNES PAR ORDRE DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE H SOI S LA DIRECTION DU COMITÉ DES TRAVAUX H1STOHIQIIES ET DES SOCIÉTÉS SAVANTES. DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIOUE DU DEPARTEMENT DU HAUT- RHIN COMPRENANT LES NOMS DE LIEU ANCIENS ET MODERNES RKDIfiÉ SOIS LES U.SPICES DR LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE MULHOUSE PAR M. GEORGES STOFFEL MEMBRE DE CETTE SOCIETE oowuaramtun on mnnftu de l'instruction pcbliqui i>oir i.ks mu un historiques PARIS IMPRIMERIE IMPÉRIALE \i Dcc<; lxviii DC Gll INTRODUCTION. PARTIE DESCRIPTIVE. Le département du Haut-Rhin est limité" au IV. par celui du Bas-Rhin; à l'E. par le Rhin, qui le sépare de l'Allemagne; au S. par la Suisse et le département du Doubs, et à l'O. par ceux de la Haute-Saône et des Vosges. Il est situé entre les &7 2 5' et liH° 1 8' de latitude septentrionale, et entre les h" ih' et 5° 1 h' de longitude orientale du méridien de Paris. Sa plus grande longueur du nord au sud, depuis l'Allemand-Rom- bacfa jusqu'à Lucelle, est de 95 kilomètres; sa plus grande largeur, depuis Bue jusqu'à Hiiniiigue, de 60 kilomètres. D'après le cadastre, sa superficie CMnprend k\ i.->.-\'-\ hectares U ares 91 centiares, qui se subdivisent ainsi : Terra labourables i57,47o h 00* 00 e Prairies naturelles 55,696 00 00 Vergers, pépinières, jardins 5,676 00 00 ' tseraies , aunaies . saussaies 1 o4 00 00 Châtaigneraies 1,117 00 00 Landes, pâlis, bmyèius 27,824 00 00 $ \ ignés 1 1,622 17 71 Bois et forêts 113,576 00 00 Propriétés bâties 1,936 00 00 Etangs, abreuvoirs, mares, canaux d'irrigation 1,61 1 00 00 Cimetières, églises, presbytères, bâtiments publics..] Rivières, lacs, ruisseaux \ 34,790 86 5o Routes, chemins, places publiques, rues ) Total 4 11,2 2 3 o4 21 Haut-Rhin, a . -

LISTE DES COMMUNES PAR CANTON De 1802 À 18701
LISTE DES COMMUNES PAR CANTON 1 de 1802 à 1870 ARRONDISSEMENT DE COLMAR: Canton d'Andolsheim: Andolsheim, Artzenheim, Baltzenheim, Bischwihr, Durrenentzen, Fortschwihr, Grussenheim, Holtzwihr, Horbourg, Houssen, Jebsheim, Kunheim, Muntzenheim, Riedwihr, Sundhoffen, Urschenheim, Wickerschwihr, Widensolen, Wihr-en-Plaine. Canton de Colmar: Colmar, Sainte-Croix-en-Plaine. Canton d'Ensisheim: Biltzheim, Blodelsheim, Ensisheim, Fessenheim, Hirtzfelden, Meyenheim, Munchhouse, Munwiller, Niederentzen, Niederhergheim, Oberentzén, Oberhergheim, Pulversheim, Réguisheim, Roggenhouse, Rumersheim-le-Haut, Rustenhart. Canton de Guebwiller: Bergholtz, Bergholtz-Zell, Buhl, Guebwiller, Lautenbach, Lautenbach-Zell, Linthal, Murbach, Orschwihr, Rimbach-près-Guebwiller, Rimbach-Zell. Canton de Kaysersberg: Ammerschwihr, Béblenheim, Bennwihr, Ingersheim, Katzenthal, Kaysersberg, Kientzheim, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Ostheim, Riquewihr, Sigolsheim, Zellenberg. Canton de Lapoutroie: Bonhomme (Le), Fréland, Labaroche, Lapoutroie, Orbey. Canton de Munster: Breitenbach, Eschbach-au-Val, Griesbach-au-Val, Gunsbach, Hohrod, Luttenbach, Metzeral, Muhlbach, Munster, Sondernach, Soultzbach, Soultzeren, Stosswihr, Wasserbourg. Canton de Neuf-Brisach: Algolsheim, Appenwihr, Balgau, Biesheim, Dessenheim, Geiswasser, Heiteren, Hettenschlag, Logelheim, Nambsheim, Neuf-Brisach, Obersaasheim, Vogelgrun, Volgelsheim, Weckolsheim, Wolfgantzen. Canton de Ribeauvillé: Bergheim, Guémar, Hunawihr, Illhaeusern, Ribeauvillé, Rodern, Rorschwihr, Saint- Hippolyte, Thannenkirch. -

Le Risque Mouvement De Terrain
LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 1. Qu’est-ce qu’un mouvement de terrain ? Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d'origines diverses, résultant de la déformation, de la rupture et du déplacement du sol. Leur apparition est conditionnée par les contextes géologiques, hydrogéologiques et topographiques, aggravés par les conditions météorologiques et l’action de l’homme. Les mouvements de terrains comprennent : les chutes de blocs, les effondrements et affaissements de cavité souterraine, les glissements de terrains et les phénomènes de tassements différentiels appelés aussi retrait-gonflement, ces derniers ne représentent pas de danger direct pour l’homme mais endommagent les constructions. Ces phénomènes d’ampleur variable ont des répercussions tant sur les biens que sur les personnes. Sur le département du Haut-Rhin, plus de 200 évènements ont été recensés lors de l’inventaire des mouvements de terrains réalisé par le BRGM entre 2003 et 2005. 2. Les principaux types de mouvements de terrain dans le Haut-Rhin 2.1. Les chutes de blocs Le phénomène de chutes de blocs se manifeste par le dérochement d’éléments d’une falaise. Il est conditionné par la nature géologique de la roche, son état d’altération et de fissuration et par le profil topographique préexistant. Cette évolution naturelle d’une falaise peut être accélérée par des secousses sismiques, une amplification de l’érosion, le phénomène de gel-dégel, et par le terrassement de talus trop raides. Les blocs déstabilisés, dont le volume est très variable, peuvent s’accumuler au pied de l’escarpement ou dévaler un talus sur une grande distance. -

Vos Conseillers Départementaux
t SupplémenSUPPLÉMENT HAUT-RHIN MAGAZINE N° 50 - MAI 2015 Vos conseillers départementaux Nouvelle assemblée La première réunion du Conseil départemental du Haut-Rhin s’est tenue le 2 avril 2015. Présentation des 34 conseillers départementaux élus dans les 17 cantons du Haut-Rhin Les 34 conseillers départementaux haut-rhinois 26 18 22 33 17 21 34 16 19 25 27 29 30 23 28 31 32 13 14 15 20 24 9 5 7 10 11 12 6 1 3 8 2 4 1 Nicolas Jander (UDI) 13 Monique Martin (DVD) 25 Lara Million (UMP) 2 Sabine Drexler (DVD) 14 Lucien Muller (UMP) 26 Marc Schittly (UMP) canton d’Altkirch canton de Wintzenheim canton de Mulhouse-3 3 Yves Hemedinger (UMP) 15 Patricia Fuchs (UMP) 27 Philippe Trimaille (UDI) 4 Martine Dietrich (UMP) 16 Olivier Becht (DVD) 28 Fatima Jenn (DVD) canton de Colmar-1 canton de Rixheim canton de Mulhouse-2 5 Michel Habig (UMP) 17 Pascale Schmidiger (UMP) 29 Pierre Bihl (UMP) 6 Betty Muller (DVD) 18 Max Delmond (UDI) 30 Émilie Helderlé (SE) canton d’Ensisheim canton de Saint-Louis canton de Sainte-Marie-aux-Mines 7 Eric Straumann (UMP) 19 Vincent Hagenbach (UDI) 31 Alain Couchot (UMP) 8 Brigitte Klinkert (DVD) 20 Josiane Mehlen-Vetter (UDI) 32 Catherine Rapp (UMP) canton de Colmar-2 canton de Kingersheim canton de Mulhouse-1 9 Rémy With (DVD) 21 Karine Pagliarulo (DVD) 33 Raphaël Schellenberger (UMP) 10 Fabienne Orlandi (DVD) 22 Alain Grappe (UMP) 34 Annick Lutenbacher (UMP) canton de Masevaux canton de Guebwiller canton de Cernay 11 Pierre Vogt (SE) 23 Daniel Adrian (DVD) 12 Marie-France Vallat (PS) 24 Bernadette Groff (UDI) canton de Wittenheim canton de Brunstatt 2 17 femmes et 17 hommes pour une nouvelle assemblée Les 22 et 29 mars dernier se sont tenues pour la première fois les élections départementales qui ont remplacé les élections cantonales. -

Quel Espace Solidarité Senior Contacter ?
DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN Direction de l'Autonomie Quel Espace Solidarité Senior contacter ? Espace Solidarité Senior ALTKIRCH 03 89 08 98 30 [email protected] Espace Solidarité Senior COLMAR 03 89 20 17 77 [email protected] Espace Solidarité Senior GUEBWILLER 03 89 49 67 20 [email protected] Espace Solidarité Senior HORBOURG-WIHR 03 89 21 74 94 [email protected] Espace Solidarité Senior ILLZACH 03 89 45 15 33 [email protected] Espace Solidarité Senior MULHOUSE 03 89 59 68 88 [email protected] Espace Solidarité Senior MUNSTER 03 89 30 23 16 [email protected] Espace Solidarité Senior RIBEAUVILLE 03 89 78 27 61 [email protected] Espace Solidarité Senior RIEDISHEIM 03 89 65 04 95 [email protected] Espace Solidarité Senior SAINT-LOUIS 03 89 89 71 00 [email protected] Espace Solidarité Senior THANN 03 89 82 62 63 [email protected] Espace Solidarité Senior WITTENHEIM 03 89 50 68 31 [email protected] COMMUNES Espace Solidarité Senior Algolsheim Horbourg-Wihr Altenach Altkirch Altkirch Altkirch Ammerschwihr Ribeauvillé Andolsheim Horbourg-Wihr Appenwihr Horbourg-Wihr Artzenheim Horbourg-Wihr Aspach Altkirch Aspach-le-Bas Thann Aspach-Michelbach Thann Attenschwiller Saint-Louis Aubure Ribeauvillé Baldersheim Illzach Balgau Horbourg-Wihr Ballersdorf Altkirch Balschwiller Altkirch Baltzenheim Horbourg-Wihr Bantzenheim Illzach Bartenheim Saint-Louis Battenheim Illzach Beblenheim Ribeauvillé Bellemagny Altkirch Bendorf -

176 Paraphe Du Maire 351 VILLE DE WITTENHEIM Sous La Présidence De Monsieur Antoine HOMÉ, Maire MONSIEUR LE MAIRE Ouvre La S
176 VILLE DE WITTENHEIM PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE WITTENHEIM DE LA SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2013 Sous la Présidence de Monsieur Antoine HOMÉ, Maire MONSIEUR LE MAIRE ouvre la séance à 19 h 00 en souhaitant une cordiale bienvenue aux élus municipaux. Il salue également les auditeurs, l’Adjoint Honoraire Christian GRACCO, les représentants de la presse locale ainsi que les collaborateurs administratifs. Présents : Mme Marie-France VALLAT, M. Philippe RICHERT, Mme Brigitte LAGAUW, M. Arnaud KOEHL, Mme Catherine RUNZER, M. Francis KNECHT-WALKER, Mme Anne-Catherine LUTOLF-CAMORALI, M. Albert HAAS, Mme Livia LONDERO, Adjoints – Mme Thérèse ANZUINI, M. Jean STRITMATTER, Mme Christiane-Rose KIRY, Mme Martine BRIAND, M. Alain WERSINGER, Conseillers Municipaux Délégués – M. Jomaa MEKRAZI, M. Joseph RUBRECHT, M. Joseph WEISBECK, Mme Ginette RENCK, Mme Sonia GASSER, M. Maurice LOIBL, Mme Renée METZGER, M. Hechame KAIDI, M. Maurice HAFFNER, M. Patrick PICHENEL, Mme Sylvie SCHAFFHAUSER, Mme Claudette RIFFENACH, M. Philippe DUFFAU, Conseillers Municipaux. Excusée : Mme Rosine HARTMANN, Conseillère Municipale. Absente non excusée : Mme Annick HAVÉ, Conseillère Municipale. Ont donné procuration : M. Didier CASTILLON, Conseiller Municipal, à M. Antoine HOMÉ, Maire – Mme Joseline ROZMARYNOWSKI, Conseillère Municipale, à M. Maurice LOIBL, Conseiller Municipal – Mme Christine KELLER, Conseillère Municipale, à Mme Catherine RUNZER, Adjointe au Maire. Madame Laurence FAYE est désignée secrétaire de séance. Ordre du jour : Rapporteur : Monsieur le Maire Antoine HOMÉ 1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 11 juillet 2013. 2. Communications diverses. 3. Intercommunalité – Rapport d’activités 2012 de m2A – Information. 4. Conseil Général du Haut-Rhin – Contrat de Territoire de Vie 2014/2019 – Projets présentés par la Ville de Wittenheim dans le cadre de l’appel à projets d’intérêt local. -

Plan Local D'urbanisme Rapport De Présentation 2
PPLLAANN LLOOCCAALL DD’’UURRBBAANNIISSMMEE 1. RAPPORT DE PRESENTATION P.O.S. INITIAL Approuvé le 27.12.1977 Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal REVISION N°1 en date du : approuvée le 28.02.1994 REVISION N°2 21 janvier 2008 approuvée le 20.03.1995 REVISION N°3 approuvée le 17.02.1997 REVISION N°4 approuvée le 20.12.1999 ELABORATION P.L.U REVISION SIMPLIFIEE N°1 approuvée le 11.07.2005 APPROBATION REVISION SIMPLIFIEE N°2 approuvée le 12.12.2005 REVISION SIMPLIFIEE N°3 approuvée le 12.12.2005 REVISION SIMPLIFIEE N°4 approuvée le 23.04.2007 SOMMAIRE GENERAL INTRODUCTION......................................................................................................................................................................... 2 PREMIERE PARTIE LE DIAGNOSTIC.................................................................................................................... 8 DEUXIEME PARTIE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT............................ 104 TROISIEME PARTIE LA JUSTIFICATION DU PROJET............................................................................... 244 QUATRIEME PARTIE L’INCIDENCE DU PROJET SUR L’ENVIRONNMENT................................... 263 INTRODUCTION Introduction Situation géographique Contexte intercommunal Ville de Mulhouse Service Urbanisme Plan Local d'Urbanisme Rapport de Présentation 2 LA SITUATION GEOGRAPHIQUE Localisée dans le Sud de l’Alsace, Mulhouse se trouve au pied des collines du Sundgau, sur les bords de l’Ill, à l’endroit où la rivière entre dans la plaine d’Alsace et croise la voie naturelle entre bassin du Rhin / bassin du Rhône par le seuil de Belfort. Cette position est renforcée aujourd’hui par l’existence Introduction du canal à grand gabarit qui rejoint les ports rhénans vers l’Est. Placée au sein d’une région dynamique et bénéficiant d’une situation privilégiée, Mulhouse est la première ville du Haut-Rhin par son poids économique et démographique. -

Hiérarchiser Et Positionner Les Zones D'activités Economiques
Hiérarchiser et positionner les Zones d’Activités Economiques Décembre 2014 AXE B - HIERARCHISER ET POSITIONNER Les ZAE de la région mulhousienne. Aménagée et occupée Aménagée ou en cours d’aménagement Extension inscrite dans les POS/PLU Glossaire CAHR : Comité d’Action du Haut Rhin CCISAM : Chambre de commerce et d’industrie Sud Alsace-Mulhouse PFRS : Communauté de Communes de la Porte de France Rhin Sud PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques PLU : Plan Local d’Urbanisme PSA : Peugeot Société Anonyme SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale ZA : Zone d’Activités ZAE : Zone d’Activités Economiques ZAC : Zone d’Aménagement Concerté ZI : Zone Industrielle ZIMR : Zone Industrielle de Mulhouse Rhin 2 ZAE agence d’urbanisme de la région mulhousienne AXE B - ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES SOMMAIRE Introduction 4 HIÉRARCHISER LES ZAE Méthodologie 5 3 sites à projet 6 Résultat du scoring 7 Les zones les plus stratégiques 7 Les zones faiblement stratégiques 8 Les zones non stratégiques 9 Le cas des créations de ZA 10 Des plus intéressantes... 10 aux moins stratégiques 10 Considérer des espaces cohérents 11 QUELLES DISPONIBILITÉS FONCIÈRES ? Dans l’agglomération mulhousienne 13 Dans le Haut-Rhin 14 Des disponibilités apparemment importantes 14 Quelle vocation pour l’agglomération mulhousienne ? 15 POSITIONNER LES ZAE Analyse sommaire du tissu économique 16 Le volume d’emploi estimé 16 L’emploi par secteur 16 Les établissements par taille 16 Concentration de l’emploi dans quelques zones -

(Strasbourg) Colmar Bollwiller Mulhouse
DU 10DU DÉCEMBRE 29 JUILLET 2017 AU 9AU DÉCEMBRE 7 JUILLET 20172018 Strasbourg(Strasbourg) ➜ Colmar Sélestat ➜- Bollwiller ➜Bollwiller Colmar - - ➜Mulhouse (Mulhouse) Mulhouse DU LUNDI AU VENDREDI SAUF JOURS FÉRIÉS 8 8 O 8 8 O 8 8 8 O 8 Strasbourg 05.14 05.51 06.18 06.51 07.21 07.51 08.21 08.25 08.51 Sélestat 05.38 06.11 06.38 07.10 07.40 08.11 08.40 08.55 09.10 Colmar 05.50 06.04 06.23 06.32 06.51 07.04 07.23 07.34 07.53 08.04 08.24 08.53 09.07 09.23 Herrlisheim-près-Colmar l 06.09 l 06.37 l 07.10 l 07.39 l 08.09 l l l l Rouffach l 06.14 l 06.42 l 07.14 l 07.44 l 08.14 l l 09.14 l Merxheim l 06.18 l 06.47 l 07.19 l 07.48 l 08.18 l l 09.19 l Raedersheim l 06.22 l 06.50 l 07.22 l 07.52 l 08.22 l l 09.22 l Bollwiller 06.03 06.25 l 06.53 l 07.26 l 07.55 l 08.25 l l 09.25 l Staffelfelden l 06.29 l 06.57 l 07.29 l 07.59 l 08.29 l l 09.29 l Mulhouse Dornach l 06.36 l 07.04 l 07.36 l 08.06 l 08.36 l l 09.36 l Mulhouse 06.14 06.40 06.44 07.08 07.14 07.40 07.44 08.10 08.14 08.40 08.44 09.14 09.40 09.44 Numéro de circulation 96201 831351 96265 831353 96203 831355 96205 831357 96207 831359 96209 96211 832317 96213 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 O 8 8 O 8 Strasbourg 09.21 09.51 10.21 10.51 11.21 11.51 12.21 12.51 13.21 13.51 Sélestat 09.43 10.10 10.40 11.10 11.42 12.10 12.41 13.10 13.40 14.10 Colmar 09.56 10.02 10.23 10.53 11.23 11.54 12.23 12.35 12.53 13.04 13.23 13.53 14.04 14.23 Herrlisheim-près-Colmar l 10.08 l l l l l 12.41 l 13.09 l l 14.09 l Rouffach l 10.13 l l l l l 12.46 l 13.14 l l 14.14 l Merxheim l 10.18 l l l l l 12.50 l 13.19 l l 14.18 l Raedersheim