CH ALCI Dl DAE (HYMENOPTERA CHALCIDOIDEA)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
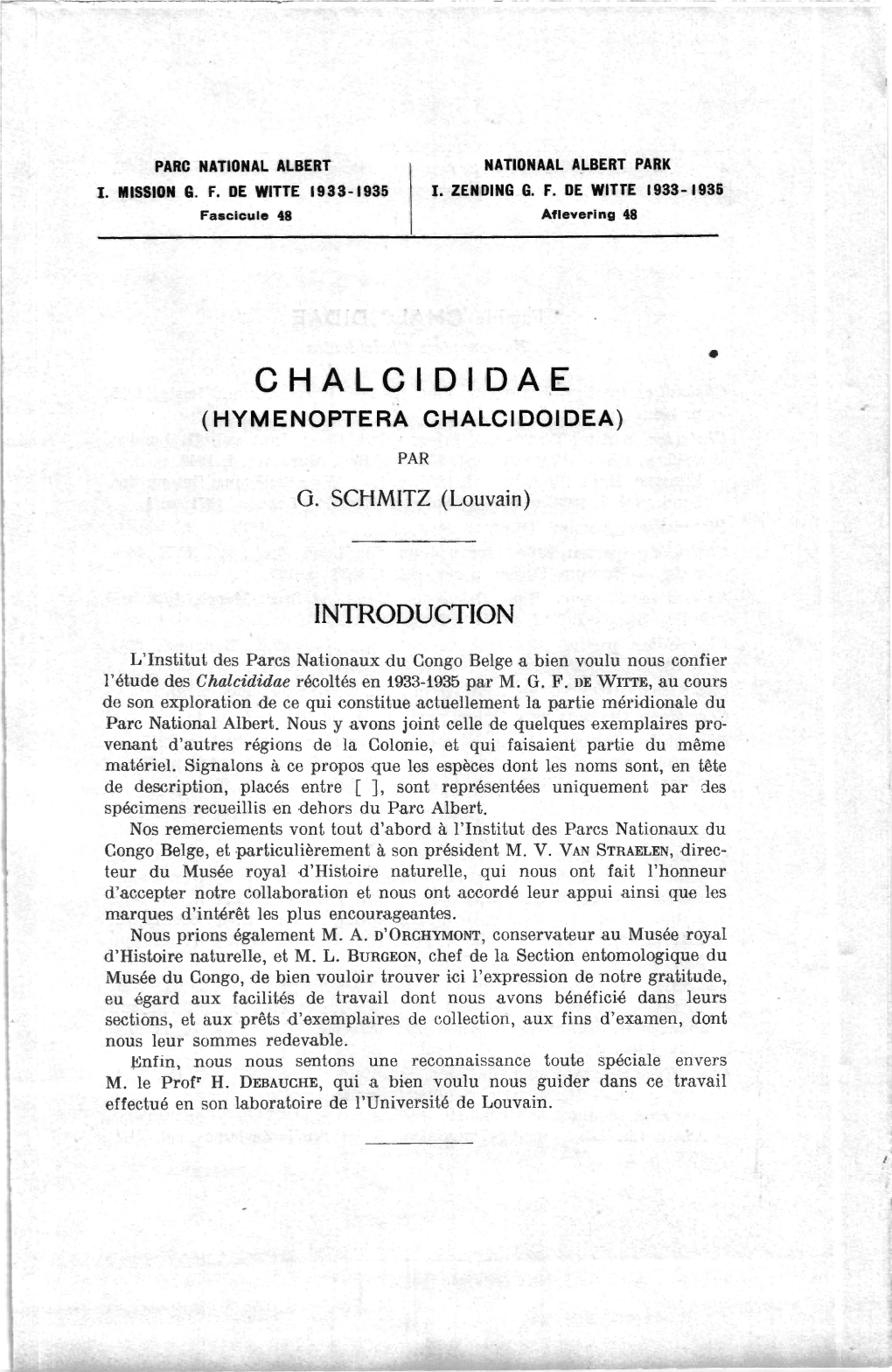
Load more
Recommended publications
-

Contributions Toward a Lepidoptera (Psychidae, Yponomeutidae, Sesiidae, Cossidae, Zygaenoidea, Thyrididae, Drepanoidea, Geometro
Contributions Toward a Lepidoptera (Psychidae, Yponomeutidae, Sesiidae, Cossidae, Zygaenoidea, Thyrididae, Drepanoidea, Geometroidea, Mimalonoidea, Bombycoidea, Sphingoidea, & Noctuoidea) Biodiversity Inventory of the University of Florida Natural Area Teaching Lab Hugo L. Kons Jr. Last Update: June 2001 Abstract A systematic check list of 489 species of Lepidoptera collected in the University of Florida Natural Area Teaching Lab is presented, including 464 species in the superfamilies Drepanoidea, Geometroidea, Mimalonoidea, Bombycoidea, Sphingoidea, and Noctuoidea. Taxa recorded in Psychidae, Yponomeutidae, Sesiidae, Cossidae, Zygaenoidea, and Thyrididae are also included. Moth taxa were collected at ultraviolet lights, bait, introduced Bahiagrass (Paspalum notatum), and by netting specimens. A list of taxa recorded feeding on P. notatum is presented. Introduction The University of Florida Natural Area Teaching Laboratory (NATL) contains 40 acres of natural habitats maintained for scientific research, conservation, and teaching purposes. Habitat types present include hammock, upland pine, disturbed open field, cat tail marsh, and shallow pond. An active management plan has been developed for this area, including prescribed burning to restore the upland pine community and establishment of plots to study succession (http://csssrvr.entnem.ufl.edu/~walker/natl.htm). The site is a popular collecting locality for student and scientific collections. The author has done extensive collecting and field work at NATL, and two previous reports have resulted from this work, including: a biodiversity inventory of the butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea & Papilionoidea) of NATL (Kons 1999), and an ecological study of Hermeuptychia hermes (F.) and Megisto cymela (Cram.) in NATL habitats (Kons 1998). Other workers have posted NATL check lists for Ichneumonidae, Sphecidae, Tettigoniidae, and Gryllidae (http://csssrvr.entnem.ufl.edu/~walker/insect.htm). -

Jonathan Dickinson State Park
Jonathan Dickinson State Park APPROVED Unit Management Plan STATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION Division of Recreation and Parks June 15, 2012 i TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION ..........................................................................................................1 PURPOSE AND SIGNIFICANCE OF THE PARK.....................................................1 PURPOSE AND SCOPE OF THE PLAN .....................................................................7 MANAGEMENT PROGRAM OVERVIEW................................................................9 Management Authority and Responsibility...................................................................9 Park Management Goals ............................................................................................10 Management Coordination.........................................................................................10 Public Participation....................................................................................................10 Other Designations ....................................................................................................11 RESOURCE MANAGEMENT COMPONENT INTRODUCTION ........................................................................................................13 RESOURCE DESCRIPTION AND ASSESSMENT ..................................................17 Natural Resources......................................................................................................17 Topography...........................................................................................................17 -

John Pennekamp Coral Reef State Park 2018 Draft Unit Management
John Pennekamp Coral Reef State Park Advisory Group Draft Unit Management Plan STATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION Division of Recreation and Parks August 2018 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION ...................................................................................1 PURPOSE AND SIGNIFICANCE OF THE PARK ....................................... 3 Park Significance ...............................................................................4 PURPOSE AND SCOPE OF THE PLAN..................................................... 4 MANAGEMENT PROGRAM OVERVIEW ................................................ 10 Management Authority and Responsibility ........................................... 10 Park Management Goals ................................................................... 11 Management Coordination ................................................................ 11 Public Participation ............................................................................ 12 Other Designations ........................................................................... 12 RESOURCE MANAGEMENT COMPONENT INTRODUCTION ................................................................................. 13 RESOURCE DESCRIPTION AND ASSESSMENT .................................... 14 Natural Resources ............................................................................. 14 Topography ................................................................................. 14 Geology ..................................................................................... -

Bill Baggs Cape Florida State Park
Bill Baggs Cape Florida State Park APPROVED Unit Management Plan STATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION Division of Recreation and Parks October 11, 2012 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION.............................................................................................................1 PURPOSE AND SIGNIFICANCE OF THE PARK.....................................................1 Park Significance ...........................................................................................................1 PURPOSE AND SCOPE OF THE PLAN......................................................................2 MANAGEMENT PROGRAM OVERVIEW ................................................................8 Management Authority and Responsibility..............................................................8 Park Management Goals ..............................................................................................8 Management Coordination..........................................................................................9 Public Participation.......................................................................................................9 Other Designations......................................................................................................10 RESOURCE MANAGEMENT COMPONENT INTRODUCTION...........................................................................................................11 RESOURCE DESCRIPTION AND ASSESSMENT.................................................12 Natural Resources.......................................................................................................12 -

I:\Approved Plans\District 5\Bahia Honda\05-23-2003 Approved Plan
BAHIA HONDA STATE PARK UNIT MANAGEMENT PLAN APPROVED PLAN STATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION Division of Recreation and Parks MAY 23, 2003 Department of Environmental Protection Jeb Bush Marjorie Stoneman Douglas Building David B. Struhs Governor 3900 Commonwealth Boulevard, MS 140 Secretary Tallahassee, Florida 32399-3000 May 23, 2003 Ms. BryAnne White Government Operations Consultant II Office of Park Planning Division of Recreation and Parks Bahia Honda State Park Lease Number: # 3609 Dear Ms. White: The Division of State Lands has completed the review of Bahia State Park Land Management Plan and find that it fulfills all the requirements of Rule 18-2.021, F.A.C., and ss. 253.034 and 259.032, F.S. Therefore, on May 23, 2003, the Office of Environmental Services, acting as agent for the Board of Trustees of the Internal Improvement Trust Fund approves this plan. The plans five-year update will be due in May 2008. Approval of this land management plan does not waive the authority or jurisdiction of any governmental entity that may have an interest in this project. Implementation of any upland activities proposed by this management plan may require a permit or other authorization from federal and state agencies having regulatory jurisdiction over those particular activities. Sincerely, Delmas T. Barber Delmas T. Barber, OMC Manager Office of Environmental Services Division of State Lands More Protection, Less Process Printed on recycled paper. TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION 1 PURPOSE AND SCOPE OF PLAN 1 MANAGEMENT -

Lower Florida Keys National Wildlife Refuges
Lower Florida Keys National Wildlife Refuges Comprehensive Conservation Plan U.S. Department of the Interior Fish and Wildlife Service Southeast Region October 2009 COMPREHENSIVE CONSERVATION PLAN LOWER FLORIDA KEYS REFUGES National Key Deer Refuge Key West National Wildlife Refuge Great White Heron National Wildlife Refuge Monroe County, Florida U.S. Department of the Interior Fish and Wildlife Service Southeast Region Atlanta, Georgia October 2009 TABLE OF CONTENTS COMPREHENSIVE CONSERVATION PLAN EXECUTIVE SUMMARY ....................................................................................................................... 1 I. BACKGROUND ................................................................................................................................. 3 Introduction ................................................................................................................................... 3 Purpose and Need For The Plan .................................................................................................. 3 U.S. Fish and Wildlife Service ...................................................................................................... 6 National Wildlife Refuge System .................................................................................................. 6 Legal and Policy Context .............................................................................................................. 8 National and International Conservation Plans and Initiatives .................................................... -
20140421 SLIPSP Approvedplan.Pdf
St. Lucie Inlet Preserve State Park APPROVED Unit Management Plan STATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION Division of Recreation and Parks April 21, 2014 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION PURPOSE AND SIGNIFICANCE OF THE PARK ....................................... 1 Park Significance ............................................................................... 1 PURPOSE AND SCOPE OF THE PLAN .................................................... 2 MANAGEMENT PROGRAM OVERVIEW .................................................. 7 Management Authority and Responsibility ............................................. 7 Park Management Goals ..................................................................... 8 Management Coordination .................................................................. 9 Public Participation ............................................................................ 9 Other Designations ............................................................................ 9 RESOURCE MANAGEMENT COMPONENT INTRODUCTION ............................................................................... 11 RESOURCE DESCRIPTION AND ASSESSMENT .................................... 12 Natural Resources ........................................................................... 12 Topography ................................................................................. 12 Geology ...................................................................................... 15 Soils ......................................................................................... -
Uraniidae) and Their System a Tic, Evolutionary, and Ecological Significance
Journal of the Lepidopterists' SOciety 45(4), 1991, 296-347 FOOD PLANT ASSOCIATIONS OF THE URANIINAE (URANIIDAE) AND THEIR SYSTEM A TIC, EVOLUTIONARY, AND ECOLOGICAL SIGNIFICANCE DAVID C, LEES Flat 6, 23 Normanton Road, South Croydon, Surrey, CR2 7 AE, United Kingdom AND NEAL G. SMITH Smithsonian Tropical Research Institute, Unit 0948, APO AA34002-0948 U.S.A. ABSTRACT. Larval and adult food plant records for the moth subfamily Uraniinae (sensu Sick 1937) are reviewed. Reliable larval food plant records for all seven genera include only the genera Omphalea L., Endospermum Benth., and Suregada Roxb. ex Rottl. (Euphorbiaceae), and this specialization on Euphorbiaceae supports Sick's concept of Uraniinae (based on meta thoracic and tympanal morphology) as a monophyletic group. Whereas Omphalea is known to be fed on only by larvae of the three strictly day-flying genera (Urania Fabricius, Chrysiridia Hiibner, and Alcides Hiibner), Endospermum is a recorded foodplant for Alcides and three primarily nocturnal genera (Lyssa Hiibner, Urapteroides Moore, and Cyphura Warren). The latter two genera have been traditionally included in the Microniinae, as has been Urapteritra Viette, whose larval food plant Suregada is reported here for the first time. Some ecological and evolutionary aspects of uraniine larval foodplant specialization are discussed. A putative phylogeny of Uraniinae based on published hearing organ and larval morphology is presented, and the phylo genetic significance of larval foodplant relationships evaluated. Adult foodplants (nectar resources) for the diurnal uraniines are summarized, and the possibility of their role in the moths' reproductive or predator defense ecology is briefly discussed. Additional key words: Microniinae, Omphalea, Endospermum, Suregada, Euphor biaceae. -

Outhern Lepidopterists' NEUJS
outhern Lepidopterists' NEUJS Vol. 26 N0.1 March 31, 2004 THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE SOUTHERN LEPIDOPTERISTS' SOCIETY ORGANIZED TO PROMOTE SCIENTIFIC INTEREST AND KNOWLEDGE RELATED TO UNDERSTANDING THE LEPIDOPTERA FAUNA OF THE SOUTHERN REGION OF THE UNITED STATES (WEBSITE: www.southernlepsoc.org/) J. BARRY LOMBARDINI: EDITOR ERINNYIS ALOPE (DRURY) REARING NOTES IN FLORIDA BY JEFF SLOTTEN Erinnyis a/ope (Drury), the A lope Sphinx, ranges throughout the Neotropical Region from northern Argentina north to Arkansas and Kansas as strays, according to Hodges (1971). Though adult moths can be found feeding on flowers at dusk to dawn, they are seldom encountered. They are not readily attracted to lights or bait. In Florida, the moth is resident throughout the peninsula and larvae are readily encountered on locally grown papayas (Carica papaya L.). Covell(1984) lists Allamanda sp. and Jatropha sp. as other host plants. I have had the pleasure of rearing this beautiful sphinx moth in Gainesville, Florida. Thanks to fellow Southern Lepidopterist member Tom Neal, I have been able to record the life history through the accompanying photos from stock collected on his papaya trees in Gainesville (Please See Color Insert B: Fig. 1). Tom has set up native plant communities in his yard. The papayas were planted near nectar sources for the adult moths. The green, round ova are laid on the undersides of the leaves. Larvae eclose about one week after they are laid and do not eat the entire egg shell (Fig. 2). Larvae develop rapidly (hey, it's a harsh environment out there!). Young larvae are very well camouflaged on the leaves and stems of papaya. -

Edwards Wasp Moth,Lymire Edwardsii
EENY182 Edwards Wasp Moth, Lymire edwardsii (Grote) (Insecta: Lepidoptera: Arctiidae: Ctenuchinae)1 Dale H. Habeck and Frank W. Mead2 Introduction There are continuous generations in southern Florida, and caterpillars may be found any month of the year. Distribu- The caterpillars of Edwards wasp moth frequently cause tion records may not be entirely indicative of the true extensive injury to Ficus trees. Bratley (1929) called it range. Once larvae mature, they crawl about and pupate on the rubber tree caterpillar because of its injury to rubber walls of buildings as well as on many non-hosts. Therefore, trees (Ficus spp.). The immature stages were described by movement of nursery plants with attached pupae may result Edwards (1887) and Dyar (1890). Genung (1959) published in its presence in areas well outside its normal range. a comprehensive study on the moth’s biology and its control in the Lake Worth, Florida area. Description Adult Size varies, but the wingspan usually ranges from 35 to 40 mm. The wings and thorax are bluish gray. The abdomen is blue dorsally and white ventrally. The prothorax and Figure 1. Dorsal view of an adult Edwards wasp moth, Lymire edwardsii (Grote). Credits: Jeff Hollenbeck Distribution Edwards wasp moth is common throughout southern Florida. It has been reared from as far north as Monticello Figure 2. Ventral view of an adult Edwards wasp moth, Lymire edwardsii (Grote). (Jefferson County), but most records are from south of Credits: Jeff Hollenbeck a line from St. Petersburg to Vero Beach (Kimball 1965). 1. This document is EENY182 (originally published as DPI Entomology Circular 234), one of a series of the Department of Entomology and Nematology, UF/IFAS Extension. -

Invasive Species Pathway Risk Analysis for California
• · ~ , ·.. .•1-;<11 , ... ... ., ~~'- ... ,i-.,_,,, .., ~ ._. .·• .. - ' . ' Invasive Species Pathway Risk Analysis for California Prepared by: Christiana Conser, University of California Davis Ph.D. Student, Department of Plant Sciences Table of Contents INTRODUCTION ............................................................................................................................................. 3 DEFINITIONS .................................................................................................................................................. 3 OVERVIEW ..................................................................................................................................................... 4 California Invasive Species Advisory Committee (CISAC) ......................................................................... 4 CISAC Strategic Framework....................................................................................................................... 4 CISAC Invasive Species List ........................................................................................................................ 4 METHODOLOGY ............................................................................................................................................ 5 RESULTS ........................................................................................................................................................ 8 Invasive Species Pathway Risk Analysis by Taxonomic Group ..................................................................... -

Edwards Wasp Moth, Lymire Edwardsii (Grote) (Insecta: Lepidoptera: Arctiidae: Ctenuchinae)1
Archival copy: for current recommendations see http://edis.ifas.ufl.edu or your local extension office. EENY-182 Edwards Wasp Moth, Lymire edwardsii (Grote) (Insecta: Lepidoptera: Arctiidae: Ctenuchinae)1 Dale H. Habeck and Frank W. Mead2 Introduction result in its presence in areas well outside its normal range. The caterpillars of Edwards wasp moth frequently cause extensive injury to Ficus trees. Description Bratley (1929) called it the rubber tree caterpillar because of its injury to rubber trees (Ficus spp.). The Egg immature stages were described by Edwards (1887) The egg is spherical and almost translucent; and Dyar (1890). Genung (1959) published a deposited singly or in batches on the underside of the comprehensive study on the moth's biology and its foliage (Genung 1959). control in the Lake Worth, Florida area. Distribution Edwards wasp moth is common throughout southern Florida. It has been reared from as far north as Monticello (Jefferson County), but most records are from south of a line from St. Petersburg to Vero Beach (Kimball 1965). There are continuous generations in south Florida, and caterpillars may be found any month of the year. Distribution records may not be entirely indicative of the true range. Once larvae mature, they crawl about and pupate on walls of buildings as well as on many non-hosts. Therefore, Figure 1. Eggs of the Edwards wasp moth, Lymire movement of nursery plants with attached pupae may edwardsii (Grote). Credits: Division of Plant Industry 1. This document is EENY-182 (originally published as DPI Entomology Circular 234), one of a series of Featured Creatures from the Entomology and Nematology Department, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida.