Bruno Bernard Bernard Bruno Que Par
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
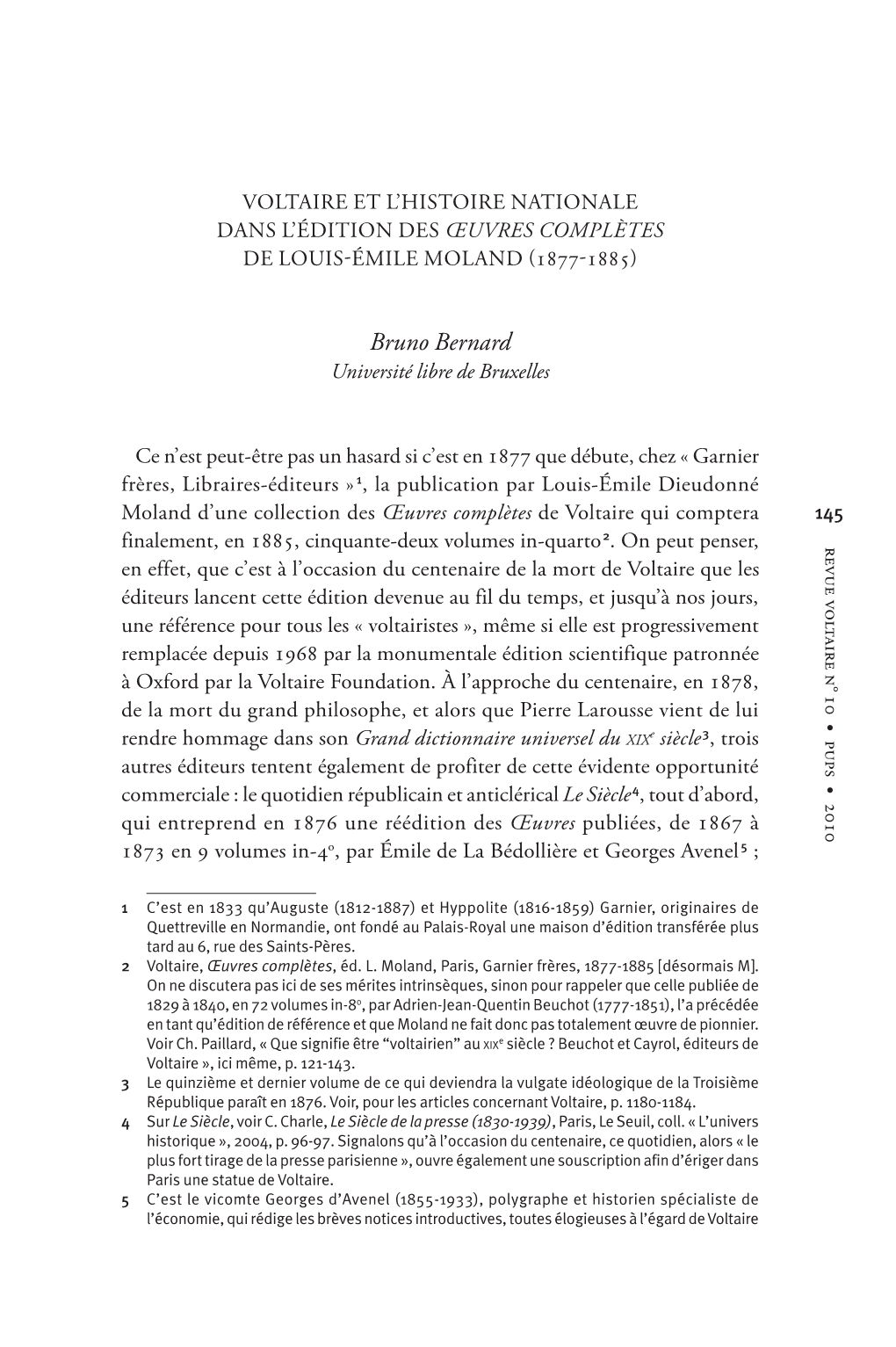
Load more
Recommended publications
-

Livres Anciens
1 CARTES: FRANCE GOUJON : Provence : Vaison et environs, une feuille 100 € / 120 € (91X60), entoilée et repliée. VIGNON : Lons-le-Saunier et environs, une feuille (91X59), entoilée et repliée, carte en couleurs. HEUGUET : Grenoble et le Dauphiné, une feuille (91X60), entoilée et repliée. Carte de l'Estérel, carte du Touring club. Carte de Fontainebleau. Fin du XVIIIème. 2 CARTES : NAPLES JORIO (Le chanoine D. Andrea De) : Indicazione del piu 100 € / 150 € Rimarcabile in Napoli e Contorni del Canonico, Naples, vers 1830, une feuille repliée sous jaquette de papier marbré de l'époque. Plan de Pompéi, Naples, 1833, une feuille repliée sous jaquette imp. en noir. La première carte est en noir, la seconde en couleurs. 3 CARTES : EXPEDITION CITROEN CENTRE-ASIE : 3ème mission. G.M. HAARDT- 120/ 150 € AUDOUIN-DUBREUIL. Pochette vendu au bénéfice de la Soc.de Géographie. Bien complet de la carte. Petite déchirure à la pochette. Carte dépliante du Dauphiné, Isère et Hautes-Alpes, vers 1810, entoilé. Les Ballons dirigeables et l’aviation. Lyon, 1887 ; in – 12 br. Le Livre illustré des Patiences. 60 jeux de patiences. Bruxelles, 2ème éd. Kiessling, s.d. ; in – 8° perc. ill. d’éd. Plan-Guide et Liste des rues de Tunis. Tunis, La Caravelle, 1954. In – 12 br. 2 Calendriers publicitaires de la ville de Vittel. 1929 – 1934. Plan du métropolitain de Paris. Paris, Taride, s.d. (vers 1913). Plan dépliant représentant les huit premières lignes du métro parisien. Houlgate. BOUZIGUES (Alcide) : Voyage fantastique en bicyclette de Paris à Lannemezan. Paris, Chez l’auteur, 1896 ; in-12, br. LIVRES ANCIENS 4 AVIGNON : LACOMBE : Dict. -

The Subversive Court of Louise Bénédicte De Bourbon, Daughter-In-Law of the Sun King (1700–1718)”
Phi Alpha Theta Pacific Northwest Conference, 8–10 April 2021 Jordan D. Hallmark, Portland State University, graduate student, “Parody, Performance, and Conspiracy in Early Eighteenth-Century France: The Subversive Court of Louise Bénédicte de Bourbon, Daughter-in-Law of the Sun King (1700–1718)” Abstract: This paper examines how the French princess Louise Bénédicte de Bourbon, duchesse du Maine (1676–1753), the wife of Louis XIV’s illegitimate son, the duc du Maine, established an exclusive court at her château de Sceaux beginning in the year 1700 that challenged the centralized cultural system of the French monarchical state. Located twenty kilometers away from the rigid and controlling political center of Versailles, the court of the duchesse du Maine subverted social norms by inventing and performing parodies of court protocols, chivalric orders, emblems, and other forms of monarchical imagery. In a time and place where women were both legally and socially barred from holding positions of authority, the duchesse du Maine created a parallel world in which she was the sovereign, presiding over a court of important political, cultural, and intellectual figures, including the philosopher Voltaire. By considering the significance of this subversive court culture in the context of the factional divisions and dynastic crises emerging in the last years of Louis XIV’s reign, this paper will show how the seemingly frivolous aristocratic divertissements of the duchesse du Maine and her circle were informed by political, social, and dynastic ambitions that would culminate in a conspiracy to overthrow the French regent, Philippe d’Orléans, in 1718. “Parody, Performance, and Conspiracy in Early Eighteenth-Century France: The Subversive Court of Louise-Bénédicte de Bourbon, Daughter-In-Law of the Sun King (1700–1718)” by Jordan D. -

Louis XIV's Medal Cabinet at Versailles1
article Louis XIV’s medal cabinet at Versailles1 Robert Wellington when swedish architect Nicodemus Tessin Struck to commemorate almost all notable the Younger (1654-1728) visited France for the events from the reign, when these medals were third time in 1687, he wrote a memoir of the placed alongside their ancient precursors they extraordinary things that he had seen there. became an extension of the premier numismat- Alongside his account of the more famous ic cabinet in France. By amassing a vast numis- gardens, galleries and salons of the palace of matic collection, Louis XIV created a distinctly Versailles is an extended account of Louis XIV’s French encyclopedia of history that culminated Cabinet des Médailles – one of the most opulent in a celebration of his own reign. rooms in the château. The walls of the Cabinet Tessin’s sketch of the Cabinet des Médailles were covered with mirrors, it had a coffered appears on a sheet of paper folded three times, dome decorated in lapis lazuli blue with gilt into eighths, presumably to make a more stable rosettes, and gold stuccowork abounded. The surface to draw upon as the Swedish party room held a precious collection of cabinet was conducted around the palace. When the paintings by some of the greatest early modern sheet is unfolded, the study is perpendicular masters, small silver and bronze statuettes, to a text describing the Cabinet that includes a extraordinary engraved gems, and armoires plan of the space in ink amongst Tessin’s near filled with more than 27,000 coins and medals. -

Refashioning the Respectable Elite Woman in Louis XIV's Paris Madame De Sévigné & Ninon De Lenclos
Riikka-Maria Pöllä Refashioning the Respectable Elite Woman in Louis XIV’s Paris Madame de Sévigné & Ninon de Lenclos Copyright © Riikka-Maria Pöllä Cover images: (on the left) Ninon de Lenclos by Louis Ferdinand Elle the Younger. Châteaux de Versailles et de Trianon. (On the right) Madame de Sévigné (1665) by Claude Lefèbvre. Hôtel Carnavalet, Paris. Graphic design: Juha Nenonen Printed in Helsinki Bofori, 2017 ISBN 978-951-51-3061-7 (paperback) ISBN 978-951-51-3043-3 (PDF) Riikka-Maria Pöllä Refashioning the Respectable Elite Woman in Louis XIV’s Paris Madame de Sévigné & Ninon de Lenclos Academic dissertation to be publicly discussed, by due permission of the Faculty of Arts at the University of Helsinki in lecture hall 13, on the 28th of April, 2017 at 12 o’clock. Abstract Refashioning the Respectable Elite Woman in Louis XIV’s Paris Madame de Sévigné & Ninon de Lenclos Riikka-Maria Pöllä University of Helsinki This PhD thesis is an analysis of the appearances, material culture and sexuality of the respectable woman, l’honneste femme, in Paris under the regime of Louis XIV. Through the examples of Madame de Sévigné and Ninon de Lenclos, the study describes how Parisian elite women were able to fashion the ideal of l’honneste femme and how reality and ideals were combined in Parisian society. The study is based on the idea that female chastity is not the only key factor when evaluating and refashioning l’honneste femme and the 17th century female ideal was composed from different elements: elite status, education, manners, material culture, outer appearance and sexuality; residential area also played a role, especially the quartier of Le Marais with its fourishing elite culture. -

The Chevalier De Lorraine As “Maître En Titre”
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles Sociétés de cour en Europe, XVIe-XIXe siècle - European Court Societies, 16th to 19th Centuries Articles et études | 2017 The Chevalier de Lorraine as “Maître en Titre”: The Male Favourite as Prince, Partner and Patron Le chevalier de Lorraine comme « Maître en titre » : le favori mâle comme prince, partenaire et patron Jonathan Spangler Electronic version URL: http://journals.openedition.org/crcv/14427 ISSN: 1958-9271 Publisher Centre de recherche du château de Versailles This text was automatically generated on 14 December 2017. The Chevalier de Lorraine as “Maître en Titre”: The Male Favourite as Prince,... 1 The Chevalier de Lorraine as “Maître en Titre”: The Male Favourite as Prince, Partner and Patron Le chevalier de Lorraine comme « Maître en titre » : le favori mâle comme prince, partenaire et patron Jonathan Spangler 1 In June 1701, the only brother of Louis XIV of France, Philippe, Duke of Orléans, passed away in his château in Saint-Cloud just outside of Paris. He left behind a widow and a son, but also a significant male favourite, with whom he had shared his life for nearly forty years: Philippe, Chevalier de Lorraine. The new Duke of Orléans offered to continue his late father’s gift to the Chevalier of a pension (about 10,000 écus, or 30,000 livres), and to allow him to keep his apartments at the Palais-Royal. Several contemporaries noted the gesture, and added that the Chevalier retained the rooms, but refused the pension. Dangeau quotes the young Orléans as offering it because, “I inherit the totality of his wealth, thus it will always be him who gives it to you”. -

Sources Et Bibliographie Sur L'étiquette
Sources et bibliographie sur l’étiquette (XVIe-XVIIIe siècles) (liste non exhaustive) Sources manuscrites Archives des affaires étrangères AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 171 : Saint-Simon, 16 – 1563-1583. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1817 : Cérémonial, 1 – 1433-1683. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1818 : Cérémonial, 2 – 1279-1638. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1819 : Cérémonial, 3 – 1380-1644. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1820 : Cérémonial, 4 – 1559-1589. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1821 : Cérémonial, 5 – 1204-1594. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1822 : Cérémonial, 6 – 1350-1531. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1823 : Cérémonial, 7 – 1533-1622. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1824 : Cérémonial, 8 – 1625-1690. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1825 : Cérémonial, 9 – 1398-1660. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1826 : Cérémonial, 10 – 1499-1632. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1827 : Cérémonial, 11 – 1645-1698. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1828 : Cérémonial, 12 – 1660-1665. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1829 : Cérémonial, 13 – 1467-1632. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1830 : Cérémonial, 14 – 1558-1704. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1831 : Cérémonial, 15 – 1558-1704. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1832 : Cérémonial, 16 – 1353-1704. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1833 : Cérémonial, 17 – 1508-1690. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1834 : Cérémonial, 18 – 1646-1701. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1835 : Cérémonial, 19 – 1601-1695. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1836 : Cérémonial, 20 – 1644-1697. AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1837 : Cérémonial, 21 – 1621-1690. -

Autographes & Manuscrits
_25_06_15 AUTOGRAPHES & MANUSCRITS & AUTOGRAPHES Pierre Bergé & associés Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 Paris 92 avenue d’Iéna 75116 Paris T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 Bruxelles Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles Autographes & Manuscrits T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65 PARIS - JEUDI 25 juIN 2015 www.pba-auctions.com VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PARIS Pierre Bergé & associés AUTOGRAPHES & MANUSCRITS DATE DE LA VENTE / DATE OF THE AUCTION Jeudi 25 juin 2015 - 13 heures 30 June Thursday 25th 2015 at 1:30 pm LIEU DE VENTE / LOCATION Drouot-Richelieu - Salle 8 9, rue Drouot 75009 Paris EXPOSITION PRIVÉE / PRIVATE VieWinG Sur rendez-vous à la Librairie Les Autographes 45 rue de l’Abbé Grégoire 75006 Paris T. + 33 (0)1 45 48 25 31 EXPOSITIONS PUBLIQUES / PUBlic VieWinG Mercredi 24 juin de 11 heures à 18 heures Jeudi 25 juin de 11 heures à 12 heures June Wednesday 24th from 11:00 am to 6:00 pm June Thursday 25th from 11:00 am to 12:00 pm TÉLÉPHONE PENDANT L’EXPOSITION PUBLIQUE ET LA VENTE T. +33 (0)1 48 00 20 08 CONTACTS POUR LA VENTE Eric Masquelier T. + 33 (0)1 49 49 90 31 - [email protected] Sophie Duvillier T. + 33 (0)1 49 49 90 10 - [email protected] EXPERT POUR LA VENTE Thierry Bodin Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d'Art 45 rue de l'Abbé Grégoire, 75006 Paris T. -

'We Have Been Informed That the French Are Carrying
chapter 28 ‘We have been Informed that the French are Carrying Desolation Everywhere’: The Desolation of the Palatinate as a European News Event Emilie Dosquet After the fall of Philippsburg, the Dauphin went into the Palatinate which he subjugated entirely. He seized by Siege Manheim, Frankenthal & Heidelberg. The towns of Worms, Spire, Oppenheim & many others opened their Doors without resistance. But these towns of Worms, Spire & Oppenheim, which gave themselves up to the French, & prided them- selves on being treated according to the common laws of War, experi- enced a cruel fate, more terrible than that of Heidelberg; because they were not only completely destroyed and consumed with fire, but besides that, the overly credulous Inhabitants, who had taken their main per- sonal effects to put them in a safe place, fell prey to pillage & the fury of the Soldier. Since we have seen the description of it in the public News, I will skip the details of the cruelties & inhumanities which are capable of touching the most insensitive hearts.1 Borrowed word for word from the eleventh issue of the “historical and political mercure” Lettres sur les matières du temps dated 15 June 1689, these few lines of Henri de Limiers’ Histoire de Louis xiv constitute a narrative of what the author 1 [Henri de Limiers], Histoire de Louis xiv. Roi de France et de Navarre. Où l’on trouve une Recherche éxacte des Intrigues de cette Cour dans les principaux Etats de l’Europe. Par H. P. D. L. D. E. D. (Amsterdam, 1717), vol. 4, p. 282: “Après la prise de Philipsbourg, le Daufin entra dans le Palatinat qu’il réduisit entièrement. -

| University Microfilms, a XERPK Company, Ann Arbor, Michigan
70-26,296 HANDEN, Jr., Ralph Donnelly, 1932- ^ THE SAVOY NEGOTIATIONS OF THE COMTE DE TESSE, 1693-1696. [Portions of Text In French]. The Ohio State University, Ph.D., 1970 History, modern i t | University Microfilms, A XERPK Company, Ann Arbor, Michigan Copyright by Ralph Donnelly Handen, Jr. 1971' THIS DISSERTATION HAS BEEN MICROFILMED EXACTLY AS RECEIVED THE SAVOY NEGOTIATIONS OF THE COMTE DE TESsf 1693-1696 DISSERTATION Presented In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University By Ralph Donnelly Handen, Jr., B.S. , B.D. The Ohio State University 1970 Approved by / A dviser Deportment of History AC KNOWLEDGMENTS Among those who have aided me during my graduate studies In history and in the writing of this dissertation, I wish to express my special thanks to Professor John C. Rule of the Ohio State Uni versity, who has encouraged me from the beginning. Professor Ragnhild Hatton of the London School of Economics has also rendered counsel and support on more than one occasion. Finally, my thanks to the staffs of the Blbliotheaue Nationale, the Archives des Affaires Etrangeres. and the Archives de Guerre, for their gracious assistance during the summer of 1968. li VITA April 25, 1932 Born - San Diego, California 1954 B.S. , California Institute of Technology, Pasadena, California 1957 B.D ., Fuller Theological Seminary, Pasadena, California 1965-1967 Teaching Assistant, Department of History, The Ohio State University, Columbus, Ohio 1967-1970 Acting Instructor, Department of History, University of California, Riverside, California PUBLICATIONS "Bibliography of Works on Carl Lotus Becker and Charles Austin Beard, 1945-1963." History and Theory V. -

CHILDREN of the REVOCATION: the REEDUCATION of FRENCH PROTESTANTS AFTER 1685 by ELIZABETH ANN CHURCHICH a Dissertation Submitted
CHILDREN OF THE REVOCATION: THE REEDUCATION OF FRENCH PROTESTANTS AFTER 1685 By ELIZABETH ANN CHURCHICH A dissertation submitted to the Graduate School – New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Program in History under the direction of Dr. Jennifer Jones and approved by ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ New Brunswick, New Jersey May 2013 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Children of the Revocation: The Reeducation of French Protestants after 1685 by ELIZABETH ANN CHURCHICH Dissertation Director: Jennifer M. Jones, Ph.D. This dissertation examines the Revocation of the Edict of Nantes in late seventeenth-century France and its connections to the absolutist monarchy of Louis XIV and the shifting educational ideals of the period. Focusing on the detailed implementation of the edict in Paris, it discusses the importance of the development of a new bureaucratic structure that allowed Louis XIV to remain relatively involved in the details of implementation, while entrusting the daily operations to individuals loyal to the crown. Placing the Revocation in the context of administrative expansion, growing central control, and idealized Christian kingship, Louis XIV’s decision to end toleration of Protestantism in France becomes clearer. It also argues that education and social reform were central in the conception and execution of this edict, and that the Revocation was part of a moment in which conversion through education appeared possible. In combining religious conversion and education in an effort to form Protestants into French Catholics, Louis XIV built upon an absolutist vision of education and connected his efforts to a flourishing debate. -

Ninon De Lenclos (1623-1705), Le Parcours D’Une Libertine
Université de Montréal Ninon de Lenclos (1623-1705), le parcours d’une libertine au XVIIe siècle. par Martine Hardy Département d’histoire Faculté des Arts et Sciences Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures et postdoctorales en vue de l’obtention du grade de maître ès art en histoire option recherche Août 2011 ©Martine Hardy, 2011 Université de Montréal Faculté des études supérieures et postdoctorales Ce mémoire intitulé : e Ninon de Lenclos (1623-1705), le parcours d’une libertine au XVII siècle. Présenté par : Martine Hardy a été évalué par un jury composé des personnes suivantes : Susan Dalton, présidente-rapporteuse Dominique Deslandres, directrice de recherche Lucie Desjardins, membre du jury i Résumé Grâce aux concepts développés par l’histoire du genre et des femmes, ce mémoire e cherche à jeter un regard nouveau sur le parcours de la courtisane libertine du XVII siècle Anne de Lenclos, surnommée Ninon. C’est que l’image qui a été véhiculée de Ninon depuis e le XVIII siècle ne rend pas compte de la complexité du personnage : elle ne met l’accent que sur sa liberté sexuelle, ou au contraire, sur son intelligence et son rôle dans la vie littéraire du Grand Siècle. Une relecture de la correspondance de la courtisane et des documents notariés (actes économiques, testament et inventaire après-décès) la concernant permet cependant de mettre au jour le portrait d’une femme de tête bien différente de celle qui avait jusqu’alors été décrite, réussissant à concilier les transgressions qu’elle n’a cessé de commettre contre l’ordre établi jusqu’à la fin de sa vie à la réputation d’une salonnière admirée et respectée. -

Catalogue 16 01 2019
HOTEL DES V ENTES DE C LERMONT -FERRAND Sarl Bernard VASSY & Philippe JALENQUES Société agréée par le Conseil des Ventes Volontaires n° 2002-111 Experts près la Cour d'Appel de Riom 19 Rue des Salins - 63000 CLERMONT-FERRAND - Tél. 04 73 93 24 24 – Fax. 04 73 35 54 34 [email protected] - interencheres.com MERCREDI 16 JANVIER à 11h00 et à 14h30 Vente en live LIVRES ANCIENS ET MODERNES Expert : Michel Thévenet, expert près la Cour d’Appel de Riom - 06 86 96 01 39 - [email protected] Expositions publiques : Mardi 15 janvier 2019 de 14h à 18h Mercredi 16 janvier 2019 de 9h à 11h Liste et photos sur www.interencheres.com/63002 Bernard VASSY et Philippe JALENQUES Commissaires Priseurs Associés & Habilités TELEPHONE Experts près la Cour d'Appel de Riom VENTE 19, rue des Salins, 63000 Clermont-Ferrand Tél. 04 73 93 24 24 – Fax. 04 73 35 54 34 interencheres.com – email : [email protected] ENCHERES PAR TELEPHONE / ORDRES D'ACHAT Nom et Prénom : Adresse : Téléphone et Fax : Adresse mail : Je vous prie d'acquérir pour mon compte personnel et aux limites indiquées en euro, les lots que j'ai désignés ci- dessous (les limites ne comprennent pas les frais de vente de 21 % TTC à rajouter en plus de l'adjudication) . Les enchères téléphoniques ne sont prises que pour les lots dont l’estimation est d’au moins 150 euros. Je joins un RIB ou à défaut un chèque signé, non rempli, à l'ordre de la SARL Vassy et Jalenques.