(Microsoft Powerpoint
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
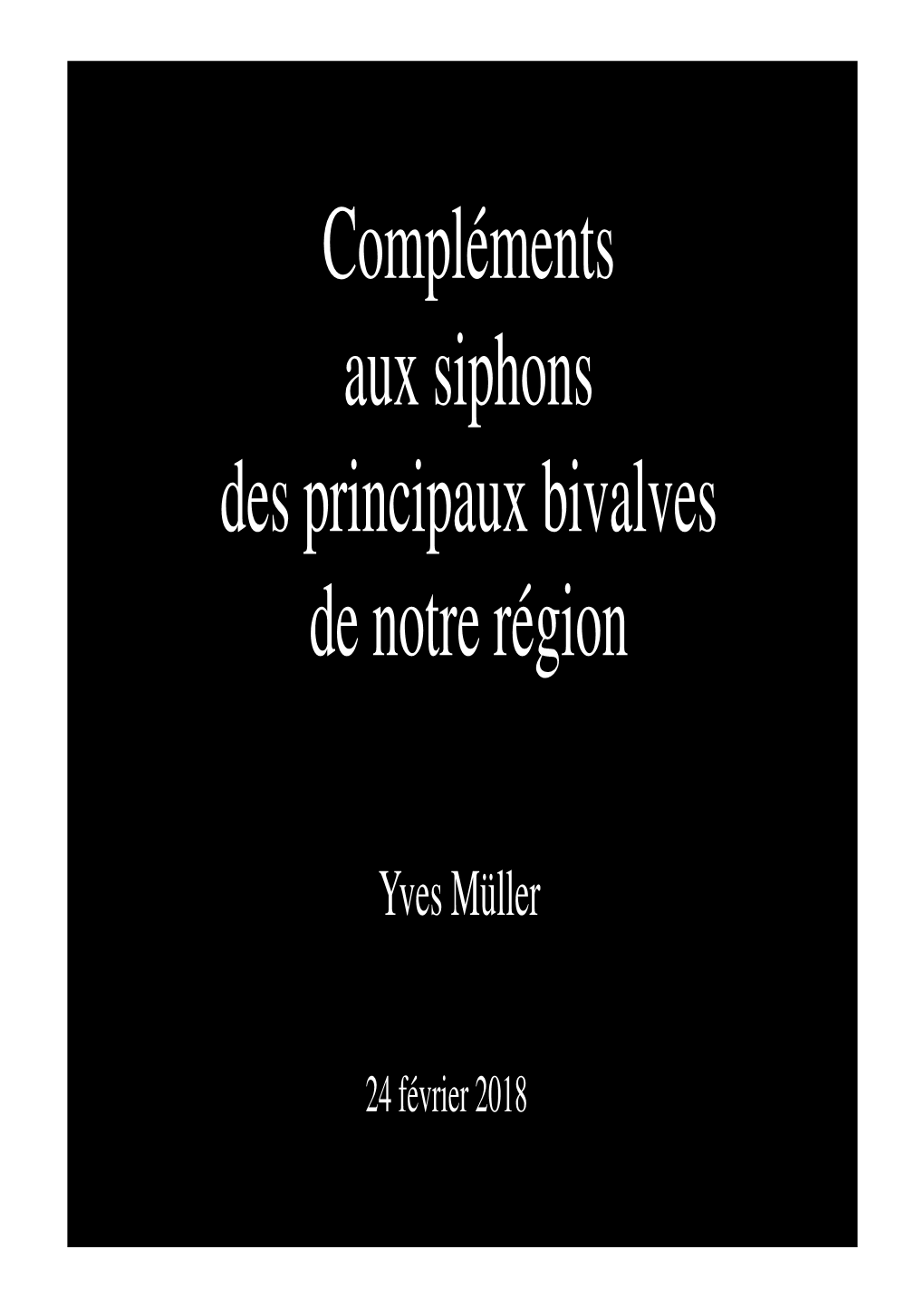
Load more
Recommended publications
-

Biogeographical Homogeneity in the Eastern Mediterranean Sea. II
Vol. 19: 75–84, 2013 AQUATIC BIOLOGY Published online September 4 doi: 10.3354/ab00521 Aquat Biol Biogeographical homogeneity in the eastern Mediterranean Sea. II. Temporal variation in Lebanese bivalve biota Fabio Crocetta1,*, Ghazi Bitar2, Helmut Zibrowius3, Marco Oliverio4 1Stazione Zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale, 80121, Napoli, Italy 2Department of Natural Sciences, Faculty of Sciences, Lebanese University, Hadath, Lebanon 3Le Corbusier 644, 280 Boulevard Michelet, 13008 Marseille, France 4Dipartimento di Biologia e Biotecnologie ‘Charles Darwin’, University of Rome ‘La Sapienza’, Viale dell’Università 32, 00185 Roma, Italy ABSTRACT: Lebanon (eastern Mediterranean Sea) is an area of particular biogeographic signifi- cance for studying the structure of eastern Mediterranean marine biodiversity and its recent changes. Based on literature records and original samples, we review here the knowledge of the Lebanese marine bivalve biota, tracing its changes during the last 170 yr. The updated checklist of bivalves of Lebanon yielded a total of 114 species (96 native and 18 alien taxa), accounting for ca. 26.5% of the known Mediterranean Bivalvia and thus representing a particularly poor fauna. Analysis of the 21 taxa historically described on Lebanese material only yielded 2 available names. Records of 24 species are new for the Lebanese fauna, and Lioberus ligneus is also a new record for the Mediterranean Sea. Comparisons between molluscan records by past (before 1950) and modern (after 1950) authors revealed temporal variations and qualitative modifications of the Lebanese bivalve fauna, mostly affected by the introduction of Erythraean species. The rate of recording of new alien species (evaluated in decades) revealed later first local arrivals (after 1900) than those observed for other eastern Mediterranean shores, while the peak in records in conjunc- tion with our samplings (1991 to 2010) emphasizes the need for increased field work to monitor their arrival and establishment. -

T.C. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orta
T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA KARADENİZ’DEKİ MOLLUSCA FAUNASI VE KATALOGLANMASI MUSTAFA BİÇER Bu tez, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans derecesi için hazırlanmıştır. ORDU 2014 TEZ BİLDİRİMİ Tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, tezin içerdiği yenilik ve sonuçların başka bir yerden alınmadığını, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. İmza Mustafa BİÇER Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir. I ÖZET ORTA KARADENİZ’ DEKİ MOLLUSCA FAUNASI VE KATALOGLANMASI Mustafa BİÇER Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014 Yüksek Lisans Tezi, 60s Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYDIN Bu çalışma ile Orta Karadeniz’de birçok sayıda familya ve cins ile temsil edilen mollusca sınıfına ait türlerin Ordu İlindeki dağılımının belirlenmesi ve araştırılması amaçlanmıştır. Mollusca türlerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, derinlikleri 0-25 m arasında değişen 14 istasyondan örneklemeler yapılmıştır. Araştırma mediolittoral bölgeden elle, dalarak ve el direcleri -

Reconnaître Les Principaux Bivalves Fouisseurs Ou Foreurs Au Moyen De Leurs Siphons
Reconnaître les principaux bivalves fouisseurs ou foreurs au moyen de leurs siphons. 56 espèces Clé de détermination des 20 taxons les plus gros Yves MÜLLER Yves Müller Mai 2016 Reconnaître les principaux bivalves fouisseurs ou foreurs au moyen de leurs siphons. Dans la quasi-totalité des ouvrages traitant des mollusques lamellibranches (ou mollusques bivalves), ce sont les coquilles qui sont décrites (la conchyologie) avec principalement la description des charnières pour la classification. Pour les parties molles (la malacologie) ce sont les branchies qui sont utilisées. Ce qui n’est pas très accessible au plongeur même photographe ! Selon Martoja (1995) 75 % des espèces de bivalves vivent dans les fonds meubles. Certaines espèces trahissent leur présence par leurs siphons qui affleurent à la surface du sédiment, mais il est difficile, au cours d’une plongée, d’identifier les bivalves enfouis dans le sédiment. D’autres espèces de bivalves vivent dans des substrats durs (bois, roche). Ils forent alors une loge dans ce substrat et en général seuls les siphons sont visibles. Le même problème se pose, à quelle espèce appartiennent les siphons ? Selon Bouchet et al. (1978 :92): « Les siphons constituent un moyen de détermination des bivalves aussi fiable que la coquille et la charnière ». Des auteurs anciens comme Deshayes (1844-1848), Forbes et Hanley (1850-1853), Jeffreys (1863, 1865) et Meyer & Möbius (1872) et quelques autres plus récents comme Owen (1953 ; 1959), Purchon (1955a, b), Holme (1959) et Amouroux (1980) ont décrit les siphons de plusieurs espèces. La plupart des espèces de bivalves mesurent entre un et plusieurs centimètres mais les siphons sont pour la plupart courts ou très fins et rétractiles au moindre danger, donc difficilement observables en plongée. -

A World Dataset on the Geographic Distributions of Solenidae Razor Clams (Mollusca: Bivalvia)
Biodiversity Data Journal 7: e31375 doi: 10.3897/BDJ.7.e31375 Data Paper A world dataset on the geographic distributions of Solenidae razor clams (Mollusca: Bivalvia) Hanieh Saeedi‡,§,|, Mark J Costello ¶ ‡ Department of Marine Zoology, Crustaceans, Senckenberg Research Institute and Natural History Museum, 60325 Frankfurt am Main, Germany § Institute for Ecology, Diversity and Evolution, Goethe University Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany | OBIS data manager, deep-sea node, Frankfurt am Main, Germany ¶ Institute of Marine Science, University of Auckland, Auckland 1142, New Zealand Corresponding author: Hanieh Saeedi ([email protected]) Academic editor: Dimitris Poursanidis Received: 05 Nov 2018 | Accepted: 09 Jan 2019 | Published: 31 Jan 2019 Citation: Saeedi H, Costello M (2019) A world dataset on the geographic distributions of Solenidae razor clams (Mollusca: Bivalvia). Biodiversity Data Journal 7: e31375. https://doi.org/10.3897/BDJ.7.e31375 Abstract Background Using this dataset, we examined the global geographical distributions of Solenidae species in relation to their endemicity, species richness and latitudinal ranges and then predicted their distributions under future climate change using species distribution modelling techniques (Saeedi et al. 2016a, Saeedi et al. 2016b). We found that the global latitudinal species richness in Solenidae is bi-modal, dipping at the equator most likely derived by high sea surface temperature (Saeedi et al. 2016b). We also found that most of the Solenidae species will shift their distribution ranges polewards due to global warming (Saeedi et al. 2016a). We also provided a comprehensive review of the taxon to test whether the latitudinal gradient in species richness was uni-modal with a peak in the tropics or northern hemisphere or asymmetric and bimodal as proposed previously (Chaudhary et al. -

Embryonic and Larval Development of Ensis Arcuatus (Jeffreys, 1865) (Bivalvia: Pharidae)
EMBRYONIC AND LARVAL DEVELOPMENT OF ENSIS ARCUATUS (JEFFREYS, 1865) (BIVALVIA: PHARIDAE) FIZ DA COSTA, SUSANA DARRIBA AND DOROTEA MARTI´NEZ-PATIN˜O Centro de Investigacio´ns Marin˜as, Consellerı´a de Pesca e Asuntos Marı´timos, Xunta de Galicia, Apdo. 94, 27700 Ribadeo, Lugo, Spain (Received 5 December 2006; accepted 19 November 2007) ABSTRACT The razor clam Ensis arcuatus (Jeffreys, 1865) is distributed from Norway to Spain and along the British coast, where it lives buried in sand in low intertidal and subtidal areas. This work is the first study to research the embryology and larval development of this species of razor clam, using light and scanning electron microscopy. A new method, consisting of changing water levels using tide simulations with brief Downloaded from https://academic.oup.com/mollus/article/74/2/103/1161011 by guest on 23 September 2021 dry periods, was developed to induce spawning in this species. The blastula was the first motile stage and in the gastrula stage the vitelline coat was lost. The shell field appeared in the late gastrula. The trocho- phore developed by about 19 h post-fertilization (hpf) (198C). At 30 hpf the D-shaped larva showed a developed digestive system consisting of a mouth, a foregut, a digestive gland followed by an intestine and an anus. Larvae spontaneously settled after 20 days at a length of 378 mm. INTRODUCTION following families: Mytilidae (Redfearn, Chanley & Chanley, 1986; Fuller & Lutz, 1989; Bellolio, Toledo & Dupre´, 1996; Ensis arcuatus (Jeffreys, 1865) is the most abundant species of Hanyu et al., 2001), Ostreidae (Le Pennec & Coatanea, 1985; Pharidae in Spain. -

Marteilia Refringens and Marteilia Pararefringens Sp
Parasitology Marteilia refringens and Marteilia pararefringens sp. nov. are distinct parasites cambridge.org/par of bivalves and have different European distributions Research Article 1,2 1,2,3 1 4 5 Cite this article: Kerr R et al (2018). Marteilia R. Kerr , G. M. Ward , G. D. Stentiford , A. Alfjorden , S. Mortensen , refringens and Marteilia pararefringens sp. nov. J. P. Bignell1,S.W.Feist1, A. Villalba6,7, M. J. Carballal6, A. Cao6, I. Arzul8, are distinct parasites of bivalves and have different European distributions. Parasitology D. Ryder1 and D. Bass1,3 145, 1483–1492. https://doi.org/10.1017/ S003118201800063X 1Pathology and Microbial Systematics Theme, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Weymouth, Dorset DT4 8UB, UK; 2Biosciences, College of Life and Environmental Sciences, Received: 19 July 2017 3 Revised: 16 January 2018 Stocker Road, University of Exeter, Exeter EX4 4QD, UK; Department of Life Sciences, The Natural History 4 Accepted: 8 February 2018 Museum, Cromwell Road, SW7 5BD, London, UK; Division of fish, Department of animal health and antimicrobial First published online: 11 June 2018 strategies, National Veterinary Institute (SVA), Sweden; 5Institute of Marine Research, PO. Box 1870, Nordnes, 5817 Bergen, Norway; 6Centro de Investigacións Mariñas, Consellería do Mar da Xunta de Galicia, 36620 Vilanova de Key words: Arousa, Spain; 7Department of Life Sciences, University of Alcalá, 28871 Alcalá de Henares, Spain and 8Institut Marteilia refringens; Marteilia pararefringens; Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer), Laboratoire de Génétique et Pathologie des ITS1 rDNA; IGS rDNA; Paramyxida; Mollusques Marins, Avenue de Mus de Loup, 17390 La Tremblade, France Ascetosporea; Mytilus edulis; Ostrea edulis Author for correspondence: Abstract Grant D. -

Mollusc Fauna of Iskenderun Bay with a Checklist of the Region
www.trjfas.org ISSN 1303-2712 Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12: 171-184 (2012) DOI: 10.4194/1303-2712-v12_1_20 SHORT PAPER Mollusc Fauna of Iskenderun Bay with a Checklist of the Region Banu Bitlis Bakır1, Bilal Öztürk1*, Alper Doğan1, Mesut Önen1 1 Ege University, Faculty of Fisheries, Department of Hydrobiology Bornova, Izmir. * Corresponding Author: Tel.: +90. 232 3115215; Fax: +90. 232 3883685 Received 27 June 2011 E-mail: [email protected] Accepted 13 December 2011 Abstract This study was performed to determine the molluscs distributed in Iskenderun Bay (Levantine Sea). For this purpose, the material collected from the area between the years 2005 and 2009, within the framework of different projects, was investigated. The investigation of the material taken from various biotopes ranging at depths between 0 and 100 m resulted in identification of 286 mollusc species and 27542 specimens belonging to them. Among the encountered species, Vitreolina cf. perminima (Jeffreys, 1883) is new record for the Turkish molluscan fauna and 18 species are being new records for the Turkish Levantine coast. A checklist of Iskenderun mollusc fauna is given based on the present study and the studies carried out beforehand, and a total of 424 moluscan species are known to be distributed in Iskenderun Bay. Keywords: Levantine Sea, Iskenderun Bay, Turkish coast, Mollusca, Checklist İskenderun Körfezi’nin Mollusca Faunası ve Bölgenin Tür Listesi Özet Bu çalışma İskenderun Körfezi (Levanten Denizi)’nde dağılım gösteren Mollusca türlerini tespit etmek için gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, 2005 ve 2009 yılları arasında sürdürülen değişik proje çalışmaları kapsamında bölgeden elde edilen materyal incelenmiştir. -

Clams” Fauna Along French Coasts
Asian Journal of Research in Animal and Veterinary Sciences 1(1): 1-12, 2018; Article no.AJRAVS.39207 The Regulation of Interspecific Variations of Shell Shape in Bivalves: An Illustration with the Common “Clams” Fauna along French Coasts Jean Béguinot1* 1Biogéosciences, UMR 6282, CNRS, Université Bourgogne Franche-Comté, 6, Boulevard Gabriel, 21000 Dijon, France. Author’s contribution The sole author designed, analyzed, interpreted and prepared the manuscript. Article Information DOI: 10.9734/AJRAVS/2018/39207 Editor(s): (1) Andras Fodor, Department of Animal Sciences, Ohio State University, USA. Reviewers: (1) Mahmoud Abdelhamid Dawood, Kafrelsheikh University, Egypt. (2) Mbadu Zebe Victorine, Democratic Republic of Congo. Complete Peer review History: http://www.sciencedomain.org/review-history/23116 Received 24th November 2017 th Original Research Article Accepted 6 February 2018 Published 10th February 2018 ABSTRACT I report an unexpected negative covariance occurring between two major parameters governing shell growth in marine bivalves, especially within the order Veneroida. This relationship is highlighted, here, considering a set of forty, rather common species of clams collected from French coasts. Interestingly, this negative covariance has two (geometrically related) consequences on the pattern of variation of shell shape at the inter-specific level: (i) An extended range of variation of shell elongation ‘E’ is made compatible with. (ii) A severely restricted range of variation of the ventral convexity ‘K’ of the shell contour. I suggest that: (i) The extended range of interspecific variation of the shell elongation ‘E’ results from a trend towards larger differentiation between species according to this functionally important parameter E, while, in contrast, (ii) The strongly restricted range of variation of the ventral convexity ‘K’ of the shell contour might arguably result from a common need for improved shell resistance, face to mechanical solicitations from the environment, either biotic or abiotic. -

Biodiversità Ed Evoluzione
Allma Mater Studiiorum – Uniiversiità dii Bollogna DOTTORATO DI RICERCA IN BIODIVERSITÀ ED EVOLUZIONE Ciclo XXIII Settore/i scientifico-disciplinare/i di afferenza: BIO - 05 A MOLECULAR PHYLOGENY OF BIVALVE MOLLUSKS: ANCIENT RADIATIONS AND DIVERGENCES AS REVEALED BY MITOCHONDRIAL GENES Presentata da: Dr Federico Plazzi Coordinatore Dottorato Relatore Prof. Barbara Mantovani Dr Marco Passamonti Esame finale anno 2011 of all marine animals, the bivalve molluscs are the most perfectly adapted for life within soft substrata of sand and mud. Sir Charles Maurice Yonge INDEX p. 1..... FOREWORD p. 2..... Plan of the Thesis p. 3..... CHAPTER 1 – INTRODUCTION p. 3..... 1.1. BIVALVE MOLLUSKS: ZOOLOGY, PHYLOGENY, AND BEYOND p. 3..... The phylum Mollusca p. 4..... A survey of class Bivalvia p. 7..... The Opponobranchia: true ctenidia for a truly vexed issue p. 9..... The Autobranchia: between tenets and question marks p. 13..... Doubly Uniparental Inheritance p. 13..... The choice of the “right” molecular marker in bivalve phylogenetics p. 17..... 1.2. MOLECULAR EVOLUTION MODELS, MULTIGENE BAYESIAN ANALYSIS, AND PARTITION CHOICE p. 23..... CHAPTER 2 – TOWARDS A MOLECULAR PHYLOGENY OF MOLLUSKS: BIVALVES’ EARLY EVOLUTION AS REVEALED BY MITOCHONDRIAL GENES. p. 23..... 2.1. INTRODUCTION p. 28..... 2.2. MATERIALS AND METHODS p. 28..... Specimens’ collection and DNA extraction p. 30..... PCR amplification, cloning, and sequencing p. 30..... Sequence alignment p. 32..... Phylogenetic analyses p. 37..... Taxon sampling p. 39..... Dating p. 43..... 2.3. RESULTS p. 43..... Obtained sequences i p. 44..... Sequence analyses p. 45..... Taxon sampling p. 45..... Maximum Likelihood p. 47..... Bayesian Analyses p. 50..... Dating the tree p. -

And Clavatula Hupferi
Additional information on the identity of Clavatula quinteni Nolf & Verstraeten, 2006 and Clavatula xanteni Nolf & Verstraeten, 2006 with a link towards more twin species Frank Nolf Pr. Stefanieplein, 43/8 B-8400 Oostende, Belgium [email protected] Keywords: Clavatula quinteni, C. xanteni, shells have never been the object of any Callumbonella suturale, Laevicardium crassum, discussion, until now. We wonder why the Laevicardium oblongum, Fusinus mollis, Fusinus authors Johan Verstraeten and Frank Nolf have albinus, Gibbula pennanti, Gibbula umbilicalis, never been notified about that problem by Rolán twin species. and Ryall. It seems that this is a cowardly attack to completely eliminate both authors from the Abstract: This paper is an answer to vague conchological forum, after an earlier try by E. allegations about the identity of Clavatula Rolán (2008). In this paper we want to clarify this quinteni and C. xanteni, both described eight situation and to reveal the origin of this polemic. years ago, made by two colleagues in the sister The real status of both Clavatula quinteni and C. magazine ‘Xenophora’. The underlying reason of xanteni will be clarified followed by a few this confusing and irrational act is revealed, a examples of more twin species. thorough comparison of the two species is made resulting in a link to similar problems with regard A historic survey preceding the description to identifying twin species. of Clavatula quinteni – C. xanteni. Abbreviations: Important note: All quotes taken from CFN: Private collection of Frank Nolf (Oostende, colleagues’ personal messages were literally Belgium) copied here and therefore sometimes still CJV: Private collection of Johan Verstraeten contain grammatical mistakes. -

DNA Barcoding of Razor Clam Solen Spp.(Solinidae, Bivalva) In
BIODIVERSITAS ISSN: 1412-033X Volume 21, Number 2, February 2020 E-ISSN: 2085-4722 Pages: 478-484 DOI: 10.13057/biodiv/d210207 DNA barcoding of razor clam Solen spp. (Solinidae, Bivalva) in Indonesian beaches NINIS TRISYANI1,, DWI ANGGOROWATI RAHAYU2, 1Department of Fisheries, Faculty of Engineering and Marine Science, Universitas Hang Tuah. Jl Arif Rahman Hakim 150, Surabaya 60111, East Java, Indonesia. Tel .: +62-31-5945864, Fax .: +62-31-5946261, email: [email protected] 2Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Negeri Surabaya. Jl. Ketintang, Surabaya 60231, East Java, Indonesia. Tel.: +62-31-8280009, Fax.: +62-31-8280804, email: [email protected] Manuscript received: 1 December 2019. Revision accepted: 9 January 2020. Abstract. Trisyani N, Rahayu DA. 2020. DNA barcoding of razor clam Solen spp. (Solinidae, Bivalva) in Indonesian beaches. Biodiversitas 21: 478-484. Solen spp. are shells with various morphological characteristics with a wide distribution of tropical and subtropical beaches, including Indonesia. The identification of Solen spp. is generally based on its morphological characteristics. This method is very problematic due to specimens share similarity in morphology and color. This study was using DNA barcode as a molecular identification tool. The bivalve COI sequence was amplified using PCR and molecular phylogenetic analysis using the Neighbor-Joining method. The amplified COI gene has a length of about 665 bp. The purpose of this study was to evaluate genetic variation and compare the phylogenetic Solen spp. in Indonesian waters. The composition of the nucleotide bases of Solen spp. the comparative species are A = 26.79%, C = 23.16%, G = 19.17% and T = 30.93%. -

Portadas 25 (1)
© Sociedad Española de Malacología Iberus, 32 (1): 65-85, 2014 Nomenclatural notes on some European marine bivalve species Apuntes nomenclaturales sobre algunas especies de bivalvos de Europa Rudo von COSEL*, Serge GOFAS** & Jean-Maurice POUTIERS* Recibido el 6-XI-2013. Aceptado el 17-I-2014 ABSTRACT Some nomenclatural issues affecting European species are discussed. The following taxa are treated under ICZN Art. 23.9, with the required references provided: - Mytilus variabilis Krauss, 1848 (currently Brachidontes variabilis (Krauss, 1848)) is declared nomen protectum against the senior homonym Mytilus variabilis Fischer von Waldheim, 1807, declared nomen oblitum. The still earlier name Brachidontes ustulatus (Lamarck, 1819), currently used as the valid name for a native species of Western Aus- tralia, should take precedence over B. variabilis (Krauss, 1848) were it demonstrated that it is the same biological species, but in the current state of knowledge it is proposed to keep them separate. - Modiola nigra Gray, 1824 (currently Musculus niger (Gray, 1824)) is declared nomen protectum against the senior synonym Mytilus discors svecicus Fabricius, 1788, declared nomen oblitum. - Ostrea flexuosa Poli, 1795 (currently Flexopecten flexuosus (Poli, 1795)) is declared nomen protectum against the senior synonym Ostrea coarctata Born, 1778, declared nomen oblitum. - Chama aculeata Poli, 1795 (currently Centrocardita aculeata (Poli, 1795)) is declared nomen protectum against the senior homonym Chama aculeata Ström, 1768, declared nomen oblitum, thereby making valid the current usage and avoiding the need for using the junior synonym Centrocardita elegans (Requien, 1848). - Solen marginatus Pulteney, 1799 is declared nomen protectum against the senior syn- onyms Hypogaea tentaculata Poli, 1791, Solen rotundatus Spengler, 1794 and Solen gla- dius Röding, 1798, all declared nomina oblita.