Wajdi Mouawad
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
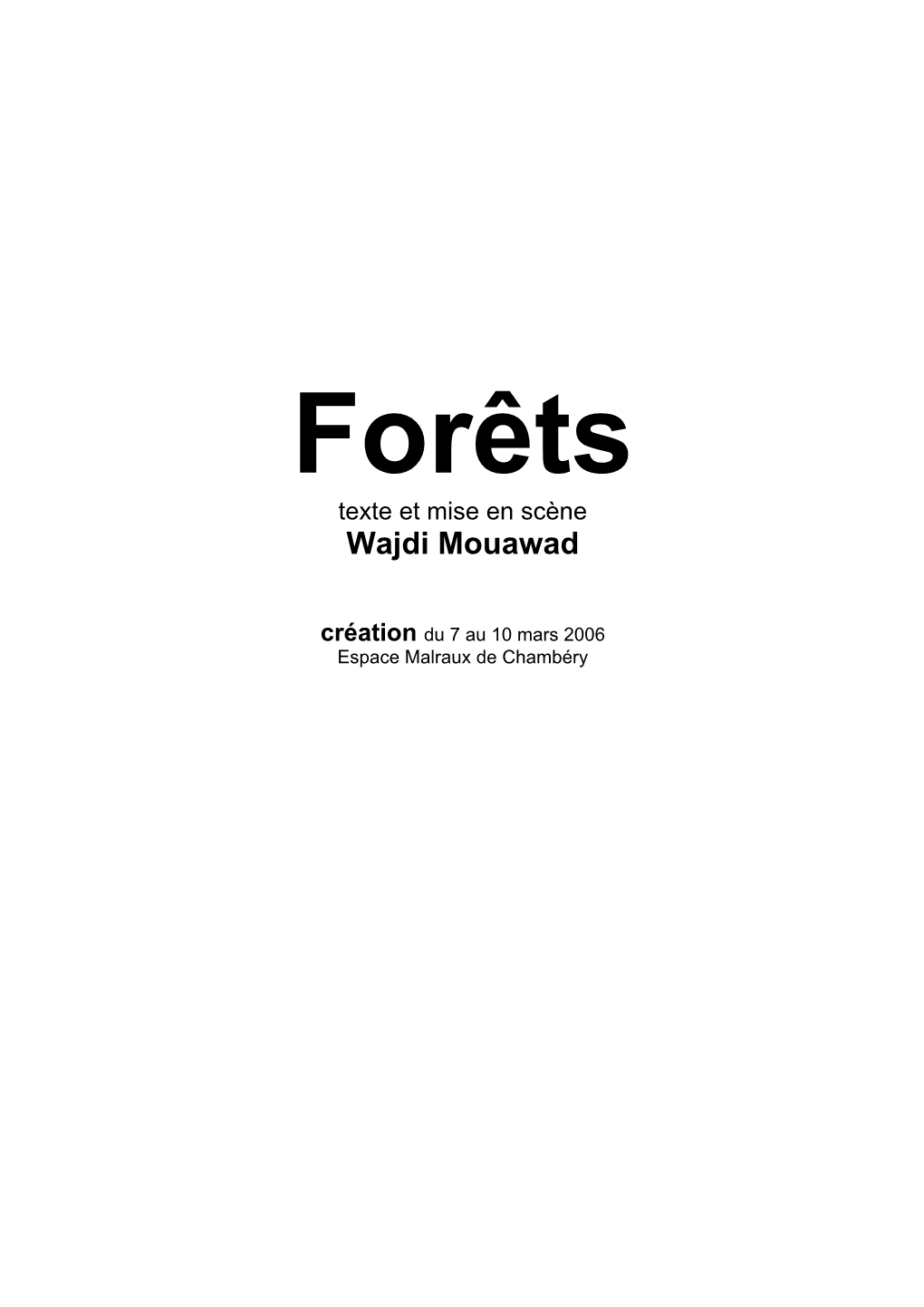
Load more
Recommended publications
-

Thesis Submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research
University of Alberta The Performance of Identity in Wajdi Mouawad’s Incendies by Nicole Renault A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Drama ©Nicole Renault Fall 2009 Edmonton, Alberta Permission is hereby granted to the University of Alberta Libraries to reproduce single copies of this thesis and to lend or sell such copies for private, scholarly or scientific research purposes only. Where the thesis is converted to, or otherwise made available in digital form, the University of Alberta will advise potential users of the thesis of these terms. The author reserves all other publication and other rights in association with the copyright in the thesis and, except as herein before provided, neither the thesis nor any substantial portion thereof may be printed or otherwise reproduced in any material form whatsoever without the author's prior written permission. Library and Archives Bibliothèque et Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de l’édition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A 0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre référence ISBN: 978-0-494-54187-6 Our file Notre référence ISBN: 978-0-494-54187-6 NOTICE: AVIS: The author has granted a non- L’auteur a accordé une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant à la Bibliothèque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par télécommunication ou par l’Internet, prêter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des thèses partout dans le loan, distribute and sell theses monde, à des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non- support microforme, papier, électronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. -

Press Kit Directed by Written and Uawad Wajdi Mou
Press Kit written and directed by Wajdi Mouawad 5 — 30 December 2018 Contact details Dorothée Duplan, Flore Guiraud, Camille Pierrepont assisted by Louise Dubreil 01 48 06 52 27 | [email protected] Downloadable Press kit and photos: www.colline.fr > professionnels > bureau de presse 2 Tous des oiseaux 5 – 30 December 2018 at La Colline – théâtre national Show in German, English, Arabic, and Hebrew surtitled in French duration: 4h interval included Cast and Creative Text and stage direction Wajdi Mouawad with Jalal Altawil Wazzan Jérémie Galiana or Daniel Séjourné Eitan Victor de Oliveira the waiter, the Rabbi, the doctor Leora Rivlin Leah Judith Rosmair or Helene Grass Norah Darya Sheizaf Eden, the nurse Rafael Tabor Etgar Raphael Weinstock David Souheila Yacoub or Nelly Lawson Wahida Assistant director Valérie Nègre Dramaturgy Charlotte Farcet Artistic collaboration François Ismert Historical advisor Natalie Zemon Davis Original music Eleni Karaindrou Set design Emmanuel Clolus Lighting design Éric Champoux Sound design Michel Maurer Costume design Emmanuelle Thomas assisted by Isabelle Flosi Make-up and hair design Cécile Kretschmar Hebrew translation Eli Bijaoui English translation Linda Gaboriau English translation Uli Menke Arabic translation Jalal Altawil 2018 Production La Colline – théâtre national The show was created on Novembre 17th in the Main venue at La Colline and has received the Great Prize 2018 of the Professional Review Association. The text has been published by Léméac/Actes Sud-Papiers in January 2018. 3 On tour -

YANA MEERZON This Essay Examines the Forms of History and Memory Representation in Incendies, the 2004 Play by Wajdi Mouawad, An
YANA MEERZON STAGING MEMORY IN WAJDI MOUAWAD ’S INCENDIES : ARCHAEOLOGICAL SITE OR POETIC VENUE ? This essay examines the forms of history and memory representation in Incendies , the 2004 play by Wajdi Mouawad, and its 2010 film version, directed by Denis Villeneuve. Incendies tells the story of a twin brother and sister on the quest to uncover the mystery of their mother’s past and the silence of her last years. A contemporary re-telling of the Oedipus myth, the play examines what kind of cultural, collective, and individual memo - ries inform the journeys of its characters, who are exilic children. The play serves Mouawad as a public platform to stage the testimony of his child - hood trauma: the trauma of war, the trauma of exilic adaptation, and the challenges of return. As this essay argues, when moved from one medium to another, Mouawad’s work forces the directors to seek its historical and geographical contextualization. If in its original staging, Incendies allows Mouawad to elevate the story of his personal suffering to the universals of abandoned childhood, to reach in its language the realms of poetic expres - sion, and to make memory a separate, almost tangible entity on stage, then the 2010 film version by Villeneuve turns this play into an archaeological site to excavate the recent history of a single war-torn Middle East country (supposedly Lebanon), an objective at odds with Mouawad’s own view of theatre as a venue where poetry meets politics. Naturally the transposition from a play to a film presupposes a significant mutation of the original and raises questions of textual fidelity. -

Wajdi Mouawad
Wajdi Mouawad Born in 1968, author, actor, and director Wajdi Mouawad spends his early childhood in Lebanon, his adolescence in France, and his young adult years in Quebec before settling in France, where he now lives. He studied in Montreal at École nationale de théâtre du Canada, and is awarded a diploma in performance in 1991. Upon graduation he begins codirecting his first company, Théâtre Ô Parleur, with actor Isabelle Leblanc. In 2005, he establishes two companies, Abé Carré Cé Carré, in Quebec, with Emmanuel Schwarts, and Au Carré de l’Hypoténuse in France. During this time, in 2000, he assumes the role of artistic director for the Théâtre de Quat’Sous in Montreal, a position he will hold for four seasons. He and his French company, Au Carré de l’Hypoténuse were associate artists at l'Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie, from 2008 to 2010. In 2009 he is artist in residence of the 63rd edition of the Festival d’Avignon, where he stages the quartet Le Sang des Promesses. He serves as artistic director for the Théâtre français du Centre national des Arts d’Ottawa from 2007 to 2012. Since September 2011, he has been associated artist at the Grand T- Nantes. In April 2016, he is nominated to assume the role of director for the National Theater in Paris, La Colline. His career as stage director began with the Théâtre Ô Parleur, as he contributed his own works to be performed: Partie de cache-cache entre deux Tchécoslovaques au début du siècle (1991), Journée de noces chez les Cromagnons (1994) et Willy Protagoras enfermé dans les toilettes (1998), puis Ce n’est pas la manière qu’on se l’imagine que Claude et Jacqueline se sont rencontrés coécrit avec Estelle Clareton (2000). -

De Wajdi Mouawad Dirección Mario Gas Índice
PRODUCCIÓN COPRODUCCIÓN DE Wajdi Mouawad DIRECCIÓN Mario Gas Índice 4 Ficha 6 Incendios/Wajdi Mouawad 7 Ysarca/Pilar de Yzaguirre 8 Mario Gas 9 Escenografía 11 Actores 22 Contacto 2 reparto NAWAL Nuria Espert NAWAL JOVEN Laia Marull JEANNE Carlota Olcina SIMON Álex García HERMILE LEBEL Ramón Barea ANTOINE Alberto Iglesias SAWDA Lucía Barrado NIHAD Edu Soto Ficha ficha artística AUTOR Wajdi Mouawad PRODUCTORES DELEGADOS Paco Pena y Alicia Moreno TRADUCTOR Eladio de Pablo COPRODUCCIÓN Teatro de la Abadía PRODUCCIÓN YSARCA S.L DIRECTORA - Pilar de Yzaguirre DIRECTOR Mario Gas SUBDIRECTORA - Pilar Gª de Yzaguirre ESCENOGRAFÍA Carl Fillion GERENTE - Elisa Ibarrola ESCENÓGRAFA ASOCIADA Anna Tussell VESTUARIO Antonio Belart PROYECCIONES Álvaro Luna ESPACIO SONORO Orestes Gas ILUMINACIÓN Felipe Ramos AYUDANTE VESTUARIO Cristina Martínez AYUDANTE DE DIRECCIÓN Montse Tixé DOSSIER m comunicación 4 5 Una mujer acaba de morir. Se llamaba Nawal Marwan. Y hoy, en la lectura del testamento, ella abre la puerta a su silencio y a sus secretos, a los misterios dolorosos de una familia. Ha dejado a sus gemelos, Jeanne y Simon, un cuaderno rojo, una chaqueta de tela verde y dos sobres que comportan una pe- tición llena de consecuencias, como otras tantas cajas de Pan- dora, orígenes de males y mara- villas, cuyo contenido arrastrará a los gemelos hacia un pasado desconocido, hacia un conti- nente lejano, hacia un segundo nacimiento. “La infancia es un cuchillo clavado en la garganta. No se lo arranca uno fácilmen- te” escribe Wajdi Mouawad. “Solamente las palabras tienen el poder de arrancarlo y calmar así la quemadura.” Wajdi Mouawad En el transcurso de los últimos veinte años, Wajdi Mouawad se ha destacado tanto en Canadá como en Europa gracias al vigor de su palabra y a la singularidad nítida de su estética teatral. -

Dossier Pédagogique
Du 9 au 19 novembre 2011 DES FEMMES LES TRACHINIENNES / ANTIGONE / ÉLECTRE Sophocle Texte français Robert Davreu Mise en scène Wajdi Mouawad GRANDE SALLE Dossier pédagogique « Le scarabée est un insecte qui se nourrit des excréments d’animaux autrement plus gros que lui. Les intestins de ces animaux ont cru tirer tout ce qu’il y avait à tirer de la nourriture ingurgitée par l’animal. Pourtant, le scarabée trouve, à l’intérieur de ce qui a été rejeté, la nourriture nécessaire à sa survie grâce à un système intestinal dont la précision, la finesse et une incroyable sensibilité surpassent celles de n’importe quel mammifère. De ces excréments dont il se nourrit, le scarabée tire la substance appropriée à la production de cette carapace si magnifique qu’on lui connaît et qui émeut notre regard : le vert jade du scarabée de Chine, le rouge pourpre du scarabée d’Afrique, le noir de jais du scarabée d’Europe et le trésor du scarabée d’or, mythique entre tous, introuvable, mystère des mystères. Un artiste est un scarabée qui trouve, dans les excréments mêmes de la société, les aliments nécessaires pour produire les œuvres qui fascinent et bouleversent ses semblables. L’artiste, tel un scarabée, se nourrit de la merde du monde pour lequel il œuvre, et de cette nourriture abjecte il parvient, parfois, à faire jaillir la beauté. » Wajdi Mouawad 2 TEXTE SOPHOCLE MISE EN SCENE WAJDI MOUAWAD Du 9 au 19 novembre 2011 DES FEMMES LES TRACHINIENNES / ANTIGONE / ÉLECTRE Avec Pierre Ascaride Bertrand Cantat en alternance avec un autre musicien Olivier Constant -

INFLAMMATION DU VERBE VIVRE LES LARMES D'oedipe
www. wajdimouawad.fr DETEXSTE &M MISEO EN SUcèNER wAjDI NMOUTAwSAD n i o d o J e i h p o S © INFLAMMATION DU VERBE VIVRE LIBREMENT INSPIRÉ DE PHILOCTÈTE DE SOPHOCLE LES LARMES D’ OEDIpE LIBREMENT INSPIRÉ D’ OEDIPE À COLONE DE SOPHOCLE contact Au Carré de l’Hypoténuse Arnaud Antolinos 00 33 6 20 71 81 70 - [email protected] contact EPOC productions Emmanuelle Ossena 00 33 6 03 47 45 51 - [email protected] Des Mourants Mentions équipe, remerciements, production page 1 Présentation chemin, contexte, genèse page 2 intention, compendium page 3 Biographies interprètes page 4 wajdi Mouawad Biographie parcours, spectacles, récompenses page 5 Oeuvres publications, autres travaux page 6 dossier au 29.02.16 Mentions textes wajdi Mouawad publiés aux éditions Leméac-Actes Sud-Papiers librement inspirés de Philoctète et Œdipe à Colone de Sophocle mise en scène wajdi Mouawad assistance à la mise en scène Alain Roy dramaturgie charlotte Farcet scénographie Emmanuel clolus musiques originales Michael jon Fink réalisation sonore Michel Maurer lumières Sébastien pirmet costumes Emmanuelle Thomas son jérémie Morizeau plateau Marion Denier et Magid El Hassouni illustrations Sophie jodoin direction de production et tournée Maryse Beauchesne direction technique pierre-Yves chouin direction générale Arnaud Antolinos secretariat général Marie Bey relations presse Dorothée Duplan - agence planBey diffusion Emmanuelle Ossena - EpOc productions Inflammation interprétation Dimitris Kranias le chauffeur de taxi, wajdi Mouawad Wahid du verbe vivre -

Scorched by Wajdi Mouawad Translated by Linda Gaboriau
Scorched by Wajdi Mouawad translated by Linda Gaboriau an NAC English Theatre / Tarragon Theatre (Toronto) English-language world premiere coproduction Study Guide THE NATIONAL ARTS CENTRE ENGLISH THEATRE PROGRAMMES FOR STUDENT AUDIENCES 2006-2007 SEASON Peter Hinton Artistic Director, English Theatre This Study Guide was written and researched by Jim McNabb for the National Arts Centre, English Theatre, February, 2007. It may be used solely for educational purposes. The National Arts Centre English Theatre values the feedback of teachers on the content and format of its Study Guides. We would appreciate your comments on past Study Guides, on this current one, or suggestions on ways to improve future Study Guides. Comments may be directed to Martina Kuska either by email at [email protected] or by fax at (613) 943-1401. Theatre5 Media Partner part of the NAC’s About This Guide This study guide is formatted in easy-to-copy single pages. They may be used separately or in any combination that works for your classes. The two colour pages found at the end of the Guide are intended for display in the classroom but may also be copied for distribution. Table of Contents page(s) About the Play ....................................................................................................1 œ 2 Setting; Plot Synopsis; Characters....................................................................1 Characters (continued); Style; Themes................................................................2 Some Things to Watch For in the production -

Incendies WAJDI MOUAWAD - STANISLAS NORDEY
30 AVRIL > 27 MAI 2012 CRÉATION Incendies WAJDI MOUAWAD - STANISLAS NORDEY L’ENFANCE EST UN COUTEAU PLANTÉ DANS LA GORGE. mise en scène Stanislas Nordey collaboratrice artistique Claire-Ingrid Cottanceau scénographie Emmanuel Clolus lumière Stéphanie Daniel création son Antoine Guilloux costumes Myriam Rault assistant Mohand Azzoug accompagnement vocal Martine-Joséphine Thomas peinture Yann Chollet avec Claire-Ingrid Cottanceau - Raoul Fernandez - Damien Gabriac Charline Grand - Frédéric Leidgens - Julie Moreau - Véronique Nordey Victor de Oliveira - Lamya Regragui - Serge Tranvouez Relations avec les publics Amandine Leroux - Marie Picgirard - Anaïs Riquelme 01 43 90 49 45 - [email protected] 01 43 90 11 11 THÉÂTRE D’IVRY ANTOINE VITEZ M° Mairie d’Ivry www.theatre-quartiers-ivry.com “ Simon, je t’appelle pour te dire que je pars vers le pays. Je vais essayer de retrouver ce père, et si je le trouve, s’il est encore en vie, je vais lui remettre l’enveloppe. Ce n’est pas pour elle, c’est pour moi. C’est pour toi. Pour la suite. Mais pour ça, c’est d’abord elle, c’est Maman qu’il faut retrouver, dans sa vie d’avant, dans celle que toutes ces années elle nous a cachée. Elle nous a rendus aveugles. Aujourd’hui j’ai peur de devenir folle. © Brigitte Enguérand © Brigitte Je vais raccrocher, Simon. Je vais raccrocher et tomber tête première, tomber très loin de cette “ Il n’y a plus de temps. Le temps est une poule géométrie précise qui structurait ma vie. a qui on a tranché la tête, le temps court comme J’ai appris à écrire et à compter, à lire et à parler. -

What Is Québécois Literature? Reflections on the Literary History of Francophone Writing in Canada
What is Québécois Literature? Reflections on the Literary History of Francophone Writing in Canada Contemporary French and Francophone Cultures, 28 Chapman, What is Québécois Literature.indd 1 30/07/2013 09:16:58 Contemporary French and Francophone Cultures Series Editors EDMUND SMYTH CHARLES FORSDICK Manchester Metropolitan University University of Liverpool Editorial Board JACQUELINE DUTTON LYNN A. HIGGINS MIREILLE ROSELLO University of Melbourne Dartmouth College University of Amsterdam MICHAEL SHERINGHAM DAVID WALKER University of Oxford University of Sheffield This series aims to provide a forum for new research on modern and contem- porary French and francophone cultures and writing. The books published in Contemporary French and Francophone Cultures reflect a wide variety of critical practices and theoretical approaches, in harmony with the intellectual, cultural and social developments which have taken place over the past few decades. All manifestations of contemporary French and francophone culture and expression are considered, including literature, cinema, popular culture, theory. The volumes in the series will participate in the wider debate on key aspects of contemporary culture. Recent titles in the series: 12 Lawrence R. Schehr, French 20 Pim Higginson, The Noir Atlantic: Post-Modern Masculinities: From Chester Himes and the Birth of the Neuromatrices to Seropositivity Francophone African Crime Novel 13 Mireille Rosello, The Reparative in 21 Verena Andermatt Conley, Spatial Narratives: Works of Mourning in Ecologies: Urban -

Wajdi Mouawad
programme eng 09 15/05/09 10:03 Page 1 63rd Festival d’Avignon 7-29 July 2009 Complement in English to the programme This document does not replace the full programme but complements it by offering an English translation of all the texts presenting the artists and shows of the festival. The page numbers refer to the programme in French where further details and full credits are also available. The Festival d’Avignon has long been an interna- Finally, a special programme has been prepared tional platform for the performing arts, gathering this summer: artists and audiences from all around the world. This year, the programme welcomes artists and • Some shows will benefit from English surtitles performances from many countries and many lan- or simultaneous translation into English. This guages will be heard on the festival stages: service will only be available for a limited number French from three different continents as well as of performances: English, Spanish, Italian, Arabic, Polish, German Le Livre d’or de Jan, Saturday 11th July at 10 p.m. and Hebrew. It is important to allow the artists to Les Inepties volantes, Friday 12 July at 10 p.m. express themselves in their own languages, but it Des témoins ordinaires,Wednesday 21 July at is also important tofacilitate access to their work 2.30 p.m. & Sunday 26 July at6p.m. for as wide an audience as possible. For many Les Cauchemars du gecko, Friday 24 July at 6 p.m. years we have provided French surtitles for the La Menzogna, Saturday 25 July at 10 p.m. -

Dossier Pédagogique Des Femmes
DOSSIER PEDAGOGIQUE Des Femmes Les Trachiniennes / Antigone / Electre de Sophocle mise en scène WajdiMouawad du mercredi 12 au samedi 15 octobre 2011 Dossier pédagogique réalisé par Rénilde Gérardin, professeur du service éducatif : [email protected] , Contacts relations publiques : Margot Linard : [email protected] Jérôme Pique : [email protected] texte Sophocle traduction en français Robert Davreu mise en scène WajdiMouawad assistance à la mise en scène Alain Roy conseil artistique François Ismert scénographie Emmanuel Clolus costumes Isabelle Larivière assistée de Raoul Fernandez lumières Eric Champoux assisté de Eric Le Brec'h musique originale Bertrand Cantat, Bernard Falaise, Pascal Humbert, Alexander MacSween réalisation sonore Michel Maurer assisté de Olivier Renet maquillages et coiffures Angelo Barsetti illustrations Sophie Jodoin interprétation Camille Adam en alternance avec Bertrand Cantat Olivier Constant Samuël Côté Sylvie Drapeau Bernard Falaise en alternance avec Martien Bélanger (à l’automne 11 – hiver 12) Charlotte Farcet Raoul Fernandez ou Richard Thériault (au printemps 12) Pascal Humbert en alternance avec Benoît Lugué Patrick Le Mauff Sara Llorca Alexander MacSween (à Nantes, Génève) en alternance avec Guillaume Perron (tournée 11 – 12) Véronique Nordey en alternance avec un autre comédien (au printemps 12) Marie-Eve Perron direction de production Maryse Beauchesne direction technique et régie lumières Eric Le Brec'h régie son Olivier Renet régie plateau Eric Morel habilleuse Emmanuelle