ZAP Cotes De Millau Rapport Perimetre Arreté
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
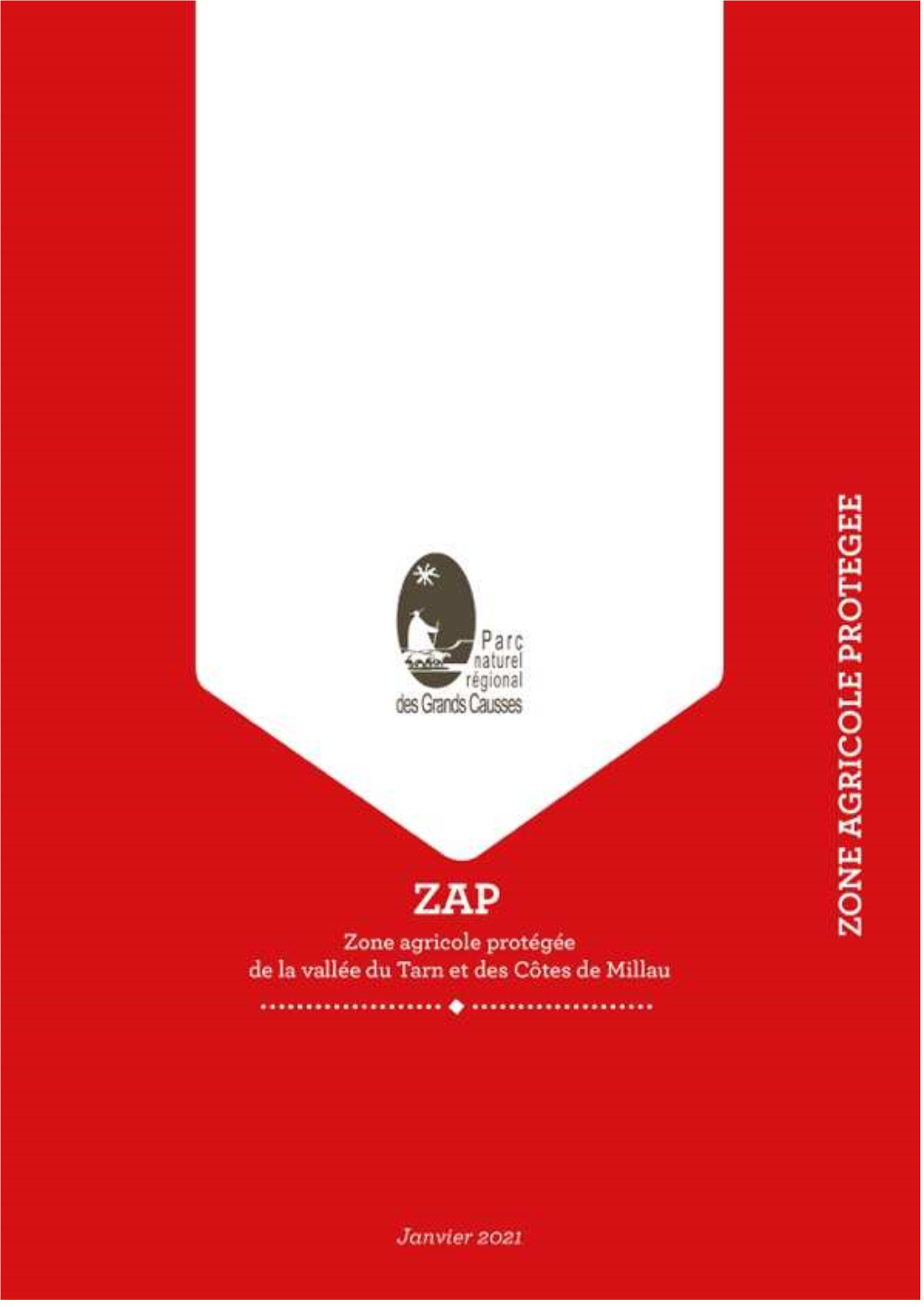
Load more
Recommended publications
-

215-Meyrueis-Millau-Des-Le-01092020.Pdf
MILLAU > PEYRELEAU > MEYRUEIS ANNÉE 2020 - 2021 Du 1/09/2020 au 31/08/2021 JOURS SEMAINE L à V Me L à V Me V L à V Samedi Dimanche et Fêtes (sauf 1er mai) PÉRIODES SCOLAIRES • • Aveyron PETITES VACANCES • • ÉTÉ • • • • • • • • Horaires Transporteur Causse Causse Causse Causse Causse Causse Causse Causse Causse Causse Causse Mur-de-Barrez MILLAU Gare routière 09:40 12:15 14:00 17:25 18:15 18:30 18:35 09:40 14:00 17:25 18:35 215 AGUESSAC 09:50 12:20 14:10 17:35 18:20 18:40 18:45 09:50 14:10 17:35 18:45 AUTOCAR MAS DE COMPEYRE 09:53 12:23 14:13 17:38 18:23 18:43 18:55 09:53 14:13 17:38 18:55 Laguiole PAILHAS 09:55 12:25 14:15 17:40 18:25 18:45 19:00 09:55 14:15 17:40 19:00 RIVIERE SUR TARN 10:00 12:30 14:20 17:45 18:30 18:50 19:05 10:00 14:20 17:45 19:05 Conques Capdenac Viviez-Decazeville BOYNE 10:05 12:33 14:25 17:50 18:33 18:53 19:10 10:05 14:25 17:50 19:10 Espalion MOSTUEJOULS Mostuejouls 10:10 12:35 14:30 17:55 18:35 18:55 19:15 10:10 14:30 17:55 19:15 St-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac PEYRELEAU Peyreleau / le Rozier 10:15 12:40 14:35 18:00 18:40 19:00 19:20 10:15 14:35 18:00 19:20 Lanuéjouls St-Christophe-Marcillac LES VIGNES 14:50 14:50 Laissac MEYRUEIS 13:10 19:10 19:30 19:35 19:35 Villefranche de-Rouergue Rodez Séverac-d’Aveyron Luc-Primaube Pont-de-Salars Rieupeyroux Ligne 215 Le Truel Les Douzes Najac Baraqueville Rivière-sur-Tarn Boyne Rentrée scolaire : Point d'arrêt accessible Compeyre Naucelle Aguessac Les jours de rentrée scolaires sont définis La Caze Meyrueis par le calendrier académique. -

Plateforme D'accompagnement Et De
PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉPIT DES AIDANTS DE LA RÉSIDENCE MUTUALISTE LES CHEVEUX D’ANGE PLATEFORME 26 rue Lucien Costes - 12100 Millau D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉPIT DES AIDANTS RÉSIDENCE MUTUALISTE LES CHEVEUX D’ANGE NOUS CONTACTER AU : 26 rue Lucien Costes - 12100 Millau 05 65 58 44 20 Du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 14h à 18h [email protected] www.umm.fr — NOS PARTENAIRES — La plateforme d’accompagnement aux aidants s’appuie sur un réseau de partenaires du milieu médical, médico-social, social et associatif, dont l’expérience est reconnue dans la prise en soin et l’accompagnement des personnes présentant des troubles cognitifs neuro évolutifs et de leurs proches. Conception Monochrome - Ne pas jeter sur la voie publique sur la voie Monochrome - Ne pas jeter Conception LA PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉPIT DES AIDANTS vous accompagne vers des possibilités de soutien, ne restez pas seul ! POUR QUI ? NOTRE SOUTIEN PASSE PAR Le service est destiné aux Aidants dont le proche vit à domicile : Un accompagnement vers du temps libre (« répit ») Votre proche présente des troubles cognitifs (maladies neuro afin de souffler et sortir du quotidien, lutter contre l’isolement évolutives de type Maladie d’Alzheimer et apparentées, Maladie et l’épuisement. de Parkinson, Scérose en plaque), > à domicile, en relation avec les services d’aide à domicile, Vous habitez sur le territoire d’intervention, nous venons vous proposer de renforcer la présence d’Auxillaire de Vie Sociale (AVS) pour que vous puissiez avoir du temps pour vous. Votre proche fréquente ou ne fréquente pas l’accueil de jour Les Cheveux d’Ange. -

Feuille1 Page 1 Agen-D'aveyron 8 €/M² Aguessac 8 €/M² Les Albres 8
Feuille1 Agen-d'Aveyron 8 €/m² Aguessac 8 €/m² Les Albres 8 €/m² Almont-les-Junies 8 €/m² Alpuech 8 €/m² Alrance 8 €/m² Ambeyrac 8 €/m² Anglars-Saint-Félix 8 €/m² Arnac-sur-Dourdou 8 €/m² Arques 8 €/m² Arvieu 8 €/m² Asprières 8 €/m² Aubin 8 €/m² Aurelle-Verlac 8 €/m² Auriac-Lagast 8 €/m² Auzits 8 €/m² Ayssènes 8 €/m² Balaguier-d'Olt 8 €/m² Balaguier-sur-Rance 8 €/m² Balsac 8 €/m² La Bastide-l'Évêque 8 €/m² La Bastide-Pradines 8 €/m² La Bastide-Solages 8 €/m² Belcastel 8 €/m² Belmont-sur-Rance 8 €/m² Bertholène 8 €/m² Bessuéjouls 8 €/m² Boisse-Penchot 8 €/m² Bor-et-Bar 8 €/m² Bouillac 8 €/m² Bournazel 8 €/m² Boussac 8 €/m² Bozouls 8 €/m² Brandonnet 8 €/m² Brasc 8 €/m² Brommat 8 €/m² Broquiès 8 €/m² Brousse-le-Château 8 €/m² Brusque 8 €/m² Buzeins 8 €/m² Cabanès 8 €/m² Calmels-et-le-Viala 8 €/m² Calmont 8 €/m² Camarès 8 €/m² Camboulazet 8 €/m² Camjac 8 €/m² Page 1 Feuille1 Campagnac 8 €/m² Campouriez 8 €/m² Campuac 8 €/m² Canet-de-Salars 8 €/m² Cantoin 8 €/m² Capdenac-Gare 8 €/m² La Capelle-Balaguier 8 €/m² La Capelle-Bleys 8 €/m² La Capelle-Bonance 8 €/m² Baraqueville 8 €/m² Cassagnes-Bégonhès 8 €/m² Cassuéjouls 8 €/m² Castanet 8 €/m² Castelmary 8 €/m² Castelnau-de-Mandailles 8 €/m² Castelnau-Pégayrols 8 €/m² La Cavalerie 8 €/m² Le Cayrol 8 €/m² Centrès 8 €/m² Clairvaux-d'Aveyron 8 €/m² Le Clapier 8 €/m² Colombiès 8 €/m² Combret 8 €/m² Compeyre 8 €/m² Compolibat 8 €/m² Comprégnac 8 €/m² Comps-la-Grand-Ville 8 €/m² Condom-d'Aubrac 8 €/m² Connac 8 €/m² Conques 8 €/m² Cornus 8 €/m² Les Costes-Gozon 8 €/m² Coubisou 8 €/m² Coupiac 8 €/m² Coussergues -

Liste Des Associations 2018
LISTE DES ASSOCIATIONS 2018 [email protected] JOGA CANTA TOGA CAPOEIRA SOM BASKET MILLAU 8 Rue des Commandeurs 12100 MILLAU Les coopérateurs Rue Pierre Bergié > 06 76 65 95 58 12100 MILLAU SPORT > [email protected] > 06 82 36 73 53 ALPINA > Président : MICHEL Jocelyn > [email protected] 1, rue Antoine Guy 12100 MILLAU > Président : BALITRAND Pierre > 06 15 73 45 10 KARATE CLUB SHOTOKAN MILLAU > [email protected] 10, rue Louis Blanc 12100 MILLAU SOM JUDO KARATÉ > Présidente : HUGUENOT Marie-Chantal > 09 52 88 43 79 Rue du Rec 12100 MILLAU > [email protected] > 05 65 61 22 66 ASS. SPORTIVE TAEKWONDO > Président : MENDRE Cyril > [email protected] SONMUDO MILLAU > Présidente : NAZON Laurie 127 Chemin de Gandalous 12100 MILLAU LO BARTAS > 06 81 19 53 54 4, rue Guilhem Estève 12100 MILLAU SOM L’HIRONDELLE MILLAVOISE > [email protected] > 06 78 50 76 34 Gymnase Jean Moulin BP40116 > Président : LANGLOIS Christophe > [email protected] 12100 MILLAU > Président : ASTIER Henri > 05 65 59 94 23 CLUB CYCLOTOURISTE MILLAVOIS > [email protected] 31, rue du Barry 12100 MILLAU MADE IN SALSA > Président : PANIS Olivier > 05 65 61 34 60 Mairie de Rivière du Tarn Place du Palié > [email protected] 12640 RIVIERE SUR TARN SOM MILLAU RUGBY AVEYRON > 06 73 81 01 99 12, rue du Rajol 12100 MILLAU CLUB SUBAQUATIQUE > [email protected] > 05 65 60 26 48 DU SUD AVEYRON > Président : SABATHIER Philippe > [email protected] 10 Rue de la Prise d’Eau 12100 MILLAU > Président : PEREZ Thierry > -

Plaquette-Nvx-Arrivants.Pdf
v ’ Secrétariat de Mairie Ouverture au public : Le lundi au vendredi de 8h30 à 12h. La permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi midi. Permanence des élus sur rendez-vous pris au secrétariat Tél : 05 65 58 41 00 - Fax : 05 65 58 41 01 E-mail : [email protected] Sommaire A votre arrivée dans la commune ........................................................................... P. 3 L’équipe municipale et ses commissions. .................................................................................................... P.4 Services & équipements ................................................................................................................................. P.5 -à 7 Scolarité ................................................................................................................ P.8 Petite enfance .......................................................................................................................................................... P.9 Les associations de notre village ................................................................................................................ P. 10 Les professionnels et artisans ....................................................................................................................... P. 11 Les festivités ......................................................................................................................................................... P. 12 Numéros utiles ................................................................................................................................................. -

ANNEXE E Secteurs De Recrutement Des Lycées
ANNEXE E SECTEURS DE RECRUTEMENT DES LYCÉES Zone Lycées publics de secteur géographique 012RDZ Foch RODEZ, Monteil RODEZ 01215RA Foch RODEZ, Monteil RODEZ, Mermoz AURILLAC 01246DVF La Découverte DECAZEVILLE, Savignac- Beauregard VILLEFRANCHE, Champollion FIGEAC 01281MST Jaurès SAINT AFFRIQUE, Vigo MILLAU, Bellevue ALBI 012DCZ15 (élèves du Cantal vers La Découverte) 012DECA La Découverte DECAZEVILLE, Savignac- Beauregard VILLEFRANCHE 012DVR Foch RODEZ, Monteil RODEZ, La Découverte DECAZEVILLE Savignac- Beauregard VILLEFRANCHE 012MILL Jaurès SAINT AFFRIQUE, Vigo MILLAU 012MSTAR Foch RODEZ, Monteil RODEZ, Jaurès SAINT AFFRIQUE, Vigo MILLAU (1) Secteurs hors Aveyron relevant d’un accord de sectorisation pris par le DASEN du département concerné (2) Communes hors Aveyron sectorisées en Aveyron 1 Zone Commune de résidence géographique AGEN D’AVEYRON 012RDZ AGUESSAC 012MILL ALBRES (LES) 012DECA ALMONT LES JUNIES 012DECA ARGENCES EN AUBRAC 01215RA (1) ALRANCE 012RDZ AMBEYRAC 012DECA ANGLARS SAINT FELIX 012DECA ARNAC S/DOURDOU 012MILL ARQUES 012RDZ ARVIEU 012RDZ ASPRIERES 012DECA AUBIN 012DECA AURIAC-LAGAST 012RDZ AUZITS 012DECA AYSSENES 012MILL BALAGUIER D’OLT 012DECA BALAGUIER S/RANCE 012MILL BARAQUEVILLE 012RDZ BAS SEGALA (LE) 012DECA BASTIDE PRADINES 012MILL BASTIDE SOLAGES (LA) 012MSTAR BELCASTEL 012DVR BELMONT S/RANCE 012MILL BERTHOLENE 012RDZ BESSUEJOULS 012RDZ BOISSE-PENCHOT 012DECA BOR ET BAR 012DECA BOUILLAC 012DECA BOURNAZEL 012DECA BOUSSAC 012RDZ BOZOULS 012RDZ BRANDONNET 012DECA BRASC 012MSTAR BROMMAT 01215RA (1) BROQUIES 012MILL -
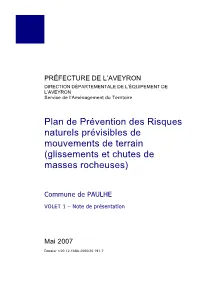
Paulhe Note De Presentation
PRÉFECTURE DE L’AVEYRON DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT DE L’AVEYRON Service de l’Aménagement du Territoire Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de mouvements de terrain (glissements et chutes de masses rocheuses) Commune de PAULHE VOLET 1 – Note de présentation Mai 2007 Dossier n°20.12-168A.2000/20.191-7 2 / 46 3 / 46 Sommaire 1. CONTEXTE ................................................... ................................................... ................................................... ................... 5 2. DOSSIER RÉGLEMENTAIRE ................................................... ................................................... ...................................... 6 3. MÉTHODOLOGIE ................................................... ................................................... ................................................... ....... 7 3.1 A VANT PROPOS ................................................... ................................................... ................................................... .............. 7 3.2 C ONDITIONS D’INTERVENTION ................................................... ................................................... .............................................. 7 4. ANALYSE DES DONNÉES GÉOLOGIQUES ET GÉOTECHNIQUES ................................................... ..................... 9 4.1 C ONTEXTE MORPHOLOGIQUE . GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE ................................................... ................................................ 9 -

Cheeses Part 2
Ref. Ares(2013)3642812 - 05/12/2013 VI/1551/95T Rev. 1 (PMON\EN\0054,wpd\l) Regulation (EEC) No 2081/92 APPLICATION FOR REGISTRATION: Art. 5 ( ) Art. 17 (X) PDO(X) PGI ( ) National application No 1. Responsible department in the Member State: I.N.D.O. - FOOD POLICY DIRECTORATE - FOOD SECRETARIAT OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD Address/ Dulcinea, 4, 28020 Madrid, Spain Tel. 347.19.67 Fax. 534.76.98 2. Applicant group: (a) Name: Consejo Regulador de la D.O. "IDIAZÁBAL" [Designation of Origin Regulating Body] (b) Address: Granja Modelo Arkaute - Apartado 46 - 01192 Arkaute (Álava), Spain (c) Composition: producer/processor ( X ) other ( ) 3. Name of product: "Queso Idiazábaľ [Idiazábal Cheese] 4. Type of product: (see list) Cheese - Class 1.3 5. Specification: (summary of Article 4) (a) Name: (see 3) "Idiazábal" Designation of Origin (b) Description: Full-fat, matured cheese, cured to half-cured; cylindrical with noticeably flat faces; hard rind and compact paste; weight 1-3 kg. (c) Geographical area: The production and processing areas consist of the Autonomous Community of the Basque Country and part of the Autonomous Community of Navarre. (d) Evidence: Milk with the characteristics described in Articles 5 and 6 from farms registered with the Regulating Body and situated in the production area; the raw material,processing and production are carried out in registered factories under Regulating Body control; the product goes on the market certified and guaranteed by the Regulating Body. (e) Method of production: Milk from "Lacha" and "Carranzana" ewes. Coagulation with rennet at a temperature of 28-32 °C; brine or dry salting; matured for at least 60 days. -

Société Archéologique Du Mid I De La France Journées D'étude La Maison
Journées d’étude La maison médiévale en Aveyron Toulouse, 11‐12 juillet 2013 France la de i Mid du Archéologique Société Avec le concours de l’UMR 5608 T.R.A.C.E.S Les intervenants Élodie CASSAN, chargée d’inventaire au service du patrimoine historique du Conseil général du Lot. Virginie CZERNIAK, maître de conférences en Histoire de l’art à l’Université de Toulouse-Le Mirail, membre de l’U.M.R. FRA.M.ESPA Christophe ÉVRARD, animateur de l’architecture et du patrimoine du Pays d’art et histoire des bastides du Rouergue Guilhem FERRAND, docteur en Histoire, membre de l’U.M.R. 5136 FRA.M.ESPA Françoise GALÉS, docteur en Histoire de l’art, chargée d’inventaire de la Ville de Millau Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP, docteur en Histoire de l’art et archéologie, membre de l’U.M.R. 5608 T.R.A.C.E.S Diane JOY, chef de projet de la mission d’inventaire à la Communauté d’agglomération du Grand Rodez Bastien LEFEBVRE, maître de conférences d’Histoire de l’art à l’Université de Toulouse-Le Mirail, membre de l’U.M.R. 5608 T.R.A.C.E.S Yoan MATTALIA, docteur en Histoire de l’art, Université de Toulouse-Le Mirail, membre de l’U.M.R. 5608 T.R.A.C.E.S Frédéric MAZERAN, architecte du patrimoine, Conseil général de l’Hérault Anne-Laure NAPOLÉONE, docteur en Histoire de l’art, membre de l’U.M.R. 5136 FRA.M.ESPA Gérard REVEL, propriétaire et restaurateur du château de Montarnal (Aveyron) Maurice SCELLÈS, conservateur du patrimoine, service Connaissance du patrimoine, Région Midi-Pyrénées Gilles SÉRAPHIN, architecte du patrimoine, professeur à l’École de Chaillot 1 Journées d’étude. -

Résultats De La Première Phase Du Mouvement Classés Par Nom Des
Résultats de la première phase du mouvement classés par nom des communes Commune CIVIL NOM PRENOM Poste Agen d'Aveyron M LAUBUGE DOMINIQUE E.P.PU LA PRADELIE Agen d'Aveyron Aguessac M ALRIC NICOLAS E.P.PU JACQUES PREVERT Aguessac Alrance ME BONNAFE ROSE E.P.PU Alrance Alrance ME FABRE MAGALI Direction E.P.PU Alrance Ambeyrac ME JAYR CLAIRE E.P.PU Ambeyrac Anglars St Félix ME BOUDET CHRISTELLE REMP.ST.FC E.P.PU Anglars St Félix Anglars St Félix ME SEGONDS LAETITIA E.P.PU Anglars St Félix Aubin ME NAVARRO SONIA E.P.PU JEAN BOUDOU Aubin Aubin ME GUITARD MARINA Direction E.P.PU MARCEL PAGNOL Aubin Balsac ME PEREZ FLORENCE E.P.PU Balsac Baraqueville ME MARTY SANDRINE E.E.PU GEORGES BRASSENS Baraqueville Baraqueville ME RIVIERE DELPHINE Direction E.E.PU GEORGES BRASSENS Baraqueville Baraqueville ME BICHWILLER CHRISTELLE TIT.R.BRIG E.M.PU GEORGES BRASSENS Baraqueville Baraqueville ME BOUDES COSTES LAURENCE U.P.I CLG ALBERT CAMUS Baraqueville Bozouls ME FALGUIER ARLETTE TIT.R.BRIG E.P.PU ARSENE RATIER Bozouls Bozouls M MAGNE FRANCIS Direction E.P.PU ARSENE RATIER Bozouls Brommat ME BELARD FABIENNE Direction E.P.PU Brommat Broquies M BRU MYLENE Direction E.P.PU Broquiès Calmont M LAFARGE MARC Direction E.E.PU CEIGNAC Calmont Camjac ME GAUBERT-CERLES CELINE E.P.PU Camjac Campagnac ME MARTIN PATRICIA E.P.PU Campagnac Cantoin M BOUTEMY PHILIPPE Direction E.P.PU Cantoin Capdenac ME RASPAIL ORPHEE Direction E.M.PU CHANTEFABLE Capdenac Gare Comps la grand ville ME MAILLE CROS SEVERINE E.P.PU ESCOLA DE LOS MARRONIERS Comps-la-grand-ville Coupiac ME MOREAU DIANE Direction E.P.PU Coupiac Coupiac ME SCHNEIDER ANNE HELENE E.P.PU Coupiac Cransac M DELTEIL CLEMENT TIT.R.BRIG E.E.PU EMILE ZOLA Cransac Cransac ME SAKHAROV MARIE -NOELLE I.M.E. -

L'aveyron N°152
152 sur les chapeaux de roue ! AOÛT 2010 N° Point de vue SOMMAIRE ACTUALITÉS 3 Haut débit : une nouvelle étape Agir pour L’AVEYRON 4-5 Rentrée Scolaire 6 L’agriculture au cœur de la visite du Président DOSSIER 7 Nant et Cornus : l’atout tourisme TERRITOIRES 8 Campagnac, Saint-Geniez, Sévérac : la politique du terrain 9 Marcillac-Conques : les atouts du développement rural DOSSIER TERRITOIRES 10 Ouest Aveyron : animer le territoire 11 Le projet de contournement sud de Villefranche Escalade, gymnastique, cyclisme, basket- DOSSIER 12 Sud Aveyron : fixer la population TERRITOIRES ball, automobile, rugby, pétanque… Depuis quelques semaines et ce mois d’août PARTENARIAT encore, l’Aveyron accueille de très nombreuses 13 Rallye du Rouergue : l’Aveyron mobilisé ! manifestations sportives de haut niveau, avec MAgAZINE une participation internationale remarquée. 14 Najac, dans le méandre de l’Histoire Ce n’est pas un hasard. 15 Rafettes : l’esprit famille Nos territoires offrent un cadre naturel assez exceptionnel à de nombreuses disciplines 16-17 CANTONS de plein air. Les collectivités locales ont 18 gROUPES POLITIQUES su créer des équipements performants. 19 AgENDA Mais rien ne serait pourtant possible sans la mobilisation des clubs et associations qui Notre Histoire constituent la base de l’animation sportive. 20 Emma Calvé, éternelle Carmen Ils ne comptent ni leur temps et ni leur peine et ceci à longueur d’année dans toutes les communes. Dans la réflexion que je conduis sur la SUR LE VIF... ruralité, j’ai souhaité, dès cet automne, rencontrer les acteurs du territoire. Ils ont des propositions à formuler. Leur savoir- faire et leur expérience de terrain, à l’image des bénévoles du secteur associatif, me semblent précieux pour nourrir les actions politiques que je compte mettre en œuvre. -

Gorgesdes Raspes Et Vallée
Le guide touristique 2016 Gorges des Raspes et Vallée Découvrir Bouger de la Muse Visiter Déguster Dormir www.tourisme-muse-raspes.com N NE NW 12 1 E 0 30 2 11 N 60 330 20 3 W SE 000 10 90 40 E 300 340 60 320 120 W SW 4 80 270 NE 9 300 150 S NW 100 240 S 5 180 8 210 280 120 6 SE 7 N 260 SW 140 D911 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 240 160 A 220 180 D809 200 Canet-de-Salars E D911 B N St-Léons St-Laurent Micropolis Verrières -de-Lévézou D993 Curan C Salles-CuranW St-Beauzély N E Estalane D809 Aguessac D D902 Bouloc D30 Azinières D993 Le Sahut Rouviaguet D911 Alrance Ronsignac Castelnau- E W D25 Pégayrols La Selve 7A E S 5 Millau Montjaux Aire de Brocuéjouls Ladepeyre Viaduc de Millau Prunhac Coudols Roquetaillade D96 Peyre D809 Villefranche Vabrette F -de-Panat Le Tondut Viala- Creissels du-Tarn Candas O Ayssènes Le Minier Aire des Cazalous D200 Ambias D44 Viaduc de Millau D902 S La Nauc Lestrade NDD Taysses St-Georges- G Bosc de-Luzençon St-Rome-de-Tarn Melvieu St-Victor Réquista Le Truelrn D992 a Thouels T D25 D200 D993 Les A75 Les Costes La méri Axous die nne S H D902 - Gozon Domaine St-Rome- Connac de Nayac Cansac de-Cernon D999 Pinsac D250 Lincou Brousse- Broquiès Roquefort- le-Château D200 Ste-Eulalie I D25 Sur-Souzon Brasc Malben de Cernon St-Izaire D23 D25 D993 Tournemire D33 Coupiac Montclar St-Affrique J D999 Vabres-lʼAbbaye Le Figayrol D902 St-Jean dʼAlcas K Plaisance St-Juéry Le Viala D33 Cornus Lapeyre St-Beaulize L St-Sernin Rebourguil Versols -sur Rance St-Félix de Sorgues D999 St-Pierre Fondamente Montlaur Latour M D54 Pousthomy Monfranc Verrières St-Julien Sylvanès N Camarès Belmont- Ceilhes- sur-Rance et-Rocozels Laval- Cénomes Roquecezière Fayet La Graverie Sommaire 4 5 Guide Encarts légendés Découvrir ......................................................