9782849509043.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
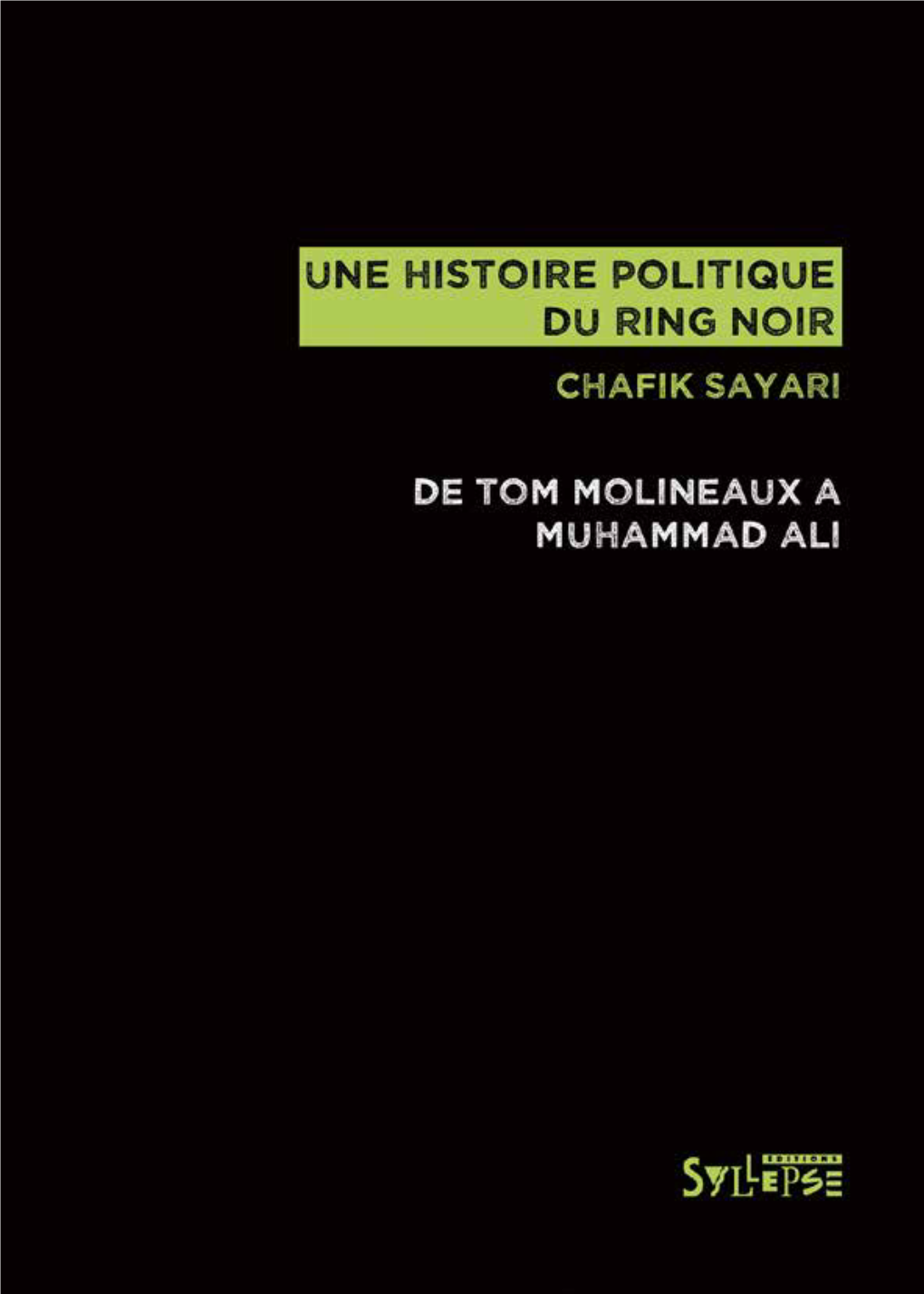
Load more
Recommended publications
-

On Modernity, Identity and White-Collar Boxing. Phd
From Rookie to Rocky? On Modernity, Identity and White-Collar Boxing Edward John Wright, BA (Hons), MSc, MA Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy. September, 2017 Abstract This thesis is the first sociological examination of white-collar boxing in the UK; a form of the sport particular to late modernity. Given this, the first research question asked is: what is white-collar boxing in this context? Further research questions pertain to social divisions and identity. White- collar boxing originally takes its name from the high social class of its practitioners in the USA, something which is not found in this study. White- collar boxing in and through this research is identified as a practice with a highly misleading title, given that those involved are not primarily from white-collar backgrounds. Rather than signifying the social class of practitioner, white-collar boxing is understood to pertain to a form of the sport in which complete beginners participate in an eight-week boxing course, in order to compete in a publicly-held, full-contact boxing match in a glamorous location in front of a large crowd. It is, thus, a condensed reproduction of the long-term career of the professional boxer, commodified for consumption by others. These courses are understood by those involved to be free in monetary terms, and undertaken to raise money for charity. As is evidenced in this research, neither is straightforwardly the case, and white-collar boxing can, instead, be understood as a philanthrocapitalist arrangement. The study involves ethnographic observation and interviews at a boxing club in the Midlands, as well as public weigh-ins and fight nights, to explore the complex interrelationships amongst class, gender and ethnicity to reveal the negotiation of identity in late modernity. -

Friday, May 29, 2020 6:30 P.M
FRIDAY, MAY 29, 2020 6:30 P.M. | STEPHENS CO. EXPO CENTER | DUNCAN, OKLAHOMA 6:30 P.M. ON FRIDAY, MAY 29, 2020 STEPHENS CO. EXPO CENTER DUNCAN, OKLAHOMA Welcome to the 2020 Bred to Buck Sale, With all the changes going on in the world, one thing that remains the same is our focus of producing elite bucking bulls. For over 35 years, we have strived to produce the very best in the business. We know the competition gets better every year so we work to remain a leader in the industry. One thing we have proven is all the great bulls are backed by proven cow families. Our program takes great pride in our cows and we KNOW they are the key to our operation. We sell 200 plus females each year between the Fall Female Sale and this Bred to Buck Female Sale, so we have our cow herd fine-tuned to only the most proven cow families. It is extremely hard to select females for this sale knowing that many of our very best cows will be leaving the program. However, we do take pride in the success our customers have with the Page genetics. There are so many great success stories from our customers, and we can’t begin to tell them all. Johna Page Bland, Office 2020 is a year we will never forget, our country has experienced changes and regulations that we have never seen throughout history. We will get through this, but we will have to 580.504.4723 // Fax: 580.223.4145 make some adjustments along the way. -

Rocky Balboa - Wikipedia, the Free Encyclopedia Page 1 of 7
Rocky Balboa - Wikipedia, the free encyclopedia Page 1 of 7 Rocky BalboaYour continued donations keep Wikipedia running! From Wikipedia, the free encyclopedia (Redirected from Rocky balboa) Robert "Rocky" Balboa, Sr. (b. July 6, 1945) is a fictional Rocky Balboa athlete, portrayed by Sylvester Stallone who has appeared in the Rocky series from 1976 to 2006. He is famous for being extremely tenacious and 'fighting with his heart', as his trainer Mickey Goldmill famously intones. His style, endurance, determination, and pleasant personality greatly resemble the real life heavyweight champion, Rocky Marciano, even though the creation of the character was directly inspired by Chuck Wepner. He embodies the rugged tenacity often associated with the people of his native Philadelphia. Contents 1 Biography Rocky in the theatrical poster for Rocky III . 1.1 Humble beginnings: background Statistics 1.2 The breakthrough Real name Robert Balboa, Sr. 1.3 The Stallion vs. The King: the rematch 1.4 The best of times and the worst of times Nickname The Italian Stallion, 1.5 Hard times (s) Philadelphia's Favorite 1.6 Looking forward to the future Son, 2 Personal life The Philadelphia Slugger, The Iron Horse from 2.1 Family Philadelphia 3 Fight record 4 Character origin Rated at 202 lbs (92 kg) 5 Boxing style Nationality American 6 References Birth date July 6, 1945 (age 62) 7 External links Birth place Columbus Grove, Ohio Stance Southpaw Biography Boxing record Total fights 81 Humble beginnings: background Wins 57 Wins by 54 Robert Balboa was born on July 6, 1945 as the only child to a KO Roman Catholic-Italian American family. -

No Place Like Home Art Festival Gets New Name, Location by Andrew Tallackson Last Summer, Erika Hanner Attended Her fi Rst Lakefront Art Festival
THE TM 911 Franklin Street Weekly Newspaper Michigan City, IN 46360 Volume 32, Number 4 Thursday, February 4, 2016 No Place Like Home Art Festival Gets New Name, Location by Andrew Tallackson Last summer, Erika Hanner attended her fi rst Lakefront Art Festival. As the new ex- ecutive director at Lubeznik Center for the Arts, she wanted to take in the full effect — the sights and sounds — of the event, one of the center’s major fundraisers held for years in Washington Park. Her fi rst impressions were favorable. Au- gust’s snug temperatures, waves lapping against Lake Michigan’s shores — the set- ting, Hanner said, was “lovely.” The artists were happy, with attendance hovering be- tween 3,500 and 3,800. Volunteers manned stations throughout the festivities. It was, she said, a “well-oiled machine.” But Hanner also observed what she called a “literal disconnect” in terms of fairgoers Continued on Page 2 Amy Hilber talks to festivalgoers at the Felted Farmers Market. Photo by Bob Wellinski The grounds outside Lubeznik Center for the Arts, 101 W. Second St., will house the Lakefront Art and Artisan Festival. THE Page 2 February 4, 2016 THE 911 Franklin Street • Michigan City, IN 46360 219/879-0088 • FAX 219/879-8070 In Case Of Emergency, Dial e-mail: News/Articles - [email protected] email: Classifieds - [email protected] http://www.thebeacher.com/ PRINTED WITH Published and Printed by TM Trademark of American Soybean Association THE BEACHER BUSINESS PRINTERS Delivered weekly, free of charge to Birch Tree Farms, Duneland Beach, Grand Beach, Hidden 911 Shores, Long Beach, Michiana Shores, Michiana MI and Shoreland Hills. -

BIG 80S Study Guide
STUDY GUIDE FOR SQUEAKY CLEAN’S PROGRAM “BIG 80s” “BIG 80s” is a fast-paced overview of the decade when technology developed for business, universities and the military was turned into consumer products that found their way into nearly every American home. TECHNOLOGY: THE USE OF SCIENCE TO INVENT USEFUL THINGS The program combines live musical performances of 1980s music with brief “commercials,’ presenting various aspects of new technology that changed life in the 1980s. ABOUT THE SHOW BIG 80s features live performances of t hits from the era combined with a multimedia overview of the decade, with a special focus on the role of technology in changing everyday life. ● Pre Show/Introduction: a selection of early MTV videos; "Big Brother/Max Headroom" and 1984 sur- veillance ● Technology commercial: “1980s Technology: We’re Moving In…We’re Taking Over” ● Song: What I Like About You (BIG things from the 1980s) ● Technology commercial: the computer comes home, Bill Gates and Steve Jobs, early years of the World Wide Web and E-mail ● Song: Material Girl (greed/excess/conspicuous consumption) SQUEAKY CLEAN MUSIC CORP. P.O. BOX 3453, NEW HYDE PARK, NY 11040 (718) 347-2373 [email protected] ● Technology commercial: Computers and CGI change moviemaking ● Song: Ghostbusters (thrill and chills in 1980s movies) ● Technology commercial: computer chips in toys; video games, early game consoles ● Song: Girls Just Wanna Have Fun (popular 1980s toys, many of which utilize technology) ● Song: We Will Rock You (1980s metal bands) ● Technology commercial: -

2 Nina's Rev Editor's Revision Heroic Aging in The
COPAS—Current Objectives of Postgraduate American Studies 15.1 (2014) “You Ought to Stop Trying Because You Had Too Many Birthdays?”—The Making of an Aged Hero in Rocky Balboa Nina Schnieder ABSTRACT: This article deals with one of Hollywood’s most popular (sport) action heroes, Rocky Balboa, who, after thirty years of screen history, increasingly has to face the obstacles of age in the last installment of the franchise. Although cultural assumptions seem to contradict the combination of aging and sports hero, the article claims that the athletic protagonist Rocky Balboa is actually perceived as a true American action hero by the depiction of his progressed age as a motivation to once again “go the distance.” The article focuses on the aspects of work and the aging male body and it aims to show how the Rocky series has always dealt with the issue of male aging. KEYWORDS: age/aging; Rocky Balboa; boxing; work; male body Introduction When in 2006 Sylvester Stallone announced to release a sixth and presumably last Rocky movie—written and directed by himself—critics as well as countless studio bosses advised him not to do so, because at sixty they did not picture him as a “magnet for young moviegoers” (Weiner). Before the movie was released, audiences laughed at the trailers and critics ridiculed the project as a joke, as they seemed to watch, according to Philippa Gates, “a vanity play to make an aging star feel vital and relevant to a new generation,” and they named it a ridiculous attempt to live up to former successes. -

The Ticker, October 17, 1989
VoIeeforoYer'55 Years * 1932· * ..... 6t11de1ds'- . * 1919 * Vol. 52. No.9 Baruch College, CUNY October 17, 1989 • DSSG .Approves . Budget .g~ "Off-White" Paper Raises Questions Government Asks For -n ~ By EDWARD ASANTE $500 Increase .-e_. The black and Hispanic faculty has shows that "he is only forthe whites." o - filed a petition demanding theresigna- In a response to the demand for his MarilynMikuls~ The 1989-90 budget was approved director of Campus Planning tion of the Vice President of Develop- removal. Wertheimer. in a letter to all by council last week. according to Day ment Stephen Wertheimer. because' of the signatories ofthe petition. saidthat Session Student Government Trea- . the nature of his widely circulated the paper "was an exploration of pos surer, Apollo Matthew. The budget .Paint Peels'At memo that strongly opposed the estab- sible, even outlandish options and then went before the Board of Direc lishment of a black and Hispanic scenarios and, in point of fact. hardly tors on Thursday, Oct. 12 where it was alumni association in the school. anything was implemented or ulti approved without changes.' 24th Street Building The petition stated that "the memo mately discussed seriously. Its lan- The DSSa's total operating budget ... that bears the mocking title '00- guage was regrettably reugh and con this year comes to $84,225, roughly White Paper on the Black/Hispanic versational and blunt andcouldbe seen Mikulsky Cites "Hair Grease" Alumni' shows that the as insensitive.t''He went on to say that By RAFAEL'MARTlNEZMachiaveliian cynicism of this man is a lot of time has.beenspent on Iitiga- , . -

Hip: 199 Trainer Name: Brandon Presto Consigned By: Michelle Linnert Location
ALWAYS B HANNY Sire: ALWAYS A VIRGIN Dam: TOOTIN HANNY Sire of Dam: I SCOOT HANOVER Registered Owners: Spring Valley Ranch , Canonsburg, PA, US;Michelle R Linnert , Canonsburg, PA, US P Transfer Date: 2/ 3/2020 Paperless Certificate held electronically at the USTA Hip: 199 Trainer Name: Brandon Presto Consigned By: Michelle Linnert Location: Year Gait Starts 1st 2nd 3rd Money Won Record Time Track Code (4 starts) (4 starts) (5 starts) (5 starts) Money Won Wins Money Won Wins Lifetime Totals: 11 $75,424 $7,848 2 $10,548 3 Domestic LTD: 46 11 13 4 $75,424 4,1:54.0f Mea Avg $ Per Start 2020 Pace 16 3 5 2 $22,165 4,1:54.0f Mea $1,385.31 2019 Pace 20 4 4 2 $31,659 3,1:56.2f Phl $1,582.95 2018 Pace 10 4 4 0 $21,600 2,2:02.0 Humb $2,160.00 Stewards Lists: Lasix: EPP: Coggins: Bled: 3/4/20 MEA 01/17/20 MEA Page 1 of 4 Date Purse Temp Cond Dist Rc Time Act Tm $ Won Driver/Trainer Domestic Lifetime Winnings Claimed Track Class Post 1/4 1/2 3/4 Str Fin Call Comment LQ Odds Competition 08/17/2020 6,300 75 FT 1 27.2 57.2 125.3 155.4 155.4 $3,150 David M Palone/Brandon J Presto 75,424 Race 6 Mea L CDCL FMNW6 6 2 1 1 1/2h 1/1q 30.1 4.50 ALWAYS B HANNY,GOLDEN ISLES,ROCK N ROLL BABE 08/04/2020 5,400 77 FT 1 27.1 56.0 124.2 154.0 154.0 $2,700 David M Palone/Brandon J Presto 72,274 Race 8 Mea L CDCL FM1B3 9 1 1 1 1/1h 1/t 29.3 3.00 ALWAYS B HANNY,IDEAL BUBBY,FAIRY GOLD 07/28/2020 5,400 84 FT 1 27.1 55.1 124.0 156.2 156.3 $648 David M Palone/Brandon J Presto 69,574 Race 12 Mea L CDCL FM1B3 7 5° 1° 1 1/h 3/t 32.3 *1.30 STRONG COFFEE,IFEELLIKESASSY,ALWAYS B -

The Newsroom's Toy Department: the Different Images of Sports Journalists in Films
The Newsroom’s Toy Department: The Different Images of Sports Journalists in Films By David Sobieraj The Newsroom’s Toy Department Sobieraj 2 ABSTRACT Sports are a major part of pop culture. Sports are not just games that athletes play; they are a way of life. The roles that sportswriters and broadcasters play in the movies are a microcosm of the roles they play in real life. Most movies that include sportswriters as characters portray them as a myriad of anonymous fictional journalists who act more like paparazzi than news reporters. These characters flash cameras and yell out questions to sports stars. When real-life journalists portray themselves in bit-part roles, they are sometimes portrayed as caricatures, mocking the role of sportscasting as well as themselves. In contrast, actors who portray real-life well-known journalists and actors who play fictional sports journalists in major roles in a film take on the role of sportscasters who believe their job is to inform the public about star athletes. Moreover, the manner in which women sportswriters are depicted in films reflects the manner in which they are viewed in the real world. In summary, the journalists that cover sports in movies portray the same roles that they take on in the real world. Some are just paparazzi, looking for the latest dirt on well-known athletes. Some don’t take themselves seriously and see their job as more entertainment than hard news. Finally, some do see their role as investigative journalists who bring to light important information on the star athletes that they cover. -

That 80'S Show! - the Olitp Ics, Film, and Television of the Reagan Years Gable Hackett East Tennessee State Universtiy
East Tennessee State University Digital Commons @ East Tennessee State University Electronic Theses and Dissertations Student Works 5-2016 That 80's Show! - The olitP ics, Film, and Television of the Reagan Years Gable Hackett East Tennessee State Universtiy Follow this and additional works at: https://dc.etsu.edu/etd Part of the History Commons Recommended Citation Hackett, Gable, "That 80's Show! - The oP litics, Film, and Television of the Reagan Years" (2016). Electronic Theses and Dissertations. Paper 3048. https://dc.etsu.edu/etd/3048 This Thesis - Open Access is brought to you for free and open access by the Student Works at Digital Commons @ East Tennessee State University. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of Digital Commons @ East Tennessee State University. For more information, please contact [email protected]. That 80’s Show! – The Politics, Film, and Television of the Reagan Years _____________________ A thesis presented to the faculty of the Department of History East Tennessee State University In partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Arts in History _____________________ by Gable Hackett May 2016 _____________________ Dr. Daryl A. Carter, Chair Dr. Elwood Watson Dr. Dinah Mayo-Bobee Keywords: Reagan, History, Politics, Entertainment, 1980’s, Cold War ABSTRACT That 80’s Show! – The Politics, Film, and Television of the Reagan Years by Gable Hackett The 1980’s were a transformative era for the United States of America. The nation had been through a very tumultuous and difficult period following the Kennedy assassination, the Vietnam War, Watergate Scandal, and recession that had plagued the late 1970’s. -

UN- M* Reporter Ad-Salesman Does Life Photographer Copy-Editor Treat You
SIDELINES Wednesday, June 9, 1982 3 Rocky IIT surprisingly well-done Work'ttt-home plans ByJANENEGUPTON away any more of the can prove risky plot.Rocky followers can just another person. Of course, the Movie Critic NEED EXTRA CASH? It started occurring more frequently in the '70s: When about guess the outcome. amount of money you receive is TIRED OF WASTING YOUR based on the number of replies "Rocky" regulars Stallone and a. movie is a box-office hit, the producers turn out a SPARE TIME? to your ad, and you must pay to Meredith are joined by Talia sequel—and, in many cases, "turn" is an accurate Newspapers and magazines mail the envelopes to your Shire and Burt Young in "Rocky description, since the films are often poor imitations of are full of advertisements telling "employer," which substantially III." But while their per- their predecessors. you how to "earn extra money at decreases your 25c fee per reply. formances are good, equally as home" or "get rich quick." ANOTHER angle is to have good (and perhaps even better) ; The trend has escalated in the Express card, appearances on Unfortunately, some ads you place the ad soliciting are Carl Weathers and Mr. T. "80s. with such films as "The Muppet Show" and the promote what are appropriately stamped envelopes, then have like. This type of activity comes called work-at-home schemes— "'Superman." "Star Wars" and WEATHERS plays a former you stuff the envelopes—with to be Rocky's life. SCHEMES because usually the "Bock) " giving birth to seconds World's Champion, whose title material you have paid the And, of course, with the fame iMid even thirds. -

The Triumphs and Tribulations of the Rocky Franchise
The Triumphs and Tribulations of the Rocky Franchise What is it about the iconic Rocky films starring Sylvester Stallone that makes them so appealing? Why do we find ourselves settling in on the couch to watch one whenever they’re on broadcast television, like a moth to the proverbial flame? Ultimately, was it necessary for the series to be “capped off” by the sometimes questionable last film in the series, Rocky Balboa? The answers to these questions, though mainly steeped in opinionated reflection, have a lot to do with the “underdog scenario,” and the way in which audiences tend to gravitate to these stories; here is an everyday neighborhood figure many of us can relate to, who smashes through the odds against him no matter how large or seemingly unstoppable his opponents appear to be…and that’s always the underlying power behind a feel-good film. Interestingly enough, the Rocky franchise plays much like a superhero/comic book series in structure: With each passing film, our main character boxes his way through tougher and tougher adversaries, much like a comic book hero does with his rogues gallery of villains, even though it sometimes goes a bit too far with regard to suspension of disbelief (if anyone punched as hard as Dolph Lundgren’s character did in Rocky IV, no one would survive the hit, let alone come back for more). Rocky, the first entry from 1976 directed by John G. Avildsen – who would go on to direct the fifth film to bring the “Philadelphia” theme full circle – introduces us to down-on- his-luck street/club fighter Rocky Balboa, who collects debts for a local loan shark by day and battles local thuggish boxers by night.