Traditions Profanes Et Religieuses À Uruffe
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
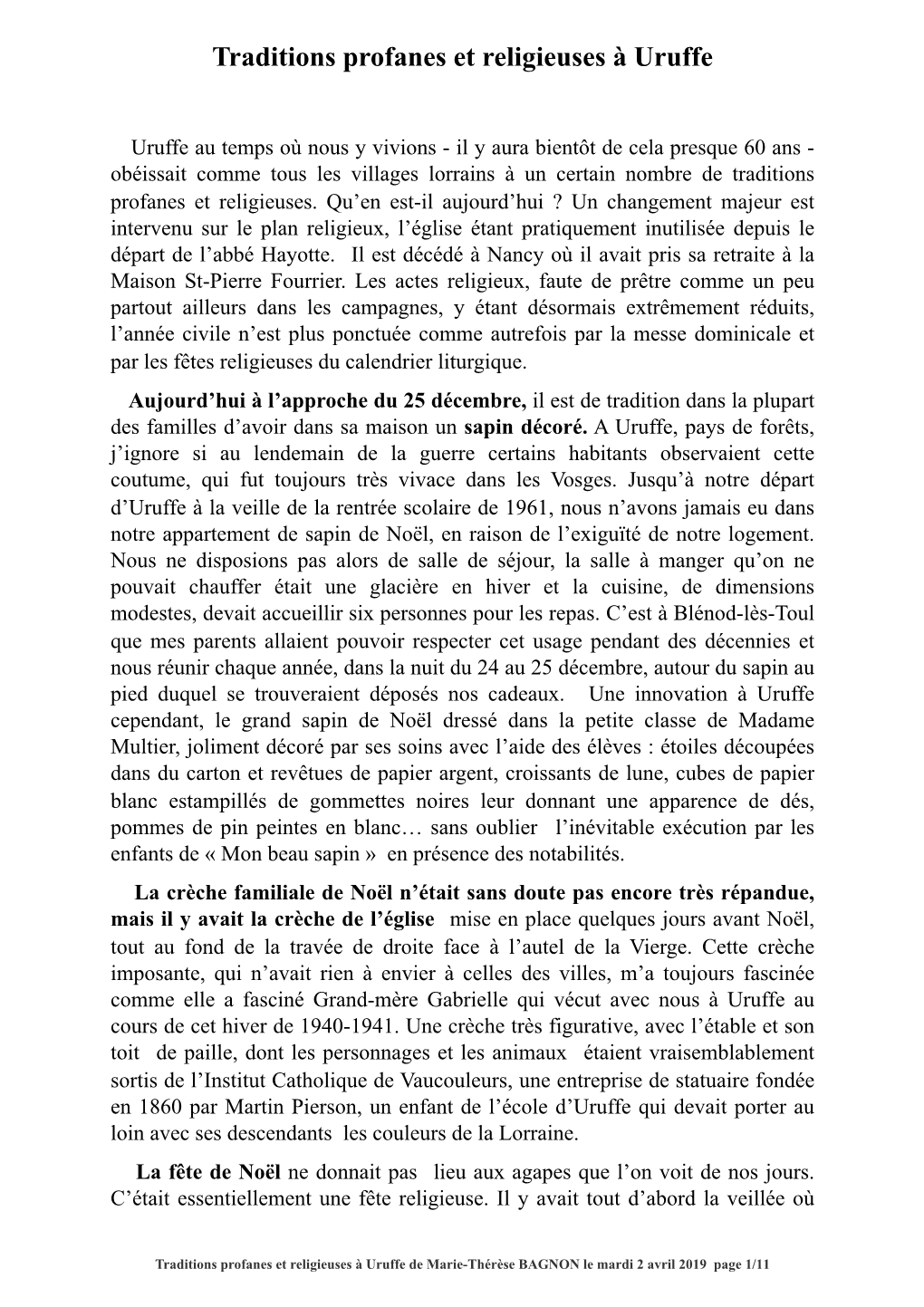
Load more
Recommended publications
-

RAPPORT MORAL 2020 De M
Association des maires et des présidents d’intercommunalité de Meurthe-et-Moselle (ADM54) Assemblée générale 2020 RAPPORT MORAL 2020 de M. Noël GUERARD, maire de LESMENILS, secrétaire général de l’ADM54 Une équipe administrative au service des élus L’Association emploie, au 1er septembre 2020, 17 personnes en CDI, sous la responsabilité d’Anne-Mathilde COSTANTINI, directrice et de Laurent HANNEZO, directeur adjoint ; au service administration générale, sous la responsabilité d’Hervé RICHARD, Catherine BOUTEIL, Agnès BRYS, Alicia DIZEK (mise à disposition partielle à l’Association des communes forestières), et Magali KIRSCH , au service juridique, sous la responsabilité de Valentine DUHAUT, Amine BENEDDIF, Anne COGERY, Léo MAFFEIS et Nicolas MARCHETTO, au service informatique, sous la responsabilité de Yann FORT, Rodrigue DARVIEUX, Cyril DIEZ CARDONA, Julien SERRURIER et José VAZ. Bilan des services Les services ont évidemment été impactés par le confinement 2020 lié à la pandémie, mais tous ont continué en télétravail ou présentiel car le nombre de circulaires a explosé durant cette période et tant le service juridique que le service informatique ont accompagné les collectivités pour traverser la crise. Service juridique Au conseil juridique, le nombre de saisines au 1er septembre 2020 atteint un niveau jamais égalé : 5 100 questions d’ores et déjà posées alors que la moyenne annuelle se situe autour de 6 000 questions. Les élections municipales et communautaires ainsi que la période sanitaire exceptionnelle ont été des facteurs déterminants du nombre exponentiel de questions. Les 5 juristes ont eu à cœur de maintenir le service malgré le confinement. Même avec un nombre important de questions, la compétence et la réactivité des juristes dans les dossiers confiés ont continué à être louées et reconnues par les communes et EPCI adhérents. -

Fiche Structure : Alliance Villes Emploi
Fiche structure : Alliance Villes Emploi - www.ville-emploi.asso.fr TERRITOIRE Pays : France Région : Grand Est Département : (54) Meurthe-et-Moselle Ville : Neuves-Maisons Liste des communes couvertes : Aboncourt ((54) Meurthe-et-Moselle), Affracourt ((54) Meurthe-et-Moselle), Aingeray ((54) Meurthe-et-Moselle), Allain ((54) Meurthe-et-Moselle), Allamps ((54) Meurthe-et-Moselle), Andilly ((54) Meurthe-et-Moselle), Ansauville ((54) Meurthe-et-Moselle), Aroffe ((88) Vosges), Autrey ((54) Meurthe-et-Moselle), Avrainville ((54) Meurthe-et-Moselle), Bagneux ((54) Meurthe-et-Moselle), Bainville-aux-Miroirs ((54) Meurthe-et-Moselle), Bainville-sur-Madon ((54) Meurthe-et-Moselle), Barisey-au-Plain ((54) Meurthe-et-Moselle), Barisey-la-Côte ((54) Meurthe-et-Moselle), Battigny ((54) Meurthe-et-Moselle), Benney ((54) Meurthe-et-Moselle), Beuvezin ((54) Meurthe-et-Moselle), Bicqueley ((54) Meurthe-et-Moselle), Blénod-lès-Toul ((54) Meurthe-et-Moselle), Boucq ((54) Meurthe-et-Moselle), Bouvron ((54) Meurthe-et-Moselle), Bouzanville ((54) Meurthe-et-Moselle), Bralleville ((54) Meurthe-et-Moselle), Bruley ((54) Meurthe-et-Moselle), Bulligny ((54) Meurthe-et-Moselle), Ceintrey ((54) Meurthe-et-Moselle), Chaligny ((54) Meurthe-et-Moselle), Chaouilley ((54) Meurthe-et-Moselle), Charmes-la-Côte ((54) Meurthe-et-Moselle), Chaudeney-sur-Moselle ((54) Meurthe-et-Moselle), Chavigny ((54) Meurthe-et-Moselle), Choloy-Ménillot ((54) Meurthe-et-Moselle), Clérey-sur-Brenon ((54) Meurthe-et-Moselle), Colombey-les-Belles ((54) Meurthe-et-Moselle), Courcelles ((54) -

DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 1Ère Circonscription
DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 1ère circonscription CUSTINES BRIN-SUR-SEILLE BOUXIERES-AUX-CHENES BRIN-SUR-SEILLE MONCEL-SUR-SEILLE BOUXIERES-AUX-CHENES MAZERULLES BOUXIERES-AUX-DAMES BOUXIERES-AUX-DAMES AMANCE AMANCE MAZERULLES LLAY--SAIINT--CHRIISTOPHE EULMONT SORNEVILLE EULMONT LAITRE-SOUS-AMANCE SORNEVILLE LAITRE-SOUS-AMANCE CHAMPENOUX DOMMARTIN- CHAMPENOUX DOMMSOAURST-IANM-SAONUCSE-AMANCE AGINCOURT LANEUVELOTTE AGINCOURT MALZEVILLE LANEUVELOTTE DOMMARTEMONT SEICHAMPS SEICHAMPS VELAINE-SOUS-AMANCE ESSEY-LES-NANCY ESSEY-LES-NANCY SAINT-MAX PULNOY NANCY-2 PULNOY SAULXURES-LES-NANCY NANCY SAULXURES-LES-NANCY NANCY-3 Légende Couleur : Canton Entre Seille et Meurthe Grand Couronné Saint-Max Nancy-3 Nancy-2 SICOM 54 06/12/2016 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 2ème circonscription NANCY-1 LAXOU JARVILLE- LA-MALGRANGE VILLERS-LES-NANCY VANDOEUVRE-LES-NANCY HEILLECOURT HOUDEMONT LUDRES Légende Couleur : Canton Laxou Vandoeuvre-lès-Nancy Jarville-la-Malgrange Nancy-1 SICOM 54 06/12/2016 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 3ème circonscription MONT-SAINT-MARTIN VILLE-HOUDLEMONT MONT-SAINT-MARTIN GORCY LONGLAVILLE SAULNES GORCY LONGLAVILLE VILLE-HOUDLEMONT SAINT-PANCRE SAULNES COSNES-ET-ROMAIN HERSERANGE COSNES-ET-ROMAIN LONGW Y LONGW Y SAINT-PANCRE HERSERANGE TELLANCOURT LEXY MEXY VILLERS-LA-CHEVRE MEXY ALLONDRELLE-LA-MALMAISON TELLANCOURT LEXY ALLONDRELLE-LA-MALMAISON VILLERS-LA-CHEVRE HAUCOURT-MOULAINE FRESNOIS-LA-MONTAGNE REHON HUSSIGNY-GODBRANGE EPIEZ-SUR-CHIERS FRESNOIS-LA-MONTAGNE HAUCOURT HUSSIGNY-GODBRANGE -MOULAINE EPIEZ-SUR-CHIERS -

Uruffe En 1846 Sur La Départementale N° 18
Uruffe en 1846 sur la Départementale n° 18 La route reliant Vézelise à Vaucouleurs figurait dès 1750 sur la Carte de Cassini, établie à la veille de la Révolution à la demande du roi Louis XV. Baptisée Départementale n° 18 au 19ème siècle, élargie à plusieurs reprises en un temps où le roulage ne cessait de se développer, elle desservait le bourg de Colombey-les-Belles, promu chef-lieu de canton par la réorganisation administrative de la Constitution de l’An VIII, ainsi que Vannes-le Châtel, Uruffe et Gibeaumeix. Le Concordat, complété par les Articles Organiques, avait élevé Colombey au rang de Paroisse-mère avec son curé, les autres paroisses du canton étant des succursales avec desservant sous la surveillance du curé. Tel était, schématiquement parlant, le cadre administratif et religieux où s’est inscrit le village d’Uruffe au cours du 19ème siècle. Depuis Colombey la Route, après avoir croisé l’ancienne voie romaine se dirigeant vers Chalon-sur-Saône, gagnait Vannes-le-Châtel dont l’appellation rappelait le château que s’était fait construire à la fin du 16ème siècle Jean-Jacques de Ligniville, membre de l’une des familles les plus importantes de Lorraine qui s’était illustrée au service de ses Ducs. Un puissant seigneur que le comte de Ligniville, ancien gouverneur de Toul sous le Roi Henri, qui avait participé au traité de paix entre le duc de Lorraine Charles III et Henri IV, et avait signé la minute du contrat de 1598 concernant le mariage de l’héritier lorrain, le futur Henri II, avec la protestante Catherine de Bourbon, la sœur du roi. -

Arrete SF 13 09 2012.Pdf
A N N E X E N° 1 Listes des communes lorraines et niveau de dotation en sages-femmes libérales de leur zone d'emploi de rattachement Le découpage INSEE des zones d'emploi (1994) est celui fixé dans l'arrêté ministériel du 12 juin 2012 portant modification de l’arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique. Il ne s'agit pas du découpage le plus récent. Les communes lorraines sont classées dans l'ordre croissant de leur code INSEE. -

Ce Que Le Miroir Colombien Nous Renvoie
le paysan lorrain vendredi 22 août 2014. page 16 la Vie d’Ici On sort • EN MOSELLE 23 au 25 août : THEATRE aujourd’hui le Dédé il travaille -Fête du canard seul toute la journée». Et il ne à Ancy-sur-Moselle. reste que deux cultivateurs au village. L’aîné peste encore «on ENVIRONS DE NANCY nous a dit : «il faut produire. 28 au 31 août : Ce que le miroir On faisait confiance aux techni- -Spectacle équestre au pôle ciens… Le crédit, c’est le moteur hippique de l’économie. Qu’est qu’on était de Rosières-aux-Salines. naïf !». Dimanche 31 août : Fresque provocatrice -Forum des associations colombien nous renvoie à Saint-Nicolas-de-Port. Romain, le petit-fils, aura-t’il Une critique provocatrice de l’agriculture d’ici aujourd’hui, la capacité de s’installer ? Rien LUNEVILLOIS n’est moins sûr, même s’il parle Vendredi 22 août : à la lumière du ressenti au contact des paysans colombiens. de se «diversifier». Le rideau -16h à 19h, marché Le spectacle «Made in Colombia» d’Anne Boyé-Tuizat s’ouvre tombe sur cette avant-première. des producteurs fermiers, sur un vaste échange avec le public. La première en septembre. Pas tout à fait tout de même, car dans la cour du château après le salut final, les comédiens de Lunéville. rejoignent le public. Anne-Boyé- -21h, reconstitution rance-Colombie : le choc Tuizat présente ses collègues et de la bataille de Gerbéviller, des agricultures. Andréa, rappelle la genèse du projet. Et le avec le Souvenir Français. paysanne colombienne, dialogue s’instaure. -

Concerning the Community List of Less-Favoured Farming Areas Within the Meaning of Directive the Requirements for Less-Favoured
15 . 11 . 89 Official Journal of the European Communities No L 330 / 31 COUNCIL DIRECTIVE of 23 October 1989 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( France ) ( 89 / 587 /EEC ) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , Whereas the three types of areas communicated to the Commission satisfy the conditions laid down in Article 3 ( 3 ), Having regard to the Treaty establishing the European ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 / 268 /EEC ; whereas the first meets Economic Community , the requirements for mountain areas, the second meets the requirements for less-favoured areas in danger of Having regard to Council Directive 75 /268 /EEC of 28 April depopulation where the conservation of the countryside is 1975 on mountain and hill farming and farming in certain necessary and which are made up of farming areas which are less-favoured areas (*), as last amended by Regulation ( EEC ) homogeneous from the point of view of natural production No 797/ 85 ( 2 ), and in particular Article 2 ( 2 ) thereof, conditions , and the third meets the requirements for areas affected by specific handicaps ; Having regard to the proposal from the Commission , Whereas, according to the information provided by the Member State concerned , these areas have adequate Having regard to the opinion of the European infrastructure , Parliament ( 3 ), Whereas Council Directive 75 / 271 /EEC of 28 April 1975 HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE : concerning the Community list of less-favoured areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( 4 ), supplemented Article 1 by Directives 76 /401 / EEC ( 5 ), 76 / 631 / EEC ( 6 ), 77 /178 /EEC ( 7 ) and 86-/ 655 /EEC ( 8 ) indicates the areas of The areas situated in the French Republic which appear in the the French Republic which are less-favoured within the Annex form part ofthe Community list ofless-favoured areas meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive within the meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 /268 /EEC ; 75 /268 / EEC . -

Base De Loisirs Intercommunale De Favières
Le cahier d’info de la Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois M AI 2015 N°72 PAGE Développement social 14 L’emploi conçu comme un droit PAGE Développement social 15 Les besoins de la petite enfance : questionnaire Base de loisirs intercommunale de Favières PAGE Ouverture de la base Environnement 6 Sam.13 juin Journée Sensations fortes Atlas de biodiversité Dim. 28 juin té Communau de communes 04X COMMUNE À LA UNE 12/13 X É CONOMIE Sommaire Bulligny Eflm\cc\j\eki\gi`j\j Hl\jfek$\cc\j[\m\el\j6 05/08X ?A9IKAK CA;IE ;E MIE Gif^iXdd\[\i\jkXliXk`fe[\cÊ8if]]\ 14/15X ; É M ELOPPEMENK J OCIAL GcXk\j]fid\j CÊ\dgcf`ZfelZfdd\le[if`k 8kcXj[\Y`f[`m\ij`k DfY`c`kjfc`[X`i\ @ddfY`c`\i Hl\jk`feeX`i\1c\jY\jf`ej[\cXg\k`k\\e]XeZ\ <e]Xekj#gXi\ekj#^iXe[$gXi\ekj#Xjj`jkXekj%%% 09/11X C ULK U I E EK A EUNEJJE EffYX 16/17X L OIJ I IJ K OUI I J ME Ij`[\eZ\[ÊXik`jk\j~cÊZfc\ I\e[\q$mfljGXki`df`e\gflikflj :fek\\kdXi`fee\kk\j :`\[\jm\ii`\ij1c\jY\XloaflijXii`m\ek H`>fe^ Leeflm\Xlm`ccX^\%%% K_ki\[\:i`jkXc 18/20X A GEN; A Jf`i\Zfek\~Dfekc<kif`k Grains de Pays - N°72 Pôles et services Journal trimestriel édité par la Communauté de de la Communauté de communes Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois )MPASSEDELA#OLOMBEs"0 #OLOMBEY LES "ELLES sSocial et solidarité :$EMANDEURSDEMPLOI )NSERTION #)!3 0ETITE%NFANCE sHabitat et Cadre de Vie :2ECHERCHEDUNELOCATION (ABITAT 5RBANISME sÉconomie et tourisme :-ONTAGEDEPROJET )MMOBILIERDENTREPRISEx Directeur de la publication : Philippe PARMENTIER sCulture et Jeunesse :!NIMATIONLECTURE 0ROJETSCULTURELS -

Meine Coeur De Vert
RANDONNÉES NATURE EN L’ENS : UN LIEN ENTRE LES Meurthe Moselle 5 COMMUNES ET LA FORÊT Acquis en 2011 par le conseil départemental & de Meurthe-et-Moselle, les 300 hectares de forêt au sein du Massif de Meine concernent cinq communes : Allamps, Bulligny, Vannes- POUR VENIR le-Châtel, Blénod-lès-Toul et Uruffe. Leurs FACILEMENT habitants, depuis des siècles, aiment leur forêt, FLASHEZ-MOI ! À MEINE / VANNES LE CHATEL qui les a fait vivre, les a nourri, chauffé, leur a permis de créer 18 CONSEIL DÉPARTEMENTAL de l’emploi et aujourd’hui propose un lien direct avec la nature. ACCÈS : RANDO Le chat sauvage, notamment, peuple ce territoire forestier aux 54 MEINE ambiances contrastées. Commune de Blénod-lès-Toul De Toul, vers Blénod-les-Toul par D 960, Plus d’infos sur les ENS : Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle e-mail : [email protected] - téléphone : +33 (0) 3 83 94 56 87 puis RD 114 vers Uruffe. Parking : au niveau du totem “Blénod-les-Toul”, suivre les panneaux Coeur de vert au niveau COEUR DE VERT › ENTRE AMBIANCES MÉRIDIONALES RD114 (accès limité aux derniers dimanches du er er DANS LA FORÊT PROFONDE ET MONTAGNARDES... mois entre le 1 octobre et le 1 mars). S E E U N Q TIE GI LES POINTS D’INTÉRÊT À VOIR SUR LE PARCOURS : R PÉDAGO » Les 10 totems, espacés de 500 m, » Les ruines de la Chapelle Sainte Menne, » Le four à charbon. APRÈS LA MARCHE : » Les caves, les vignobles et les vignerons de Bulligny et Blénod-lès-Toul (Côtes de Toul), » Le circuit du Bois Brûlé de Bulligny (voir fiche randonnée n°19), À VANNES-LE-CHÂTEL : » La Compagnie des Verriers, Cheminer dans le Massif de Meine fait passer des ambiances (démonstration de soufflage de verre méridionales des anciennes carrières de calcaire à l’atmosphère et boutique au +33 (0)3 83 50 18 43), fraiche et intime des fonds de vallon, où coule par intermittence le À BLÉNOD-LES-TOUL : ruisseau de la Deuille. -

Official Journal C 30 Volume 33 of the European Communities 8 Febraary 1990
yr-^^ /*/*• • "I "Y* 1 ISSN 0378-6986 Official Journal c 30 Volume 33 of the European Communities 8 Febraary 1990 English edition Information and Notices Notice No Contents Page I Information II Preparatory Acts Commission 90/C 30/01 Proposal for Council Directive amending Directive 86/465/EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75/ 268/EEC (Federal Republic of Germany) 1 90/C 30/02 Proposal for a Council Directive concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75/268/EEC (France) 35 90/C 30/03 Proposal for Council Directive amending Directive 81/645/EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75/ 268/EEC (Greece) 50 90/C 30/04 Amended proposal for a Council Directive on the annual accounts and consolidated accounts of insurance undertakings 51 90/C 30/05 Re-examined proposal for a Council Directive amending Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations 89 90/C 30/06 Re-examined proposal for a Council Directive on company law concerning single- member private limited companies 91 90/C 30/07 Re-examined proposal for a Council Directive amending Directive 87/102/EEC of 22 December 1986 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit 92 90/C 30/08 Re-examined proposal for a: — Council Directive amending Directive 86/298/EEC on rear-mounted roll-over protection structures narrow-track tractors — Council Directive amending Directive 87/402/EEC on roll-over protection structures mounted at the front of narrow-track tractors — Council Directive amending Directive 77/536/EEC on roll-over protection structures for tractors (standard) 95 Price: 12 ECU 8. -

4 La Paroisse D'uruffe Sous L'ancien Régime
La Paroisse d’Uruffe sous l’Ancien Régime La Paroisse d’Uruffe sous l’Ancien Régime Elle relève du bailliage de Gondrecourt jusqu’en 1751 puis de celui de Lamarche jusqu’à la Révolution, l’un et l’autre faisant partie du Barrois mouvant. La paroisse est non seulement une circonscription ecclésiastique mais aussi une division administrative, la séparation entre le spirituel et le temporel n’existant pas sous l’Ancien Régime. Elle a des limites bien définies, dépend d’une église, est soumise à l’autorité d’un prêtre résident, le curé. Elle a pour patron St Martin et relève, avec son annexe Gibeaumeix, du doyenné de Vaucouleurs et de l’officialité de Bar, un tribunal diocésain traitant des affaires ecclésiastiques mais aussi des affaires séculières concernant quelque homme d’Eglise, et enfin des crimes et délits commis en des lieux relevant de l’Eglise. La nomination du curé Uruffe est une cure sous patronage ecclésiastique, le patronage de la cure appartenant au Chapitre cathédral de Toul : la collation ou nomination aux bénéfices obéit à l’alternative selon laquelle la collation aux petits bénéfices est réservée au Pape les mois impairs, et au chapitre cathédral les mois pairs au cours desquels celui-ci a toute liberté de choix. Le curé nommément désigné, encore faut-il officialiser la désignation. C’est ainsi que le 3 janvier 1567, le chapitre cathédral de Toul a procédé à la nomination pour la cure d’Uruffe et de son annexe Gibeaumeix. En 1620, la cure vacante d’Uruffe s’était retrouvée pourvue de deux titulaires, l’un par le chapitre, l’autre par Jacques de Ligniville, seigneur du lieu et de Vannes. -

Ménagers 2021
Services déchets ménagers 2021 Collecte des Ordures Ménagères - par village et par jour, toutes les semaines Sortez votre bac la veille au soir et placez LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI le en bordure de rue Allain • Bagneux • Barisey-au-Plain • Blénod-lès-Toul • Allamps • Colombey-les-Belles • Crépey Aboncourt • Battigny • Beuvezin • Courcelles • Barisey-la-Côte • Gibeaumeix • Crézilles • Bulligny • • Germiny • Moutrot • Ochey • Dolcourt • Favières • Fécocourt • Gélaucourt • Mont-l’Étroit • Saulxures-lès-Vannes • Mont-le-Vignoble Vannes-le-Châtel Zone en Prave Gémonville • Grimonviller • Pulney • Saulxerotte • Thuilley-aux-Groseilles • Uruffe Selaincourt • Tramont-Émy • Tramont-Lassus • Tramont-Saint-André • Vandeléville • Vicherey Pas de collecte les jours fériés Renseignements au 03 54 95 62 41 Collecte du Tri Sélectif - par village et par jour, tous les 15 jours LES SACS ÉCO-TRI LUNDI MARDI MERCREDI sont disponibles Pas de collecte dans votre mairie SEMAINE IMPAIRE Allain • Bagneux • Blénod-lès-Toul • Crézilles • Colombey-les-Belles • Moutrot à partir de la semaine 1 Barisey-au-Plain • Bulligny • Mont-le-Vignoble • Ochey les jours fériés Germiny • du 04/01/2021 au 08/01/2021 Thuilley-aux-Groseilles • Rattrapage pour le TRI : Autorisé Zone en Prave • Si jour férié le lundi Flacons et bidons de lave-glace SEMAINE PAIRE Allamps • Barisey-la-Côte • Aboncourt • Beuvezin • Courcelles Battigny • Crépey • Dolcourt • > collecte le mardi Non autorisé Gibeaumeix • Uruffe • • Fécocourt • Pulney • Gémonville • Favières • Gélaucourt • à partir de la semaine 2 Combustible liquide. Vannes-le-Châtel Grimonviller • Tramont-Lassus • Mont-l’Étroit • Saulxerotte • • Si jour férié le mardi ou le Tout flacon et bidon ayant contenu du 11/01/2021 au 15/01/2021 Tramont-Émy • Saulxures-lès-Vannes • mercredi des produits chimiques ou Tramont-Saint-André • Selaincourt > collecte le jour précédent dangereux (white spirit, acétone..