Cas De La Commune Rurale De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
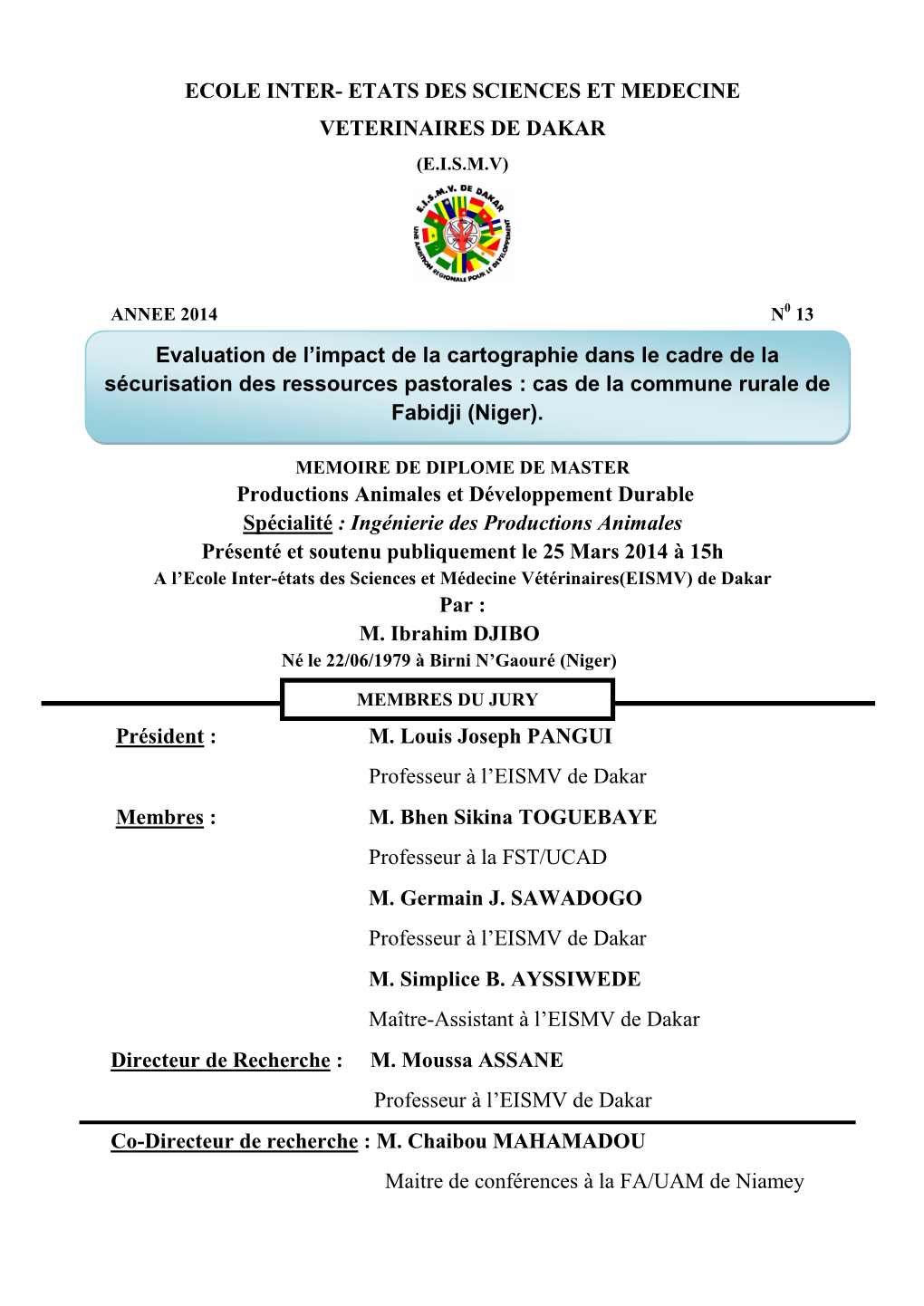
Load more
Recommended publications
-

Rapport Cartographie ESRAJ Niger VF.Pdf
RAPPORT DE LA CARTOGRAPHIE DES ACTEURS IMPLIQUES DANS L’EDUCATION A LA SANTE REPRODUCTIVE DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES ET EVALUATION DE SON ETAT DE MISE EN ŒUVRE AU NIGER Avec l’appui de : Décembre 2020 1 SIGLES ET ACRONYMES ACTN : Association des Chefs Traditionnels du Niger AFD : Agence Française de Développement ANBEF : Association Nigérienne pour le Bien-Etre Familial ANIMAS Sutura : Association Nigérienne de Marketing Social ARDSES : Alliance des Religieux pour le Développement Sanitaire, Economique et Social ASC : Agents de Santé Communautaires CARE International : Cooperative for Assistance and Relief Everywhere International CARPF : Coalition des Acteurs pour le Repositionnement de la Planification Familiale CCC : Communication pour un Changement de Comportement CCSC : Communication pour le Changement Social et Comportemental CEG : Collège d’Enseignement Général CEG/FA : Collège d’Enseignement Général Franco-Arabe CES : Complexe d’Enseignement Secondaire CES/FA : Complexe d’Enseignement Secondaire Franco-Arabe CISLS : Coordination Inter Sectorielle de Lutte contre le SIDA CPON : Consultation Post Natale CPN : Consultation Pré Natale CPNR : Consultation Pré Natale Recentrée CNA : Cinéma Numérique Ambulant CNSR : Centre National de Santé de la Reproduction COGES : Comité de Gestion des Etablissements Scolaires ONG COMSED : Communication Santé Education et Développement COSAN : Comité de Santé CRDI : Centre Régional de Développement Industriel 2 CRS : Catholic Relief Service CSI : Centre de Santé Intégré CSP : Complexe Scolaire -

World Bank Document
SFG1950 Public Disclosure Authorized _________ Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux Risques Climatiques (PASEC) _________ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (CGES) Public Disclosure Authorized RAPPORT DEFINITIF Janvier 2016 TABLE DES MATIERES ESMF SUMMARY ............................................................................................................................................... 7 RESUME ............................................................................................................................................................... 9 INTRODUCTION ............................................................................................................................................... 11 CONTEXTE ........................................................................................................................................................ 11 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE ..................................................................................................................................... 11 MÉTHODOLOGIE ................................................................................................................................................ 12 STRUCTURATION DU RAPPORT .......................................................................................................................... 12 1. DESCRIPTION DU PROJET ................................................................................................................. -

NIGER: Carte Administrative NIGER - Carte Administrative
NIGER - Carte Administrative NIGER: Carte administrative Awbari (Ubari) Madrusah Légende DJANET Tajarhi /" Capital Illizi Murzuq L I B Y E !. Chef lieu de région ! Chef lieu de département Frontières Route Principale Adrar Route secondaire A L G É R I E Fleuve Niger Tamanghasset Lit du lac Tchad Régions Agadez Timbuktu Borkou-Ennedi-Tibesti Diffa BARDAI-ZOUGRA(MIL) Dosso Maradi Niamey ZOUAR TESSALIT Tahoua Assamaka Tillabery Zinder IN GUEZZAM Kidal IFEROUANE DIRKOU ARLIT ! BILMA ! Timbuktu KIDAL GOUGARAM FACHI DANNAT TIMIA M A L I 0 100 200 300 kms TABELOT TCHIROZERINE N I G E R ! Map Doc Name: AGADEZ OCHA_SitMap_Niger !. GLIDE Number: 16032013 TASSARA INGALL Creation Date: 31 Août 2013 Projection/Datum: GCS/WGS 84 Gao Web Resources: www.unocha..org/niger GAO Nominal Scale at A3 paper size: 1: 5 000 000 TILLIA TCHINTABARADEN MENAKA ! Map data source(s): Timbuktu TAMAYA RENACOM, ARC, OCHA Niger ADARBISNAT ABALAK Disclaimers: KAOU ! TENIHIYA The designations employed and the presentation of material AKOUBOUNOU N'GOURTI I T C H A D on this map do not imply the expression of any opinion BERMO INATES TAKANAMATAFFALABARMOU TASKER whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations BANIBANGOU AZEY GADABEDJI TANOUT concerning the legal status of any country, territory, city or area ABALA MAIDAGI TAHOUA Mopti ! or of its authorities, or concerning the delimitation of its YATAKALA SANAM TEBARAM !. Kanem WANZERBE AYOROU BAMBAYE KEITA MANGAIZE KALFO!U AZAGORGOULA TAMBAO DOLBEL BAGAROUA TABOTAKI TARKA BANKILARE DESSA DAKORO TAGRISS OLLELEWA -

F:\Niger En Chiffres 2014 Draft
Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 1 Novembre 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Direction Générale de l’Institut National de la Statistique 182, Rue de la Sirba, BP 13416, Niamey – Niger, Tél. : +227 20 72 35 60 Fax : +227 20 72 21 74, NIF : 9617/R, http://www.ins.ne, e-mail : [email protected] 2 Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Pays : Niger Capitale : Niamey Date de proclamation - de la République 18 décembre 1958 - de l’Indépendance 3 août 1960 Population* (en 2013) : 17.807.117 d’habitants Superficie : 1 267 000 km² Monnaie : Francs CFA (1 euro = 655,957 FCFA) Religion : 99% Musulmans, 1% Autres * Estimations à partir des données définitives du RGP/H 2012 3 Le Niger en Chiffres 2014 4 Le Niger en Chiffres 2014 Ce document est l’une des publications annuelles de l’Institut National de la Statistique. Il a été préparé par : - Sani ALI, Chef de Service de la Coordination Statistique. Ont également participé à l’élaboration de cette publication, les structures et personnes suivantes de l’INS : les structures : - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques (DSEE) ; - Direction des Statistiques et des Etudes Démographiques et Sociales (DSEDS). les personnes : - Idrissa ALICHINA KOURGUENI, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique ; - Ibrahim SOUMAILA, Secrétaire Général P.I de l’Institut National de la Statistique. Ce document a été examiné et validé par les membres du Comité de Lecture de l’INS. Il s’agit de : - Adamou BOUZOU, Président du comité de lecture de l’Institut National de la Statistique ; - Djibo SAIDOU, membre du comité - Mahamadou CHEKARAOU, membre du comité - Tassiou ALMADJIR, membre du comité - Halissa HASSAN DAN AZOUMI, membre du comité - Issiak Balarabé MAHAMAN, membre du comité - Ibrahim ISSOUFOU ALI KIAFFI, membre du comité - Abdou MAINA, membre du comité. -

Multihazard Risk Assessment for Planning with Climate in the Dosso Region, Niger
climate Article Multihazard Risk Assessment for Planning with Climate in the Dosso Region, Niger Maurizio Tiepolo 1,* ID , Maurizio Bacci 1,2 ID and Sarah Braccio 1 1 Interuniversity Department of Regional and Urban Studies and Planning (DIST), Politecnico and University of Turin, Viale G. Mattioli 39, 10125 Torino, Italy; [email protected] or [email protected] (M.B.); [email protected] (S.B.) 2 Ibimet CNR, Via G. Caproni 8, 50145 Florence, Italy * Correspondence: [email protected]; Tel.: +39-011-090-7491 Received: 13 July 2018; Accepted: 6 August 2018; Published: 8 August 2018 Abstract: International aid for climate change adaptation in West Africa is increasing exponentially, but our understanding of hydroclimatic risks is not keeping pace with that increase. The aim of this article is to develop a multihazard risk assessment on a regional scale based on existing information that can be repeated over time and space and that will be useful during decision-making processes. This assessment was conducted in Dosso (Niger), the region most hit by flooding in the country, with the highest hydroclimatic risk in West Africa. The assessment characterizes the climate, identifies hazards, and analyzes multihazard risk over the 2011–2017 period for each of the region’s 43 municipalities. Hazards and risk level are compared to the intervention areas and actions of 6 municipal development plans and 12 adaptation and resilience projects. Over the past seven years, heavy precipitation and dry spells in the Dosso region have been more frequent than during the previous 30-year period. As many as 606 settlements have been repeatedly hit and 15 municipalities are classified as being at elevated-to-severe multihazard risk. -

Arrêt N° 012/11/CCT/ME Du 1Er Avril 2011 LE CONSEIL
REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité – Travail – Progrès CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION Arrêt n° 012/11/CCT/ME du 1er Avril 2011 Le Conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière électorale en son audience publique du premier avril deux mil onze tenue au Palais dudit Conseil, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LE CONSEIL Vu la Constitution ; Vu la proclamation du 18 février 2010 ; Vu l’ordonnance n° 2010-01 du 22 février 2010 modifiée portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition ; Vu l’ordonnance n° 2010-096 du 28 décembre 2010 portant code électoral ; Vu l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de Transition ; Vu le décret n° 2011-121/PCSRD/MISD/AR du 23 février 2011 portant convocation du corps électoral pour le deuxième tour de l’élection présidentielle ; Vu l’arrêt n° 01/10/CCT/ME du 23 novembre 2010 portant validation des candidatures aux élections présidentielles de 2011 ; Vu l’arrêt n° 006/11/CCT/ME du 22 février 2011 portant validation et proclamation des résultats définitifs du scrutin présidentiel 1er tour du 31 janvier 2011 ; Vu la lettre n° 557/P/CENI du 17 mars 2011 du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante transmettant les résultats globaux provisoires du scrutin présidentiel 2ème tour, aux fins de validation et proclamation des résultats définitifs ; Vu l’ordonnance n° 028/PCCT du 17 mars 2011 de Madame le Président du Conseil constitutionnel portant -
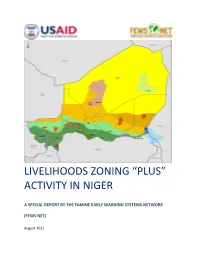
Livelihoods Zoning “Plus” Activity in Niger
LIVELIHOODS ZONING “PLUS” ACTIVITY IN NIGER A SPECIAL REPORT BY THE FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK (FEWS NET) August 2011 Table of Contents Introduction .................................................................................................................................................. 3 Methodology ................................................................................................................................................. 4 National Livelihoods Zones Map ................................................................................................................... 6 Livelihoods Highlights ................................................................................................................................... 7 National Seasonal Calendar .......................................................................................................................... 9 Rural Livelihood Zones Descriptions ........................................................................................................... 11 Zone 1: Northeast Oases: Dates, Salt and Trade ................................................................................... 11 Zone 2: Aïr Massif Irrigated Gardening ................................................................................................ 14 Zone 3 : Transhumant and Nomad Pastoralism .................................................................................... 17 Zone 4: Agropastoral Belt ..................................................................................................................... -

Western Niger
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0°0'0" 5°0'0"E Gao!(o (! KOROGOUSSOU T!ilia ! Menaka ! Tchin Tabaraden o ANSONGO Efein!atas !Amerkay Assagueiguei ! ! Digue Diga ! Abalak !Taza ! Assas Ibessetene! Gouno Koara ! ! Me!riza Bourobouré ! Bangou Tawey ! Takanamat ! Tahououilane Tiloa ! ! ! In Lelou ! ! Ngaba ! In Aouara Tongo Tongo Adabda ! Abarey ! ! Firo Bani Bangou ! ! 15°0'0"N ! 15°0'0"N ! ! Tuizégorou Soumat ! ! ! ! Gollo Abala ! Karkamat ! Fadama Tahoua ! Bakin Dabagi Zérma Daré Garbey !( ! ! In Karkada o ! ! Tiam Bangou ! ! ! ! Soumassou ! ! Kabé Kaina Sanam ! Labandam Tonkosom! ! Ouèlla Sabon Gari Tebaram Edir TAHOUA ! Mangahizé-Keina ! ! !Keita ! ! ! Ayorou Kassi Gourou Kaourakéri ! May Farin Kay In Tigar ! ! ! Gosso Ouanzerbé Golbégui ! Foïma Makani Moza Tondikoiré ! ! ! Téguey ! ! Mangaïzé Taroum ! Maulela Bari Touri Bagaroua ! !Tabotaki !Kasi Tondi Ataraba! Salmossi ! Farmei ! ! Bankilaré ! ! Guidan Tanimou Kokorbé Gounizé ! ! Dakoro ! Tondi ! !Toukounous ! ! Koufey Banizongou o Fatatako Gassa Ziban ! Danga Tondi Bia !! !Dinkildimi Kiwindi! ! ! Banizongou ! ! ! Rwafi ! Illela Gorom-Gorom GOROM-GOROM Koro Goussou Séwan ! Mondolo Wali Koara ! Logazeido Djingines ! ! Maourey Maynaai ! ! Dakala ! OUALo LAM ! Yalouma Filingue ! ! ! ! ! Fanaka Koara ! Zama Makourdi ! Doungouro ! ! Dey ! ! Sabara !Safia ! Féfandou Lahaba Ba!nimate Majia Samo Kanofulé Ouallam ! Toulou Ndamésa ! ! ! ! ! Kabay ! Amanbodi Fondézangou ! Dinkim Sehia Dan Gona o Dabré ! ! ! ! ! Taratako ! Sargam Banikan Boukou Gadèrga ! Tillaberi ! ! ! Geza Wakawa ! ! ! ! ! Dingazi -

«Fichier Electoral Biométrique Au Niger»
«Fichier Electoral Biométrique au Niger» DIFEB, le 16 Août 2019 SOMMAIRE CEV Plan de déploiement Détails Zone 1 Détails Zone 2 Avantages/Limites CEV Centre d’Enrôlement et de Vote CEV: Centre d’Enrôlement et de Vote Notion apparue avec l’introduction de la Biométrie dans le système électoral nigérien. ▪ Avec l’utilisation de matériels sensible (fragile et lourd), difficile de faire de maison en maison pour un recensement, C’est l’emplacement physique où se rendront les populations pour leur inscription sur la Liste Electorale Biométrique (LEB) dans une localité donnée. Pour ne pas désorienter les gens, le CEV servira aussi de lieu de vote pour les élections à venir. Ainsi, le CEV contiendra un ou plusieurs bureaux de vote selon le nombre de personnes enrôlées dans le centre et conformément aux dispositions de création de bureaux de vote (Art 79 code électoral) COLLECTE DES INFORMATIONS SUR LES CEV Création d’une fiche d’identification de CEV; Formation des acteurs locaux (maire ou son représentant, responsable d’état civil) pour le remplissage de la fiche; Remplissage des fiches dans les communes (maire ou son représentant, responsable d’état civil et 3 personnes ressources); Centralisation et traitement des fiches par commune; Validation des CEV avec les acteurs locaux (Traitement des erreurs sur place) Liste définitive par commune NOMBRE DE CEV PAR REGION Région Nombre de CEV AGADEZ 765 TAHOUA 3372 DOSSO 2398 TILLABERY 3742 18 400 DIFFA 912 MARADI 3241 ZINDER 3788 NIAMEY 182 ETRANGER 247 TOTAL 18 647 Plan de Déploiement Plan de Déploiement couvrir tous les 18 647 CEV : Sur une superficie de 1 267 000 km2 Avec une population électorale attendue de 9 751 462 Et 3 500 kits (3000 kits fixes et 500 tablettes) ❖ KIT = Valise d’enrôlement constitués de plusieurs composants (PC ou Tablette, lecteur d’empreintes digitales, appareil photo, capteur de signature, scanner, etc…) Le pays est divisé en 2 zones d’intervention (4 régions chacune) et chaque région en 5 aires. -

Niger Mali Algeria Nigeria Chad Burkina Faso Benin Libya Cameroon
! ! p ! p ! ! !I-n-Amguel !Hirhafor thv !Tazrouk aao Murzuq Terhenanet !Recorded Priority #1, 2, & 3 Tit ! Tahîfet Abales!sa ! ! TAMANRASSET Languages of Libya Silet p pKOUROU ARKENNE ! Amsel ! Niger p Poste Ma! urice Cortier Algeria Tamanghasset Borkou-Ennedi-Tibesti tuq Adrar ! k Small city thv ! ! Populated place ! ! ! Bordj Le Prieur ! Railroads ! !!! ! ! Description ! Operational, Multiple Operational, Single; Operational, Unknown Unexamined/Unsurveyed thv ! ! ! ! Doubtful; Not Usable; Under Construction ! TESSALIT ! Countries VMap 0 tuq Provinces p Ti-n-Zaouâtene Languages ! Uninhabited/Unknown mey ! Recorded Priority 1 Languages Ki!dal Aney Agadez ! aao-NER, Arabic, Algerian Saharan Spoken Aguelhok Emi Tchouma! Tomdje-bNEoRu, Zcatrmoau Anefok Achénouma! Télabit ! Afassa ! taq ! ! bms dzg-NER, Dazaga Dirkou! fuh-NER, Fulfulde, Western Niger ¼DIRKOU fuq-NER, Fulfulde, Central-Eastern Niger Tchintoulous kby-NER, Kanuri, Manga Goûgaram ! Kidal ! k knc-NER, Kanuri, Central Dannet Mali Anou Zeggerin! krt-NER, Kanuri, Tumari ! bms Anefis i-n-Darane Timia mey-NER, Arabic, Hassaniyya ! ! shu-NER, Arabic, Shuwa I-n-Tebezas ! Adouda tda-NER, Tagdal ! ! Tel!oue!s Guermat ! thz-NER, Tamajeq, Tayart ! Edjouma Teguidda I-n-Tessoum ! ! Almoustarat ! ! ttq-NER, Tamajaq, Tawallammat ! Abardokh ttq !Teguidda In Tagait Tagadaba tuq-NER, Tedaga Tchirozérine Niger k Aguessis Bamba ! !Atri ! ! !! aao ! twq-NER, TasawBaaqou!ndo ! !Kira Taoussa ! I-N-Teguia ! ! ! ! ! ! Taguelalf Tin Daoulne ! ! Gargouné !! ! ! N!ana Dérièn Bourèm Guindou Alars¼as thz ! -

2019 Rapport Enquete SMART.Pdf
Rapport Final ENQUETE NATIONALE DE NUTRITION PAR LA METHODOLOGIE SMART Données collectées entre 16 août et 25 septembre 2019 Décembre 2019 Rapport Final de l’Evaluation nationale de la situation nutritionnelle par la méthodologie SMART Enquête conduite par INS (Institut National de la Statistique) Adresse : Direction Générale : 182, Rue de la SIRBA BP : 13 416 Niamey - Niger Téléphone : (227) 20 72 35 60/20 72 21 72/73 Fax : (227) 20 72 21 74 - NIF : 9617/R http:// www.stat-niger.org, e-mail : [email protected] Pour toute information complémentaire sur cette enquête, veuillez contacter : Dr Nassirou Ousmane Direction de la Nutrition, Président du comité de pilotage [email protected] M. Souleymane ALZOUMA Directeur des Enquêtes et Recensement à l’INS Email : [email protected] M. Ali OUSMANE Coordonnateur de l’Evaluation nutritionnelle (INS) Email : [email protected] Mme. Hélène Schwartz Spécialiste en Nutrition à l’UNICEF-Niger Email: [email protected] M. Adama N’DIAYE Spécialiste en Nutrition à l’UNICEF-Niger Email : [email protected] Mme. Bintou Dadare Tidjani Nutritionniste au PAM Email : [email protected] M. Ado Balla Abdoul Azizou Consultant Coordonnateur de l’Enquête Email : [email protected] Enquête nationale de nutrition avec la méthodologie SMART - 2019, Niger Page | 1 REMERCIEMENTS La réalisation et la réussite de cette enquête sont la résultante d’une large collaboration entre toutes les personnes impliquées depuis la conception jusqu’à la rédaction du rapport. L’INS tient ainsi à adresser toute sa reconnaissance aux autorités administratives nationales, régionales, départementales et communales ainsi qu’aux autorités coutumières et traditionnelles des localités enquêtées pour le bon accueil et les facilités offertes aux équipes de collecte. -

Évaluation De L'importance Du Parcours Gadoudhé, Dans L
Djibo et al. J. Appl. Biosci. 2016 Évaluation de l’importance du parcours Gadoudhé , dans l’alimentation du bétail de la commune rurale de Fabidji au Niger. Jo urnal of Applied Biosciences 106 :10 266 –10 273 ISSN 1997–5902 Évaluation de l’importance du parcours Gadoudhé, dans l’alimentation du bétail de la commune rurale de Fabidji au Niger. Ibrahim Djibo 1* , Mani Mamman 2, Amy Bakhoum 3, Oumar Sarr 3, Hamani Marichatou 1, Léonard .E. Akpo 3, Moussa Assane 4 1UAM/FA Laboratoire d’insémination artificielle et de production d’azote liquide, BP n° 10960 Niamey, NIGER 2UTA/FSA Département productions animales, BP n° 225 Tahoua, Niger 3UCAD/FST Laboratoire d’Écologie et d’Ecohydrologie, BP n° 5 005 Dakar – Fann, SENEGAL 4EISMV Laboratoire de physiologie et de pharmacodynamie, BP n° 5 077 Dakar – Fann, SENEGAL *Correspondance : Ibrahim Djibo, Email : [email protected] Original submitted in on 12th July 2016. Published online at www.m.elewa.org on 31 st October 2016 http://dx.doi.org/10.4314/jab.v106i1.6 RESUME Objectif : L’objectif est d’évaluer l’importance du parcours Gadoudhé , dans l’alimentation du bétail de la commune rurale de Fabidji au Niger. Méthodologie et résultats : Une enquête a été menée auprès des éleveurs de la commune rurale de Fabidji (Niger), sur l’utilité du parcours dans l’alimentation du bétail. Les résultats indiquent la présence dans la zone d’une flore riche de 47 espèces dont 27 herbacées et 20 ligneuses. Selon les éleveurs, la proportion du bétail fréquentant régulièrement le parcours est d’environ 2 500 têtes par espèce de ruminants, alors que la quantité du fourrage et les ressources hydriques du parcours, bien que sécurisé, sont insuffisantes pour assurer l’alimentation du bétail.