HIEN O. C.Mdi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Burkina Faso
STATUS OF AGRICULTURAL INNOVATIONS, INNOVATION PLATFORMS AND INNOVATIONS INVESTMENT Burkina-Faso Program of Accompanying Research for Agricultural Innovation www.research4agrinnovation.org Status of Agricultural Innovations, Innovation Platforms and Innovations Investments in Burkina-Faso iii Contributors to the study Souleymane Ouédraogo (2016). (2016). Status of Agricultural Innovations, Innovation Platforms, and Innovations Investment. 2015 PARI project country report: Republic of Burkina Faso. Forum for Agricultural Research in Africa (FARA), Accra Ghana FARA encourages fair use of this material. Proper citation is requested. Acknowledgements FARA: Yemi Akinbamijo, Fatunbi Oluwole Abiodun, Augustin Kouevi ZEF: Heike Baumüller, Joachim von Braun, Oliver K. Kirui Detlef Virchow, The paper was developed within the project “Program of Accompanying Research for Agricultural Innovation” (PARI), which is funded by the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ). iv Table of Contents Study Background vii Part 1: Inventory of Agricultural Technological Innovations Introduction 2 Methodology 3 Concepts and definitions 4 Function, Domain and Types of Innovations 5 Intervention areas 7 Drivers of Innovation 9 Effects of identified innovations 9 Inventory of innovation platforms (IP) 8 Inventory of technologies with high potential for innovation 11 Conclusion 14 Part 2: Inventory and Characterisation of Innovation Platforms Introduction 17 Methodology 18 Maize Grain IP in Leo 20 Choice of maize IP of Leo 22 The Concept -

Water Management of Upper Comoé Basin (Burkina Faso)
2010 Water management of the Upper Comoé river basin, Burkina Faso Dr. Julien Cour WAIPRO project (USAID) International Water Management Institute Ouagadougou, Burkina Faso 16/06/2010 Outlines 1. Introduction ..................................................................................................................... 4 1.1. Objectives ................................................................................................................. 6 1.2 Outlines of the report................................................................................................ 6 2. Water Management in the study area .............................................................................. 7 2.1 Generalities ................................................................................................................... 7 2.2 Water available and water uses ................................................................................ 9 3. Existing water management tools and their potential use ............................................. 14 3.1 Existing tools .......................................................................................................... 14 3.2 The « Comoé Simulation Tool » ........................................................................... 15 3.3 Uptake of the CST by the CLE committee (« comité restreint”) .......................... 18 3.4 Multi-stage stochastic linear program .................................................................... 20 3.5 Available Data ....................................................................................................... -

Burkina Faso
USAID’s Act to End Neglected Tropical Diseases | West Program FY2020 Annual Work Plan BURKINA FASO Burkina Faso FY20 Annual Work Plan October 1st, 2019 – September 30th, 2020 TABLE OF CONTENTS I. ACRONYMS ................................................................................................................................................. 3 II. TECHNICAL NARRATIVE ............................................................................................................................. 5 1. National NTD Program Overview ...................................................................................................... 5 2. IR1 ACTIVITIES PLANNED: LF, TRA, OV:.............................................................................................. 5 i. Lymphatic Filariasis ........................................................................................................................... 5 a. Previous and current FY activities and context ............................................................................ 5 b. Plan and justification for FY20 ..................................................................................................... 8 ii. Trachoma........................................................................................................................................ 12 a. Previous and current FY activities and context .......................................................................... 12 b. Plan and justification for FY20 .................................................................................................. -
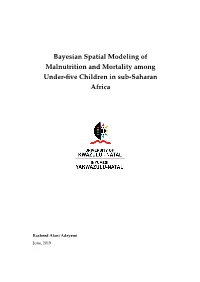
Bayesian Spatial Modeling of Malnutrition and Mortality Among Under-five Children in Sub-Saharan Africa
Bayesian Spatial Modeling of Malnutrition and Mortality among Under-five Children in sub-Saharan Africa Rasheed Alani Adeyemi June, 2019 Bayesian Spatial Modeling of Malnutrition and Mortality among Under-five Children in sub-Saharan Africa Rasheed Alani Adeyemi Master of Statistics, University of Ilorin, Kwara State, Nigeria Master of Mathematical Statistics, University of Cape Town, South Africa Bachelor of Technology (Ind. Mathematics), Federal University of Technology, Akure A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Thesis Supervisors: Professor Temesgen Zewotir Professor Shaun Ramroop School of Mathematics, Statistics and Computer Science College of Agriculture, Engineering and Science University of KwaZulu-Natal, South Africa Copyright in relation to this Thesis ©Copyright 2019. All rights reserved, University of KwaZulu-Natal, South Africa Dedication ‘Acquire knowledge, it enables its possessor to distinguish right from wrong; it lights the way to Heaven; it is our friend in the desert; our society in solitude, our companion when friendless; it guides us to happiness; it sustains us in misery” ::::::::::::::::::::: The Prophet Mohammad(pbuh). To: Nike my Lovely wife and friend & Halimat Adebusola(F) and Abdulbasit Adedeji(M) my blessed children. i Declaration of Authorship I, RASHEED ALANI ADEYEMI, declare that this thesis titled ’Bayesian spatial Model- ing of Malnutrition and Mortality among under-five children in sub-Saharan Africa’ and the work presented in it are my own. I confirm that: • This work was done wholly or mainly while in candidature for a research de- gree at this University. • No part of this thesis has previously been submitted for a degree or any other qualification at this University or any other institution. -

11.3. Zoning of Forest Reserves 11.3.1. Basic Idea of the Zoning
11.3. Zoning of Forest reserves 11.3.1. Basic idea of the Zoning The most important fact regarding zoning of the Gouandougou and Kongouko forest reserves in relation to the basic policies of the management plan for these forest reserves is that the creation of such village organizations as GGFs and a GGF Union as implementing bodies of the management plan will be unrealistic for some time to come. Accordingly, it will be essential for the administration/Forest Service to develop the basics for participatory forest reserve management in the future while conducting the management work (including educational activities and the control of illegal activities, i.e. law enforcement). In other words, the Forest Service should try to enhance the involvement of local villagers in the management of these forest reserves through the use of forest resources in the reserves. When full-scale participatory forest reserve management commences following the establishment of GGFs and a GGF Union in the future, it will be necessary to review the management plan in place, including the zoning plan, with reference to the situation in the Bounouna and Toumousséni forest reserves. Figure 11.2 shows the zoning plan for the Gouandougou forest reserve and Kongouko forest reserve respectively. These two forest reserves are endowed with relatively rich natural resources and the dependence and development pressure of residents of villages near these forest reserves are comparatively low. Accordingly, zones to promote the use of forest products by local villagers will be set up near the villages concerned to provide incentives for local villagers to conserve forest resources. -

PIATA 2019 Outcome Monitoring Report AGRA Burkina Faso Consolidated Report KIT Royal Tropical Institute, Amsterdam 30 April 2020
PIATA 2019 Outcome Monitoring Report AGRA Burkina Faso Consolidated report KIT Royal Tropical Institute, Amsterdam 30 April 2020 PIATA 2019 Outcome Monitoring Report – AGRA Burkina Faso 1/128 Colophon Correct citation: KIT, 2020. Burkina Faso Outcome Monitoring Report 2019, AGRA-PIATA Programme. Alliance for a Green Revolution in Africa, Nairobi; KIT Royal Tropical Institute, Amsterdam. Contributors: KIT fieldwork: Bertus Wennink, Helena Posthumus and Esther Smits KIT team: Geneviève Audet-Bélanger, Verena Bitzer, Coen Buvelot, Peter Gildemacher, Rob Kuijpers, Helena Posthumus, Boudy van Schagen, Elena Serfilippi, Esther Smits, Marcelo Tyszler, Bertus Wennink NAZAN Consulting: Adolphe Kadeoua, Gisèle Tapsoba-Maré and the team of enumerators from NAZAN Consulting Photo: International Institute of Tropical Agriculture (IITA) Language edit: WRENmedia This report has been commissioned by AGRA to monitor its PIATA programme progress in Burkina Faso. KIT Royal Tropical Institute Amsterdam, the Netherlands www.kit.nl AGRA Nairobi, Kenya www.agra.org PIATA 2019 Outcome Monitoring Report – AGRA Burkina Faso 2/128 Contents Colophon 2 Contents 3 Acronyms 5 List of tables 6 List of figures 9 1 Summary of results 10 1.1 Introduction 10 1.2 System analysis 11 1.3 Household survey 14 1.4 SME performance 15 2 Objectives and scope of the report 17 Part I: Qualitative system analysis 19 3 Introduction system analysis 20 3.1 Agricultural policy context 20 3.2 AGRA objectives and activities 21 4 Policy and state capability 23 4.1 System performance 23 4.2 -
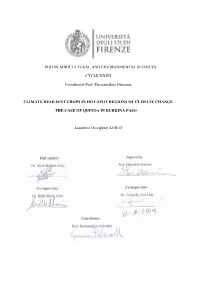
Phd in Agricultural and Environmental Sciences
PHD IN AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES CYCLE XXXII Coordinator Prof. Pietramellara Giacomo CLIMATE RESILIENT CROPS IN HOT-SPOT REGIONS OF CLIMATE CHANGE THE CASE OF QUINOA IN BURKINA FASO Academic Discipline AGR 02 I declare that this PhD thesis is my own work and that, to the best of my knowledge, it contains no material previously published or written by another person, nor material which to a substantial extent has been accepted for the award of any other degree or diploma of the university or other institute of higher learning, except where due acknowledgment has been made in the text. Correspondence: Jorge Alvar-Beltrán, Department of Agronomy, Food, Environmental and Forestry Sciences and Technology (DAGRI), University of Florence, Piazzale delle Cascine 18, 50144, Florence, Italy. Email address: [email protected]; Tel.: +39-2755741 TABLE OF CONTENTS……………………………………………………………………… p.1 ABSTRACT……………………………………………………………………………………. p.5 RIASSUNTO……………………………………………………………………..…….………. p.6 ACKNOWLEDGEMENTS…………………………………………………………………… p.9 LIST OF FIGURES……………………………………………………………………………. p.11 LIST OF TABLES……………………………………………………….….…………………. p.13 LIST OF ACRONOMYS……………………………………………………………………… p.15 LIST OF ACRONOMYS: UNITS & OTHERS………………………………..……………. p.16 CHAPTER 1: GENERAL INTRODUCTION 1.1. Background information………………………………………………………….…..…….. p.17 1.1.1. Observed and projected regional changes in precipitation……………..…………… p.17 1.1.2. Observed and projected regional changes in temperature…………………..………. p.18 1.1.3. The vulnerability of Burkina Faso to climate change………………….……..……... p.19 1.1.4. Agricultural adaptation to climate change………………………….………..……… p.19 1.2. Justification of the topic and gaps in literature ………….………………………………… p.21 1.3. Research questions and problems addressed………………………………………………. p.22 1.4. Research aims and objectives………………...………………...………………………….. p.23 1.5. Structure of the research…………………………………………………………………… p.24 1.6. -

Final Report Agra Baseline Survey Burkina Faso
AGRA BASELINE SURVEY AGRA Baseline Study in Burkina Faso BURKINA FASO FINAL REPORT AGRA Baseline Study in Burkina Faso Submitted to the Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) By Institute of Statistical, Social and Economic Research (ISSER), University of Ghana Contributors: Robert D. Oseia, Isaac Osei-Akotoa, Felix A. Asantea, Stephen Afranieb, Aba O. Crentsila, Louis S. Hodeya, Pokuaa Adua, Kwabena Adu-Ababioa, Samuel Dakeya, and Makafui Dzudzora a Institute of Statistical, Social and Economic Research (ISSER), University of Ghana b Centre for Social Policy Studies, University of Ghana Email of Corresponding Author: [email protected] June 2017 AGRA Baseline Study in Burkina Faso Table of Content TABLE OF CONTENT .......................................................................................................................... I LIST OF TABLES ................................................................................................................................. I LIST OF FIGURES ............................................................................................................................. III ACRONYMS AND ABBREVIATIONS .................................................................................................. IV EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................................... 1 INTRODUCTION ........................................................................................................................ 1 BACKGROUND -

Line-Transect Data May Not Produce Reliable Estimates of Interannual Sex-Ratio and Age Structure Variation in West African Savannah Ungulates
Tropical Zoology, 2020 Vol. 33 | Issue 1 | 14-22 | doi:10.4081/tz.2020.67 Line-transect data may not produce reliable estimates of interannual sex-ratio and age structure variation in West African savannah ungulates Emmanuel M. Hema1-3, Yaya Ouattara4, Maomarco Abdoul Ismael Tou4, Giovanni Amori5*, Mamadou Karama4 and Luca Luiselli3,6,7 1Université Dédougou, UFR/Sciences Appliquées et Technologiques, Dédougou, Burkina Faso; 2Laboratoire de Biologie et Ecologie Animales, Université Ouaga 1 Prof Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou Burkina Faso; 3Institute for Development, Ecology, Conservation and Cooperation, Rome, Italy; 4Secrétariat Exécutif, AGEREF/CL, Banfora, Burkina Faso; 5Research Institute on Terrestrial Ecosystems, CNR, Rome, Italy; 6Department of Applied and Environmental Biology, Rivers State University of Science and Technology, Port Harcourt, Nigeria; 7Département de Zoologie, Faculté des Sciences, Université de Lomé, Togo Received for publication: 30 April 2019; Revision received: 8 March 2020;only Accepted for publication: 13 March 2020 Abstract: Adult sex ratios and age structures are importantuse wildlife population parameters, but they have been poorly investigated in ungulate species in West African savannahs. We used line transects to investigate these parameters in 11 ungulates from a protected area in south-western Burkina Faso during the period 2010-2018. We created an empirical model of “detectability” for each species based on its main ecological characteristics (habitat and group size) and body size, and then compared the observed interannual inconsistency in sex ratios and age structures with the a priori detectability score. Six out of 11 species showed low interannual inconsistency in sex ratio and age structure. In 82% of the study species, however, the predicted detectability score matched the observed score, with two exceptions being Tragelaphus scriptus and Sincerus caffer. -

BURKINA FASO Staple Food and Livestock Market Fundamentals 2017
FEWS NET BURKINA FASO Staple Food and Livestock Market Fundamentals 2017 BURKINA FASO STAPLE FOOD AND LIVESTOCK MARKET FUNDAMENTALS SEPTEMBER 2017 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Chemonics International Inc. for the Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), contract number AID-OAA-I-12-00006. The Famine Early Warning Systems Network i authors’ views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States government. FEWS NET BURKINA FASO Staple Food and Livestock Market Fundamentals 2017 About FEWS NET Created in response to the 1984 famines in East and West Africa, the Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) provides early warning and integrated, forward-looking analysis of the many factors that contribute to food insecurity. FEWS NET aims to inform decision makers and contribute to their emergency response planning; support partners in conducting early warning analysis and forecasting; and provide technical assistance to partner-led initiatives. To learn more about the FEWS NET project, please visit www.fews.net. Disclaimer This publication was prepared under the United States Agency for International Development Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) Indefinite Quantity Contract, AID-OAA-I-12-00006. The authors’ views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States government. Acknowledgments FEWS NET gratefully acknowledges the network of partners in Burkina Faso who contributed their time, analysis, and data to make this report possible. -

Burkina Faso
Ramsar Sites Information Service Annotated List of Wetlands of International Importance Burkina Faso 25 Ramsar Site(s) covering 1,940,481 ha Barrage de Bagre Site number: 1,874 | Country: Burkina Faso | Administrative region: Centre-Est et Centre-Sud Area: 36,793 ha | Coordinates: 11°34'57"N 00°41'13"E | Designation dates: 07-10-2009 View Site details in RSIS The Bagré Dam, located in the northern Sudanian phytogeographic area, is composed of an artificial permanent freshwater lake and the irrigated lakeside land. The Site is very rich in biodiversity: it is home to trees and shrubs such as Lannea acida, Vitellaria paradoxa, Tamarindus indica, Khaya senegalensis, Acacia albida and Acacia gourmaensis, and to fish, amphibian, mollusc and aquatic reptile communities. The hippopotamus is the most notable species on the Site, with a total estimated number of 100 individuals. Their presence indirectly supports several valued species of fish in the lake, so they too are valued and protected. The Site is valuable not only for biodiversity conservation but also erosion control, sediment and nutrient retention, storm protection and groundwater replenishment. The stable waters of the lake enable numerous socio-economic and agricultural activities. Poor farming practices have led to soil erosion on the banks and resulting siltation. Barrage de la Kompienga Site number: 1,875 | Country: Burkina Faso | Administrative region: à cheval entre la Région de l'Est (en grande partie) et la région du Centre-Est Area: 17,545 ha | Coordinates: 11°11'N 00°36'59"E | Designation dates: 07-10-2009 View Site details in RSIS Situated in the east of the country, the Site comprises a permanent freshwater lake, as well as human- made features including several irrigated land areas and a dam which is principally used for the production of hydroelectricity. -

Burkina Faso
Burkina Faso: June – October 2018 Chronology of Violent Incidents Related to Al-Qaeda affiliates Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM) and Ansaroul Islam, and Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) November 1st , 2018 By Rida Lyammouri Disclaimer: This report was compiled from open-source documents, social media, news reports, and local participants. 2016-2018 Sahel MeMo LLC All Rights Reserved. Burkina Faso: June – October 2018 Takeaways and Trends • Militants activity in Burkina Faso have been on the rise for the past two years. Since June 2018 Sahel MeMo observed similar trend with an expansion from Northern parts bordering Mali and Niger, to the Est Region on the borders with Benin, Niger, and Togo. Militant groups have been trying to establish a base there since early 2016, explaining groups’ ability to carry complex deadly attacks, including the use of improvised explosive devices (IEDs). • Violence in the eastern part of Burkina Faso by militant groups most likely to continue. In addition to targeting security forces and intimidation acts against civil servants, militants will look to continue to disrupt gold mining in the area. In fact, security forces in charge of protecting gold mines or escorting staff have been subject to attacks by militants at least in August 2018. If this to continue, livelihoods of local communities benefiting from gold mining could be at risk if security situation continues to deteriorate in the region. • These attacks are mostly attributed rather than claimed by militant groups known to operate in Burkina Faso. These militant groups include Ansaroul Islam, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimeen (JNIM), and Islamic State in the Greater Sahara (ISGS).