Monuments Historiques Du Xxème Siècle En
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
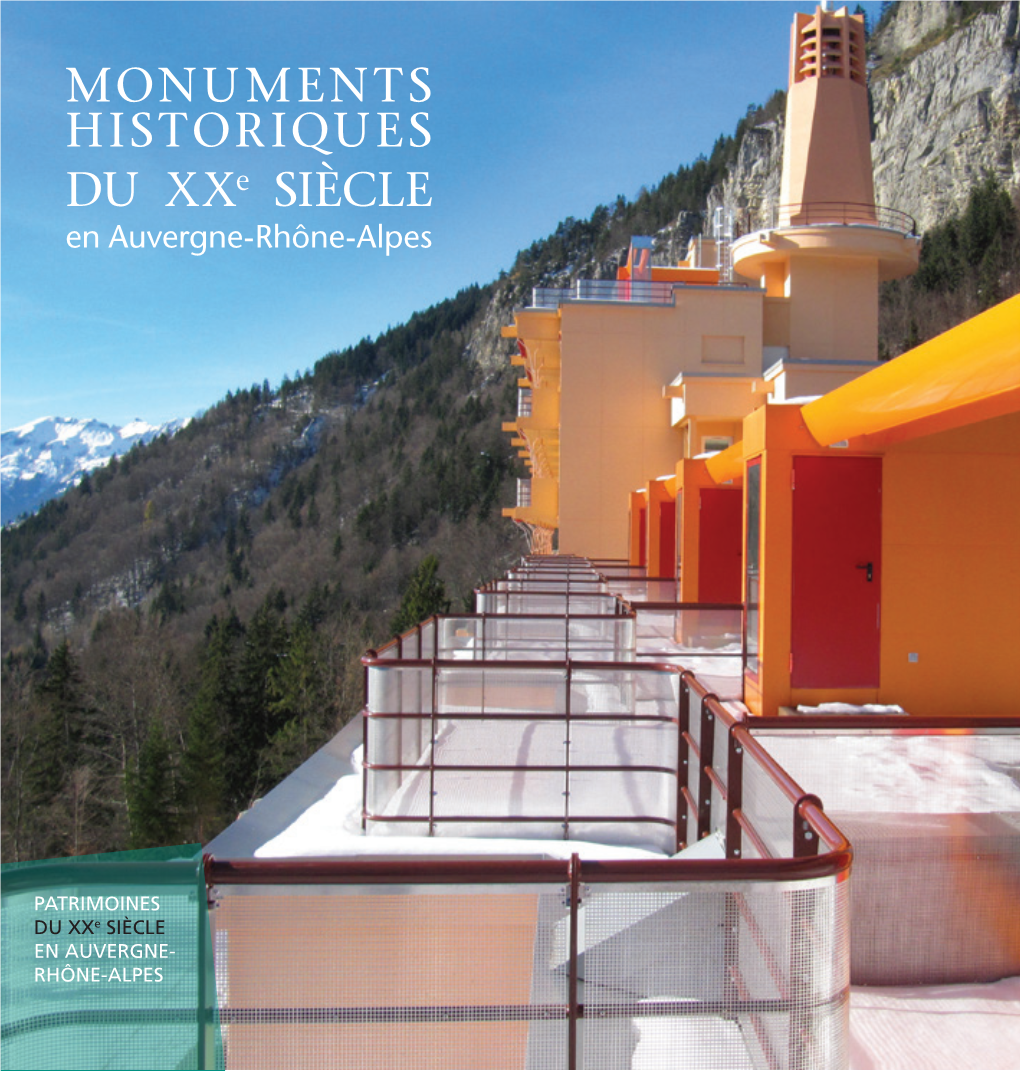
Load more
Recommended publications
-

Les Grandes Dates
Les grandes dates «Vigueur persistante et fécondité» Cette chronologie du «service des monuments historiques» traite aussi bien du domaine des immeubles, de leurs abords, des espaces protégés, que des objets mobiliers et des orgues. Elle évoque aussi le domaine de l'archéologie et de l'inventaire général du patrimoine culturel et l'émergence des associations de sauvegarde, des associations de professionnels et des organisations internationales. Ministère de la culture et de la communication - direction générale des patrimoines - octobre 2013 1789 - 1913 1789 Décret des 2-4 novembre 1789 qui met les biens ecclésiastiques «à la la disposition de la Nation». Cette disposition concerne autant les biens du clergé régulier que les édifices du culte et les meubles les garnissant. Sauf aliénation intervenue postérieurement (par exemple dans le cadre de la vente des biens nationaux), tous les édifices du culte et tous les objets mobiliers qu'ils contiennent, et qui sont antérieurs à 1789, sont propriété publique. Un avis du Conseil d'État du 2 pluviôse an XIII a précisé que cette appropriation publique s'était faite au profit des communes en ce qui concerne les églises paroissiales ; seules les cathédrales, sièges d'évêchés, sont propriété de l'État (ainsi que quelques édifices acquis ou réaffectés au culte postérieurement). 1790 Instruction du 13 octobre 1790 chargeant les directoires des départements et la municipalité de Paris de «dresser l'état et de veiller à la conservation des monuments, des églises et maisons devenus domaines nationaux». La Commission des monuments organisée en 10 sections se réunit à compter du 8 novembre 1790 : les savants rassemblés dans cette commission doivent donner leur avis sur la vente ou le recueil pour la Nation des livres, monuments, chartes, et autres objets scientifiques. -

Fiche De Synthèse La Protection Du Patrimoine Et Sa Genèse1
Fiche de Synthèse Pierre-Alain FOUR 01-09-2003 Agenda métropolitain- Automne 2003- Gros plan : Quand le Patrimoine devient un ressort de la modernité La protection du patrimoine et sa genèse1 Introduction « Dans notre vie culturelle contemporaine, peu de mots ont autant de pouvoirs d’évocation que celui de « patrimoine ». Il évoque pêle-mêle l’authenticité de certains objets, leur valeur, le poids de la tradition ou le respect à l’égard du passé, un appareil législatif et réglementaire, des institutions, des usages touristiques et savants, une architecture du réemploi, voire un développement culturel » remarque Dominique Poulot dans Patrimoine et Musées2. Omniprésente dans notre quotidien, la notion de patrimoine, dans son acception contemporaine, se développe à partir du début du XIXè. Dominique Poulot note encore que « La notion de patrimoine ne s’est imposée, dans la sorte d’évidence qui est aujourd’hui la sienne, qu’à l’issue d’un processus complexe, de très longue durée, et profondément culturel ». Elle a donc connu des évolutions intenses et, d’une certaine façon, similaires à celles des sciences sociales passant du positivisme rationaliste du XIXè siècle au soupçon contemporain. Aujourd’hui, nous insistons sur les conditions socio-économiques qui fabriquent un point de vue sur telle ou telle question et le patrimoine n’échappe pas à cette mise en perspective. On ne peut aborder la question de la politique de protection du patrimoine hors du contexte sociétal qui lui a permis de voir le jour. Et parfois, telle restauration nous en apprend plus sur les mentalités d’une époque que le bâtiment lui-même : la notion de patrimoine était comprise différemment, ne serait-ce que parce que les conditions qui en ont permis l’émergence étaient différentes de celles qui la sous-tendent aujourd’hui. -

A Journey Through Time
A journey through time The 30 churches of the Saint-Emilion area THE GRAND SAINT-ÉMILIONNAIS: LAND OF CHURCHES The Grand Saint-Émilionnais offers a rich heritage highlighted by the presence of vines, punctuated by historical monuments from different periods and architectures, shaping our typical villages and hamlets. Romanesque, Gothic or monolithic churches punctuate our territory, such as landmarks for visitors strolling from the Dordogne riverbanks to the limestone plateau. This preserved and valued heritage make the Grand Saint- Emilionnais an exceptional territory. We wish you a pleasant discovery of the Saint-Émilion area! THE 22 TOWNS OF THE SAINT-ÉMILION AREA Belvès de Castillon 3 Francs 3 Gardegan et Tourtirac 4 Les Artigues de Lussac 5 Lussac 5 Montagne 6 Néac 7 Petit-Palais et Cornemps 7 Puisseguin 8 Saint-Christophe des Bardes 8 Sain-Cibard 9 Saint-Émilion 10 Saint-Etienne de Lisse 11 Saint-Genés de Castillon 11 Saint-Hippolyte 12 Saint-Laurent des Combes 12 Saint-Pey d’Armens 13 Saint-Phillipe d’Aiguille 13 Saint-Sulpice de Faleyrens 13 Sainte-Terre 14 Tayac 14 Vignonet 14 LEXICON 15 2 Belvès de Castillon Notre Dame de Belvès de Castillon The church was built in the 19th century at the place of an older one in a neo Romanesque style which was very popular in that time. Its simplicity reminds us of the medieval past of this parish. Only the bell tower suggests that the current church is newer. Every day (no schedules available) This church shelters a Merovingian GPS: 44°52'42.1"N 0°01'53.5"W capital, which is listed as a “Monument historique” (French national heritage). -

MONUMENT HISTORIQUE La Neuve Lyre (27)
16MAGAZINE n° Octobre 2014 Monument ACTUALITÉS historique P2 Château CONCOURS de la Chapelle P.4 Les Compagnons P4 Château de Chambord P6 Château de Vaux-le-Vicomte P8 Abbaye Royale de St-Jean-d’Angely P10 Basilique Sainte-Clotilde P12 Édito Vous le constaterez, ce numéro est largement consacré pas un travail de machine, pas plus que ne le sont nos aux restaurations des monuments français. Les ouvrages partenariats. C’est pourquoi, nous devons être proches sont prestigieux tant en valeur symbolique, patrimoniale de vous et disponibles dès que nécessaire. Nous devons que technique. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer multiplier nos rencontres et nos moments d’échanges à ce bel effort de rénovation de nos patrimoines et tous privilégiés. ces succès sont véritablement encourageants pour nous. Cela nous amène à rester d’autant plus humbles à l’heure Tout prochainement, nous serons présents à Artibat de choisir nos pierres, sélectionner nos ardoises et effec- (Rennes) et au Salon international du patrimoine cultu- tuer de multiples tris. rel (Paris). Vous y retrouverez les « standards » CUPA, autant que vous pourrez y découvrir les nouveautés de Le paysage ardoisier se réorganise et plus que jamais, le l’année. souhait de CUPA est de continuer à être la référence en matière de qualité des produits, qualité des services et Ces rendez-vous sont essentiels pour vous, comme pour qualité de sa présence commerciale. nous. Nos équipes s’étoffent, nos méthodes se structurent, C’est la rencontre et la convivialité. C’est le métier ! nos exigences se spécifient. Pour autant, l’ardoise n’est ERWAN GALARD Responsable de la communication et du marketing SALONS Cette année, le Salon International du Patrimoine Culturel fête son 20ème anniversaire Du 6 au 9 novembre au Carrousel du Louvre C’est l’événement de référence qui fédère les profession- nels de la restauration et de la sauvegarde du patrimoine qu’il soit bâti ou non bâti, matériel ou immatériel. -

20190609 France & Germany-190124-1-D-S
Phone: 951-9800 Toll Free:1-877-951-3888 E-mail: [email protected] www.airseatvl.com 50 S. Beretania Street, Suite C - 211B, Honolulu, HI 96813 Arc de Triomphe Cities Covered: Berlin, Potsdam, Cologne,Traveling Koblenz, Dates: Rudesheim, Frankfurt, Heidelberg, Rothenburg, Nuremberg, Munich, Hohenschwangau, Lindau, Meersburg,Jun Titisee, 30 – Baden Jul 17, Baden, 2019 Strasbourg, (18 Days) Colmar, Dijon, Beaune, Fontainebleau, and Paris Price per person: $ 7,488 Incl: Tax & Fuel Charge Single Supp: $ 1,950 Eiffel Tower The Louvre Museum Neuschwanstein Castle The Package Includes Roundtrip International Flight from Honolulu * 44 Meals & Admissions as Stated * UNESCO World Heritage Sites: * • Sanssouci Palace and Park • Cologne Cathedral Church • Rüdesheim am Rhein • Strasbourg's historic city center • Palace of Fontainebleau • Paris, Banks of the Seine • The Palace of Versailles The Louvre Museum, Notre Dame de Paris, Place Charles de Gaulle, The Avenue des Champs Elysees, * Place De La Concorde, Arc de Triomphe & More… Wine tasting at: * • Rudesheim am Rhein, Germany • Beaune, France 90 minute thermal bath at Caracalla Spa * Seine River Cruise in Paris * Evening Panorama Cruise on the Rhine River * FREE * Moulin Rouge Dinner Show Use of * Hotel City Tax in each City Wireless * Gratuity for Tour Guide & Drivers Tour Guide System Day 1 ** Jun 30 Honolulu Newark Berlin We start our vacation by boarding an international flight bound for Berlin, the capital of Germany. Meals and snacks will be served on the plane. Day 2 ** Jul 1 Overnight at onboard We will do a transit at Newark Airport, and overnight onboard. Meals and snacks will be served on the plane. -

Amiens Métropole
Villes et Pays dart et dhistoire Amiens Métropole laissez-vous conter Les Journées Européennes du Patrimoine 14 & 15 septembre 2013 1913-2013 : cent ans de protection du 7 au 19 septembre La porte du ravelin de Montrescu, dite aussi porte François Ier, ici représentée par les frères Duthoit, est l’un des plus anciens éléments du site de la citadelle et le premier à avoir été classé monument historique sur la liste de 1840. DITO Transmettre et partager ! un enjeu majeur pour les patrimoines d’Amiens Métropole Cette année, la thématique du ministère de la Culture - « 1913-2013 : cent ans de protection » - se propose de commémorer la loi fondatrice pour la protection des monuments historiques Een France, celle du 31 décembre 1913. Par la même occasion, elle vise à célébrer le 30e anniversaire des Journées européennes du patrimoine, un évènement de la rentrée cher aux Amiénois. Mais que signifie au juste le classement au titre des monuments historiques ? Les arguments juridiques de ce classement tirent leur origine de la volonté d’épargner les chefs- d’œuvre de l’art et les monuments qui portent le témoignage des saccages de la Révolution française. Outre la prise de conscience patrimoniale de l’Etat, c’est la mobilisation de chaque acteur (professionnel, propriétaire et gestionnaire, privés et publics…) mais aussi celle de chacun d’entre nous, qui s’impose pour mener à chaque instant une lutte déterminée et affronter l’usure du temps et les atteintes de toutes sortes. L’évolution du processus de préservation et de conservation s’inscrit également dans un mouvement étroitement lié au sentiment d’appartenance à la nation et à la construction identitaire de la France et de ses territoires. -

Regards Sur L'objet Monument Historique En Languedoc-Roussillon
p a t r i m o i n e p r o t é g é Monuments en mémoire Communication Regards sur l’objet Monument historique et de la en Languedoc-Roussillon Œuvres d’art, décors et ensembles historiques Culture monuments historiques et objets d’art du Languedoc-Roussillon Ministère de la Ministère d i r e c t i o n r é g i o n a l e d e s a f f a i r e s culturelles Auteurs Hélène Palouzié [HP] Chargée de mission auprès de la crmh, drac lr Conservateur des antiquités et objets d’art de l’Hérault Delphine Christophe [DC] Conservateur régional des Monuments historiques, crmh, drac lr Alain Daguerre de Hureaux [ADH] Directeur régional des affaires culturelles, drac lr Philippe Hertel [PH] Conservateur en chef du patrimoine, crmh, drac lr Laurent Hugues [LH] Conservateur en chef du patrimoine, crmh, drac lr Jean-Bernard Mathon [JBM] Directeur du Centre de conservation restauration du patrimoine, Conseil général des Pyrénées-Orientales Conservateur des antiquités et objets d’art des Pyrénées-Orientales Olivier Poisson [OP] Conservateur général du patrimoine Avec la participation de : François Amigues Conservateur des antiquités et objets d’art de l’Aude Guillaume Bernard Conservateur des antiquités et objets d’art du Gard Isabelle Darnas Conservateur en chef du patrimoine, Conseil général de la Lozère Conservateur des antiquités et objets d’art de la Lozère Jean-Jacques Fauré Conservateur délégué des antiquités et objets d’art de l’Aude Couverture : Hérault, Montpellier, hôtel de Lunas. Panneau de laque sur bois (détail), vers 1714. -

Le Centre Des Monuments Nationaux Présente L'exposition La Splendeur
Dossier de presse, le 5 décembre 2018 Le Centre des monuments nationaux présente l’exposition La splendeur retrouvée de la basilique Saint-Denis François Debret (1777-1850) architecte romantique à la basilique cathédrale de Saint-Denis du 30 novembre 2018 au 24 novembre 2019 Contacts presse : Basilique de Saint-Denis : Joséphine Marino, chargée d’actions culturelles : 01 49 21 14 84 Serge Santos, administrateur : 06 20 38 43 34 Pôle presse du CMN : Su-Lian Neville 01 44 61 22 96 [email protected] Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN : presse.monuments-nationaux.fr Communiqué de presse Le Centre des monuments nationaux propose à la basilique Saint-Denis de redécouvrir un aspect méconnu de l’histoire de ce monument historique grâce à l’exposition « La splendeur retrouvée de la basilique Saint-Denis, François Debret (1777-1850) architecte romantique » du 30 novembre 2018 au 24 novembre 2019. Au lendemain de la Révolution et alors que se construit la notion de patrimoine, le cas de la restauration de la basilique Saint-Denis permet d’éclairer la pratique artistique et architecturale en cette première moitié du XIXe siècle. Cette exposition a été l’occasion de réaliser une application de visite permettant d’explorer les verrières créées par François Debret, qui constituent la majorité des vitraux aujourd’hui en place, et d’en découvrir l’iconographie. De 1806 à 1885, la basilique Saint-Denis fut affectée au culte de la mémoire des souverains. Pendant la Révolution, l’ancienne abbatiale avait été vandalisée. Au XIXe siècle des travaux considérables furent décidés sous chaque régime en fonction du contexte politique et des modes successives. -

Napoleon's Legacy the Development of National Museums in Europe
Napoleon’s Legacy The Development of National Museums in Europe 1794-1830 International conference 31 January - 2 February 2008 Universiteit van Amsterdam Napoleon’s Legacy The Development of National Museums in Europe 1794-1830 International conference Organized by the Huizinga Research Institute of Cultural History (Amsterdam) and the Institute for Museum Research (Berlin). Thursday, 31 January - Saturday, 2 February 2008 Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231 and University Library (Doelenzaal), Singel 425, Universiteit van Amsterdam The French Revolution and the subsequent Napoleonic Wars had a major impact on European museums. Between 1794 and 1813 enormous quantities of artworks, natural specimens, scientific objects, books and manuscripts from collections in the conquered areas in Germany, the Netherlands, Italy, Austria and Spain were transported to Paris by the French armies. During a relatively short period of 15 years the general public had the opportunity to admire an overview of what, for the first time in history, might be labelled ‘European heritage’, exhibited in the Louvre and the Musée d’histoire naturelle. These outstanding French museums made a great impression on the visitors and (museum) officials from abroad but at the same time evoked criticism and strengthened the need for the countries which had been robbed of their artistic and scientific treasures to create their own national museums. In this atmosphere it was only logical that after Napoleon’s final defeat at Waterloo (1815) the Allied Powers reclaimed their artistic and scientific collections. When some of the confiscated objects returned to their places of origin, their arrival back home formed an extra stimulus for the (re)institution of public museums, in Berlin, Brussels, The Hague, Madrid, Vienna, Rome, Milan and Parma, for example. -

Légende Index Des Sites Site Patrimonial
1. Monument commémoratif 3. Place Saint-Étienne 5. Maison Site de la guerre 14-18 « Romano-Gothique » Patrimonial Remarquable Le centre historique de Toulouse est reconnu Site Patrimonial Remarquable (ancien Secteur Hommage rendu par le département de la Haute-Garonne à ses enfants, cet arc Située à l’emplacement de thermes Au n° 15 de la rue Croix-Baragnon s’élève Sauvegardé) depuis le 21 août de triomphe n’oublie pas de rappeler antiques, elle fut ensuite un cimetière puis l’une des plus anciennes demeures de 1986. Il s’étend sur 254 hectares un lieu de rassemblement au Moyen Âge : l’horreur de la guerre. Achevée en la ville – et peut-être la plus photogra- dont 230 ha sur l’emprise de la 1928, cette œuvre de l’architecte Léon Philippe le Bel y tint justice en 1303. La phiée ! Bâtie entre la fin du XIIIe et le Jaussely, inscrite au titre des Monuments place accueille en son centre la fontaine début du XIVe siècle, c’est l’une des plus ville et 24 ha couvrant la Garonne. Griffoul, première fontaine publique de Historiques, s’inspire 8iomphe dont il anciennes constructions civiles subsis- En 2016, le Plan de Sauvegarde Toulouse, commandée à Jean Rancy par reprend l’aspect tripartite surmonté d’une tant à Toulouse. Doublée en profondeur et de Mise en Valeur est relancé, frise. les capitouls en 1549. Bien conservée, e elle fait l’objet de modifications ulté- côté cour au XVII siècle, surélevée d’un il accompagne les actions de Trois sculpteurs toulousains ont travaillé à troisième étage en 1923, la maison est son ornementation. -

How Art Museums in the French Revolution Crafted a National Identity, 1789-1799 Anna E
Claremont Colleges Scholarship @ Claremont Scripps Senior Theses Scripps Student Scholarship 2015 Making History: How Art Museums in the French Revolution Crafted a National Identity, 1789-1799 Anna E. Sido Scripps College Recommended Citation Sido, Anna E., "Making History: How Art Museums in the French Revolution Crafted a National Identity, 1789-1799" (2015). Scripps Senior Theses. Paper 663. http://scholarship.claremont.edu/scripps_theses/663 This Open Access Senior Thesis is brought to you for free and open access by the Scripps Student Scholarship at Scholarship @ Claremont. It has been accepted for inclusion in Scripps Senior Theses by an authorized administrator of Scholarship @ Claremont. For more information, please contact [email protected]. MAKING HISTORY: HOW ART MUSEUMS IN THE FRENCH REVOLUTION CRAFTED A NATIONAL IDENTITY, 1789-1799 by ANNA ELIZABETH SIDO SUBMITTED TO SCRIPPS COLLEGE IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE DEGREE OF BACHELOR OF THE ARTS PROFESSOR ERIC HASKELL PROFESSOR PRIYANKA BASU PROFESSOR MARY MACNAUGHTON APRIL 24, 2015 ACKNOWLEDGEMENTS 3 INTRODUCTION: ART AS A POLITICAL TOOL 4 CHAPTER ONE: THE MUSÉE CENTRAL DES ARTS 9 ROYAL ART IN THE REVOLUTION 9 PUBLIC MUSEUM PLANS AND PRIVATE COLLECTING IN THE ANCIEN RÉGIME 11 16 ENLIGHTENMENT BELIEFS ON HOW TO VIEW ART 21 26 31 CHAPTER TWO: THE MUSÉE DES MONUMENTS FRANÇAIS 36 36 41 45 50 54 CONCLUSION 57 APPENDIX A: LIST OF FIGURES 60 APPENDIX B: TIMELINE OF THE REVOLUTION 70 BIBLIOGRAPHY 72 2 Like most of the important decisions I have made at Scripps, this project started in Professor MacNaughton’s office, when I stopped in to ask what started as a simple question about thesis requirements. -

Sharing Paris: the Use and Ownership of a Neighborhood, Its Streets and Public Spaces, 1950-2012
Sharing Paris: The Use and Ownership of a Neighborhood, Its Streets and Public Spaces, 1950-2012 By Alexander Michael Toledano A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Tyler Stovall, Chair Professor David Henkin Professor Stanley Brandes Fall 2012 Abstract Sharing Paris: The Use and Ownership of a Neighborhood, Its Streets and Public Spaces, 1950-2012 by Alexander Michael Toledano Doctor of Philosophy in History University of California, Berkeley Professor Tyler Stovall, Chair This dissertation examines a lively lower-middle-class, immigrant neighborhood in the 10th arrondissement of Paris, the Faubourg Saint-Denis, from 1950 into the twenty-first century, and explores the history of everyday life in its streets and public spaces. It connects the neighborhood’s evolution to larger changes in urban redevelopment policies and municipal politics in Paris. This study challenges a core assumption held by scholars about urban neighborhoods: that everyday life and communities are shaped primarily by residents. Residents have historically been the focus of neighborhood scholarship because they are easily accessible to scholars in most archival sources and because they have been viewed as the stabilizing force that keeps chaotic cities civilized. Since the 1950s and even during the nineteenth-century, however, non-residents have been found at the core of local communities in Paris, especially in its busiest neighborhoods. These parts of the city, often centered around marketplaces and market streets, such as Les Halles, have remained vibrant due to the important role played by non-residents, many of whom have commuted long distances to them every day not only to work, but also to shop, and to socialize.