Costantini Final
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
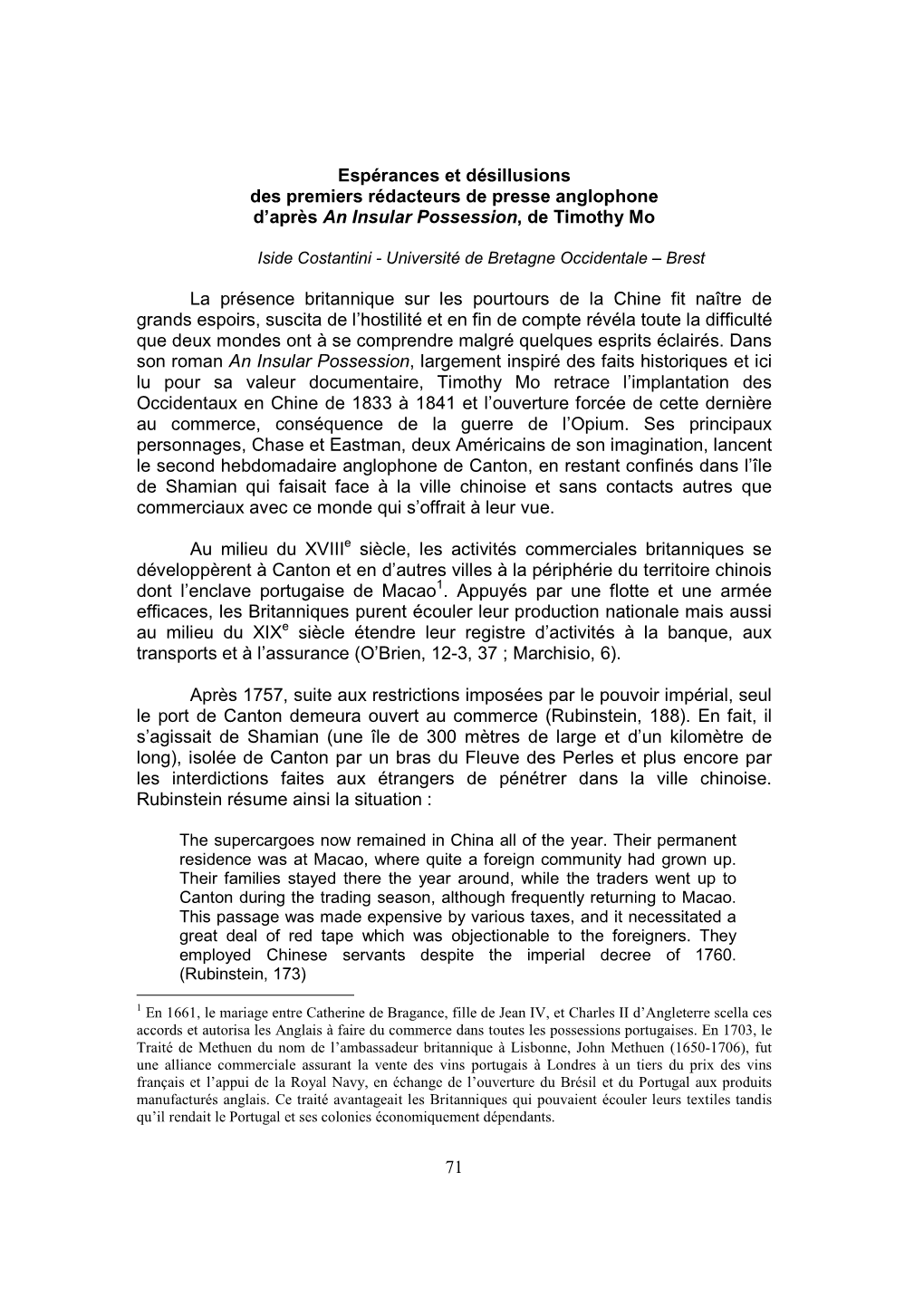
Load more
Recommended publications
-

Englischer Diplomat, Commissioner Chinese Maritime Customs Biographie 1901 James Acheson Ist Konsul Des Englischen Konsulats in Qiongzhou
Report Title - p. 1 of 348 Report Title Acheson, James (um 1901) : Englischer Diplomat, Commissioner Chinese Maritime Customs Biographie 1901 James Acheson ist Konsul des englischen Konsulats in Qiongzhou. [Qing1] Aglen, Francis Arthur = Aglen, Francis Arthur Sir (Scarborough, Yorkshire 1869-1932 Spital Perthshire) : Beamter Biographie 1888 Francis Arthur Aglen kommt in Beijing an. [ODNB] 1888-1894 Francis Arthur Aglen ist als Assistent für den Chinese Maritime Customs Service in Beijing, Xiamen (Fujian), Guangzhou (Guangdong) und Tianjin tätig. [CMC1,ODNB] 1894-1896 Francis Arthur Aglen ist Stellvertretender Kommissar des Inspektorats des Chinese Maritime Customs Service in Beijing. [CMC1] 1899-1903 Francis Arthur Aglen ist Kommissar des Chinese Maritime Customs Service in Nanjing. [ODNB,CMC1] 1900 Francis Arthur Aglen ist General-Inspektor des Chinese Maritime Customs Service in Shanghai. [ODNB] 1904-1906 Francis Arthur Aglen ist Chefsekretär des Chinese Maritime Customs Service in Beijing. [CMC1] 1907-1910 Francis Arthur Aglen ist Kommissar des Chinese Maritime Customs Service in Hankou (Hubei). [CMC1] 1910-1927 Francis Arthur Aglen ist zuerst Stellvertretender General-Inspektor, dann General-Inspektor des Chinese Maritime Customs Service in Beijing. [ODNB,CMC1] Almack, William (1811-1843) : Englischer Teehändler Bibliographie : Autor 1837 Almack, William. A journey to China from London in a sailing vessel in 1837. [Reise auf der Anna Robinson, Opiumkrieg, Shanghai, Hong Kong]. [Manuskript Cambridge University Library]. Alton, John Maurice d' (Liverpool vor 1883) : Inspektor Chinese Maritime Customs Biographie 1883 John Maurice d'Alton kommt in China an und dient in der chinesischen Navy im chinesisch-französischen Krieg. [Who2] 1885-1921 John Maurice d'Alton ist Chef Inspektor des Chinese Maritime Customs Service in Nanjing. -

Samuel Russell Wadsworth House
NATIONAL HISTORIC LANDMARK NOMINATION NPS Form 10-900 USDI/NPS NRHP Registration Form (Rev. 8-86) OMBNo. 1024-0018 SAMUEL WADSWORTH RUSSELL HOUSE United States Department of the Interior, National Park Service_____________ National Register of Historic Places Registration Form 1. NAME OF PROPERTY Historic Name: Russell, Samuel Wadsworth, House Other Name/Site Number: Honors College, Wesleyan University 2. LOCATION Street & Number: 350 High Street Not for publication: N/A City/Town: Middletown Vicinity: N/A State: Connecticut County: Middlesex Code: 007 Zip Code: 06457 3. CLASSIFICATION Ownership of Property Category of Property Private: X Building(s): X_ Public-Local: _ District: _ Public-State: _ Site: _ Public-Federal: Structure: _ Object: _ Number of Resources within Property Contributing Noncontributing 2 2 buildings _ _ sites _ _ structures _ _ objects 2 2 Total Number of Contributing Resources Previously Listed in the National Register: 2 Name of Related Multiple Property Listing: N/A NFS Form 10-900 USDI/NPS NRHP Registration Form (Rev. 8-86) OMB No. 1024-0018 SAMUEL WADSWORTH RUSSELL HOUSE Page 2 United States Department of the Interior, National Park Service National Register of Historic Places Registration Form 4. STATE/FEDERAL AGENCY CERTIFICATION As the designated authority under the National Historic Preservation Act of 1966, as amended, I hereby certify that this __ nomination __ request for determination of eligibility meets the documentation standards for registering properties in the National Register of Historic Places and meets the procedural and professional requirements set forth in 36 CFR Part 60. In my opinion, the property __ meets __ does not meet the National Register Criteria. -

Report Title 13. Jahrhundert 16. Jahrhundert 17. Jahrhundert
Report Title - p. 1 Report Title 13. Jahrhundert 1294-1305 Wirtschaft und Handel Pietro da Lucalongo ist Kaufmann in Beijing. [Wik] 16. Jahrhundert 1513 Geschichte : China - Europa : Portugal / Wirtschaft und Handel Giovanni da Empoli kommt im Auftrag von Portugal auf der Insel Lintin, nordöstlich von Macao am Perlflussdelta an. [Wik] 1516-1517 Geschichte : China - Europa : Portugal / Wirtschaft und Handel Rafael Perestrello treibt Handel in Guangzhou (Guangdong). [Wik] 1554 Geschichte : China - Europa : Portugal / Wirtschaft und Handel Leonel de Sousa macht ein chinesisch-portugiesisches Abkommen mit den Behörden von Guangdong, das freien Handel erlaubt. [PorChi1,Pta7] 17. Jahrhundert 1600 Wirtschaft und Handel Gründung der East India Company. [Int] 1602 Wirtschaft und Handel Gründung der Vereenigte Oostindische Compagnie. [Int] 1618 Geschichte : China - Europa : Daenemark / Wirtschaft und Handel Erste Handels-Expedition der Danish East India Company nach Asien. [BroK1] 1639 Wirtschaft und Handel Xu, Guangqi. Nong zheng quan shu. Vol. 1-3. (Beijing : Ping lu tang, 1639). [Abhandlung über Landwirtschaft]. [BBKL,AOI] 1639-1674 Geschichte : China - Russland / Wirtschaft und Handel Handelsroute über Bukhara nach China. Zweite Route von Tobolsk über Jungaria nach Suzhou und Beijing. Handel von Baumwolle, Seidenkleider, Medizin, Tee, Rhabarbern. [ChiRus1:S. 165] 1643-1646 Geschichte : Taiwan / Wirtschaft und Handel François Caron ist Gouverneur von Formosa (Taiwan). Er kontrolliert den Handel und die Produktion von Reis, Zucker, Salz und Indigo. [Wik] 1656 Wirtschaft und Handel Le bureau chinois des rites confirme dans un document officiel de permetter à Hollande de venir à la Cour tous les huit ans. [MarxJ1:S. 752] 1668-1670 Geschichte : China - Europa : Daenemark / Wirtschaft und Handel Zweite Handels-Expedition der Danish East India Company nach Asien [BroK1] Report Title - p. -

Russell, Samuel Wadsworth, House
NATIONAL HISTORIC LANDMARK NOMINATION NPS Form 10-900 USDI/NPS NRHP Registration Form (Rev. 8-86) OMBNo. 1024-0018 SAMUEL WADSWORTH RUSSELL HOUSE United States Department of the Interior, National Park Service______________ National Register of Historic Places Registration Form 1. NAME OF PROPERTY Historic Name: Russell, Samuel Wadsworth, House Other Name/Site Number: Honors College, Wesleyan University 2. LOCATION Street & Number: 350 High Street Not for publication: N/A City/Town: Middletown Vicinity: N/A State: Connecticut County: Middlesex Code: 007 Zip Code: 06457 3. CLASSIFICATION Ownership of Property Category of Property Private: X_ Building(s): X_ Public-Local: _ District: _ Public-State: _ Site: _ Public-Federal: Structure: _ Object: _ Number of Resources within Property Contributing Noncontributing 2 2 buildings _ _ sites _ _ structures _ _ objects 2 2 Total Number of Contributing Resources Previously Listed in the National Register: 2 Name of Related Multiple Property Listing: N/A NFS Form 10-900 USDI/NPS NRHP Registration Form (Rev. 8-86) OMB No. 1024-0018 SAMUEL WADSWORTH RUSSELL HOUSE Page 2 United States Department of the Interior, National Park Service National Register of Historic Places Registration Form 4. STATE/FEDERAL AGENCY CERTIFICATION As the designated authority under the National Historic Preservation Act of 1966, as amended, I hereby certify that this __ nomination __ request for determination of eligibility meets the documentation standards for registering properties in the National Register of Historic Places and meets the procedural and professional requirements set forth in 36 CFR Part 60. In my opinion, the property __ meets __ does not meet the National Register Criteria. -
![Russell & Co., Guangzhou, China, Records [Finding Aid]. Library Of](https://docslib.b-cdn.net/cover/9637/russell-co-guangzhou-china-records-finding-aid-library-of-2009637.webp)
Russell & Co., Guangzhou, China, Records [Finding Aid]. Library Of
Russell & Co., Guangzhou, China, Records A Finding Aid to the Collection in the Library of Congress Manuscript Division, Library of Congress Washington, D.C. 2007 Contact information: http://hdl.loc.gov/loc.mss/mss.contact Additional search options available at: http://hdl.loc.gov/loc.mss/eadmss.ms010075 LC Online Catalog record: http://lccn.loc.gov/mm80038562 Prepared by Christopher Bean and Paul Ledvina Revised by Lia Apodaca and Patrick Kerwin Collection Summary Title: Russell & Co., Guangzhou, China, Records Span Dates: 1812-1894 Bulk Dates: (bulk 1819-1840) ID No.: MSS38562 Creator: Russell & Co. Extent: 3,900 items ; 12 containers plus 4 oversize ; 5 linear feet ; 10 microfilm reels Language: Collection material in English Location: Manuscript Division, Library of Congress, Washington, D.C. Summary: Trading house founded in 1819 by Samuel Russell in Guangzhou (Canton), China. Correspondence, financial and legal records, and miscellany relating to the company and its founder, Samuel Russell (1789-circa 1862), and members of his family. Selected Search Terms The following terms have been used to index the description of this collection in the Library's online catalog. They are grouped by name of person or organization, by subject or location, and by occupation and listed alphabetically therein. People Alsop, J. W. (Joseph Wright), 1804-approximately 1878--Correspondence. Alsop, Richard, 1761-1815--Correspondence. Ammidon, Philip--Correspondence. Astor, John Jacob, 1763-1848--Correspondence. Butler, Cyrus, 1767-1849--Correspondence. Forbes, John Murray, 1771-1831--Correspondence. Forbes, R. B. (Robert Bennet), 1804-1889--Correspondence. Heard, Augustine, 1785-1868--Correspondence. Hubbard, Gurdon Saltonstall, 1802-1886--Correspondence. Hubbard, S. D. (Samuel Dickinson), 1799-1855--Correspondence. -

國立臺灣大學文學院歷史學系學士班學生論文department of History
國立臺灣大學文學院歷史學系 學士班學生論文 Department of History, College of Liberal Arts National Taiwan University Bachelor Degree Thesis 鴉片危機中的商業轉機: 羅伯特‧賓奈特‧福貝斯與中美交流 Commercial Chances in the Crisis of Opium: Robert Bennet Forbes and Sino-American Communications 吳昌峻 Chang-Jiun Wu 指導教授:陳慧宏 博士 Hui-Hung Chen 中華民國 106 年 7 月 July 2017 誌謝 於大二下的暑假,因替牛道慧老師工作,受到許多提點,並認識到中美貿易 研究的重要性。此外,我亦向牛道慧老師借用了兩冊史料,此對於本研究有極大 的幫助。於 2016 年春夏之交,本篇論文已開始醞釀:我開始注意到福貝斯此人, 並思考其是否具有研究價值。但是,因為我沒有足夠的研究經驗,因此想要透過 修習學士論文的課程,以完成此篇中美交流論文。在尋找學士論文的指導老師時, 經由秦曼儀老師的引薦,找到了目前的指導老師-陳慧宏老師。在第一次見面及 討論題目之後,獲得了陳慧宏老師的許可,方才開始修習學士論文的課程。而本 篇論文之撰寫,亦由此正式展開。 陳慧宏老師對論文的細節相當重視,在數次的往返修改之後,我開始對論文 的寫作方法與格式,有較確切的認知。此外,陳慧宏老師亦鼓勵我參與「105 學年 學士班學士論文獎」的校內競賽,並在準備期間給予我很多建議與幫助。另外, 特別感謝陳熙遠老師於四月時參與論文審查,並提供許多論文修改的方向,使我 的論文可以更加精實。最終,此論文在「105 學年學士班學士論文獎」中取得校長 獎的名次。於獲獎後,又依循著兩位老師給我的指點,繼續修改論文。如今已近 畢業,此版論文經過多次的翻新。此論文的完成,象徵著我大學學習生涯的成果, 亦是象徵著下一個學習階段的開始。學海無涯,為勤是岸,共勉之。 最後,感謝我的家人及朋友給我的幫助與建議,若沒有他們的陪伴與相處、 不斷地交流與鼓勵,則此篇論文,將不可能如期完成。 ii 中文摘要 本論文是以美國商人羅伯特‧賓奈特‧福貝斯(1804-1889;以下簡稱福貝斯) 為中心,討論在中國鴉片危機時早期中美的商業交流。而福貝斯,正是於鴉片戰 爭前夕參與中國貿易的美國商人。福貝斯與中國的關係密切,自 1817 年 10 月 17 日乘著廣州貨運號(Canton Packet)首次向中國出航後,長年經營中美貿易。他曾 掌管過伶仃貿易站的走私貿易,又在鴉片危機變化多端的局面下,運用中、美、 英三方的多邊關係,成功地處理對華貿易。喜於寫作的他,為後世留下大量的史 料,可以做為研究中美早期交流的材料。 目前關於福貝斯的史料,已出版者包括 《個人回憶錄》(Personal Reminiscences; 2009)、《對中國與中國貿易的評論》 (Remarks on China and the China Trade; 1844)、《來自中國的信件》(Letters from China; 書寫於 1838-1840 年)。過去研究者很少從福貝斯這樣的個人觀點出發, 並以以上三件重要的個人資料入手,探討早期中美的商業關係。本研究希望可以 透過梳理這些史料,從福貝斯的角度,進入早期中美貿易與鴉片戰爭前後的歷史 中,用「以小觀大」的眼光,看這個時代的交流與變局。 本研究的問題意識如下:從福貝斯的生平,是否可以「以小觀大」,看到該 時代的商業背景以及中美商業往來的關係?此外,福貝斯與美國在華商人是如何 度過鴉片危機造成的貿易困境?美國、英國與中國在鴉片危機的當下,又存在著 -

Frolicking in the Opium Trade
FROLICKING IN THE OPIUM TRADE The Frolic was constructed in Baltimore at 209 tons displacement weight, which means that the shipbuilders were paid just over $5,000 for the hull alone. The hull form was that of the sharp pilot boat, a fast V-shaped rather than a generous U-shaped cross-section, and its two masts were mounted at an extreme rake angle, approaching 20 degrees. It was 97 feet from bow to stern 1 and 24 feet /2 inches in beam width at its widest point, which means that it had a length-to-beam ratio of four, and was 10 feet deep, measuring amidships from the keelson up to the underside of the deck planking. It carried two main anchors and an auxiliary anchor, with three 90-fathom chains. Its deck had bulwarks, and initially there were two ships cannon on wheeled carriages, firing 9-pound balls through hinged gunports in these bulwarks. Fully rigged, the vessel set its owners back more than $16,000, and by the time they had the ship completely outfitted and provisioned for its 1st voyage, their expenses had run to more than $20,000. HDT WHAT? INDEX FROLIC FROLIC 1844 April: John James Dixwell (would he have been a descendant of the John Dixwell AKA James Davids who had been a regicide of King Charles I but had managed to marry and live out his life unmolested in New Haven, Connecticut?) arranged for William Gardner to build two clipper ships at Baltimore, one a 140-ton schooner to be named the Dart, to be used as a coaster making opium deliveries along the China coast, and the other a 200-ton brig (actually it would weigh in at 209 tons displacement) to be named the Frolic, equipped with hermaphrodite rigging and sails, which is to say, square rigged on the foremast but fore-and-aft rigged on the mainmast, to be ready for a China run by about the beginning of September.1 I have tried to describe a world system that ultimately linked Pomo Indians with Boston businessmen, Baltimore shipbuilders, Bombay opium merchants, smugglers on the coast of China, and newly rich consumers in Gold Rush California. -

Wake in Guangzhou: the History of the Earth Guangzhou Biennale, 2008
Wake in Guangzhou: The History of the Earth Guangzhou Biennale, 2008 A sample of earth is removed from Huagui lu, a street in the Liwan District, the former merchant quarters of Guangzhou. The earth sample is placed in the courtyard of the Guangzhou Contemporary Art Museum so that dormant seeds previously Buried in deep layers can germinate when exposed to sunlight. Guangzhou is a port city, formerly known as Canton, and for different periods throughout Chinese history, it was the only city through which foreigners were allowed to enter China and the Liwan District, the only place in China that foreigners were allowed to live in. While the seeds in the mound of earth taken from the Liwan District germinated and plants grew, research uncovered the possiBiliGes of seed carriers to the Liwan District. Ibn Bauta was a scholar Born in Tangier, Morocco. He liked to travel and went to Damascus where VeneGans who had sugar plantaons in Greece would go to trade. Then he went to Cairo-HeBron-Jerusalem-Bethlehem-Iraq-Iran-Aden- Mogadishu-MomBassa (alternavely seeds could have arrived via the Kenyan ivory trade to Guangzhou), ZanziBar, Kilwa, Oman, Hormuz, Anatolia, Turkey, Sinop, Caffa (where he joined up with the caravan of Obeg, the Khan of the Golden Horde and went to the Volga River), ConstanGnople (where he met Emperor Andronicos III, Afghanistan (Alternavely seeds could have arrived via the BriGsh who sent an expediGon force there to put their candidate on the throne), CamBay, Calicut, Maldives (where he married into the royal family), Sri Lanka, Vietnam and Guangzhou. -

The Connecticut River Valley & the China Trade
estern merchants have always been attracted to the products of China W and the profits of trade with the Orient. The earliest trade with the Chinese was in the second century B.C. across the “Silk Road,” a The Connecticut network of trails named for the precious Chinese cloth that formed the most valuable and abundant commodity transported across it. After Portugal forged sea routes to China in the mid-sixteenth River Valley & century, other foreign nations sailed there in search of trade. The English East India Company, estab- lished in 1600, soon dominated the China trade. Canton Waterfront with Steamer Spark, Studio of Tingqua, Guan Lianchang (b. 1809, active dates 1840–1870), Canton, China. ca. 1855. Gouache on pith paper, wood, and glass. Chinese laborers loading tea onto boats anchored on the Pearl River. The foreign factories at Canton in the distance are as seen from the island of Honam. 60.215. At first, spices were the main attraction, but as the seventeenth century progressed, merchants sought new commodities such as tea. The British prevented Americans from entering into direct trade with China until after the end of the China Trade the Revolution in 1783. Britain needed the American colonies as a market for its own manu- by Amanda Lange factured goods and for the porcelains, silks, and teas brought back from the East by the English 158 www.antiquesandfineart.com August / September East India Company. Prior to the Revolution, limited quantities of Chinese trade goods, including porcelains, appeared in the Connecticut River Valley by way of Hartford, Boston, and New York. -

Rise & Fall of the Canton Trade System L
Merchants West & East Not just anyone could enter the China trade, on either the Western or the Chinese side. Only a small number of wealthy and powerful men could enjoy its large risks and profits. The members of the English East India Company and the Dutch VOC were some of the largest and most powerful landowners in the country, who had great influence in the politics of their country. Since the elites depended on trade for much of their income, they could use their political influence to direct policy toward protecting their business profits, even at the cost of war. Merchants of the Canton Trade “A Merchant Naval Captain,” 1830–1835 “The Hong Merchant Mouqua,” ca. 1840s attributed to George Chinnery by Lam Qua The unidentified captain wears a naval Mouqua (or Mowqua, Chinese name Lu jacket and stands with his telescope on the Guangheng), was one of the most deck of a ship, off the shore of China, prosperous hong merchants. He wears probably Canton. The China trade robes indicating his official rank. The captains and supercargoes were usually suffix -qua (guan in Mandarin) means young men from prominent families who “official.” The hong merchants did not get left home to make their fortunes. The official degrees through the regular captain commanded the ship, and the examination system, but obtained their supercargo took charge of the sale of posts by purchasing them at high prices commercial goods. Sometimes these roles from the regular officials. They were were one and the same. responsible for all foreign trade in Canton. National Maritime Museum Peabody Essex Museum [cwPT_1830c_nmmBHC3169] [cwPT_1840s_ct79] During the Seven Years War, from 1757 to 1763, England and France fought for global domination primarily to protect their trading interests. -

China Mirage First Chapter Excerpt
INTRODUCTION The future policy of Japan towards Asiatic countries should be similar to that of the United States towards their neighbors. A “Japanese Monroe Doctrine” in Asia will remove the temptation to European encroachment, and Japan will be recognized as the leader of the Asiatic nations. — President Theodore Roosevelt1 The people of China well over a century have been, in thought and in objective, closer to us Americans than almost any other peoples in the world — the same great ideals. China, in the last — less than half a century has become one of the great democracies of the world. — President Franklin Delano Roosevelt2 Two American presidents from the first half of the twentieth century blazed the path into Asia still followed by the United States today. These two presidents were cousins, and, although they lived a genera- tion apart, both followed similar paths to power: from New York State legislator to assistant secretary of the Navy to New York governor and, finally, to president of the United States. Both Presidents Roosevelt conducted their Asian diplomacy in sim- ilar style, personally taking the reins to deal directly and secretly with Asian affairs, often circumventing their own State Departments. Nei- ther Roosevelt traveled to Asia or knew many Asians, but both were ChinaMirage_HCtextF1.indd 3 3/5/15 10:59:28 AM T HE C HINA M IRAGE Presidents Theodore and Franklin Delano Roosevelt (Courtesy of the Library of Congress) supremely confident that they had special insights. The parallels are not exact. Theodore was enamored of Japan and allowed himself to be taken in by a propaganda campaign directed from Tokyo and led by a Harvard-educated Japanese friend. -

Bibliography Index
Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20013 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Frederic Delano Grant, Jr Title: The Chinese cornerstone of modern banking : the Canton guaranty system and the origins of bank deposit insurance 1780-1933 Date: 2012-10-24 253 BIBIOLOGRAPHY 1. Primary sources 1.a. Unpublished primary sources American Philosophical Society, Philadelphia, Pennsylvania. Stephen Girard Papers, Estate of Stephen Girard, deceased, microfilm copies on deposit with the American Philosophical Society. Deposition of Benjamin C. Wilcocks, undated, in Stephen Girard's records of the lawsuit Girard v. Biddle (commenced in the Sept. 1806 term of the Court of Common Pleas of Philadelphia County). Stephen Girard, "Observations on Mr. Benjamin C. Wilcocks's Deposition,” in Stephen Girard's records of the lawsuit Girard v. Biddle (commenced in the Sept. 1806 term of the Court of Common Pleas of Philadelphia County). Letter, Stephen Girard (Philadelphia) to Edward George and Samuel Nichols, 3 January 1810, Letterbook 11. Franklin Roosevelt Library, Hyde Park, New York. Delano Family Papers, Edward Delano Correspondence. Letter from Edward Delano to Franklin Hughes Delano, dated Canton 24 September 1841. Historical Society of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania. Breck Family Papers, Library Company of Philadelphia, on deposit. Letter from Conseequa (Canton) to Peter Dobell, 3 April 1813. Gratz Collection, Box 44, Case 14. Conseequa's Account Current with George Emlen. Willings & Francis Papers, 1805 folder. Letters from William Read (Canton) to Willings & Francis, 9 Nov. 1805 and 10 Dec. 1805. Letter from William Read (Canton) to Willings & Francis, dated 27 November 1805. Statement of Gregory Baboom, dated 28 December 1805.