Plan Local D'urbanisme
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
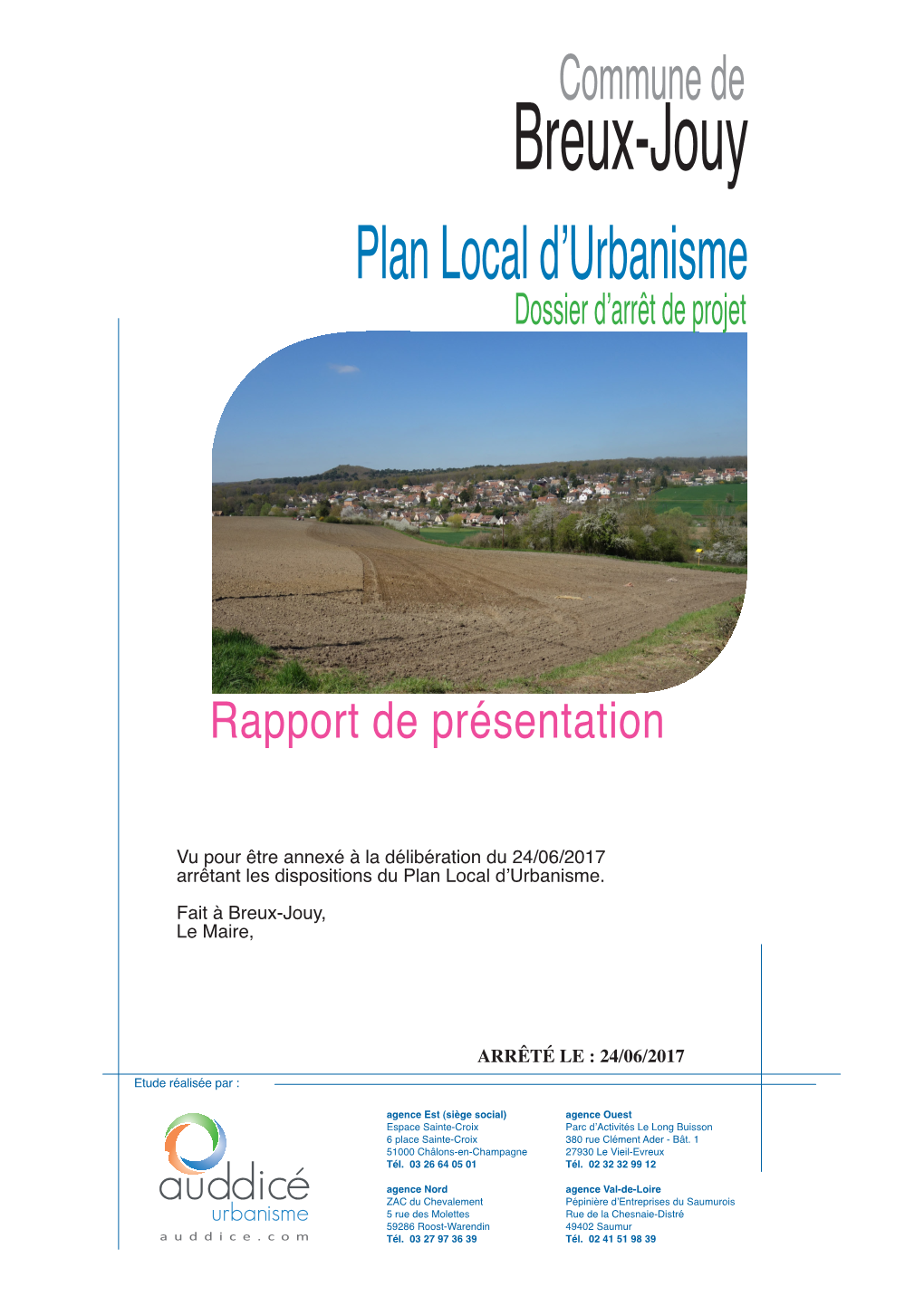
Load more
Recommended publications
-

Les 21 Cantons De L'essonne Élections Départementales 22 Et 29 Mars 2015
Les 21 cantons de l’Essonne Élections départementales 22 et 29 mars 2015 • Canton d’Arpajon (58 772 habitants) Arpajon, Avrainville, Boissy‐sous‐Saint‐Yon, Bouray‐sur‐Juine, Bruyères‐le‐Châtel, Cheptainville, Égly, Guibeville, Janville‐sur‐Juine, Lardy, Leuville‐sur‐Orge, La Norville, Ollainville, Saint‐Germain‐lès‐ Arpajon, Saint‐Yon, Torfou. • Canton d’Athis‐Mons (52 138 habitants) Athis‐Mons, Juvisy‐sur‐Orge, Paray‐Vieille‐Poste. • Canton de Brétigny‐sur‐Orge (58 940 habitants) Brétigny‐sur‐Orge, Leudeville, Longpont‐sur‐Orge, Marolles‐en‐Hurepoix, Saint‐Michel‐sur‐Orge, Saint‐Vrain. • Canton de Corbeil‐Essonnes (55 921 habitants) Corbeil‐Essonnes, Écharcon, Lisses, Villabé. • Canton de Dourdan (63 773 habitants) Angervilliers, Breuillet, Breux‐Jouy, Briis‐sous‐Forges, Chamarande, Chauffour‐lès‐Étréchy, Corbreuse, Courson‐Monteloup, Dourdan, Étréchy, Fontenay‐lès‐Briis, La Forêt‐le‐Roi, Forges‐les‐ Bains, Les Granges‐le‐Roi, Janvry, Limours, Mauchamps, Richarville, Roinville‐sous‐Dourdan, Saint‐ Chéron, Saint‐Cyr‐sous‐Dourdan, Saint‐Maurice‐Montcouronne, Saint‐Sulpice‐de‐Favières, Sermaise, Souzy‐la‐Briche, Le Val‐Saint‐Germain, Vaugrigneuse, Villeconin. • Canton de Draveil (45 786 habitants) Draveil, Étiolles, Saint‐Germain‐lès‐Corbeil, Soisy‐sur‐Seine. • Canton d’Épinay‐sous‐Sénart (45 594 habitants) Boussy‐Saint‐Antoine, Épinay‐sous‐Sénart, Morsang‐sur‐Seine, Quincy‐sous‐Sénart, Saint‐Pierre‐du‐ Perray, Saintry‐sur‐Seine, Tigery, Varennes‐Jarcy. • Canton d’Étampes (59 083 habitants) Abbeville‐la‐Rivière, Angerville, Arrancourt, -

Albatrans-9103-Depliant-Hiver.Pdf
Bus 91.03 DOURDAN MASSY-PALAISEAU Bus 91.03 DOURDAN MASSY-PALAISEAU Nucléaires Massy-Palaiseau Massy Centre Gare Du lundi au vendredi le Mesnil-Sevin Plateau 8 Militaire 3 6 0 de Moulon 5:30 6:00 6:10 6:20 6:28 6:33 6:38 6:43 6:49 6:55 7:00 7:05 7:10 3 91.05 • 91.06 • 91.10 • 91.11 DOURDAN Gare D 9 St-Aubin N CEAT • Keolis Meyer D 128 PalaiseauPolytechnique Rhodon Mobicaps • RATP LONGVILLIERS Plessis-Mornay (Péage) 5:35 6:05 6:15 6:25 6:33 6:38 6:43 6:48 6:54 7:00 7:05 7:10 7:15 St-Rémy-lès- N 1 18 Chevreuse Parc Champlain BRIIS-SOUS-FORGES Gare Autoroutière 5:47 6:17 6:27 6:37 6:45 6:50 6:55 7:00 7:06 7:12 7:17 7:22 7:27 ZA les Algorithmes Scientifique Dampierre- Orsay 6:02 6:32 6:42 6:52 7:00 7:05 7:10 7:15 7:21 7:27 7:33 7:38 7:43 en-Yvelines 6 MASSY-PALAISEAU Gare N 30 CNRS D 988 Courcelle- St-Forget sur-Yvette Villebon- sur-Yvette 1 6 4 5 9 7:15 7:20 7:25 7:30 7:35 7:40 7:45 7:50 7:55 8:00 8:05 8:11 8:16 Chevreuse Paris Sud E DOURDAN Gare 4 0 - D N Gif-sur-Yvette A 1 Grand la Hacquinière LONGVILLIERS Plessis-Mornay (Péage) 7:20 7:25 7:30 7:35 7:40 7:45 7:50 7:55 8:00 8:05 8:10 8:16 8:21 Ragonant Bures- N 188 Bois Persan ZA de sur-Yvette Courtabœuf Parc Nord Senlisse Belleville BRIIS-SOUS-FORGES Gare Autoroutière 7:32 7:37 7:42 7:47 7:52 7:57 8:02 8:07 8:12 8:17 8:22 8:28 8:33 Garnes S D Saulx-les- MASSY-PALAISEAU Gare 7:48 7:53 8:00 8:05 8:12 8:17 8:22 8:28 8:33 8:38 8:43 8:49 8:54 1 les Greens 18 4 la Ferté Les Ulis 1 Chartreux 9 D 6 les Poudr 0 9 les Hameaux D du Lavoir Boullay- Mondétour 8:24 8:30 8:46 9:00 9:15 9:40 10:00 10:30 -

C H a M a R a N D E Plan Local D'urbanisme
C H A M A R A N D E ESSONNE PLAN LOCAL D’URBANISME Orientation d’Aménagement et de Programmation N° 3.2 Secteur des « Poiriers Rouges » Approuvé 21 novembre 2017 Mairie de Chamarande Place de la Libération 91730 Chamarande Tél : 01 60 82 20 11 E m a i l : [email protected] 1 SOMMAIRE Avant propos SITUATION DES TERRAINS 2 LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 3 LES ORIENTATIONS DE PROGRAMME 6 LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 7 Commune de CHAMARANDE RIV/LET Plan Local d’Urbanisme OAP 3.2 21 11 2017 2 Situation des terrains Les terrains objets de la présente OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) se situent au nord du plateau de Torfou. Ils sont occupés sur près de 4,5 ha par des activités de tailles et de vocations diverses. Source : fond de plan Géoportail Ils constituent avec les terrains situés sur la commune de Mauchamps en vis-à-vis à l’Ouest de la RN20, un secteur de développement économique majeur à l’échelle de la Communauté de Communes « Entre Juine et Renarde ». En effet le site Mauchamps/Chamarande est désigné comme « site majeur » et « secteur de développement économique » dans le Schéma de Cohérence Territoriale de la Communuaté de Communes « Entre Juine et Renarde ». Source : SCOT CC Entre Juine et Renarde : DOG : Document graphique n°17 Commune de CHAMARANDE RIV/LET Plan Local d’Urbanisme OAP 3.2 21 11 2017 3 Le contexte environnemental Concernant les paysages, Ce contexte est marqué notamment par son positionnement d’une part dans l’espace ouvert du plateau agricole sans relief particulier et de fait exposé aux relations de co- visibilité et d’autre part sur le parcours d’entrée dans le Parc Naturel du Gâtinais Français par la RN20. -

Projet Entrepot Terra1
Île-de-France Avis en date du 25 janvier 2020 de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France sur le projet d’entrepôt TERRA1 situé à Mauchamps (Essonne) Synthèse de l’avis Le présent avis porte sur un projet comportant, sur un terrain de 9,6 hectares, au lieu-dit Les Poiriers Rouges sur la commune de Mauchamps dans le département de l’Essonne : • la construction par la société TERRA 1 d'un entrepôt logistique (lot 2) , • l'installation d'autres locaux d'activités à ce jour non définis et qui seraient destinés à des entre- prises locales (lot 1). L'avis est émis dans le cadre d'une procédure simultanée d'autorisation environnementale (au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et de la loi sur l'eau) et de permis de construire, portant sur l'entrepôt. Le projet d’entrepôt TERRA1 à Mauchamps a été soumis à évaluation environnementale par décision de l’autorité environnementale n°DRIEE-SDDTE-2017-183 du 08 septembre 2017 Les principaux enjeux du projet identifiés par la MRAe pour ce projet concernent la consommation des terres agricoles, l’artificialisation des sols, les risques technologiques, la gestion des eaux, le paysage, les zones humides, la pollutions de sols, les déplacements et les pollutions et nuisances associées. Les principales recommandations de la MRAe portent sur les points suivants : • justifier davantage le besoin de surfaces logistiques dans ce secteur du sud de l'Essonne et étu- dier les solutions de substitution par reconversion de zones d'activités existantes, • présenter les impacts du projet sur la consommation d'espaces agricoles et l’artificialisation des sols, ainsi que les variantes étudiées, permettant de réduire ou de compenser ces impacts. -

Souzy-La-Briche
Diagnostic patrimonial du 91Centre-Essonne Souzy-la-Briche R !"#"#$%%% & & DIAGNOSTIC PATRIMONIAL DU CENTRE-ESSONNE Communes des cantons de Brétigny-sur-Orge, Etréchy et Mennecy 2009 Synthèse communale Souzy-la-Briche Canton d’Etrechy Etude réalisée par Guillaume Tozer, chargé de mission et Maud Marchand, stagiaire Sous la responsabilité scientifique de Brigitte Blanc, conservateur du patrimoine, adjointe au chef de service Avec le conseil scientifique de Roselyne Bussière, conservateur du patrimoine Service Patrimoines et Inventaire Région Île-de-France 2009 Territoire du diagnostic patrimonial dans son contexte francilien Couverture : Château de la Briche 2 CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE La convention signée en 2008 entre le Conseil Général de l’Essonne et le Conseil Régional d’Île-de-France prévoit d’établir un diagnostic du patrimoine culturel du territoire situé « entre Juine et Orge ». Ce territoire est divisé en trois cantons comprenant vingt-neuf communes : Etréchy Mennecy Brétigny-sur-Orge Auvers-Saint-Georges Auvernaux Brétigny-sur-Orge Bouray-sur-Juine Ballencourt-sur-Essonne Leudeville Chamarande Champcueil Marolles-en-Hurepoix Chauffour-lès-Etréchy Chevannes Le Plessis-Pâté Etréchy Le Coudray-Montceaux Saint-Vrain Janville-sur-Juine Echarcon Lardy Fontenay-le-Vicomte Mauchamps Mennecy Souzy-la-Briche Nainville-les-Roches Torfou Ormoy Villeconin Vert-le-Grand Villeneuve-sur-Auvers Vert-le-Petit Le territoire d’étude est situé en zone périurbaine, soumis à l’influence directe de l’agglomération parisienne et susceptible d'être significativement touché par les processus enclenchés par cette proximité. La partie septentrionale du territoire est en effet largement urbanisée (Communautés d’agglomération du Val d’Orge et de Seine-Essonne) et le phénomène tend à s’étendre vers les communes rurales, situées plus au sud, dans lesquelles on assiste à une transformation significative du patrimoine rural et à une extension considérable du bâti par le lotissement d’anciens domaines et/ou de terres agricoles. -

Édito L’ASSAINISSEMENT : UN ENJEU SANITAIRE La Rationalisation De L’Organisation ET ENVIRONNEMENTAL
Vaugrigneuse Le Val-Saint- Saint-Cyr- Germain Courson- n°8 sous-Dourdan Saint-Maurice- Monteloup Montcouronne déc 2018 Ollainville Roinville sous-Dourdan Bruyères le-Châtel Corbreuse Arpajon Saint-Chéron Breuillet Dourdan Sermaise Sainte-Mesme Breux-Jouy Egly Saint-Martin Souzy de Bréthencourt Villeconin la-Briche Saint-Yon Saint-Sulpice Mauchamps de-Favières édito L’ASSAINISSEMENT : UN ENJEU SANITAIRE La rationalisation de l’organisation ET ENVIRONNEMENTAL .................2 territoriale française est largement PROTÉGEONS LES MILIEUX engagée. C’est ainsi que dans notre NATURELS ET LA région les communes se sont constituées 5 en Communauté de Communes ou Com- BIODIVERSITÉ ............................ munauté d’Agglomération, établissements PRÉVENIR ET AGIR FACE publics à multi-compétences. AU RISQUE INONDATION .............9 Ces modifications territoriales ont à terme des incidences sur les syndicats intercommunaux ou mixtes tels que le SIBSO, notamment au regard À LA DÉCOUVERTE des compétences GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inon- DE LA VALLÉE dations) et assainissement qu’exercent depuis de nombreuses années ces syndicats. DE LA RENARDE ..........................12 C’est ainsi que le SIBSO se trouve aujourd’hui concerné par un projet de fusion avec 2 autres syndicats : le SIVOA (gestionnaire de l’Orge aval) et le SIHA (gestionnaire de la Prédecelle). Je ne vous ennuierai pas avec les tenants et les aboutissants de cette procédure, qui ne répond pas aux attentes de la majorité des collectivités adhérentes au SIBSO mais qui devrait aboutir au 1er janvier prochain à la constitution d’un nouveau syndicat, si l’arrêté inter préfectoral correspondant est bien pris d’ici la fin de l’année. Ce nouveau numéro du journal « Aux Sources de l’Orge », probablement le dernier, Un syndicat à votre service, des équipes a pour objectif de vous informer sur les plus récentes réalisations de notre syndicat à votre écoute pour la rivière et et de vous rappeler combien il est important de prendre les mesures nécessaires l’assainissement. -

Janvier 2017
232 Janvier 2017 VOTRE MAIRIE L'équipe municipale Heures d'ouvertures : à votre service Numéros utiles Lundi 8h30 - 12h Le Maire Mardi 8h30 - 12h, 13h30-17h15 SAMU : 15 Yannick HAMOIGNON Mercredi 8h30 - 12h SOS Médecin : 01 64 46 91 91 Gendarmerie : 17 Les adjoints Jeudi 8h30 - 12h, 13h30-17h15 Pompiers : 18 Dominique PERRIER Vendredi 8h30 - 12h Kiné bronchiolite : 0 810 817 812 Olivier DELSUC Samedi 8h30 - 12h Hôpital : 01 60 81 58 58 Murielle PAYOUX Monsieur le Maire reçoit SOS enfance maltraitée : 119 (anonyme) Michel HERSANT SOS viol : 01 45 85 73 00 samedi de 9h à 11h et sur rendez-vous. Violences familiales : 3919 Les conseillers municipaux Courriels : Infos escroquerie : 08 11 02 02 17 Cécile MACQUET [email protected] Stéphan GOIX [email protected] Sylviane SOREL Déchèterie Dourdan [email protected] 01 64 59 86 90 Patrick MILLOCHAU [email protected] Alain QUINQUIRY [email protected] Lundi : 14h - 17h Guilaine LE CAM Site de la mairie : Mercredi : 10h - 13h et 14h - 17h Franck GAUTIER www.mairie-roinville.fr Vendredi : 14h - 17h Dominique ECHAROUX Samedi : 10h - 13h et 14h-17h Courriel de l'école : Dimanche : 10h - 13h Stéphanie ALLAOUAT [email protected] Roland MORANO Service Administratif tel : 01 64 59 25 73 Dominique Echaroux Conseiller départemental Michel Pouzol Léa GUINARD Député de l’Essonne [email protected] - tel : 06 09 75 19 19 Secrétaire générale Rdv au 06 83 51 29 53 /07 84 30 85 23 Accueil - Service Etat Civil tel : 01 64 59 72 82 Audrey -

Les Cantons Essonniens
Les cantons essonniens Bièvres ± Verrières-le-Buisson Savigny-sur-Orge Saclay Igny Vauhallan Wissous Villiers-le-Bâcle Massy Paray-Vieille-Poste Palaiseau Gif-sur-Yvette Massy Athis-Mons Crosne Yerres Saint-Aubin Palaiseau Chilly-Mazarin Champlan Athis-Mons Vigneux-sur-Seine Yerres Morangis Gif-sur-Yvette Orsay Brunoy Villebon-sur-Yvette Longjumeau Vigneux-sur-Seine Bures-sur-Yvette Juvisy-sur-Orge Montgeron Boussy-Saint-Antoine Épinay-sous-Sénart Savigny-sur-Orge Longjumeau Varennes-Jarcy les Ulis Villejust Saulx-les-Chartreux Boullay-les-Troux Gometz-le-Châtel Draveil les Molières Gometz-la-Ville BallainvilliersÉpinay-sur-Orge Viry-ChâtillonGrigny Quincy-sous-Sénart Saint-Jean-de-Beauregard Villemoisson-sur-Orge Nozay la Ville-du-Bois Villiers-sur-Orge Viry-Châtillon Draveil Pecqueuse Soisy-sur-Seine Les Ulis Étiolles Limours Tigery Janvry Marcoussis Sainte-Geneviève-des-Bois Montlhéry Sainte-Geneviève-des-Bois Ris-Orangis Longpont-sur-Orge Fleury-Mérogis Epinay-sous-Sénart Saint-Michel-sur-Orge Briis-sous-Forges Évry Linas Courcouronnes Saint-Germain-lès-Corbeil Forges-les-Bains Evry Leuville-sur-Orge Bondoufle le Plessis-Pâté Saint-Pierre-du-Perray Fontenay-lès-Briis Ollainville Corbeil-Essonnes Vaugrigneuse Brétigny-sur-Orge Courson-Monteloup Saint-Germain-lès-Arpajon Ris-Orangis Lisses Saintry-sur-Seine Angervilliers Arpajon Bruyères-le-Châtel Corbeil-Essonnes Dourdan Villabé Saint-Maurice-Montcouronne Égly Brétigny-sur-Orge la Norville Vert-le-Grand Écharcon Morsang-sur-Seine Ormoy Breuillet Leudeville le Val-Saint-Germain Guibeville -

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N°
PRÉFET DE L’ESSONNE PRÉFET DES YVELINES Direction Départementale des Territoires de l’Essonne Direction Départementale des Territoires des Yvelines Service Environnement Service Environnement Bureau de l’Eau Unité Politique et Police de l’Eau ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL n° RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL AU TITRE DE L’ARTICLE L.211-7 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT, POUR LA RÉALISATION DU PROGRAMME PLURIANNUEL D’ENTRETIEN DE LA RIVIÈRE ORGE AMONT ET DE SES AFFLUENTS DANS LES DÉPARTEMENTS DE L’ESSONNE ET DES YVELINES, POUR LA PÉRIODE 2020-2024, PROJETÉE PAR LE SYNDICAT DE L’ORGE, DE LA RÉMARDE ET DE LA PRÉDECELLE (SYORP) LE PRÉFET DE L'ESSONNE, LE PRÉFET DES YVELINES Officier de la Légion d'Honneur, Officier de la Légion d'Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite Officier de l’Ordre National du Mérite, VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L.211-1 et suivants, et L.211-7 et suivants, L.215-2, L.215-14 et suivants, L.414-4, L.432-1 et suivants, L.433-3, L.435-5 et R.214-88 à R.214-104, R.414-23, R.435-34 à R.435-39 ; VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.151-36 et suivants, R.152-29 à R.152-35 ; VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics modifiée ; VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation -

Les Emondants PR® 3H00
Rando fiche® Les Emondants PR® 3H00 © CDRP91 11,5km L’église Saint- Sulpice- de- Favières PATRIMOINE En parcourant les chemins des coteaux et de la vallée de la Renarde, vous pourrez apprécier EGLISE DE SAINT-SULPICE- DE- FAVIÈRES l’élégance de l’église Saint- Sulpice- de- Favières. "La plus belle église de village de Le portail est très mutilé. Le thème ico- France" nographique du jugement dernier rappelle ® Dans un bourg situé à 10 km au sud encore celui des cathédrales gothiques. 159 m Code de balisage PR SITUATION FFRandonnée d’Arpajon, l’édificeactuel bâti en 60 ans L’intérieur de l’église, vaste et lumineux, Saint- Sulpice- de- Favières, à 10 km date de 1260. C’est l’un des plus beaux vaisseau élancé de lumière particulière- au sud- est d’Arpajon par les N 20 et Bonne direction D 99 69 m exemples de toute l’Ile- de- France, de ment clair et spacieux, invite à une élé- Dénivelée positive : Changement 139 m de direction l’architecture rayonnante à ses débuts. vation toute spirituelle. Cette structure à PARKING rue de Rochefontaine, à la sortie Mauvaise direction déposées marques © Sa construction fut décidée pour rempla- trois niveaux est exceptionnelle. La ver- ouest du village N 48.54196 °, cer la chapelle des Miracles du XIIe siècle, rière du collatéral droit, avec ses trente E 2.17398 ° dont il subsiste encore deux travées et médaillons, forme un ensemble cohérent une source. Saint Sulpice archevêque représentant l’apogée des techniques des DIFFICULTÉS ! BALISAGE e • montée boueuse par temps humide entre les points jaune de Bourges au VII siècle, aurait ressusci- maîtres verriers. -

RAA N°039 Spécial Publié Le 10 Avril 2018
PRÉFÈTE DE L'ESSONNE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 039 spécial publié le 10 avril 2018 Sommaire affiché du 10 avril 2018 au 9 juin 2018 Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 039 spécial publié le 10 avril 2018 SOMMAIRE DIRECCTE - Décision n° 2018-41 du 6 avril 2018 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail de l'unité départementale de l'Essonne 2 MINISTERE DU TRAVAIL DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL, ET DE L’EMPLOI D’ILE DE FRANCE Décision n° 2018-41 du 6 avril 2018 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d’inspection du travail de l’unité départementale de l’Essonne La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France soussignée, Vu l’article R 8122-6 du code du travail, Vu les décrets 2008-1503 et 2008-1510 du 30 décembre 2008 relatifs à la fusion des services d’inspection du travail, Vu l’arrêté ministériel du 12 mars 2018 portant création et répartition des unités de contrôle de l’inspection du travail, Vu la consultation du Comité Technique des Services Déconcentrés d’Ile de France en date du 23 janvier 2018, DECIDE Article 1 L’unité départementale de l’Essonne comprend 3 unités de contrôle (UC n°1, UC n°2 et UC n°3) composées de 33 sections d’inspection du travail sises 98 allée des Champs-Elysées, CS30491, 91042 EVRY COUROURONNES cedex. -

Le Siècle De Louis
Le siècle de Louis Le siècle de Louis 1790-1892 Sa vie replacée dans le contexte de l’époque Sommaire Préface Pages 1. La célébration du centenaire par le Conseil Municipal d’Etréchy 3 2. La cérémonie du centenaire dans le journal local 3 3. Un mauvais départ dans la vie 4 4. Sa famille 4.1 le plus ancien CHARPENTIER connu 5 4.2 ses arrière-grands-parents paternels 7 4.3 ses grands-parents paternels 8 4.4 ses parents 10 4.5 sa belle-famille 13 5. Pierre DOLIVIER curé de Mauchamps 5.1 le début de son ministère 14 5.2 son mariage à Mauchamps pendant la 1ére République 15 5.3 la réorganisation révolutionnaire des corps constitués 17 5.4 son serment patriotique 21 5.5 la pétition sur les causes des violences 24 5.6 son discours sur le triomphe des bonnes mœurs 24 5.7 la vente du presbytère 27 6. Les coutumes 6.1 le choix des prénoms 28 6.2 le divorce 30 6.3 la reconnaissance d’enfants naturels 31 7. L’environnement de Louis 33 8. La vie, le mariage, la mort à travers les registres de Mauchamps 35 9. La révolution naissante avec ses retombées locales 56 10.L’enfance de Louis 85 11.La Patrie en danger 86 12.Les campagnes napoléoniennes et la Légion d’honneur 96 13.Louis militaire de 1808 à 1815 112 14.Les grognards d’Etampes avant le licenciement de l’Armée 114 impériale 1 Le siècle de Louis 15.La campagne de France (décembre 1813 / avril 1814) 127 16.L’épuration de 1814 131 17.Les maîtres de postes 17.1 Simon DARBLAY maître de postes à Etréchy 140 17.2 la poste d’Etréchy après les DARBLAY 146 18.Les grognards d’Etampes après le licenciement