Constitution Et Environnement. Royaume-Uni Aurélie Duffy-Meunier
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
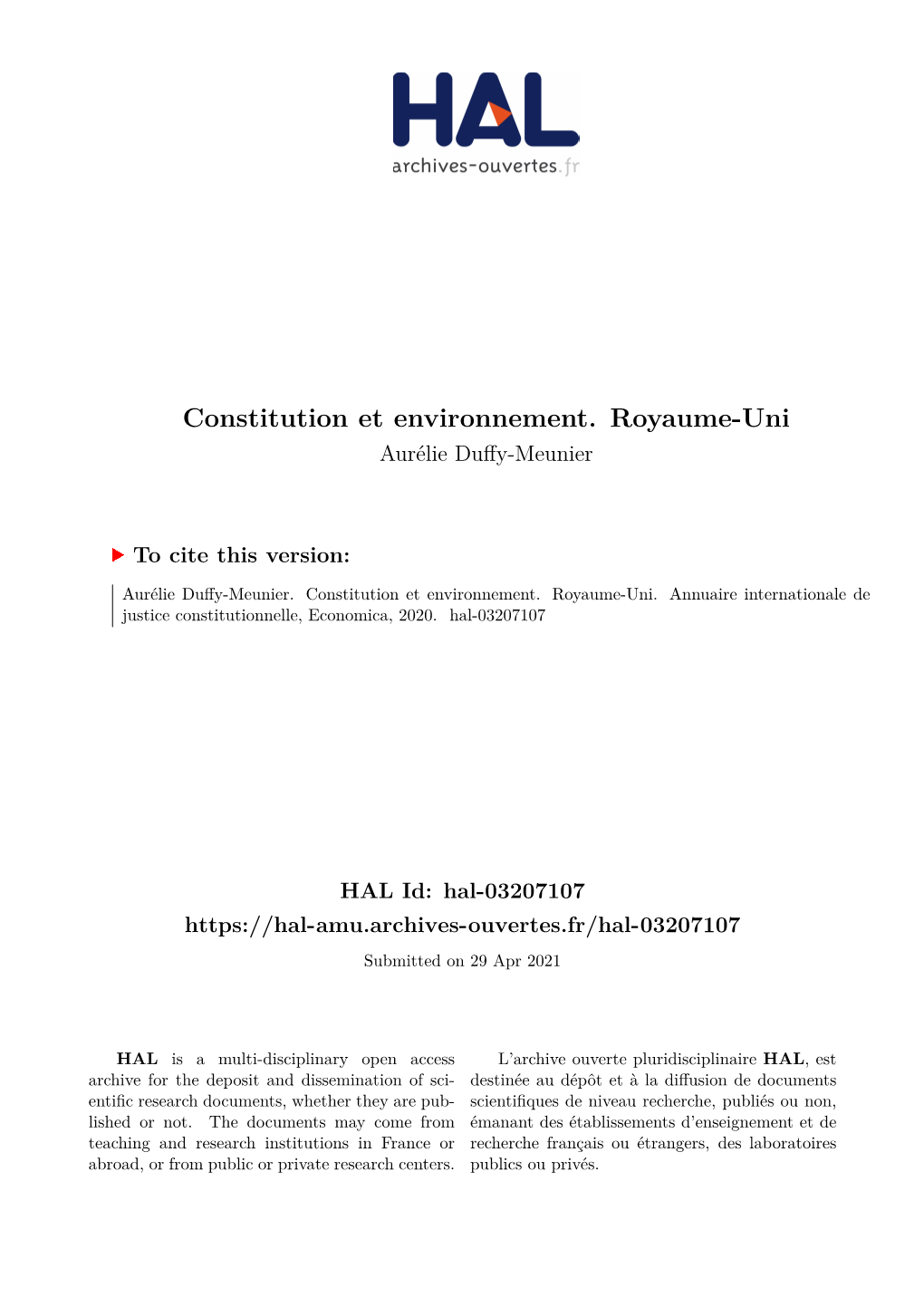
Load more
Recommended publications
-

Water Industry Act 1991
Page 1 Water Industry Act 1991 1 of 6 DOCUMENTS: UK Parliament Acts/W/WA-WG/Water Industry Act 1991 (1991 c 56)/Part III Water Supply (ss 37-93)/39 Procedure for regulations under section 38 39 Procedure for regulations under section 38 [(A1) The Secretary of State may make regulations under section 38 above-- (a) on an application by the Authority, in accordance with subsections (1) to (3) below; or (b) otherwise than on such an application, in accordance with subsections (4) to (8) below.] (1) [Where the Authority has made to the Secretary of State a written application complying with sub- section (2) below, the Secretary of State may make regulations under section 38 above if--] [(b) the Secretary of State is satisfied that a copy of the application has been served by [the Au- thority]-- (i) on every water undertaker specified in the application; . (ii) on persons or bodies appearing to the Secretary of State to be representative of persons likely to be affected by the regulations; [(iii) on the Council; and (iv) on such other persons or bodies as the Secretary of State may consider appropriate;]] (c) such period as the Secretary of State considers appropriate has been allowed for the making-- (i) by [the Authority]; and (ii) by any affected water undertaker [or person or body on whom a copy of the application has been served under paragraph [(b)] above], of representations or objections with respect to [the Authority's] proposals and any modifications pro- posed by the Secretary of State; and (d) the Secretary of State has considered [the summary mentioned in subsection (2)(bb) below,] [the Authority's] reasons for [its] proposals and every representation or objection which has been duly made with respect to those proposals, or any proposed modifications of those proposals, and has not been withdrawn. -

Centre for Law, Economics and Society Research Paper Series: 1/2019
Centre for Law, Economics and Society Research Paper Series: 1/2019 Are Economists Kings? Economic Evidence and Discretionary Assessments at the UK Utility Regulatory Agencies Despoina Mantzari Centre for Law, Economics and Society CLES Faculty of Laws, UCL Director: Professor Ioannis Lianos CLES Research Paper Series 1/2019 Are Economists Kings? Economic Evidence and Discretionary Assessments at the UK Utility Regulatory Agencies Despoina Mantzari June 2019 Centre for Law, Economics and Society (CLES) Faculty of Laws, UCL London, WC1H 0EG The CLES Research Paper Series can be found at www.ucl.ac.uk/cles/research-papers Pre-published version of: Despoina Mantzari, ‘Are Economists Kings? Economic Evidence and Discretionary Assessments at the UK Utility Regulatory Agencies’, Journal of Antitrust Enforcement, DOI: 10.1093/jaenfo/jnaa007 All rights reserved. No part of this paper may be reproduced in any form without permission of the author ISBN 978-1-910801-25-3 © Despoina Mantzari 2019 Centre for Law, Economics and Society Faculty of Laws, UCL London, WC1H 0EG United Kingdom ARE ECONOMISTS KINGS? ECONOMIC EVIDENCE AND DISCRETIONARY ASSESSMENTS AT THE UK UTILITY REGULATORY AGENCIES Despoina Mantzari* * Lecturer in Competition Law and Policy, University College London, Faculty of Laws. Email: [email protected]. I thank Ioannis Lianos, Diamond Ashiagbor, Stephen Littlechild, Andriani Kalintiri, Maria Ioannidou, the two anonymous reviewers, as well as participants at the IALS 2018 Lunchtime seminar series, the UCL Laws 2019 Lunchtime Research Seminars, the Annual Meeting of Law and Society 2018, the UK IVR conference 2017 (where an early draft of this paper received the ‘best early career paper prize’) as well as stakeholders of the Essential Services Access Network (ESAN) and policymakers at UK Office for Gas and Electricity Markets (Ofgem) for helpful comments and discussions on earlier versions of this paper. -

THE DEVELOPMENT of the WATER INDUSTRY in ENGLAND and WALES Cover Photograph: Ryburn Dam, Yorkshire
THE DEVELOPMENT OF THE WATER INDUSTRY IN ENGLAND AND WALES Cover photograph: Ryburn Dam, Yorkshire. Courtesy of Yorkshire Water Services Limited. This document sets out our understanding of the development of, and of some of the legal provisions affecting, the water industry in England and Wales. Every reasonable effort has been made to make the information and any commentary accurate and up to date, but no responsibility for its accuracy and correctness, or for any consequences of relying on it, is assumed by the Office of Water Services. The information and commentary does not, and is not intended to, amount to legal advice to any person, nor is it a substitute for the relevant legal provision. Anyone in doubt about how they may be affected by any of the legal provisions referred to in the document should seek legal advice. CONTENTS 1. OVERVIEW 1 1.1 GOVERNMENT POLICY 1 1.2 EARLY CONSOLIDATION 1 1.3 RESTRUCTURING 2 1.4 PRIVATISATION 3 1.5 THE INDUSTRY TODAY 3 2. INITIAL CO-ORDINATION OF WATER RESOURCES IN ENGLAND & WALES 5 2.1 INTRODUCTION 5 2.1.1 Water supply 5 2.1.2 Sewerage & sewage disposal 6 2.1.3 Other interests in water resources 7 2.2 WATER RESOURCES ACT 1963 8 2.2.1 Background 8 2.2.2 River Authorities 8 2.2.3 Water Resources Board 9 2.2.4 Central government 9 2.3 MANAGEMENT OF RESOURCES UNDER THE 1963 ACT 10 2.4 SERVICE DELIVERY 11 2.5 THE NEED FOR CHANGE 11 3. ESTABLISHMENT OF THE WATER AUTHORITIES 12 3.1 INTRODUCTION 12 3.2 WATER ACT 1973 12 3.2.1 Policy proposals 12 3.2.2 Functions of the water authorities 15 3.2.3 Financial arrangements 16 3.2.4 Constitution of the water authorities 16 3.2.5 Board structure 17 3.2.6 Role of central government 18 3.2.7 National Water Council 19 3.2.8 Household water bills 19 3.2.9 Statutory water companies 20 3.2.10 Pollution control 20 3.3 THE POST 1974 OPERATING ENVIRONMENT 22 3.3.1 Access to finance 22 3.3.2 Environmental performance 26 3.4 WATER ACT 1983 27 3.4.1 Constitutional changes 27 3.4.2 Financial changes 28 3.5 THE NEED FOR CHANGE 28 4. -

Water Industry Act 1991
Water Industry Act 1991 1991 CHAPTER 56 An Act to consolidate enactments relating to the supply of water and the provision of sewerage services, with amendments to give effect to recommendations of the Law Commission [25th July 1991] BE IT ENACTED by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:– Part I Preliminary . NOTES Amendment Repealed by the Water Act 2003, ss 34(4), 101(2), Sch 9, Pt 2. Date in force: 1 April 2006: see SI 2005/2714, art 4(a), (g)(i); for savings see art 5(1), Schedule, para 8 thereto. 1 . NOTES Amendment Repealed by the Water Act 2003, ss 34(4), 101(2), Sch 9, Pt 2. Date in force: 1 April 2006: see SI 2005/2714, art 4(a), (g)(i); for savings see art 5(1), Schedule, para 8 thereto. [Water Services Regulation Authority] NOTES Amendment Inserted by virtue of the Water Act 2003, s 34(1). Date in force: 1 April 2006: see SI 2005/2714, art 4(a); for transitional provisions see art 5(1), Schedule, para 8 thereto. [1A Water Services Regulation Authority] [(1) There shall be a body corporate to be known as the Water Services Regulation Authority (in this Act referred to as “the Authority”) for the purpose of carrying out the functions conferred on or transferred to it by this Act or under or by virtue of any other enactment. -
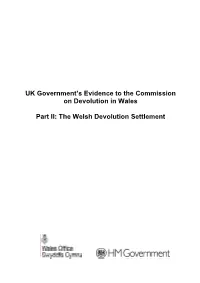
UK Government's Evidence to the Commission on Devolution in Wales Part II
UK Government’s Evidence to the Commission on Devolution in Wales Part II: The Welsh Devolution Settlement UK Government’s Evidence to the Commission on Devolution in Wales Part II: The Welsh Devolution Settlement Contents 1. Introduction Page 3 2. Agriculture, Forestry, Animals, Plants and Rural Page 16 Development 3. Ancient Monuments and Historic Buildings Page 20 4. Culture Page 20 5. Economic Development Page 24 6. Education and Training Page 35 7. Environment Page 40 8. Fire, Rescue Services and Fire Safety Page 46 9. Food Page 47 10. Health and Health Services Page 48 11. Highways and Transport Page 56 12. Housing Page 62 13. Justice Page 63 14. Local Government Page 71 15. National Assembly for Wales Page 73 16. Public Administration Page 75 17. Security and Policing Page 80 18. Social Welfare Page 88 1 19. Sport and Recreation Page 95 20. Tourism Page 96 21. Town and Country Planning Page 97 22. Water and Flood Defence Page 103 23. Welsh Language Page 113 2 1. Introduction 1.1 The UK Government welcomes the opportunity to provide evidence to Part II of the Silk Commission’s work. 1.2 We believe in devolution, and have demonstrated a strong commitment to taking devolution forward because it gives people choice and a real say over their own affairs. The decentralisation of power is one of our core aims, and we believe firmly that there are benefits in taking decisions at local level within a strong United Kingdom. 1.3 Devolution in the United Kingdom is asymmetric, reflecting the different circumstances, history and institutions of each nation within the UK. -
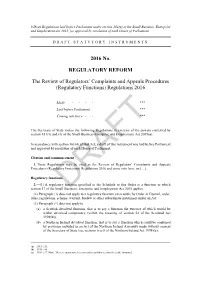
Draft Statutory Instruments
0.Draft Regulations laid before Parliament under section 161(4) of the Small Business, Enterprise and Employment Act 2015, for approval by resolution of each House of Parliament. DRAFT STATUTORY INSTRUMENTS 2016 No. REGULATORY REFORM The Review of Regulators’ Complaints and Appeals Procedures (Regulatory Functions) Regulations 2016 Made - - - - *** Laid before Parliament *** Coming into force - - *** The Secretary of State makes the following Regulations in exercise of the powers conferred by section 181(1) and (3) of the Small Business Enterprise and Employment Act 2015(a). In accordance with section 161(4) of that Act, a draft of this instrument was laid before Parliament and approved by resolution of each House of Parliament. Citation and commencement 1. These Regulations may be cited as the Review of Regulators’ Complaints and Appeals Procedures (Regulatory Functions) Regulations 2016 and come into force on […]. Regulatory functions 2.—(1) A regulatory function specified in the Schedule to this Order is a function to which section 17 of the Small Business, Enterprise and Employment Act 2015 applies. (2) Paragraph (1) does notDRAFT apply to a regulatory function exercisable by Order in Council, order, rules, regulations, scheme, warrant, byelaw or other subordinate instrument under an Act. (3) Paragraph (1) does not apply to — (a) a Scottish devolved function, that is to say a function the exercise of which would be within devolved competence (within the meaning of section 54 of the Scotland Act 1998(b)); (b) a Northern Ireland devolved function, that is to say a function which could be conferred by provision included in an Act of the Northern Ireland Assembly made without consent of the Secretary of State (see sections 6 to 8 of the Northern Ireland Act 1998)(c); (a) 2015 c.26. -
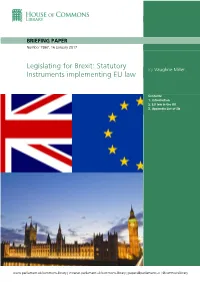
Legislating for Brexit: Statutory Instruments Implementing EU Law
` BRIEFING PAPER Number 7867, 16 January 2017 Legislating for Brexit: Statutory By Vaughne Miller Instruments implementing EU law Contents: 1. Introduction 2. EU law in the UK 3. Appendix List of SIs www.parliament.uk/commons-library | intranet.parliament.uk/commons-library | [email protected] | @commonslibrary 2 Legislating for Brexit: Statutory Instruments implementing EU law Contents Summary 4 1. Introduction 6 2. EU law in the UK 7 2.1 How are SIs to implement EU laws adopted? 7 2.1 Do the devolved Administrations adopt EU law? 8 2.2 Where can I find EU-related SIs? 8 3. Appendix List of SIs 9 3 Commons Library Briefing, 16 January 2017 Contributing Authors: Sasha Gorb Cover page image copyright EU flag, British flag and Palace of Westminster – CC0 Public domain: no attribution required. All images cropped. 4 Legislating for Brexit: Statutory Instruments implementing EU law Summary According to data on the EU’s Eur-Lex database, there are at present around 19,000 EU legislative acts in force. These are mainly directives, regulations, decisions and external agreements, but they include a range of other instruments. As Commons Briefing Paper Legislating for Brexit: the Great Repeal Bill, CBP7793, 21 November 2016, explains, a major issue for Brexit is what to do about EU legislation that has been incorporated into UK law. Section 2(2) of the European Communities Act 1972 (ECA) provides a power for subordinate legislation to be made where the EU Treaties require Member States to make provisions in their domestic law, such as for the implementation of EU directives. -
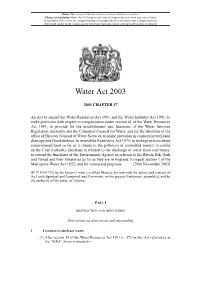
Water Act 2003 Is up to Date with All Changes Known to Be in Force on Or Before 01 September 2018
Status: This version of this Act contains provisions that are prospective. Changes to legislation: Water Act 2003 is up to date with all changes known to be in force on or before 01 September 2018. There are changes that may be brought into force at a future date. Changes that have been made appear in the content and are referenced with annotations. (See end of Document for details) Water Act 2003 2003 CHAPTER 37 An Act to amend the Water Resources Act 1991 and the Water Industry Act 1991; to make provision with respect to compensation under section 61 of the Water Resources Act 1991; to provide for the establishment and functions of the Water Services Regulation Authority and the Consumer Council for Water, and for the abolition of the office of Director General of Water Services; to make provision in connection with land drainage and flood defence; to amend the Reservoirs Act 1975; to make provision about contaminated land so far as it relates to the pollution of controlled waters; to confer on the Coal Authority functions in relation to the discharge of water from coal mines; to extend the functions of the Environment Agency in relation to the Rivers Esk, Sark and Tweed and their tributaries so far as they are in England; to repeal section 1 of the Metropolis Water Act 1852; and for connected purposes. [20th November 2003] BE IT ENACTED by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:— PART 1 ABSTRACTION AND IMPOUNDING Restrictions on abstraction and impounding 1 Licences to abstract water (1) After section 24 of the Water Resources Act 1991 (c. -
Note on Issues of EU Environmental Law and Transposition Into UK Domestic Law
Note on Issues of EU Environmental Law and Transposition into UK Domestic law Analysis of the Draft Directive 1. Essentially, the aim of the Draft Directive in question (no 11002/07) is to ensure the provision of criminal offences, carrying sufficient sanctions, in the national criminal law of member states. These offences would criminalise breaches of certain provisions of EU environmental law. This is made clear in its Article 1, which reads: “This Directive establishes measures relating to criminal law in order to protect the environment more effectively”. 2. The context of this Draft Directive (and the consultation process to which this note is directed towards) is the view that the EU is entitled to specify that breaches of environmental law should be dealt by member states with as criminal offences. The ‘guidance’ provided cites the recent ECJ decision in the ‘Ship-Source’; Commission v Council case (C440/05) as authority for this principle. I would also draw attention to, as part of this contextual background, the ECJ decision of Commission v Council (C 176/03). 3. The Draft Directive only requires the existence of criminal law provisions in respect of 9 types of environmentally-harmful conduct (Article 3). In summary, the specified conduct pertains to: a. [offence deleted from Draft Directive] b. Release of substances or ionising radiation which causes or is likely to cause death/injury/damage to environment c. Dealings with waste which causes or is likely to cause death/injury/damage to environment d. Operation of a plant dealing with dangerous activities/substances which causes or is likely to cause death/injury/damage to environment outside of the plant e. -

Legal and Institutional Aspects of Integrated Flood Management.Pdf
University of Dundee Legal and institutional aspects of integrated flood management Allan, Andrew; Rieu-Clarke, Alistair; Tyagi, Avinash C. Publication date: 2006 Link to publication in Discovery Research Portal Citation for published version (APA): Allan, A., Rieu-Clarke, A., & Tyagi, A. C. (Ed.) (2006). Legal and institutional aspects of integrated flood management. (Flood Management Policy Series; APFM Technical Document; No. 2). World Meteorological Organization (WMO). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in Discovery Research Portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from Discovery Research Portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain. • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 28. Sep. 2021 Legal and Institutional Aspects of Integrated Flood Management FLOOD MANAGEMENT POLICY SERIES Legal and Institutional Aspects of Integrated Flood Management Geneva, Switzerland January 2006 ASSOCIATED PROGRAMME ON FLOOD MANAGEMENT WMO-No. 997 The Associated Programme on Flood Management (APFM) is a joint initiative of the World Meteorological Organization and the Global Water Partnership. It promotes the concept of Integrated Flood Management (IFM) as a new approach to flood management. -
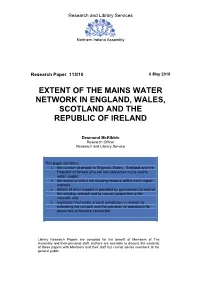
Extent of the Mains Water Network in England, Wales, Scotland and the Republic of Ireland
Research and Library Services Northern Ireland Assembly Research Paper 113/10 6 May 2010 EXTENT OF THE MAINS WATER NETWORK IN ENGLAND, WALES, SCOTLAND AND THE REPUBLIC OF IRELAND Desmond McKibbin Research Officer Research and Library Service This paper identifies: the number of people in England, Wales, Scotland and the Republic of Ireland who are not connected to the mains water supply; the extent to which the existing network within each region extends; details of what support is provided by government to extend the existing network and to connect properties to the network; and legislation that exists in each jurisdiction in relation to extending the network and the provision of assistance for properties to become connected. Library Research Papers are compiled for the benefit of Members of The Assembly and their personal staff. Authors are available to discuss the contents of these papers with Members and their staff but cannot advise members of the general public. Northern Ireland Assembly, Research and Library Service SUMMARY OF KEY POINTS Almost all (over 99%) of the UK population is served by the public water supply although in the Republic of Ireland the mains water supply is less prolific. England and Wales The powers to provide water and sewerage services in England and Wales were privatised under the Water Act 1989. Under section 41 of the Water Industry Act 1991, water companies must respond to requests (requisitions) for connection to the mains water supply, where these services are for domestic purposes. The company may require the person asking for the connection (the requisitioner) to pay a security before commencing work, and can recover the reasonable costs of providing the infrastructure from the requisitioner after the work is completed. -

Public Records Act 1958
Changes to legislation: There are outstanding changes not yet made by the legislation.gov.uk editorial team to Public Records Act 1958. Any changes that have already been made by the team appear in the content and are referenced with annotations. (See end of Document for details) View outstanding changes Public Records Act 1958 1958 CHAPTER 51 6 and 7 Eliz 2 An Act to make new provision with respect to public records and the Public Record Office, and for connected purposes. [23rd July 1958] Modifications etc. (not altering text) C1 Act excluded by Australian Constitution (Public Record Copy) Act 1990 (c.17, SIF 101),s. 1 C2 Act modified (1.4.1996) by 1995 c. 25, s. 120(2), Sch. 23 Pt. I para. 9 (with ss. 7(6), 115, 117); S.I. 1996/186, art. 3 C3 Act restricted (1.4.1999) by 1998 c. 38, s. 116(1) (with s. 143(2)); S.I. 1999/782, art. 2 Act modified (temp.) (1.4.1999) by 1998 c. 38, s. 116(2) (with s. 143(2)); S.I. 1999/782, art. 2 C4 Act excluded (24.4.2000) by S.I. 2000/942, art. 4 C5 Act applied (1.10.2007) by Mental Capacity Act 2005 (c. 9), ss. 66(4), 68(1)-(3), Sch. 5 para. 6(1) (with ss. 27, 28, 29, 62); S.I. 2007/1897, art. 2(d) C6 Act restricted by Government of Wales Act 2006 (c. 32) , s. 146(1)(2)(3), the amending provision coming into force immediately after "the 2007 election" (held on 3.5.2007) subject to s.