Universite Abou Bekr Belkaid Tlemcen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
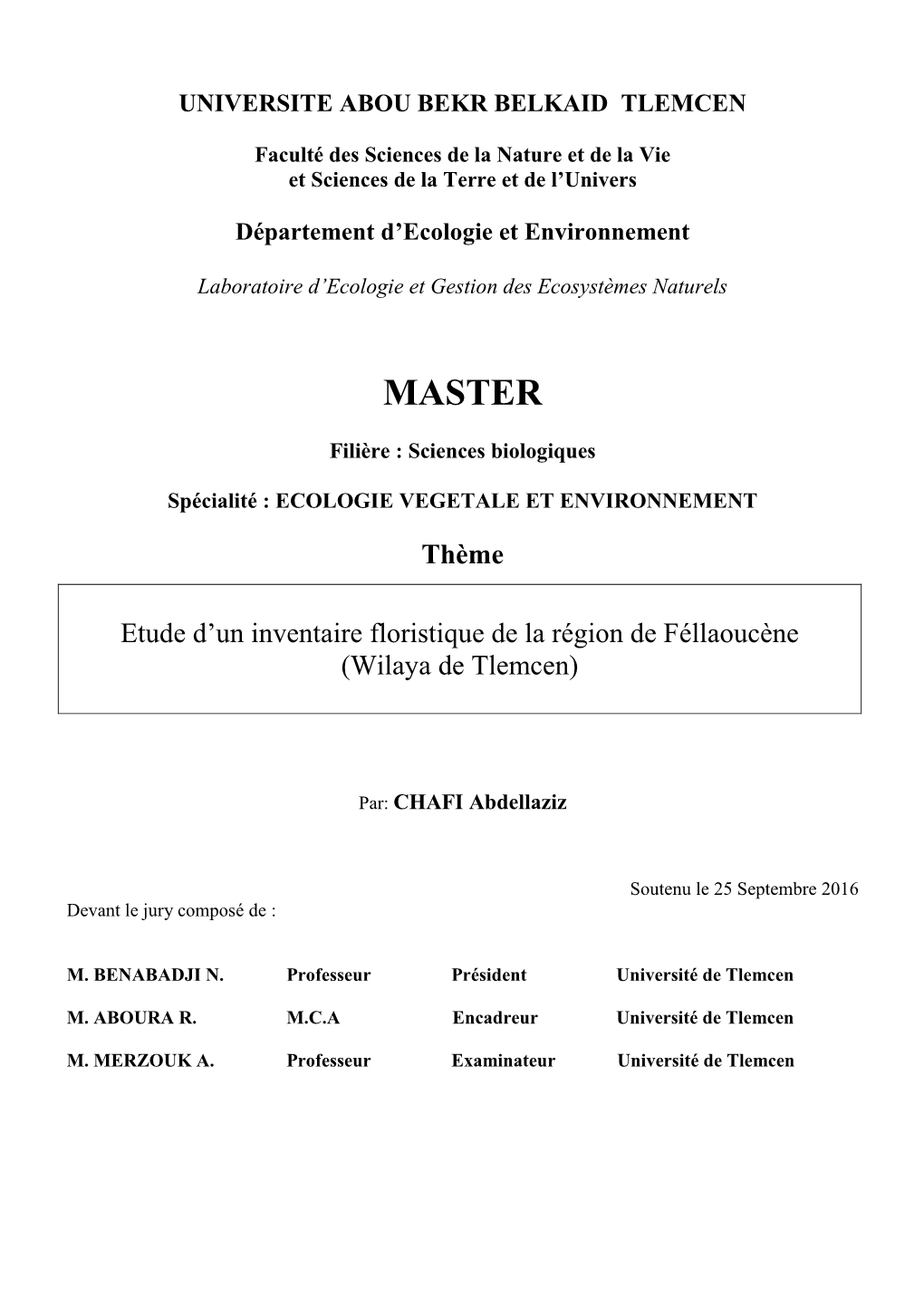
Load more
Recommended publications
-

Le Directeur Général De La Fonction Publique
18 Chaoual 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 75 20 novembre 2005 19 Arrt interminist riel du 11 Rajab 1426 Art. 2. O Le nombre de bureaux dSinspection du travail correspondant au 16 aot 2005 fixant le nombre, est fix vingt sept (27) bureaux, r partis travers le lSorganisation et la comp tence territoriale des territoire national conform ment lSannexe jointe au bureaux dSinspection du travail. pr sent arrt . OOOO Le Chef du Gouvernement, Art. 3. O Le bureau dSinspection du travail est dirig par un chef de bureau. Le ministre dSEtat, ministre de lSint rieur et des collectivit s locales, Le chef de bureau dSinspection du travail est charg de Le ministre des finances , lSanimation, de la coordination et du suivi des activit s des Le ministre du travail et de la s curit sociale, inspecteurs du travail plac s sous son autorit . Vu le d cret pr sidentiel n ° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Art. 4. O Le chef de bureau dSinspection du travail Chef du Gouvernement ; tablit des rapports p riodiques et les transmet lSinspection du travail de wilaya dont il rel ve. Vu le d cret pr sidentiel n ° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Art. 5. O Le pr sent arrt sera publi au Journal officiel de la R publique alg rienne d mocratique et Vu le d cret ex cutif n ° 03-137 du 21 Moharram 1424 populaire. correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la s curit sociale ; Fait Alger, le 11 Rajab 1426 correspondant au 16 Vu le d cret ex cutif n ° 05-05 du 25 Dhou El Kaada aot 2005. -

Médecins Généralistes
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya de : Tlemcen Médecins Généralistes Nom Prénom Adresse Commune Téléphone SENOUSSAOUI TEWFIK Boutrak Ain Fetah AIN FETAH (043)-20-90-52 GHALEM ABDELMALEK Sis, n° 02 Route de carrières Ain Fezza Tlemcen AIN FEZZA (043)-26-43-45 TERKI HASSAINE ZAKARIA Village Oucheba commune de Aîn-Fezza AIN FEZZA (057)-69-82-88 GHALEM KHALED Ain Mekrouf Ain Nehala AIN NEHALA (043)-22-21-98 BOUKLI HACENE MOHAMED TEWFIK Ain Tellout AIN TALLOUT (043)-20-38-16 EL HACI ABDERRAHMANE Citée Salem route Sidi Belabbes Ain Tellout AIN TALLOUT OUISSI RAHILA Cité nouvelle, Aîn-Tallout AIN TALLOUT ABOURA DJAOUAD Ain Youcef AIN YOUCEF Lotissement " EL OUKHOUA " commune de Aîn- BENADLA ABDERRAHMANE AIN YOUCEF (043)-24-11-73 Youcef BELKHOUCHE ABDELKRIM Rue NOURINE Abdelkader n° 03 Aïn-Youcef AIN YOUCEF BOUYAKOUB OTHMANE LOTF-ALLAH N° 02 Dar El-Aîdouni AIN-DOUZ 0555-50-17-76 BEMRAH SIDI-MOHAMMED Lieu dit Boutrak AIN-FETTAH 0552-23-91-53 BENHADJI-SERRADJ SIHAM Local n° 02, rez de chaussée Aïn-Ghoraba 0550-33-90-87 DIB ZOUBIR Chelaïda Commune de Amieur AMIEUR (079)-00-74-47 BENOSMANE GHOUTI El-Azail AZAILS SEBAA NESRINE Ecole Chafaî Boumédiène Tleta AZAILS 0560-25-79-78 KHEDIM ABDELGHANI Bab El Assa BAB EL ASSA (043)-22-12-27 BOUSHABA MIMOUNA Zouia commune de Beni-Boussaïd BENI BOUSSAID BOUGHOMD RACHID Zouia Daïra de Beni-Boussaïd BENI BOUSSAID (062)-61-79-57 KEBIR BOUMEDIENE Lotissement communal n° 07 Beni Mester BENI MESTER (043)-26-31-04 BENYELLES -

12 19 Dhou El Kaada 1434 25 Septembre 2013 JOURNAL
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 19 Dhou El Kaada 1434 12 25 septembre 2013 Ressort territorial de la conservation Wilaya Designation de la conservation Daira Commune TLEMCEN Tlemcen Tlemcen Chetouane Chetouane, Ain Fezza, Amieur MANSOURAH Mansourah Mansourah, Terny Beni Hediel, Ain Ghoraba, Beni Mester Hennaya Hennaya, Zenata, Ouled Ryah SEBDOU Sebdou Sebdou, El Aricha, El Gor Beni Snous Beni Snous, Beni Bahdel, Azail Sidi Djillali Sidi Djillali, El Bouihi REMCHI Remchi Remchi, Ain Youcef, Beni Ouarsous, Sebaa Chioukh, El Fehoul Honaine Honaine, Beni Khaled, TLEMCEN Ouled Mimoun Ouled Mimoun, Beni Semiel, Oued Lakhdar OULED MIMOUN Ain Tallout Ain Tallout, Ain Nahala Bensekrane Bensekrane, Sidi Abdelli Ghazaouet Ghazaouet, Tianet, Dar Yaghmoracen, Souahlia GHAZAOUET Marsa Ben M'hidi Marsa Ben M'hidi, M'cirda Fouaga Bab El Assa Bab El Assa, Souk Thlata, Souani Nedroma Nedroma, Djebala Maghnia Maghnia, Hammam Bougherara Fellaoucene Fellaoucene, Ain Kebira, Ain Fetah MAGHNIA Sabra Sabra, Bouhlou Beni Boussaid Beni Boussaid, Sidi Medjahed TIARET Tiaret Tiaret Dahmouni Dahmouni, Ain Bouchekif Meghila Meghila, Sidi Hosni, Sebt KSAR CHELLALA Ksar Chellala Ksar Chellala, Serguine, Zmalet Emir Abdelkader MEDROUSSA Medroussa Medroussa, Melakou, Sidi Bakhti Frenda Frenda, Ain El Hadid, Takhmaret TIARET Ain Kermes Ain Kermes, Medrissa, Djebilet Rosfa, Madna, Sidi Abderrahmane MAHDIA Mahdia Mahdia, Sebaine, Ain Dzarit, Nadorah Hamadia Hamadia, Bougara, Rechaiga RAHOUIA Rahouia Rahouia, Guertoufa Mechraâ Sfa Mechraâ Sfa, Djillali Ben Amar, Tagdemt Oued Lili Oued Lili, Tidda, Sidi Ali Mellal Sougueur Sougueur, Tousnina, Si Abdelghani, Faidja SOUGUEUR Ain Dheb Ain Dheb, Chehaima, Naima. -

Tlemcen Ministère De La Santé, De La Population Et De La Réforme
Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Direction de la santé et de la population de la wilaya de : Tlemcen Officines Pharmaceutiques Privées Nom Prénom (s) Adresse Commune Téléphone KAOUADJI S/MOHAMED ABDELHAK Boutrak commune Ain Fettah AIN FETAH (043)-33-82-32 BELARBI RADHIA Boutrak commune Ain Fettah AIN FETAH BOUKLI HACENE BASSIM Lotissement communale n° 10 Ain Fezza Tlemcen AIN FEZZA AINAD-TABET FETHI Rue des grottes - Aîn-Fezza AIN FEZZA 0560-04-01-78 GHERNATI ADNEN Aïn-Kébira Daïra de Fellaoucène AIN KEBIRA (043)-35-03-30 ZERHOUNI YACINE Ain Tellout AIN TALLOUT (043)-28-45-94 ZERHOUNI LEILA Rue Sidi Bel-Abbès - Aïn-Tellout AIN TALLOUT (043)-28-42-46 BASRI IDRISS Cité Bel-Horizon Commune de Aîn-Tallout AIN TALLOUT (043)-34-38-95 MEZIANE LATIFA Lotissement extension Sud Ouest lot n° 16 - Aîn-Youcef AIN YOUCEF BEKKARA KHADIDJA 04 rue centre Ain Youcef AIN YOUCEF (043)-24-14-87 BENAMMAR SIDI MOHAMMED N° 51 extension Sud Ouest - Aîn-Youcef AIN YOUCEF BOUNABE FATIHA Rue 1 er Novembre Ain Youcef AIN YOUCEF MAMMAD MERYEM Rue Hadj Hassini El-Izz Sidi Youcef n° 09 Commune de Aïn-Youcef AIN YOUCEF (051)-38-69-09 OUADDANE AMINA 07, Bd Larbi Ben-M'Hidi Local n° 02 Aîn-Youcef AIN YOUCEF (043)-24-19-96 BENTIFOUR AHMED Rue Nourine Abdelkader n° 148/02 Aïn-Youcef AIN YOUCEF BEDJAOUI SIHAME HASNA Ouchba n° 11 (A), local n° 02 aîn-Fezza AIN-FEZZA ABDELLI Mohammed Amin Village Aîn-Nekrouf - Aïn-Nehala AIN-NEHALA 0775-94-25-77 INAL ABDELHAKIM Amieur Local n° 46 B AMIEUR BENACHENHOU SOFIANE Chelaïda Commune de Amieur AMIEUR -

Anté Et De La Population De La Wilaya De : Tlemcen Ministère De La Santé
Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya de : Tlemcen Officines Pharmaceutiques Privées N° Nom Prénom Adresse Commune Téléphone 0001 BELARBI RADHIA Boutrak commune Ain Fettah AIN FETAH 0001 KAOUADJI S/MOHAMED ABDELHAK Boutrak commune Ain Fettah AIN FETAH (043)-33-82-32 0002 AINAD-TABET FETHI Rue des grottes - Aîn-Fezza AIN FEZZA 0560-04-01-78 0003 BOUKLI HACENE BASSIM Lotissement communale n° 10 Ain Fezza Tlemcen AIN FEZZA 0003 GHERNATI ADNEN Aïn-Kébira Daïra de Fellaoucène AIN KEBIRA (043)-35-03-30 0004 BASRI IDRISS Cité Bel-Horizon Commune de Aîn-Tallout AIN TALLOUT (043)-34-38-95 0004 ZERHOUNI YACINE Ain Tellout AIN TALLOUT (043)-28-45-94 0005 ZERHOUNI LEILA Rue Sidi Bel-Abbès - Aïn-Tellout AIN TALLOUT (043)-28-42-46 0005 BEKKARA KHADIDJA 04 rue centre Ain Youcef AIN YOUCEF (043)-24-14-87 0006 BENAMMAR SIDI MOHAMMED N° 51 extension Sud Ouest - Aîn-Youcef AIN YOUCEF 0006 BENTIFOUR AHMED Rue Nourine Abdelkader n° 148/02 Aïn-Youcef AIN YOUCEF 0007 BOUNABE FATIHA Rue 1 er Novembre Ain Youcef AIN YOUCEF Rue Hadj Hassini El-Izz Sidi Youcef n° 09 Commune de Aïn- 0007 MAMMAD MERYEM AIN YOUCEF (051)-38-69-09 Youcef 0008 MEZIANE LATIFA Lotissement extension Sud Ouest lot n° 16 - Aîn-Youcef AIN YOUCEF 0009 OUADDANE AMINA 07, Bd Larbi Ben-M'Hidi Local n° 02 Aîn-Youcef AIN YOUCEF (043)-24-19-96 0009 BEDJAOUI SIHAME HASNA Ouchba n° 11 (A), local n° 02 aîn-Fezza AIN-FEZZA 0010 ABDELLI Mohammed Amin Village Aîn-Nekrouf - Aïn-Nehala AIN-NEHALA 0775-94-25-77 0010 BENACHENHOU -

1-Les Monts De Tlemcen
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherch e scientifique UNIVERSITE ES- SENIA ORAN La république algérienne démocratique et populaire FACULTEMinistère DESde l’enseignement SCIENCES supérieur et de DEPARTEMENT la recherche scientifique DE BIOLOGIE LABORATOIRE D’ECOPHYSIOLOGIE VEGETALE THESE Présentée par : Melle BILEM Amel Pour obtenir le grade de : MAGISTERE en Biologie Ecole Doctorale Option : Biodiversité végétale méditerranéenne Contribution à l’étude histologique du Chamaerops humilis L. : Approche comparative des peuplements des Monts de Traras et des Monts de Tlemcen Soutenu devant la commission d’examen : Mr BELKHODJA Moulay Professeur Université Es Senia Oran Président Mr HASNAOUI Okkacha Maitre de Conférences Université de Saida Encadreur Mr HADJAJ Aouel Seghir Professeur Université Es Senia Oran Examinateur Mr BOUAZZA Mohamed Professeur Université A.B.B Tlemcen Examinateur 2011/2012 Dédicace Au terme de ce travail je remercie dieu le tout puissant pour m’avoir donné le courage, la volonté et la patience pour la réalisation de ce travail. Je le dédie à mes très chers parents qui m’ont encouragé durant toutes mes années d’études et je leur souhaite une vie pleine de joie et de bonheur. A mon frère IBRAHIM, AYOUB et l’’ adorable petite INES.A toute ma famille, à tous mes enseignants, aux étudiants de ma promotion ainsi à tous le pers onnel de département de Tlemcen, le département d’Oran et à tous mes amis (es). Amel BILEM Remerciements L'essentiel du travail de terrain qui a conduit à la réalisation de cette thèse a été dans les monts de Tlemcen et les monts de Traras. -

Santalales Santalacae) Communities in the Tlemcen Region
Biodiversity Journal, 2021, 12 (2): 369–378 https://doi.org/10.31396/Biodiv.Jour.2021.12.2.369.378 Composition and diversity of Osyris L. (Santalales Santalacae) communities in the Tlemcen region Ibrahim Benmechta1*, Rédda Aboura1 & Brahim Babali1 ¹Laboratory of Ecology and Management of Natural Ecosystems BP119, Department of Ecology and Environment, Faculty of Nature and Life Sciences and Earth and Universe Sciences University of Tlemcen, 13000 Algeria *Corresponding author, email: [email protected] ABSTRACT The region of Tlemcen has a very rich and diverse flora heritage thanks to its geological and climatic variations. The genus Osyris L. (Santalales Santalaceae) is a semi-parasitic species which remains continually subject to host plants that are not well known in our study area. Our main objective was to search for this species, to inventory the taxa which enter into the structuring of its populations in the Tlemcen region and then to characterize them systemati- cally, biologically and biogeographically. The bioclimatic approach of the stations studied shows a lower semi-arid bioclimatic stage which has an influence on the floristic procession of these stands dominated by therophytes. The floristic inventory carried out enabled us, above all, to identify certain host plants specific to the presence of this genus with its two species Osyris alba L. and O. lanceolata, Ochst et Steud. in the Tlemcen region. This presence obeys specific ecological conditions which will give a certain distribution that we will detail in our next work. KEY WORDS Osyris; ecology; diversity; Tlemcen, Algeria. Received 19.01.2021; accepted 13.04.2021; published online 28.05.2021 INTRODUCTION world, including Osyris alba L. -

Liste Communes Dairas De La Wilaya De TLEMCEN
Liste Communes dairas de la wilaya de TLEMCEN Wilaya Code dairas Dairas Code communes Communes TLEMCEN 1303 AIN TELLOUT 1325 AIN NEHALA TLEMCEN 1303 AIN TELLOUT 1303 AIN TELLOUT TLEMCEN 1318 BAB EL ASSA 1318 BAB EL ASSA TLEMCEN 1318 BAB EL ASSA 1308 SOUANI TLEMCEN 1318 BAB EL ASSA 1333 SOUK TLETA TLEMCEN 1338 BENI BOUSSAID 1338 BENI BOUSSAID TLEMCEN 1338 BENI BOUSSAID 1337 SIDI MEDJAHED TLEMCEN 1317 BENI SNOUS 1321 AZAIL TLEMCEN 1317 BENI SNOUS 1342 BENI BAHDEL TLEMCEN 1317 BENI SNOUS 1317 BENI SNOUS TLEMCEN 1324 BENSEKRANE 1324 BENSEKRANE TLEMCEN 1324 BENSEKRANE 1334 SIDI ABDELLI TLEMCEN 1350 CHETOUANE 1312 AIN FEZZA TLEMCEN 1350 CHETOUANE 1314 AMIEUR TLEMCEN 1350 CHETOUANE 1350 CHETOUANE TLEMCEN 1320 FELLAOUCENE 1331 AIN FETAH TLEMCEN 1320 FELLAOUCENE 1353 AIN KEBIRA TLEMCEN 1320 FELLAOUCENE 1320 FELLAOUCENE TLEMCEN 1307 GHAZAOUET 1319 DAR YAGHMORACEN TLEMCEN 1307 GHAZAOUET 1307 GHAZAOUET TLEMCEN 1307 GHAZAOUET 1329 SOUAHLIA TLEMCEN 1307 GHAZAOUET 1345 TIANET TLEMCEN 1326 HENNAYA 1326 HENNAYA TLEMCEN 1326 HENNAYA 1346 OULED RIYAH TLEMCEN 1326 HENNAYA 1316 ZENATA TLEMCEN 1344 HONNAINE 1348 BENI KHELLAD TLEMCEN 1344 HONNAINE 1344 HONNAINE TLEMCEN 1327 MAGHNIA 1328 HAMMAM BOUGHRARA TLEMCEN 1327 MAGHNIA 1327 MAGHNIA TLEMCEN 1351 MANSOURAH 1349 AIN GHORABA TLEMCEN 1351 MANSOURAH 1302 BENI MESTER TLEMCEN 1351 MANSOURAH 1351 MANSOURAH TLEMCEN 1351 MANSOURAH 1323 TERNY BENI HEDIEL TLEMCEN 1339 MARSA BEN MEHDI 1330 M'SIRDA FOUAGA TLEMCEN 1339 MARSA BEN MEHDI 1339 MARSA BEN M'HIDI TLEMCEN 1340 NEDROMA 1309 DJEBALA TLEMCEN 1340 NEDROMA 1340 NEDROMA -
The Analysis of Poverty Dynamics in Algeria: a Multidimensional Approach
Loyola University Chicago Loyola eCommons Topics in Middle Eastern and North African Economies Quinlan School of Business 9-1-2007 The Analysis of Poverty Dynamics in Algeria: A Multidimensional Approach Abderrrezak Benhabib University of Tlemcen Tahar Ziani University of Tlemcen Samir Bettahar University of Tlemcen Samir Maliki University of Tlemcen Follow this and additional works at: https://ecommons.luc.edu/meea Part of the Economics Commons Recommended Citation Benhabib, Abderrrezak; Ziani, Tahar; Bettahar, Samir; and Maliki, Samir, "The Analysis of Poverty Dynamics in Algeria: A Multidimensional Approach". Topics in Middle Eastern and North African Economies, electronic journal, 9, Middle East Economic Association and Loyola University Chicago, 2007, http://www.luc.edu/orgs/meea/ This Article is brought to you for free and open access by the Quinlan School of Business at Loyola eCommons. It has been accepted for inclusion in Topics in Middle Eastern and North African Economies by an authorized administrator of Loyola eCommons. For more information, please contact [email protected]. © 2007 the authors THE ANALYSIS OF POVERTY DYNAMICS IN ALGERIA : A MULTIDIMENSIONNAL APPROACH Abderrrezak BENHABIB, Tahar ZIANI, Samir BETTAHAR, Samir MALIKI Laboratory MECAS University of Tlemcen B.P. 226, Tlemcen, 13000, ALGERIA Abstract The study of poverty is often oversimplified and, its manifestation, perceived as dichotomous. This conventional analysis is merely based upon the splitting of the population into two groups: poor and non-poor according to some hypothetical poverty line. This is called the one-dimensional approach of poverty. In addition there is no consensus regarding the poverty threshold, as Cerioli and Zani (1990) point out that a strict division of the population into poor and non-poor is unrealistic. -
Direction De La Santé Et De La Population De La Wilaya De : Tlemcen
Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya de : Tlemcen Praticiens généralistes (médecins) N° Nom Prénom Adresse Commune Téléphone 1 SENOUSSAOUI TEWFIK Boutrak Ain Fetah AIN FETAH (043)-20-90-52 2 GHALEM ABDELMALEK Sis, n° 02 Route de carrières Ain Fezza Tlemcen AIN FEZZA (043)-26-43-45 3 TERKI HASSAINE ZAKARIA Village Oucheba commune de Aîn-Fezza AIN FEZZA (057)-69-82-88 4 GHALEM KHALED Ain Mekrouf Ain Nehala AIN NEHALA (043)-22-21-98 5 BOUKLI HACENE MOHAMED TEWFIK Ain Tellout AIN TALLOUT (043)-20-38-16 6 EL HACI ABDERRAHMANE Citée Salem route Sidi Belabbes Ain Tellout AIN TALLOUT 7 OUISSI RAHILA Cité nouvelle, Aîn-Tallout AIN TALLOUT 8 ABOURA DJAOUAD Ain Youcef AIN YOUCEF 9 BELKHOUCHE ABDELKRIM Rue NOURINE Abdelkader n° 03 Aïn-Youcef AIN YOUCEF 10 BENADLA ABDERRAHMANE Lotissement " EL OUKHOUA " commune de Aîn-Youcef AIN YOUCEF (043)-24-11-73 11 BOUYAKOUB OTHMANE LOTF-ALLAH N° 02 Dar El-Aîdouni AIN-DOUZ 0555-50-17-76 12 BEMRAH SIDI-MOHAMMED Lieu dit Boutrak AIN-FETTAH 0552-23-91-53 13 BENHADJI-SERRADJ SIHAM Local n° 02, rez de chaussée Aïn-Ghoraba 0550-33-90-87 14 BOUZIANI MUSTAPHA Lotissement 54 lots A/Nekrouf AIN-NEHALA 0774-58-17-64 15 DIB ZOUBIR Chelaïda Commune de Amieur AMIEUR (079)-00-74-47 16 BENOSMANE GHOUTI El-Azail AZAILS 17 SEBAA NESRINE Ecole Chafaî Boumédiène Tleta AZAILS 0560-25-79-78 18 KHEDIM ABDELGHANI Bab El Assa BAB EL ASSA (043)-22-12-27 19 BOUGHOMD RACHID Zouia Daïra de Beni-Boussaïd BENI BOUSSAID (062)-61-79-57 20 BOUSHABA MIMOUNA -

Journal Officiel Algérie
N° 05 Mercredi 4 Joumada Ethania 1441 59ème ANNEE Correspondant au 29 janvier 2020 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale................................... 1090,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction.... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d'expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 4 Joumada Ethania 1441 29 janvier 2020 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République............................................................................................................................. 4 Décret exécutif n° 19-391 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2019........................................................................................................................................ -
ISSN: 0975-8585 April – June 2013 RJPBCS Volume 4 Issue 2 Page
ISSN: 0975-8585 Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences Ethnobotanical approaches and phytochemical analysis of Chamaerops humilis L. (Arecaceae) in the area of Tlemcen (western Algeria) Hasnaoui O*1, 2, Benali O1, Bouazza M2 and Benmehdi H3 1 Department of Biology, Faculty of Sciences and Technology, University of Saïda 20000, Algeria 2 Ecological and natural ecosystem Managements Laboratory University of Tlemcen- 13000, Algeria 3 Department of Process Engineering, Faculty of Sciences and Technology University of Bechar 8000, Algeria. ABSTRACT In this work, we were interested of the ethno botanic study of Chamaerops humilis L. in different districts in the region of Tlemcen (Algeria). The survey which was carried out on the field shows the social role and the impact of this species on the local populations. The most used parts of the plant are the heart of palm, the spadices and the leaves. The therapeutic indications which emerge from the investigation cards analysis show the various therapeutic uses. These indications are confirmed by a phytochemical analysis of the spadices, the heart of palm and the leaves. This shows the presence of chemical groups such as: Flavonoïds, Tannins, Steroids, Saponins, Unsaturated and Terpenoid Sterols, which have a definite role on the human body. Keywords: Chamaerops humilis L., ethno botanic study, phytochemical analysis. *Corresponding author April – June 2013 RJPBCS Volume 4 Issue 2 Page No. 910 ISSN: 0975-8585 INTRODUCTION Currently, the medicinal plants have an important value in the social life of many societies. In Africa, approximately 70% of the population use traditional medicine [1]. In the area of Tlemcen (North-western Algeria) the vegetable species with therapeutic characteristics are very coveted.