Authon- Du-Perche
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
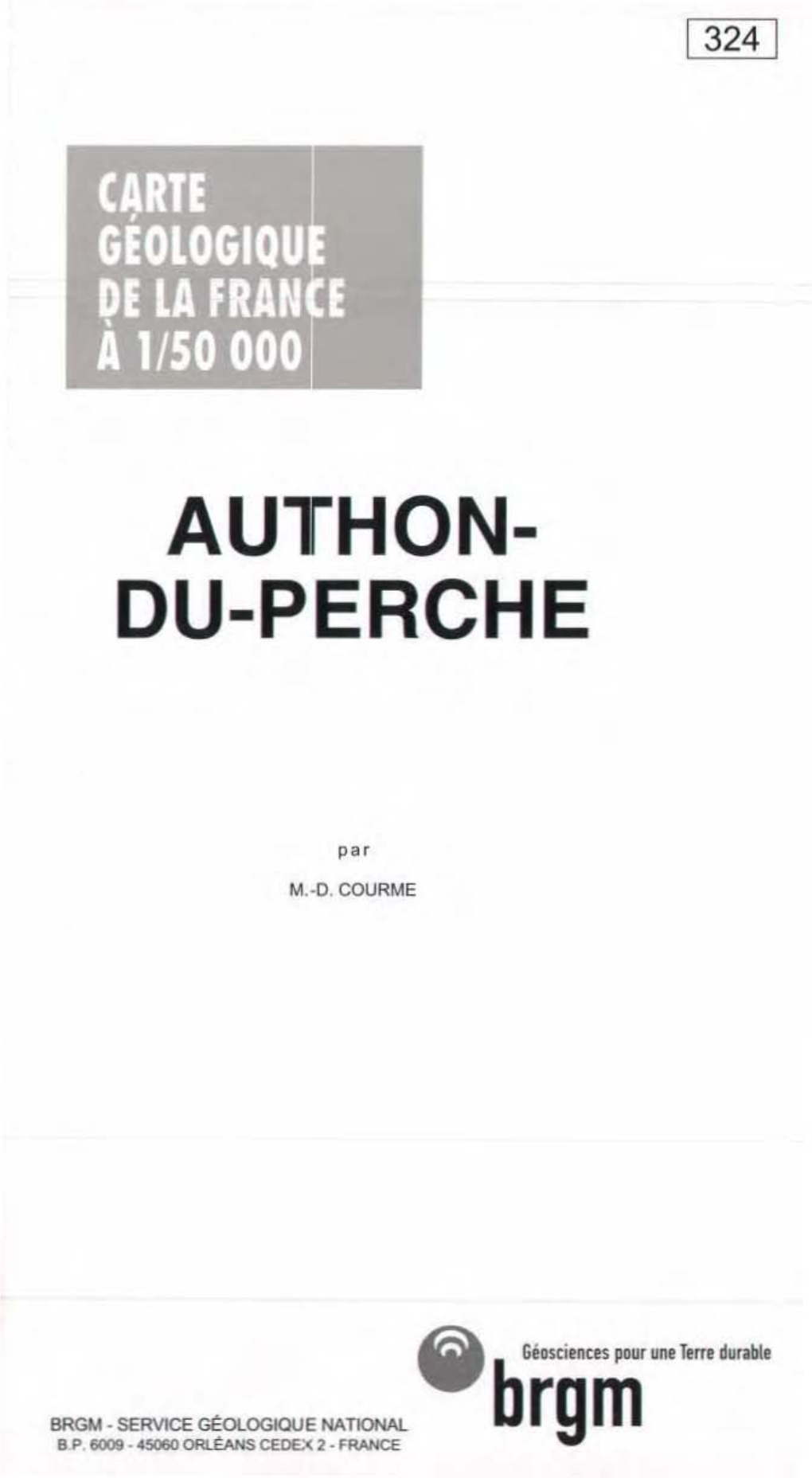
Load more
Recommended publications
-

Projet AR Ouverture Chasse 20
PRÉFÈTE D’EURE-ET-LOIR Direction Départementale des Territoires ARRÊTÉ PRÉFECTORAL OUVERTURE ET CLÔTURE DE LA CHASSE POUR LA CAMPAGNE 2018-2019 LA PRÉFÈTE D’EURE-ET-LOIR CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR, CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE, Vu les articles L. 424-2, R. 424-1 et suivants du Code de l'Environnement ; Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximum autorisé de la bécasse des bois ; Vu le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (SDGC) approuvé en date du 23 octobre 2015 ; Vu l'avis de l’assemblée générale de la Fédération des Chasseurs d’Eure-et-Loir (FDC 28) en date du 06 avril 2018 relatif aux dates d’ouverture et de fermeture ; Vu l'avis de la FDC 28 relatif à la gestion de la bécasse des bois en date du 10 juin 2011 ; Vu les avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 19 avril 2018; Vu le plan de gestion annexé au présent arrêté pour l’espèce sanglier déposé par la Fédération Départementale des Chasseurs, en application de l’article L. 425-15 du Code de l’Environnement ; Vu la consultation du public organisée du 10 avril au 1 er mai 2018; Vu le rapport de M. le Directeur Départemental des Territoires ; Vu l'avis de M. le Directeur Départemental des Territoires ; Vu l’arrêté du 11 septembre 2017 portant délégation de signature au profit de M. Sylvain REVERCHON Di- recteur Départemental des Territoires d’Eure et Loir ; Considérant que conformément à l’article R.424-6 du Code de l’Environnement, la Préfète est compétente pour fixer annuellement la période -

Conseil Communautaire Du 23 Janvier 2017 Compte-Rendu
Conseil Communautaire du 23 janvier 2017 Compte-rendu L'An deux mille dix-sept, le vingt-trois janvier, à dix-huit heures et trente minutes, les membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Perche se sont réunis au Pôle Enfance-Jeunesse, à Nogent le Rotrou, sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Perche pour délibérer sur les questions portées à l’ordre du jour. NOMBRE DE DELEGUES EN EXERCICE : 48 ETAIENT PRESENTS : 35 François HUWART , Président, Marie-Anne PICHARD , 2 ème vice-présidente, Michel THIBAULT, 3ème Vice-président, Dominique FRANCHET, 4ème Vice-président Daniel BOSSION, 5ème Vice-président, Pascal MELLINGER, Patrice LERIGET, Pascal LE TEXIER, Claude EPINETTE, Philippe BELLAY, Thomas BLONSKY, Luc CALLU, Rudy BUARD, Michel RICOUL, Philippe RUHLMANN, Sylvie CHERON, Annie SEVIN, Catherine CATESSON, Didier BOUHET, Jean-Pierre BOUDROT, Marie-Claude BENOIT-MOUSSEAU, Philippe RETOUT, Jean-Claude DORDOIGNE, Catherine MAUGER, Thierry COSSE, Gérard DEVOIR, Josiane SEIGNEUR, Guy BOCQUILLON, Catherine MENAGER, Pierrette DENIS, Jean HAREAU, Pierre FERRE, Patrick GOUHIER, Bertrand de MONICAULT, Gérard MORAND, délégués titulaires ; REPRESENTES : 2 - Pierre BOUDET par Jacques MARTIN, Marc LHUILLERY par Nathalie BRUNET ; POUVOIRS : 6 – Guy CHAMPION, 1er Vice-président, à François HUWART , Bernard MONGUILLON à Catherine CATESSON, Gaëlle COULON à Marie-Claude BENOIT MOUSSEAU , Harold HUWART à Annie SEVIN, Dominique WATTEBLED à Jean-Pierre BOUDROT , Jérémie CRABBE à Thierry COSSE, ABSENTS : 5 – Gilbert DALIBARD, Yanick FRAPSAUCE, Marie POIRIER, Cyrille NACHBAUR, Alain JOSSE, SECRETAIRE DE SEANCE : Pierre FERRE Etaient invités : Monsieur VEDELAGO, Sous-préfet de Nogent-le-Rotrou, et Monsieur MARTINEAU, Trésorier Principal de la Trésorerie de Nogent le Rotrou/Thiron Gardais/Authon du Perche, excusés. -

Sous-Préfecture De Nogent-Le-Rotrou Est Ouverte Au Public Du Lundi Au Vendredi De 8H30 À 12H00
Sous-préfectureSous-préfecture dede Nogent-le-RotrouNogent-le-Rotrou Organisation des services SOUS-PREFET Cédric BOUET SECRÉTAIRE GÉNÉRALE Michelle GARANGER LOGISTIQUE et RÉSIDENCE MISSION D’APPUI ASSISTANCE DE DIRECTION Ségolène LOETTGERS Cécile BELLINI Laurent ROQUILLET VOLONTAIRE du SERVICE CIVIQUE ACCUEIL- POINT NUMÉRIQUE POLE INGENIERIE TERRITORIALE POLE REGLEMENTATON ET SOCIALE (Manifestations culturelles et Sportives, ordre public, POLE INGÉNIERIE ÉCONOMIQUE Associations, suivi budget) Florence PARACHOUT Véronique FORTIN Michelle GARANGER Sous-Préfecture de Nogent Le Rotrou 29 rue Abbé Beulé 28401 Nogent Le Rotrou Tel : 02.37.27.72.01 Mail : [email protected] LeLe sous-préfetsous-préfet Les sous-préfets d’arrondissement ont été institués au même moment que les préfets, par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800). Il y avait alors un sous-préfet par arrondissement. Le premier sous-préfet de Nogent-le-Rotrou est Gilbert ROQUIN DE VIENNE en 14 germinal An VIII (vendredi 4 avril 1800) Arrivée de Monsieur Cédric BOUET, sous-préfet, le 27 août 2018. L’Eure et Loir comprend 4 arrondissements : - Chartres - Dreux - Châteaudun - Et Nogent le Rotrou Au 1er janvier 2019 l’arrondissement de Nogent le Rotrou comprend 48 communes réparties entre 4 EPCI à fiscalité propre : Argenvilliers, Belhomert, Champront-en-Perchet, Champrond-en-Gâtine, Chassant, Combres, Arcisses (fusion des communes Brunelles, Coudreceau, Margon), Saintigny (fusion des communes Saint Denis d’Authou et Frétigny), Corvées les Yys, Fontaine-Simon, -

Mise En Page 1
Le journal de votre Communauté de Communes JANVIER 2011 N° 2 Dossier : les compétences de la Communauté de Communes à l'école • Edito e numéro 1 du journal de notre Communauté de Communes du Perche-Gouet mettait l’accent sur les services « Enfance - Jeunesse » mis en œuvre au sein de la Lcollectivité depuis 2005. Pour mieux faire connaître ces services et donc qu’ils soient mieux utilisés nous avons édité un premier « Guide Enfance - Jeunesse » dans lequel sont recensées toutes les informations sur les structures dédiées ou accueillant des enfants de 0 à 16 ans ; ce guide sera très prochainement disponible dans chacune des 15 mairies du territoire et téléchargeable à partir du site internet de la Communauté de Communes. Pour ce numéro 2 j’ai choisi de mettre en avant « Scolaire et Péri-Scolaire », rappelant ainsi un de nos objectifs fondamentaux : contribuer à faire de nos enfants des citoyens épanouis, actifs et responsables. Nous poursuivons donc notre politique ambitieuse d’investissement dans la rénovation des locaux scolaires : • A l’école de la Bazoche-Gouet, 210 m² de nouveaux locaux neufs ont été construits • A Luigny l’école a été entièrement rénovée et réhabilitée pendant l’été 2010. • En 2011 l’important chantier de la nouvelle école d’Unverre va être ouvert. Tous ces travaux entrepris dans les structures intercommunales ont un second objectif : contribuer à la maîtrise des coûts de fonctionnement ; car comment faire face à l’augmentation constante du prix de l’énergie si ce n’est en adaptant les bâtiments pour en diminuer la consommation. La politique de notre Communauté de Communes s’inscrit donc résolument dans une logique de développement durable. -

Rapport D'activité 2020AVRIL 2021
Assainissement Urbanisme Assistance administrative et juridique Conseil financier ( Voirie ( Rapport d’activité 2020 AVRIL 2021 03 EDITOÉDITO FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT Assemblée générale 04 Assemblée générale 04Conseil Conseil d’administration d’administration Les05 adhérentsLes adhérents L’équipe MISSIONS06 L’équipe 07BILAN MISSIONSDE L’ACTIVITE 2019 Assainissement non collectif Assainissement BILAN DE L’ACTIVITÉ collectif 2020 Instruction09 Assainissement des autorisations non collectif d’urbanisme 14Voirie Assainissement collectif Assistance administrative et juridique/ Conseil16 Instruction financier des autorisations d’urbanisme 18BUDGET Voirie INFORMATION ET COMMUNICATION 21 Assistance administrative et juridique/ PERSPECTIVES 2020 Conseil financier 22 BUDGET 24 INFORMATION ET COMMUNICATION 26 PERSPECTIVES 2021 EURE-ET-LOIR INGÉNIERIEINGENIÉRIE #03#01 RAPPORT RAPPORT D’ACTIVITÉ D’ACTIVITÉ 2020 | DIRECTEUR2019 - DIRECTEUR DE PUBLICATION DE PUBLICATIONClaude TÉROUINARD CLAUDE | RÉDACTEUR TÉROUINARD EN CHEFRÉDACTEUR Adeline EN OLLIVIER CHEF ADELINE | CRÉDIT OLLIVIER PHOTOS - ConseilPHOTOGRAPHIE départemental CONSEIL d’Eure-et-Loir DÉPARTEMENTAL - Eure-et-Loir D’EURE-ET-LOIR Ingénierie |ET MISE FRÉDÉRIC EN PAGE GRAUPNER- Direction MISEde la ENcommunication PAGE DIRECTION Hélène DE COUPÉ LA COMMUNICATION | IMPRESSION ImprimerieHÉLÈNE COUPÉ départementale - IMPRESSION | ONT IMPRIMERIEÉGALEMENT DÉPARTEMENTALE PARTICIPÉ À CE NUMÉRO - ONT ÉGALEMENT Karima BENYAHIA PARTI-, CIPÉAude ÀBRANKA CE NUMÉRO, Sébastien SÉBASTIEN DAVID, Laurence DAVID, JULIE PHILIPPON VIALLE, -Julie MME VIALLE LEMAIRE, - Jean M. BASSOULET, LE BALC’H, Nicole MME HUBERMINARD, DIGER, M. MARIE. Martial LECOMTE, Sylvie DAGUET. 2 EURE-ET-LOIR INGÉNIERIE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 ÉDITO L’année 2020 aura résolument été marquée par le contexte inédit de lutte contre la propagation de l’épidémie de COVID-19. Elle nous aura cependant rappelé toute la pertinence et la nécessité d’un service public de proximité, au plus proche des besoins des euréliens. -

De Languedoüe
Ile-de-France, Gâtinais, Chartrain, Beauce Seigneuries de Boigneville et de Yermenonville Maison en Chartrain de Languedoüe Armes : Languedoüe (Beauce) : «D’or, à huit coquilles de sable posées 3, 2 & 3, séparées par deux bandes de gueules ; la coquille du milieu, en chef, plus haute Languedoüe & celle du milieu, en pointe, plus basse» variantes (Maine, Perche ?) : «D’argent, à deux fasces de gueules, accompagnées de huit coquilles de sable, 3, 2 & 3» ou : «D’or, à deux bandes de gueules accompagnées de huit coquilles de sable, 3, 2 & 3 en orle». Languedoüe, Languedoüe de La Villeneuve, La Villeneuve de Languedoüe (Ile de France) : «D’argent, à deux fasces de gueules accompagnées de huit coquilles de sable, 3, 2 & 3». Sources complémentaires : SHARY : Armorial & Nobiliaire de Montfort Cartulaires des Vaux de Cernay et Port-Royal (Sorbonne, Depoin), actes Yerres et Moulineaux, base Roglo, Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye- Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie), © 2003 Etienne Pattou Contribution de Nicolas Soulard (05/2010) Dernière mise à jour : 19/04/2021 Contribution d’Alain Ménil (relevés CRGPG, 08/2010) développant sur http://racineshistoire.free.fr/LGN branches de Luigny et Archambault 1 Jehan 1er de Languedoüe chevalier Languedoüe ép. ~1220 Olive de Lamoignon (fille de Guillaume Origines de Lamoignon, seigneur de Lamoignon, Mannay, Channay et Nannay en Nivernais + 1288, chevalier, et d’Agnès) (cités ensemble acquisitions 1334 et 1345) Philippe Chenard ép. Jeanne de Presle Languedoüe : Jean II de Languedoüe fl 1284 châtellenie de Prunay-Le-Gillon écuyer puis chevalier (cité 1284, 1334), seigneur de Villeneuve- au bailliage de Chartres Languedoüe (paroisse de Réclainville en Beauce), ép. -

Histoire De L'enseignement Primaire Dans La Commune De Luigny
Histoire de l’Enseignement Primaire dans la Commune de Luigny canton d’Authon Arsène FOUCAULT Luigny le 23 avril 1899 1 Histoire de l’enseignement primaire dans la commune de Luigny C.R.G.P. G. Février 2012 Chapitre - I - Historique très sommaire de la commune. - Situation et topographie – Bourg et hameaux qui la composent – La Population – Occupations de la majorité des habitants. - Son importance au point de vue agricole, industriel et commercial. - Conditions qui ont pu influer sur le développement de l’instruction. 2 Histoire de l’enseignement primaire dans la commune de Luigny C.R.G.P. G. Février 2012 Historique très sommaire de la commune. Voici ce qu’on lit dans le dictionnaire topographique des communes d’Eure-et-Loir de Merlet : Vers l’an 1120, Guillaume de Vichères donne à l’abbaye de Saint-Pierre en Vallée une église dans le Perche dédiée depuis les temps les plus reculés sous le vocable du bienheureux Jean-Baptiste, mais qui est maintenant tellement dégradée par les guerres civiles et étrangères et reléguée dans la solitude qui, si ce n’est le symbole de la religion qui est placé sur l’autel qu’elle renferme, les païens la prendraient plutôt pour la masure d’un malheureux paysan que pour une église des chrétiens. Cette église est située dans un lieu qui vu la grande quantité de loups qui l’infestent est appelée dans le langage vulgaire Loupni (repaire de loups). Cartulaire de Saint-Père. Luigny, à cette époque, était donc perdu au milieu des bois les plus mal hantés. -

L'indemnité Compensatoire Aux Handicaps Naturels (ICHN)
Campagne 2019 : Bilan de l’ICHN en Eure-et-Loir L’Indemnité Compensatoire Bilan des demandes d’ICHN en 2019 : aux Handicaps Naturels (ICHN) en Eure-et-Loir Sur 205 demandes déposées : ● 3 demandes rejetées pour absence de justificatifs ● 202 dossiers instruits dont : Nouvelle Zone Défavorisée Simple ● 65 non éligibles Pour lutter contre le phénomène de déprise dans des zones agricoles réputées difficiles à ● 137 recevables pour un montant total de 950 247 € exploiter, l’Union Européenne a créé, en 1976, la notion de zones défavorisées agricoles. soit 8 060 ha primés Elles permettent l’attribution de certaines aides agricoles afin d’aider les exploitants agricoles situés sur ces zones en compensant le désavantage concurrentiel lié à des conditions Les montants varient de 515 € à 19 445 € pour naturelles peu propices à l’agriculture. des surfaces primées allant de 3,5 ha à 176 ha. Carte des Zones Défavorisées Simples Suite à la révision de ces zones Les demandes non éligibles : engagées en 2016, 59 communes Eure d’Eure-et-Loir, principalement situées dans le Perche, à l’exception de Chartres, ont fait leur entrée dans les zones défavorisées simples. Liste des communes : Argenvilliers, Les Autels- Villevillon, La Bazoche-Gouet, Beauche, Beaumont-les-Autels, Belhomert-Guehouville, Bethonvilliers, Boissy-les-Perche, Champrond-en- Perchet, Chapelle-Guillaume, La Chapelle-Fortin, Les Chatelets, Bon à savoir pour la demande d’ICHN par télédéclaration : Charbonnieres, Chartres, Coudray-au- Perche, Les Etilleux, La Ferte-Vidame, Orne Fontaine-Simon, La Framboisiere, La ● Munissez vous de votre numéro fiscal, de celui de la société et de celui de chacun des Gaudaine, Lamblore, La Loupe, Louvilliers-les-Perche, Luigny, La associés. -

Definition Des Bassins Hydrographiques – Liste Des Communes Concernées
Annexe 2 - Definition des bassins hydrographiques – Liste des communes concernées Bassin versant de « l'Aigre » CHARRAY LA FERTE-VILLENEUIL LE MEE Bassin versant de « l'Avre Aval » THIVILLE AUTHEUIL de sa source jusqu'àBérou la Mulotière RUEIL-LA-GADELIERE LA CHAPELLE-DU-NOYER BEROU-LA-MULOTIERE ROMILLY-SUR-AIGRE LA FERTE-VIDAME LAMBLORE LES RESSUINTES BEAUCHE BOISSY-LES-PERCHE LA CHAPELLE-FORTIN Bassin versant de « l'Avre Amont » MONTIGNY-SUR-AVRE de Bérou la Mulotière jusqu'à l'Eure MORVILLIERS MONTREUIL ROHAIRE DAMPIERRE-SUR-AVRE ESCORPAIN PRUDEMANCHE Bassin versant de « la Blaise » SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS VERNOUILLET SAINT-REMY-SUR-AVRE MONTREUIL VERT-EN-DROUAIS TREMBLAY-LES-VILLAGES DREUX GARNAY REVERCOURT LE BOULLAY-LES-DEUX-EGLISES BREZOLLES AUNAY-SOUS-CRECY CRUCEY-VILLAGES CHERISY LAONS DREUX SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT CRECY-COUVE BEROU-LA-MULOTIERE SAULNIERES SENONCHES TREON LA FERTE-VIDAME SAINT-SAUVEUR-MARVILLE LA FRAMBOISIERE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS LOUVILLIERS-LES-PERCHE MAILLEBOIS LA MANCELIERE LE MESNIL-THOMAS LA PUISAYE SAINT-JEAN-DE-REBERVILLIERS LES RESSUINTES SAINT-MAIXME-HAUTERIVE LA SAUCELLE PONTGOUIN LES CHATELETS SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN MORVILLIERS CRUCEY-VILLAGES FONTAINE-LES-RIBOUTS SAINT-ANGE-ET-TORCAY MANOU ARDELLES DIGNY FAVIERES JAUDRAIS SENONCHES THIMERT-GATELLES LOUVILLIERS-LES-PERCHE Bassin versant de « la Cloche» Bassin versant de « la Conie » LA GAUDAINE FONTENAY-SUR-CONIE MARGON ORGERES-EN-BEAUCE COUDRECEAU GUILLONVILLE FRETIGNY NOTTONVILLE SAINT-DENIS-D'AUTHOU PERONVILLE MONTLANDON VARIZE SAINT-VICTOR-DE-BUTHON -

Eure-Et-Loire DSIL 2020 Centre
Département d’Eure-et-Loir – DSIL 2020 Situation au 30 septembre 2020 Bénéficiaire Montant de la dotation Code INSEE Coût total des projets Effet de levier (Commune ou Projets soutenus initiale attribuée (AE 2020) dép. (HT) DSIL / Coût total (%) EPCI) en euros 28 Amilly Création de sanitaires PMR à l’école élémentaire (ad’ap)26 756 5 351 20,00% 28 Aunay sous Auneau Mise en sécurité de la salle des associations82 000 16 400 20,00% 28 Aunay sous Auneau Création de cheminements piétons (pour sécurisation de l’accès aux abris bus)49 860 9 972 20,00% Réhabilitation de l’école élémentaire Yann Arthus Bertrand (changement de 28 Barjouville31 775 9 533 30,00% fenêtres et volets) Berchères St 28 Remplacement d’une chaudière à fioul par une chaudière à granulés28 630 5 726 20,00% Germain 28 Béville le Comte Rénovation de la salle des associations18 157 3 631 20,00% 28 Chartres métropole Raccordement aux réseaux de chaleur du complexe aquatique de l’Odyssée951 641 262 952 27,63% 28 Chartres métropole Aménagement du plan vert secteur de Jouy166 666 83 333 50,00% CC des portes 28euréliennes d’Ile de Création d’une maison de santé pluridisciplinaire à Epernon2 806 958 290 000 10,33% France CC entre Beauce et 28 Acquisition et travaux pour une maison de santé pluridisciplinaire à Illilers725 000 25 000 3,45% Perche CC entre Beauce et 28 Amélioration de l’éclairage public à Montigny le Chartif23 000 4 600 20,00% Perche CC entre Beauce et 28 Installation de points hot spot wifi dans toutes les communes34 617 8 654 25,00% Perche 28 Le Coudray Mise en accessibilité -

Les Manoirs Gneur De Courcelles
COUDRAY-AU-PERCHE À VOIR SUR VOTRE CHEMIN ACCÈS Parc naturel du Perche Autoroute A 11 « L’Océane », sortie n°4 Brou / Nogent à Luigny, Coudray-au-Perche D 955 Vichères (lieu-dit L’Ambition), puis D 13711 Coudray, comme on l’écrivait autrefois, est situé dans un vallon sillonné par des sources qui alimentent la Ronne. L’habitat traditionnel et D 9 jusqu’à Coudray-au-Perche est particulièrement remarquable, tant dans le bourg qu’en campagne. La charmante église Saint-Pierre est constituée de trois parties : la nef (XIIe s.), le chœur, plus élevé que la nef (XV-XVIe s.), la sacristie et les HÉBERGEMENT/RESTAURATION voûtes du chœur (XIXe s.). Meublés de tourisme et chambres d’hôtes à Authon-du-Perche, Le manoir de Courcelles (XVIe s. et tours XIIe s.) domine la rive Les Étilleux et Coudray-au-Perche gauche de la Ronne. Ce manoir est entré dans la légende avec la dame de Radrais qui fut conduite au bûcher pour avoir trahi le sei- Hôtels à Vichères et Nogent-le-Rotrou Les manoirs gneur de Courcelles. Sur la rive gauche de la Ronne, s’élève le manoir Camping à Authon-du-Perche des Basses-Loges. En limite de Souancé-au-Perche et Vichères, le châ- Restaurants et ravitaillement à Authon-du-Perche teau de Montgraham (XVe s., reconstruit en 1804) fut le cadre des méditations bucoliques de Chateaubriand. La commune rassemble trois sites naturels. Dans le Bois des Mottais se développe une flore protégée, notamment l’Osmonde CHARTE DU RANDONNEUR ÉQUESTRE royale et la Dorine à feuilles opposées. -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2021
Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 28 EURE-ET-LOIR INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 28 - EURE-ET-LOIR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 28-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 28-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 28-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 28-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires