3. Etat Actuel De L'environnement
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
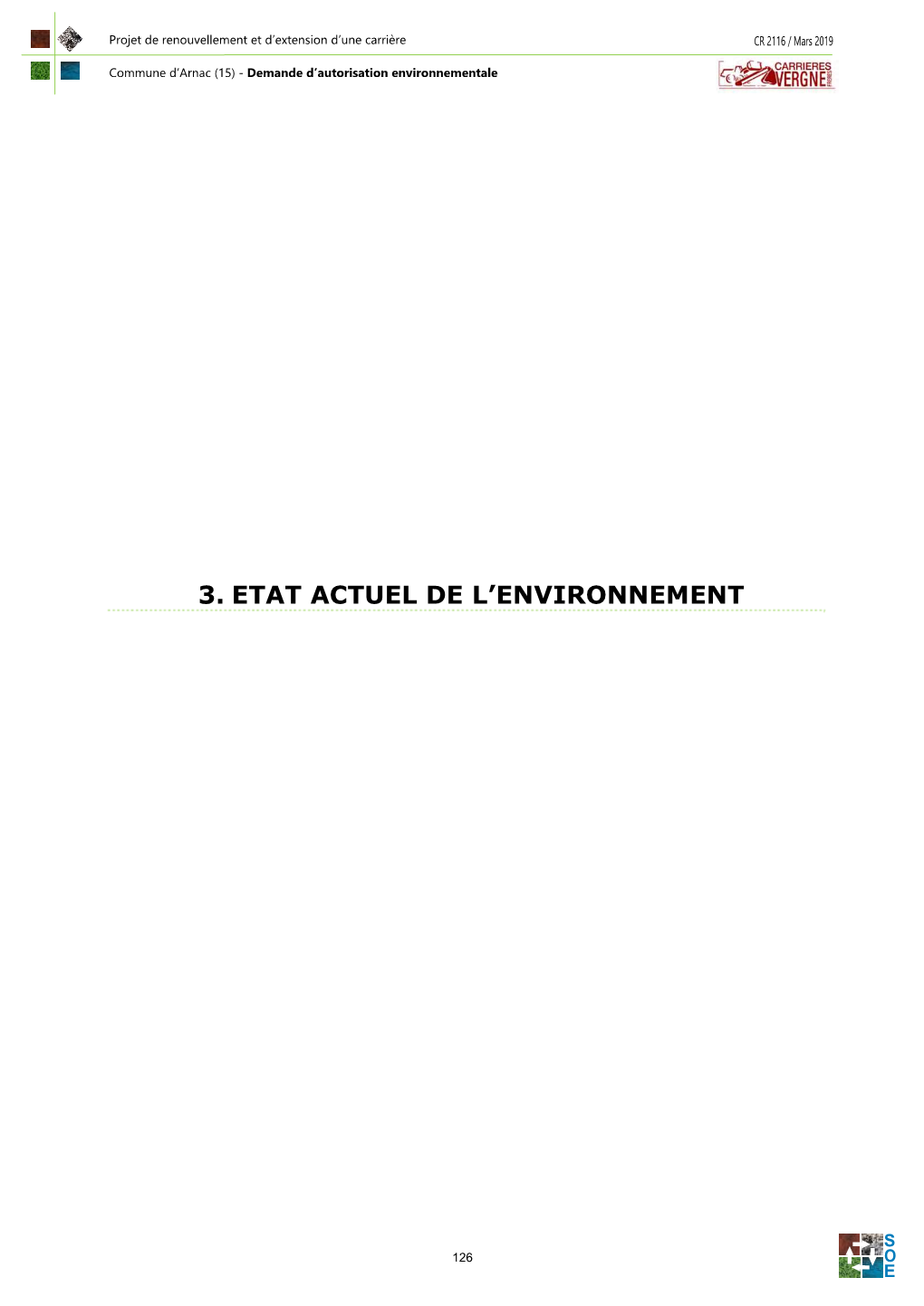
Load more
Recommended publications
-

Dossier De Demande Barrage De Hautefage
Barrage d’Hautefage I NSTALLATION DE GROUPES DE TURBINAGE DU DEBIT RESERVE Mémoire technique JUILLET 2013 Page 1/30 19 – Hautefage – Groupe de turbinage du débit réservé – Mémoire technique Juillet 2013 SOMMAIRE 1. CONTEXTE ET PRESENTATION GENERALE DU PROJET 4 1.1 LOCALISATION 4 1.2 PRESENTATION DE L ’AMENAGEMENT D ’H AUTEFAGE 4 1.3 CONTEXTE 4 1.4 IMPLANTATION GENERALE DU PROJET 5 2. DESCRIPTIF DU PROJET 5 2.1 DESCRIPTION GENERALE 5 2.2 DESCRIPTION DE L ’OUVRAGE DE PRISE D ’EAU ET D ’AMENEE 7 2.2.1 By-pass de restitution du débit réservé 7 2.2.2 Modification des conduits de fond existants – Piquage du nouveau groupe 9 2.2.3 Ouvrage de protection des vannes de vidange de fond 10 2.2.4 Vanne de tête 15 2.2.5 Conduite forcée 15 2.3 CARACTERISTIQUES ET DESCRIPTION DU GROUPE 19 2.3.1 Hauteur de chute, débit exploitable 19 2.3.2 Caractéristiques générales du groupe de restitution 19 2.3.3 Description du groupe de production 20 2.4 DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS SITUES A L ’INTERIEUR DU BATIMENT D ’EXPLOITATION 21 2.4.1 Centrale oléo-hydraulique 21 2.4.2 Evacuation de l’énergie électrique 21 2.4.3 Contrôle-commande 21 2.5 DESCRIPTION DU BATIMENT D ’EXPLOITATION 22 2.5.1 Caractéristiques générales 22 2.5.2 Toiture 22 2.5.3 Exhaure 22 2.5.4 Moyens de manutention 23 2.5.5 Accès en exploitation 23 2.5.6 Canal de fuite 23 3. REALISATION DES TRAVAUX 25 3.1 ACCES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER 25 3.2 PHASAGE ET DUREE DES TRAVAUX 25 3.2.1 Travaux préparatoires de 2013 26 3.2.2 Travaux principaux de 2014 26 Page 2/30 19 – Hautefage – Groupe de turbinage du débit réservé – Mémoire technique Juillet 2013 3.3 RESTITUTION DU DEBIT RESERVE EN PHASE CHANTIER 27 3.4 MODES OPERATOIRES SPECIFIQUES 29 3.4.1 Démontage/Remontage des vannes de fond 29 3.4.2 Blindage de la conduite forcée 30 3.4.3 Réalisation du bâtiment-usine 30 4. -

Diagnostic Sanitaire Et Social De L'arrondissement D'aurillac
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU PAYS D’AURILLAC Diagnostic sanitaire et social de l’arrondissement d’Aurillac Mars 2005 Village d’Entreprises – 14 avenue du Garric – 15000 AURILLAC 04 71 63 88 60 - 04 71 63 88 61 - Email : [email protected] – Site Internet : www.pays-aurillac.com L’étude a été conduite sous la direction d’un comité de pilotage composé comme suit : ADEPA : Mme LEROUX, M. VUILLERMOZ, Mlle VENZAC DDASS du Cantal : M. VIARD Conseil général du Cantal : M. DELACHAUX DRASS Auvergne : Mme PERRIER OBRESA : Mlle MAQUIGHEN, M. CHOQUET, Mme GRONDIN URCAM Auvergne : Mme BARBAT CPAM du Cantal : M. SAINTE-MARIE MSA du Cantal : Mme TESTA CAF du Cantal : Mme NOUGARET Nous tenons également à remercier l’Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques, la Direction Régionale de l’Equipement d’Auvergne, la Direction Départementale de l’Equipement du Cantal et l’inspection académique pour leur aide apportée lors de la réalisation de ce diagnostic. 2 SOMMAIRE I. Présentation de l’arrondissement d’Aurillac ...................................................... 6 A. Situation géographique : un territoire éloigné des métropoles régionales ..................... 6 B. La carte administrative de l’arrondissement d’Aurillac (voir annexe 2)........................ 6 C. Une démographie en légère baisse et un vieillissement de la population ...................... 8 D. Une offre d’emplois concentrée sur Aurillac, malgré l’existence de micro zones d’emploi .............................................................................................................................. -

Parks and Gardens Hikes and Treks
Plan Correze 700x630 GB:1_TXT_FR_2004 15/06/09 12:38 Page1 MONUMENTS CASTLES TYPICAL TOWNS AND VILLAGES MUSEUMS ECO-MUSEUMS ASTAILLAC (K6) ORGNAC-SUR-VEZERE (F2-F3) The typical architecture of the Corrèze includes picturesque villages of old BRIVE-LA-GAILLARDE (H3-I3) TULLE (G5) AYEN (G1) Château d’Estresses Château de Comborn half-timbered or stone houses, with slate or lauze stone roofs (as can be Musée Labenche - Art and History Museum Musée Départemental Espace des Vieux Métiers, A castel dating from the 14C, 15C and 16C, Square tower (Tour Carrée) Remains of a 15 th century castle and its chapel. Visits of the keep, seen in Xaintrie), as well as numerous fountains, bridges, mills, wells and Miscellaneous collections: geology, palaeontology, archaeology, famous de la Résistance et de la de la Locomotion et des Traditions Populaires ROMANESQUE ARCHITECTURE and King Eudes’Room (Salle du Roi Eudes). Terraced gardens overlooking th underground rooms and 10 century crypt. Open all year by prior sculpted crosses. men and history, art and decorative arts, folk traditions and natural history. (Museum dedicated to traditional trades, locomotion and folk traditions). the Dordogne. Open from 1 July t o 31 August and by prior arrangement. arrangement. Tel: +33 5 55 73 77 23 Different periods of history have left a wealth of remarkable architectural Open all year. Tel: +33 5 55 18 17 70 - www.musee-labenche.fr Déportation Resource centre. Open all year. Free This museum displays 300 000 tools and various machines from some thirty Romanesque architecture spread widely in the Bas-Limousin region Tel: +33 5 55 91 10 28 - [email protected] vestiges in villages and towns such as Argentat, Aubazine, Centre d’études Edmond Michelet POMPADOUR (E2) different trades. -

MAQUETTE ESCAPADES 2017 ID.Indd 2 12/06/2017 17:05
CALENDRIER 2017 en Août MARDI 1 VENDREDI 11 Pays de Pompadour Pays de Haute Corrèze en Juillet Lubersac Fromagerie de l’Aire des Sully Ferme de Champtiaux JEUDI 6 MARDI 25 Pays de la Xaintrie SAMEDI 12 Pays de la Xaintrie Pays des Gorges de la Pays de Haute Corrèze Ferme de Calebrousse Haute Dordogne Les escargots des plaines Ferme de Calebrousse Mon petit coin de campagne Pays de Pompadour MERCREDI 2 VENDREDI 7 Lubersac Pays des Gorges de la MERCREDI 16 Pays de Haute Corrèze Toutti Fruits Haute Dordogne Pays Pompadour Lubersac Fromagerie de l’Aire des Sully Pays de Haute Corrèze Ferme du Manus Rucher de la Panetterie Monastère de Jassonneix Pays de Pompadour Vergers de Leycuras LUNDI 10 Lubersac Pays de la Xaintrie Pays des Gorges de la MERCREDI 26 Rucher de la Panetterie Haute Dordogne La Ferme de Luc Pays des Gorges de la Vergers de Leycuras La Ferme du Manus Haute Dordogne Pays de la Xaintrie Pays de la Xaintrie MERCREDI 12 Ferme du Manus Pays des Gorges de la Ruchers de la Maronne Colombiers de la Xaintrie Haute Dordogne Pays de Pompadour Colombiers de la Xaintrie Ruchers de la Maronne Lubersac Ferme du Manus Rucher de la Panetterie JEUDI 3 JEUDI 17 JEUDI 13 Elevage de chevaux Pays de Haute Corrèze Pays de Haute Corrèze Pays de Haute Corrèze Vergers de Leycuras Escargots des plaines Escargots des plaines Escargots des plaines Pays de la Xaintrie VENDREDI 4 VENDREDI 18 Colombiers de la Xaintrie Pays de Haute Corrèze MARDI 18 Ruchers de la Maronne Pays de Haute Corrèze Pays de la Xaintrie Fromagerie de l’Aire des Sully Fromagerie de -

Compte-Rendu De La Seance Du Conseil Municipal Du 24 Mars 2015
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2015 DATE DE LA CONVOCATION : 19 mars 2015 NOMBRE : - de Conseillers en exercice : 23 - de Présents : 23 - de Représentés : 0 - de Votants : 23 L'an deux mille quinze, le mardi vingt-quatre mars à vingt heures une minute, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, Hôtel de Ville d'Argentat, sous la présidence de M. Jean Claude LEYGNAC, Maire. ETAIENT PRESENTS : M. Jean Claude LEYGNAC M. Roger CAUX M. Denis TRONCHE M. Jean-Claude ALAPHILIPPE Mme Geneviève DORGE M. Franck COMBE 1 M. Jacques JOULIE Mme Patricia VIDALLER Mme Carole MAJA Mme Lucienne FAURIE Mme Josiane PIEMONTESI M. Pascal COCHET M. Daniel BRICE M. Patrice SAINT-RAYMOND Mme Annie REYNIER Mme Laurence BRIANCON M. Richard DENOT Mme Sophie MIGNARD-LAYGUE 1 Mme Anne VIEILLEMARINGE Mme Eliane MALBERT M. Sébastien DUCHAMP Mme Françoise LAYOTTE M. Bernard PRESSET 1 Arrivée en séance au cours de la présentation du rapport de la délibération n° d-2015-03-33 SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Geneviève DORGE APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2015 Le procès-verbal du Conseil Municipal du 23 février 2015 est adopté à l'unanimité. 1/8 COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL Monsieur le Maire précise que dans le cadre des délégations consenties par le Conseil Municipal lors de sa séance du 8 avril 2014, il a l'obligation, en vertu des dispositions de l'article L. 2122-23 du CGCT de rendre compte des délégations qu'il a exercées. -

L'annuaire Departemental Des Associations Du Cantal
L’ANNUAIRE DEPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS DU CANTAL LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CANTAL – CHAQUE JOUR AUX CÔTÉS DES BÉNÉVOLES Vous voulez insérer votre association dans l’annuaire départemental, et bénéficier ainsi du large réseau d’information du Conseil départemental du Cantal, C’EST SIMPLE : Etape 1 : Télécharger le formulaire « Autorisation d’insertion dans l’annuaire associatif du Cantal » (disponible sur le site Cantal.fr) Ou Faire la demande de ce formulaire auprès du Service Jeunesse, Vie Associative, Sport du Conseil départemental du Cantal Etape 2 : Remplir l’ensemble des champs mentionnés dans le formulaire Etape 3 : Le retourner (par courrier ou mail) Conseil départemental du Cantal – Service Jeunesse, Vie Associative, Sport 28, avenue Gambetta – 15015 Aurillac Cedex ou [email protected] « Etre chaque jour aux côtés des bénévoles » Le Conseil départemental du Cantal continue de s’engager auprès des acteurs associatifs du Département et de ses bénévoles. Afin de faciliter l’engagement de bénévoles, le Département a créé le 1 er annuaire associatif du Cantal. Ce document attendu par bon nombre d’acteurs associatifs doit permettre : - aux associations de mieux se faire connaître auprès du grand public, - aux bénévoles potentiels de pouvoir bénéficier de coordonnées associatives classées par domaine d’activités et par arrondissement cantalien, - de faire aussi un éclairage particulier sur la richesse du tissu associatif départemental, par sa densité et sa diversité. Une société sans bénévole et, par conséquent sans association, ne serait pas aussi solidaire, humaniste et généreuse. C’est la raison pour laquelle, le Conseil départemental du Cantal a fait le choix d’accompagner les acteurs associatifs du Cantal dans leurs missions et dans la recherche vitale de bénévoles, pour leurs activités. -

2.4 Caractéristiques Des Éoliennes Et Du Parc Éolien
PARC EOLIEN CORREZE 1 12 rond-point de Champs-Elysées 75008 PARIS N° d’indentification RCS : 752 387 704 R.C.S Paris Téléphone : 01.40.07.95.00 Dossier de Demande d’Autorisation Unique Projet Eolien Du Deyroux Communes de Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, de Sexcles et de Mercœur Département de la Corrèze (19) RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE PIECE AU 7 Février 2016 Parc éolien du Deyroux Communes de Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Mercoeur et Sexcles (Corrèze, 19) Résumé non technique L’objectif du résumé non technique est de vulgariser, de synthétiser et simplifier l’étude d’impact. Il est avant toutes choses à destination du public qui le consultera lors de l’enquête publique. Maître d’Ouvrage : Parc éolien de Corrèze 1, filiale d’Eolfi Parc éolien du Deyroux Communes de Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Mercoeur et Sexcles (Corrèze, 19) Etude d'impact sur l'environnement Résumé non technique Janvier 2016 Maître d’Ouvrage : Parc éolien de Corrèze 1, filiale d’Eolfi Intervenants Abies : - Contrôle qualité : Paul NEAU - Coordination et rédaction : Valérie VENZAC - Biodiversité : Audrey SAUGE, Vincent TONNETOT - Cartographie : Christelle MARTY et Vincent TONNETOT ABIES, SARL au capital de 172 800 euros RCS : 448 691 147 Toulouse Code NAF : 7112B 7, avenue du Général Sarrail 31290 Villefranche-de-Lauragais – France Tél. : 05 61 81 69 00. Fax : 05 61 81 68 96 Mail : [email protected] Parc éolien du Deyroux (Camps Saint-Mathurin-Léobazel, Mercoeur et Sexcles, 19) Résumé non technique 1 Cadre général ...........................................................7 2 Le projet ............................................................... 23 3 Etat initial .............................................................. 39 4 Les variantes d’implantation ...................................... -

Partie 3.Pmd
Direction Régionale de l’Environnement du Limousin - Université de Limoges - Région Limousin 9 La Xaintrie Auriac Rilhac Xaintrie Saint-Privat Pleaux Servières le-Château Argentat 9 700 m 600 m 500 m Beaulieu-sur 400 m Dordogne 300 m Espaces agricoles 200 m Espaces forestiers Bretenoux Espaces urbanisés 0 10 km 80 Direction Régionale de l’Environnement du Limousin - Université de Limoges - Région Limousin La Xaintrie, bordée au nord et à l’ouest par la vallée de la La Xaintrie est profondément entaillée par la Maronne dont les Dordogne, prolonge encore les ambiances “montagnardes” des pentes boisées, où se mêlent feuillus et résineux, servent d’écrin aux plateaux corréziens : les reliefs dépassent presque partout 600 mètres Tours de Merle et de Carbonnières. d’altitude. Les taillis de châtaigniers sont fréquents. Parfois même les noyers Mais les horizons étirés, parfois presque plats, souvent assouplis annoncent les climats de l’Aquitaine toute proche. en longues courbes élégantes, s’ouvrent davantage. En outre, quelques champs, cultivés en céréales, s’ajoutent aux pâtures ou à la forêt. Les fermes s’implantent volontiers sur les hauts des croupes et C’est un pays plus ouvert que le plateau corrézien. des pentes dégagées. Elles sont nettement typées par leur toiture à écailles de lauze. Toute l’architecture est ici proche de celle de l’Auvergne. Topographie très plane des interfluves ; vieux châtaignier et fermes isolées (Corrèze) Entre Goulles et Sexcles (Corrèze), clairière avec pâtures encadrée par les courbes élégantes de Entre Servières-le-Château -

Catalogue Immobilier LA MARONNE IMMOBILIERE Pléaux
LA MARONNE IMMOBILIERE Place Georges Pompidou 15700 Pléaux Tel : 06.50.93.64.29 E-Mail : [email protected] Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com Page 1/46 LA MARONNE IMMOBILIERE Place Georges Pompidou 15700 Pléaux Tel : 06.50.93.64.29 E-Mail : [email protected] Vente Immeuble SALERS ( Cantal - 15 ) Surface : 85 m2 Prix : 76000 € Réf : VI078-MARONNE - Description détaillée : Ensemble de 2 immeubles parfaitement situés, aux abords de la place principale du remarquable et très fréquenté village de Salers. Il s'agit d'un premier immeuble aménagé pour l'exercice d'une activité de location saisonnière, avec pas moins de petits 6 gîtes, soit 2 par étage, qui chacun comprend une pièce de vie / chambre et une salle de bain. L'immeuble voisin a une vocation de garage / remise, et peut permettre un aménagement avantageux à qui saura exploiter son potentiel. Assainissement collectif Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13757335 voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13757335/immeuble-a_vendre-salers-15.php Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com Page 2/46 LA MARONNE IMMOBILIERE Place Georges Pompidou 15700 Pléaux Tel : 06.50.93.64.29 E-Mail : [email protected] Vente Maison SALERS ( Cantal - 15 ) Surface : 55 m2 Surface terrain : 124 m2 Surface séjour : 25 m2 Nb pièces : 3 pièces Chambres : 2 chambres SDB : 1 salle de bains Prix : 169600 € Réf : VM610-MARONNE - Description détaillée : Au c?ur de la cité médiévale de Salers tout en restant à l'abris des touristes, découvrez cette charmante maison de bourg entièrement restaurée avec goût. -

GORGES DE LA MARONNE - BARRAGE D'enchanet, SECTEUR AUVERGNE (Identifiant National : 830020176)
Date d'édition : 03/06/2021 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020176 GORGES DE LA MARONNE - BARRAGE D'ENCHANET, SECTEUR AUVERGNE (Identifiant national : 830020176) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 00007059) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire d'Espaces Naturels Auvergne, .- 830020176, GORGES DE LA MARONNE - BARRAGE D'ENCHANET, SECTEUR AUVERGNE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 18 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020176.pdf Région en charge de la zone : Auvergne Rédacteur(s) :Conservatoire d'Espaces Naturels Auvergne Centroïde calculé : 591699°-2008978° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 17/05/2011 Date actuelle d'avis CSRPN : 21/01/2021 Date de première diffusion INPN : Date de dernière diffusion INPN : 28/05/2021 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 3 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 4 6. HABITATS ..................................................................................................................................... -

BULLETIN MUNICIPAL De JUILLET 2019
BULLETIN MUNICIPAL de JUILLET 2019 Edito du Maire Mesdames, Messieurs, Chers Administrés, Ce fût un immense plaisir pour mon équipe et moi-même de servir notre commune tout au long de ces années. L’expérience de mon rôle de maire a été enrichissante auprès de vous tous ; j’ai accompli cette mission avec tout l’intérêt qu’elle méritait. Je n’ai certainement pas été parfaite, mais je peux vous assurer que j’ai fait de mon mieux. Je mesure aujourd’hui la difficulté de pouvoir satisfaire chacun tout en restant dans la légalité, l’exercice est parfois compliqué. Aujourd’hui un mandat électif exige du temps et des connaissances. Un très grand merci aux élus et aux personnels, secrétariat Sylvie et Marie-Lyne, et technique Jean Vincent, et Eric. Vous êtes les maillons essentiels d’un service municipal de qualité. Le droit de réserve avant les élections municipales de mars 2020 nous astreint à une présentation de notre bilan pour ce bulletin de juillet. Des responsabilités nous ont été accordées, il est important pour moi de vous rendre des comptes. En tant qu’élu on se doit d’utiliser les deniers publics à bon escient. Il s’agit de faire au mieux avec nos moyens pour moderniser et pérenniser nos installations, développer des services etc …. Nous étions 11 membres au départ (mars 2014), nous sommes aujourd’hui 8 membres (démission de son poste d’adjointe et conseillère municipale de Mme Véronique Puraymond ; décès de Mme Marie France Chevallier, déménagement de François Jauffret). Démission de son poste d’adjointe de Mme Odette Gubert, mais reste conseillère municipale. -

Le Diagnostic Territorial Du Bassin De
Diagnostic du territoire du bassin de vie d'Argentat date : août 2012 IV.IV.IV.DIMENSION ENVIRONNEMENTALE ET CADRE DE VIE 1.1.1.Géologie et Paysages TYPES DE SOLS ET SOUS-SOLS Le sol de la région d'Argentat, St-Privat, Mercoeur et La-Roche-Canillacest est constitué de granites, leucogranites, migmatites schisteuses, micaschistes, gneiss à deux micas, arènes pélitiques, galets de roches cristallines et volcaniques, basalte et basanite dans le secteur de Rilhac-Xaintrie. La collision entre la plaque Afrique et la plaque Europe a créé de grandes fractures dans le Massif central, à l'origine de la faille d'Argentat. La dislocation d’Argentat a fait apparaître des minéralisations aurifères de type mésothermal. Elle est jalonnée du Nord au Sud par plusieurs prospects (Au+/-As, Sb): Les Angles (19), La Planchette (19), Deyroux (19), Les Granges et Grand-Fraud (46). GÉOLOGIE SIMPLIFIÉE DE LA CORRÈZE Source DDAF Direction Départementale des Territoires Corrèze 61 / 105 Diagnostic du territoire du bassin de vie d'Argentat date : août 2012 SITES GÉOLOGIQUES REMARQUABLES DU TERRITOIRE ( Source Lithotèque du Limousin) Leptynites roches de Vic Granite altéré (St-Bonnet-les- Panorama sur le socle limousin Rocher du peintre à Camps – Tours-de-Merle) Les pays coupés Gorges et vallons forestiers à pentes très fortes. Longs versants forestiers sur gneiss, de pentes moyennes à fortes. Plateau du pays d'Albussac sur gneiss et granadiorites. Plateaux agricoles et versants forestiers sur leucogranites. Versants à dominante forestière sur micaschistes et anatexites. Rebords et plateaux agricoles sur formation basaltiques. PÉDOLOGIE DE LA CORRÈZE Source DDAF Direction Départementale des Territoires Corrèze 62 / 105 Diagnostic du territoire du bassin de vie d'Argentat date : août 2012 LE CLIMAT Le climat est de type océanique altéré.