D'objectifs Natura 2000 Des Sites « Étang De Mauguio
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
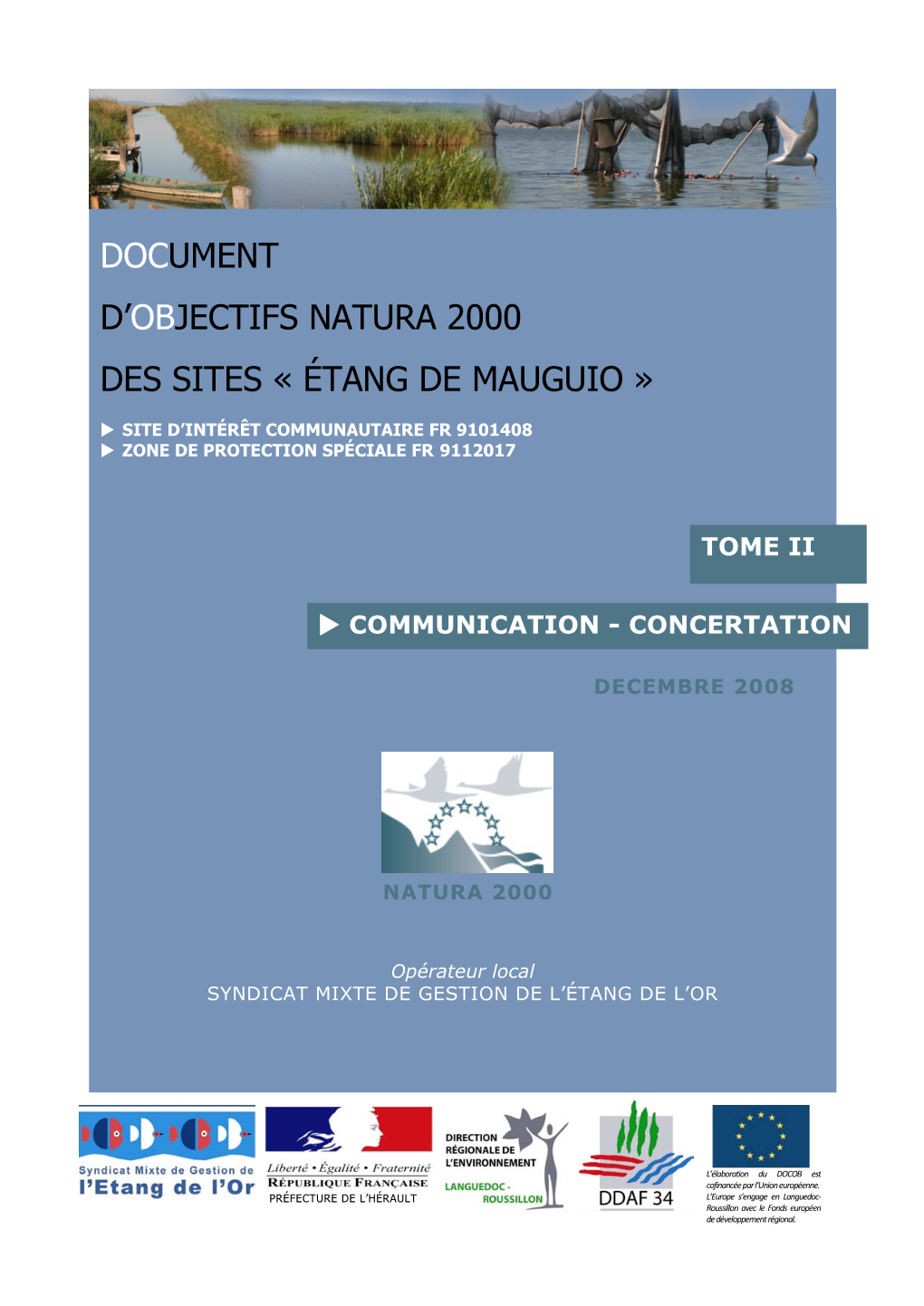
Load more
Recommended publications
-

Guide Parents Employeurs
ENFANCE Guide des parents employeurs d’assistant s maternels Guide des parents employeurs d’un assistant maternel agréé Vous souhaitez confier votre enfant à un assistant maternel. Où vous adresser ? Aux Relais Assistants Maternels (R.A.M) (voir liste page 9, 10, 11, 12, 13) créés en partenariat avec la CAF, le Conseil général et les collectivités territoriales. C’est un lieu d’information, de médiation et d’orientation pour vous et l’assistant maternel. A l’une des 19 agences départementales des solidarités du Conseil général de l’Hérault (voir dernière page). Ces agences couvrent tout notre département. Dans chacune vous trouverez des médecins pédiatres, des puéricultrices, des sage-femmes, des assistantes sociales, des éducateurs, des secrétaires pour répondre à vos questions et vous conseiller. A la mairie de votre commune. Elle possède une liste, régulièrement mise à jour, des assistants maternels résidant dans la commune. Lorsque vous confiez votre enfant à un assistant maternel vous devenez son employeur. Vous devez donc procéder à sa déclaration d’embauche. 2 Quelles sont les démarches d’embauche ? Assurez-vous que la personne est titulaire d’un agrément en cours de validité. Etablissez un contrat de travail écrit Demandez à l’assistant maternel son attestation d’assurance « responsabilité civile professionnelle ». Remplissez auprès de la CAF une demande de complément de libre choix du mode de garde et une déclaration de situation. Le centre Pajemploi vous adresse alors un carnet qui vous permettra de déclarer chaque mois la rémunération de votre employé. Le centre Pajemploi calcule le montant des cotisations et adresse directement une attestation d’emploi à votre salarié. -

Parcours N°1
PARCOURS N°1 PETIT CARNAS : 60 Kms Aller - Saint-Just - Lunel-Viel - La Bruyère - Restinclières - Beaulieu - Saint-Drézéry - Montaud - Saint-Bauzille de Montmel - Mas de Martin - Montée de la Cloze (Carnas) - Direction Vacquières - Croisement Babara à gauche - Fontanes (Hérault) - Croisement de Sainte Croix de Quintillargues à gauche - Saint-Bauzille de Montmel Retour - Montaud - Saint-Drézéry - Beaulieu - Restinclières - La Bruyère - Lunel-Viel - Saint-Just Niveau de difficulté : 2 PARCOURS N°2 GRAND CARNAS : 68 Kms - Saint-Just - Lunel-Viel - La Bruyère - Restinclière - Beaulieu - Saint-Drézéry - Montaud - Saint-Bauzille de Montmel - Mas de Martin - Montée de la Clause (Carnas) Village de Carnas - Mas Neuf - Sardan - Lecques - Salinelles - Sommières - Boisseron - Saint-Christol - Vérargues - Lunel-Viel - Saint-Just Niveau de difficulté : 2 PARCOURS N°3 LES AMBRUSCALLES : 86 Kms Même parcours que le n°1 jusqu’à Carnas La Clause puis : - Vacquières - Sauteyrargues - Claret - Les Ambruscalles - Monté de 6 kms à 5% moyenne - Direction Valflaunes - À 4,5kms prendre : - Lauret - Sauteyrargues - Vacquières - Fontanes (Hérault) - Croisement Sainte-Croix de Quintillargues, prendre à gauche - Saint-Bauzille de Montmel - Montaud - Saint-Drézéry - Beaulieu - Lunel-Viel par la Bruyère - Saint-Just Niveau de difficulté : 3 Dénivelé global : environ 560 m PARCOURS N°4 LAURET : 89 Kms Même parcours que le N°1 (Carnas) = 26 kms - Vacquières - Sauteyrargues - Les Rives - Lauret - Montée de Lauret : 3,5 kms (5% moyen) - En haut de la montée prendre à -

Taxe D'aménagement (TA) Par Commune De L'hérault
Taxe d'Aménagement (TA) par commune de l’Hérault VALEUR Communes N° INSEE Taux unique Communes à FORFAITAIRE 2018 secteurs Stationnement 2018 2018 ABEILHAN 34001 5,00% 2 000,00 € ADISSAN 34002 TABLEAU SECTEUR 2018 2 000,00 € AGDE 34003 TABLEAU SECTEUR 2018 2 000,00 € AGEL 34004 5,00% 2 000,00 € AGONES 34005 5,00% 2 000,00 € AIGNE 34006 3,00% 2 000,00 € AIGUES-VIVES 34007 TABLEAU SECTEUR 2018 2 000,00 € LES AIRES 34008 2,50% 2 000,00 € ALIGNAN-DU-VENT 34009 5,00% 5 000,00 € ANIANE 34010 5,00% 2 000,00 € ARBORAS 34011 5,00% 2 000,00 € ARGELLIERS 34012 5,00% 2 000,00 € ASPIRAN 34013 5,00% 2 000,00 € ASSAS 34014 5,00% 2 000,00 € ASSIGNAN 34015 3,00% 2 000,00 € AUMELAS 34016 5,00% 2 000,00 € AUMES 34017 5,00% 2 000,00 € AUTIGNAC 34018 4,00% 2 000,00 € AVENE 34019 3,00% 2 000,00 € AZILLANET 34020 2,50% 2 000,00 € BABEAU-BOULDOUX 34021 2,50% 2 000,00 € BAILLARGUES 34022 5,00% 5 000,00 € BALARUC-LES-BAINS 34023 5,00% 2 000,00 € BALARUC-LE-VIEUX 34024 3,00% 2 000,00 € BASSAN 34025 5,00% 2 000,00 € BEAUFORT 34026 3,00% 2 000,00 € BEAULIEU 34027 5,00% 5 000,00 € BEDARIEUX 34028 TABLEAU SECTEUR 2018 2 000,00 € BELARGA 34029 5,00% 2 000,00 € BERLOU 34030 2,00% 2 000,00 € BESSAN 34031 TABLEAU SECTEUR 2018 2 000,00 € BEZIERS 34032 TABLEAU SECTEUR 2018 2 000,00 € BOISSERON 34033 5,00% 2 000,00 € BOISSET 34034 2,00% 2 000,00 € LA BOISSIERE 34035 4,00% 2 000,00 € LE BOSC 34036 5,00% 2 000,00 € BOUJAN-SUR-LIBRON 34037 5,00% 5 000,00 € LE BOUSQUET-D'ORB 34038 TABLEAU SECTEUR 2018 2 000,00 € BOUZIGUES 34039 5,00% 2 000,00 € BRENAS 34040 1,50% 2 000,00 € BRIGNAC -

Dossier D'enquete Publique
SCHEMA DE w COH ERENCE TERRITORIALE pogs del' AGGroltÉn¡roN DU PAYS DE L'OR DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE NE PAS EMPORTER V¡sn o OMMISSAIRE EruOUCTEUR Avrs DES PensoruNES PueLnuES Assocrres 300, Av. Jacqueline AURIOL - Zone aéroportuaire - CS 70040 - 34137 Mauguio Cedex Courriel : [email protected] - Tel.04 67 12 35 00 Fax. 04 67 12 35 18 LISTE DES ORGANISMES ET DES SERVICES CONSULTES 300, Av. Jacqueline AURIOL - Zone aéroportuaire - CS 70040 - 34137 Mauguio Cedex Couniel : [email protected] - TêL 04 67 12 35 00 Fax. 04 67 12 35 18 Monsieur le Préfet de Région Monsieur le Préfet de I'Hérault Madame la Présidente de la Région Occitanie Monsieur le Président du Conseil Départemental de Hérault Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et de I'industrie de I'Hérault Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture de I'Hérault Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de I'Artisanat de I'Hérault Monsieur le Président de I'Agglomération de Montpellier Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lunel Monsieur le Président du Syndicat Mixte du SCOT du Sud du Gard Monsieur le Président du Syndicat du Bassin du Lez Madame la Présidente de I'association de Grande-Motte Environnement Monsieur le Président de I'association de Melgueil Environnement Monsieur le Président du Syndicat Mixte du bassin de I'Or Monsieur le Président de I'Agence de I'Eau Rhône Méditerranée Corse Madame la Présidente de BRGM Monsieur le Président de I'IFREMER Monsieur le Président de la SPLA Monsieur le Directeur Régional e -

Commune De Saussines
Direction Départementale des Territoires et de la Mer Service Eau, Risques et Nature PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS D'INONDATION COMMUNE DE SAUSSINES DOSSIER DE CONSULTATION OFFICIELLE Rapport de présentation Procédure Prescription Enquête Publique Approbation Elaboration 12/06/2015 Plan de Prévention des Risques d’inondation – Commune de SAUSSINES Rapport de présentation – Consultation officielle 1/75 TABLE DES MATIÈRES PREMIÈRE P ARTIE : P RINCIPES GÉNÉRAUX DES PPR ET DU RISQUE D'INONDATION ......................................9 1. I NTRODUCTION .......................................................................................................................9 1.1. C ONSTATS GÉNÉRAUX ...........................................................................................................9 1.2. P OURQUOI UNE POLITIQUE NATIONALE DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS ?................................9 1.3. L A DÉMARCHE GLOBALE DE PRÉVENTION DE L’É TAT EN MATIÈRE DE RISQUES NATURELS .....................10 1.4. C HRONOLOGIE DE LA LÉGISLATION CONCERNANT LA PRÉVENTION DES RISQUES .................................10 1.5. O BJET DU RAPPORT DE PRÉSENTATION ...................................................................................13 2. D ÉMARCHE D’ÉLABORATION D’UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS D'INONDATION ...............14 2.1. Q U’EST -CE QU ’UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS ?...............................................14 2.1.1. Que contient le plan de prévention des risques naturels inondation (PPRI) -

Février Mars Avril
Février Avril Mai Vendredi 1 à 20h30 Dimanche 1 à 15h Vendredi 12 à 19h Millefeuilles Théâtre Foot Séniors « Venez partager les livres que vous Mars "Inconnu à cette adresse" Saussines/JFC Tritons avez aimés » Vendredi 4 à 20h30 Médiathèque La Forge Stade Proposé par "Ribansol-Lire" Médiathèque La Forge Foot Vétérans Vendredi 20 à 18h30 Proposé par "Ribansol-Lire" Saussines/Le Grau du Roi Dimanche 3 à 15h Cirque "Tiravol" Samedi 13 à 12h Stade Foot Séniors Place de la Mairie Repas des ainés Samedi 12 à 19h Saussines/Teyran Proposé par les "Amis du Théâtre Salle des Fêtes Stade Populaire de Lunel" Soirée Jeux Dimanche 14 à 13h30 Salle de la Mairie Vendredi 8 à 19h Vendredi 20 à 20h30 Ecuries du Celtis Proposée par "Entre Parenthèses" Millefeuilles Foot Vétérans Challenge travail à pied Dimanche 13 à 15h « Venez partager les livres que vous Saussines/Boisseron avez aimés » Stade Samedi 20 à 20h30 Foot Séniors Humour Saussines/Vendargues Médiathèque La Forge Dimanche 22 Proposé par "Ribansol-Lire" « A l’abordage » Stade Fête de la biquette Daniel Villanova Dimanche 13 à 16h Vendredi 8 à 20h30 Proposée par le conseil municipal des Salle des Fêtes Loto Foot Vétérans jeunes Salle des Fêtes Saussines/Aubais Du Vendredi 27 Proposé par l’association l’Octave Stade au Dimanche 29 Vendredi 18 à 20h30 Samedi 9 à 19h Fête du village Foot Vétérans Soirée Jeux avec manifestations taurines Saussines/St Mathieu de Tréviers Salle de la Mairie Proposée par "Saussines en Fête" Stade Proposée par "Entre Parenthèses" Mardi 22 à 10h Dimanche 10 Coucou Solette -

Hérault Transport Lignes Régulières Hérault Transport
Réseau Hérault Transport Lignes régulières Hérault Transport L5 Navette de St Guilhem L4 Parking du Grand Site L3 L2 L3 Aéroport de Montpellier Navette des plages Commune Gare routière Point de correspondance tramway Autoroute Voie férée Lignes régulières Lignes estivales Service de la communication - Hérault Transport - 2016 Transport Service de la communication - Hérault E5 - Abeilhan E8 - Balaruc les Bains E7 - Campagnan F4 - Cazouls les Béziers F3 - Cruzy E8 - Gigean A8 - Laroque C9 - Montferrier sur Lez G2 - Oupia E8 - Poussan E5 - Roujan D9 - Saint Georges d’Orques E7 - Saint Pargoire G1 - Siran C10 - Vendargues E6 - Adissan E8 - Balaruc le Vieux B10 - Campagne F3 - Cébazan C5 - Dio et Valquières C7 - Gignac D9 - Lattes F3 - Montouliers E5 - Pailhès E5 - Pouzolles B8 - Saint André de Buèges D4 - Saint Gervais sur Mare D8 - Saint Paul et Valmalle A6 - Sorbs D7 - Vendémian F7 - Agde F5 - Bassan C4 - Camplong B4 - Ceilhes et Rocozels E5 - Espondeilhan A7 - Gornies E5 - Laurens Vendres E5 - Margon A9 - Montoulieu D10 - Palavas les Flots D7 - Pouzols D7 - Saint André de Sangonis C7 - Saint Guilhem le Désert B6 - Saint Pierre la Farge B6 - Soubès G5 - Vendres Plages F3 - Agel G2 - Beaufort D10 - Candillargues C6 - Celles D9 - Fabrègues D9 - Grabels B9 - Lauret F7 - Marseillan D9 - Montpellier E2 - Pardailhan C9 - Prades le Lez D10 - Saint Aunès C6 - Saint Guiraud E2 - Saint Pons de Thomières C6 - Soumont C11 - Vérargues A8 - Agones C10 - Beaulieu D7 - Canet F5 - Cers D5 - Faugères C4 - Graissessac B5 - Lauroux C11 - Marsillargues C7 - -

Commune De SAUSSINES
République Française Département de l'Hérault - Arrondissement de Montpellier Commune de SAUSSINES COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL VALANT PROCÉS VERBAL SÉANCE DU 26 JUIN 2019 Date d’affichage du compte rendu : le 3 juillet 2019 Présents : Henry Sarrazin, Jean-Michel Meunier, Yves Savidan, Isabelle Moronval, Catherine Vigne, Claude Cathelin, Gérard Espinosa, Isabelle Milesi, Valérie Bourgarit, Monique Masduraud (arrivée à 21h05 au point n°10, Délibération n° 2019-04-06/36) Absents ayant donné procuration : Monique Masduraud à Henry Sarrazin (jusqu’à 21h05), Jean louis PONS à Gérard ESPINOSA, Nicolas Baudesseau à Isabelle Moronval, Absents excusés : Pamela IZARD, Marion Manahiloff Secrétaire de séance : Jean-Michel Meunier Date de convocation: 20 juin 2019 Approbation des procès-verbaux de la séance du 29 avril 2019 FINANCES : Délibération modificative n°2019-2 – M14 Délibération n° 2019-04-06/27 Le Maire expose au conseil la nécessité d’une délibération modificative, suite aux observations de la Trésorerie et de la Préfecture, qui soulignent une erreur d’imputation lors de l’élaboration du BP 2019. En effet, il apparait un déséquilibre en section d’investissement, lié à certaines dépenses réelles et d’ordre. Il propose la modification suivante : Dépenses FONCTIONNEMENT Recettes FONCTIONNEMENT Total - € Total - € Dépenses INVESTISSEMENT Recettes INVESTISSEMENT chapitre 040 Article 2116 6000 Article 2158 1500 Article 2184 1500 Chapitre 21 Article 2116 + 6000 Article 2158 + 1500 Article 2184 + 1500 Total 0 € Total - € Il est demandé au -

Rapport Saint-Christol
BOISSERON CAMPAGNE GALARGUES GARRIGUES LUNEL LUNEL-VIEL MARSILLARGUES RAPPORT SAINT-CHRISTOL D’ACTIVITÉS SAINT-JUST SAINT-NAZAIRE DE PÉZAN 2012 SAINT-SÉRIÈS SATURARGUES SAUSSINES VÉRARGUES VILLETELLE www.paysdelunel.fr 2012, trois communes qui ont fait le choix du Pays de Lunel ! Un rapport d’activité, est toujours une occasion de faire une pause, de regarder le chemin parcouru, d’ouvrir des perspectives et de se féliciter de l’arrivée de nouveaux habitants, de nouvelles communes. En 2012, Garrigues, Campagne et Galargues ont choisi le Pays de Lunel pour le rejoindre au 1er janvier 2013 et nous nous félicitons du choix de leurs élus. Ils ont choisi une équipe mais aussi un projet de territoire et des valeurs qui nous sont communes. Ces valeurs, elles sont culturelles bien entendu, mais au-delà, elles portent sur les choix que nous faisons au quotidien pour le développement du Pays de Lunel. Notre engagement pour l’environnement et les valeurs du développement durable sont autant d’empreintes qui caractérisent l’action de notre équipe. C’est je crois, un facteur d’attractivité pour notre territoire. C’est aussi la raison pour laquelle, dans les mois à venir, nous allons nous engager dans une démarche agenda 21. En 2012, les indicateurs sont, comme les années précédentes, au vert. Qu’on parle de culture, de développement François Berna économique, de transports, de gestion des déchets, toujours plus de services apportés aux usagers, toujours Président plus de projets économiques soutenus, des gains de fréquentation pour nos principaux équipements. Ce rapport Maire de Saint-Sériès d’activité en est le reflet. -

Entreprendre En Pays De Lunel
# 135 /// JANVIER 2019 MENSUEL D'INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CULTURE SOLIDARITÉ Nodixia, une entreprise certifiée Votre programme réseau des Croix Rouge, les différents visages de développement durable médiathèques jusqu’en juin l’aide humanitaire P. 6 P. 11-18 P. 20 Claude Arnaud, Président, les élus, les agents de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, vous souhaitent une année solidaire Boisseron /// Campagne /// Galargues /// Garrigues /// Lunel /// Lunel-Viel /// Marsillargues Saint-Christol commune d'Entre-Vignes /// Saint-Just /// St-Nazaire De Pézan /// Saint-Sériès www.paysdelunel.fr Saturargues /// Saussines /// Vérargues commune d'Entre-Vignes /// Villetelle # 135 /// Janvier 2019 Les échos du conseil de Communauté > Signature d’une Convention d’éducation à l’environnement et au développement durable Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes développe des actions d’éducation, de sensibilisation au territoire et à la citoyenneté. Ces actions s’appuient sur une démarche forte en direction des scolaires et permettent, en Vous vous posez une question sur les services collaboration étroite avec l’Education Nationale, l’émergence de la Communauté de Communes ? Chaque de projets pédagogiques. L’Education Nationale et la mois, Pays de Lunel le Mag’ vous répond. Communauté de Communes ont donc acté une convention d’éducation à l’environnement et au développement durable « Le mois de janvier approche janvier et je n’ai pour œuvrer conjointement afin de développer des projets toujours -

Plan Des Aires
n°5 - Janvier 2017 Infos Toute l’actualité de la Commune de Mudaison www.mudaison.fr 6 ZAC Plan des Aires Action municipale Vie scolaire et Jeunesse AGGLO du Pays de l’Or 4 Haut débit 10 Plan VIGIPIRATE 14 DOSSIER CIAS Fibre optique PPMS Edito SommaireSommaire du maire Chères Mudaisonnaises, Chers Mudaisonnais Cette année 2016, a été une nouvelle fois marquée par J’adresse d’odieux attentats terroristes. A Nice, pour le 14 juillet, frappant d’innocentes victimes venues se réjouir pour mes remerciements notre fête nationale et à St-Etienne du Rouvray, le 26 aux associations juillet, où le Père Jacques HAMEL a été sauvagement et bénévoles, assassiné. Nos pensées vont, bien sûr aux victimes et aux familles touchées par ces tragiques évènements. aux artisans, Cette année 2016 a vu notre Région fusionner avec commerçants, Midi-Pyrénées, pour devenir la grande RÉGION professionnels 6 « Occitanie ». Une fusion qui ne nous a sûrement pas été de santé pour urbanisme bénéfique en ce qui concerne le financement de notre leur dynamisme, dossier L.G.V. L’impact financier de ce désengagement ZAC Lou Plan des Aires et au personnel Vie locale devra être pris en compte lors de notre budget de cette 5 Endommagement Croix de la Mission année 2017. communal pour son Vandalisme - Propreté publique Nouveau propriétaire épicerie - boucherie Sachez que vos préoccupations sont aussi les nôtres, investissement. notamment en matière d’hydraulique et de Haut Débit. Côté Urbanisme Les pages de ce bulletin vous informeront plus en 6 ZAC Lou Plan des Aires - RD 189 détail, sur les actions municipales. -

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 Sur 100
1er mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 100 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Décret no 2014-258 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l’Hérault NOR : INTA1403033D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3113-2 ; Vu le code électoral, notamment son article L. 191-1 ; Vu le décret no 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ensemble le I de l’article 71 du décret no 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; Vu la délibération du conseil général de l’Hérault en date du 27 janvier 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Art. 1er.−Le département de l’Hérault comprend vingt-cinq cantons : – canton no 1 (Agde) ; – canton no 2 (Béziers-1) ; – canton no 3 (Béziers-2) ; – canton no 4 (Béziers-3) ; – canton no 5 (Cazouls-lès-Béziers) ; – canton no 6 (Clermont-l’Hérault) ; – canton no 7 (Le Crès) ; – canton no 8 (Frontignan) ; – canton no 9 (Gignac) ; – canton no 10 (Lattes) ; – canton no 11 (Lodève) ; – canton no 12 (Lunel) ; – canton no 13 (Mauguio) ; – canton no 14 (Mèze) ; – canton no 15 (Montpellier-1) ; – canton no 16 (Montpellier-2) ; – canton no 17 (Montpellier-3) ; – canton no 18 (Montpellier-4) ; – canton no 19 (Montpellier-5) ; – canton no 20 (Montpellier - Castelnau-le-Lez) ; – canton no 21 (Pézenas) ; – canton no 22 (Pignan) ; – canton no 23 (Saint-Gély-du-Fesc) ; – canton no 24 (Saint-Pons-de-Thomières) ; .