SUR Ve:Îberie (OISE)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Plan Local D'urbanisme
5 et 7 rue Nicolas de Lancy 60810 RARAY Commune de RARAY Tél : 03 44 54 70 56 Courriel : [email protected] PLAN LOCAL D’URBANISME 16U15 Rendu exécutoire le Révision n°1 suivant une procédure simplifiée - Modification n°1 Date d’origine : ETUDE URBAINE Septembre 2016 9 P.L.U. approuvé le 25 mai 2013 et modification simplifiée n°1 approuvée le 8 août 2014 - Etudes réalisées par ARVAL Urbanisme RÉVISION N°1 SUIVANT UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE MODIFICATION N°1 - APPROBATION - Dossier annexé à la délibération municipale du 17 Septembre 2016 Urbanistes : Mandataire : ARVAL Agence d’Urbanisme ARVAL Sarl MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD 3 bis, Place de la République - 60800 CREPY-EN-VALOIS Téléphone : 03 44 94 72 16 - Fax : 03 44 39 04 61 Courriel : Nicolas. Thimonier @arval-archi.fr Equipe d’étude : N. Thimonier (Géog-Urb) ÉTUDE URBAINE DE RARAY COMMUNE DE RARAY / PNR OISE PAYS DE FRANCE PHASE 1 COMPRÉHENSION DU PAYSAGE D'INSCRIPTION DU VILLAGE Novembre 2006 D+H architecture & environnement - Groupement ATELIER 15 architecture & paysage Nathalie Hébert architecte Mireille Falque paysagiste Maé Vandais paysagiste assistante S o m m a i r e 4 Compréhension du paysage d'inscription du village Les composantes objectives du paysage......................................... p 5 Raray dans le Valois Multien.......................................................................... p 7 Un relief de plaine ondulée.............................................................................p 8 Une structure géologique simple............................................................... -

Les Cantons Et Communes De La 4Ème Circonscription De L'oise CANTON
Les cantons et communes de la 4ème circonscription de l'Oise CODE CANTON COMMUNE ARRONDISSEMENT POSTAL BETZ 60620 ACY-EN-MULTIEN SENLIS BETZ 60620 ANTILLY SENLIS BETZ 60890 AUTHEUIL-EN-VALOIS SENLIS BETZ 60620 BARGNY SENLIS BETZ 60620 BETZ SENLIS BETZ 60620 BOUILLANCY SENLIS BETZ 60620 BOULLARRE SENLIS BETZ 60141 BOURSONNE SENLIS BETZ 60440 BREGY SENLIS BETZ 60620 CUVERGNON SENLIS BETZ 60620 ETAVIGNY SENLIS BETZ 60117 GONDREVILLE SENLIS BETZ 60141 IVORS SENLIS BETZ 60800 LEVIGNEN SENLIS BETZ 60890 MAREUIL-SUR-OURCQ SENLIS BETZ 60890 MAROLLES SENLIS BETZ 60890 NEUFCHELLES SENLIS BETZ 60620 ORMOY-LE-DAVIEN SENLIS BETZ 60620 REEZ-FOSSE-MARTIN SENLIS BETZ 60620 ROSOY-EN-MULTIEN SENLIS BETZ 60620 ROUVRES-EN-MULTIEN SENLIS BETZ 60890 THURY-EN-VALOIS SENLIS BETZ 60890 VARINFROY SENLIS BETZ 60890 VILLENEUVE-SOUS-THURY (la) SENLIS BETZ 60620 VILLERS-SAINT-GENEST SENLIS CHANTILLY 60300 APREMONT SENLIS CHANTILLY 60500 CHANTILLY SENLIS CHANTILLY 60580 COYE LA FORET SENLIS CHANTILLY 60270 GOUVIEUX SENLIS CHANTILLY 60260 LAMORLAYE SENLIS CHANTILLY 60740 SAINT-MAXIMIN SENLIS NANTEUIL LE HAUDOUIN 60300 BARON SENLIS NANTEUIL LE HAUDOUIN 60440 BOISSY-FRESNOY SENLIS NANTEUIL LE HAUDOUIN 60300 BOREST SENLIS NANTEUIL LE HAUDOUIN 60440 CHEVREVILLE SENLIS NANTEUIL LE HAUDOUIN 60950 ERMENONVILLE SENLIS NANTEUIL LE HAUDOUIN 60330 EVE SENLIS NANTEUIL LE HAUDOUIN 60300 FONTAINE-CHAALIS SENLIS NANTEUIL LE HAUDOUIN 60800 FRESNOY-LE-LUAT SENLIS NANTEUIL LE HAUDOUIN 60330 LAGNY-LE-SEC SENLIS NANTEUIL LE HAUDOUIN 60950 MONTAGNY-SAINTE-FELICITE SENLIS NANTEUIL LE HAUDOUIN -
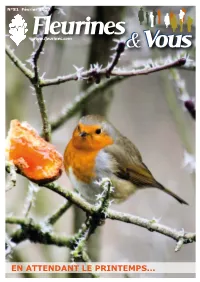
Fleurines Et Vous N 81 V4
N°81 Février 2017 Fleurines www.eurines.com &&VousVous EN ATTENDANT LE PRINTEMPS... ACTUALITÉS Édito Communauté de Communes Senlis Sud Oise : Chers Fleurinoises et Fleurinois, c’est avec un 18 communes plaisir renouvelé que j’aborde ce 81ème édito- a loi du 7 août 2005 portant sur la rial de votre Fleurines & Nouvelle Organisation Territo- Vous pour partager riale de la République (NOTRe) ensemble l’essentiel de prévoit la disparition des commu- l’actualité communale nautés de communes de petite du moment. taille en imposant leur regroupe- ment avec d’autres EPCI (1). Avant d’aborder plus en détail cette actualité, je souhaite saluer au travers de cette tribune, l’action des services Compte-tenu de la cartographie techniques communaux qui ont su au des territoires et de la densité de la début du mois, faire face aux gelées et population, le Préfet de l'Oise a Sept commissions permanentes autres pluies verglaçantes pour viabiliser procédé au regroupement de la sont mises en place au regard des et sécuriser les principaux axes de circu- Communauté de Communes des 3 compétences du nouvel ECPI : lation du village. Toutes mes félicitations Forêts (CC3F) et de la Communauté Finances, Action sociale/petite aux équipes pour cette performance, de Communes Cœur Sud Oise enfance, Développement durable/ dont l’efficacité fut encore plus percep- (CCCSO). élimination des déchets, Dévelop- tible en quittant Fleurines et en traver- sant les communes voisines… Le regroupement a été approuvé pement économique, Tourisme, par l'ensemble des Conseils Munici- Équipements communautaires, Eau A l’échelle du village, l’heure est à l’éla- paux concernés et a conduit à la /assainissement. -

Ville De Pont-Sainte-Maxence République Français E
VILLE DE PONT-SAINTE-MAXENCE RÉPUBLIQUE FRANÇAIS E PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2013 L’an deux mil treize le vingt-huit janvier à vingt heures trente, le Conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Michel DELMAS, Maire. Etaient présents : M. DELMAS M. FLAMANT, M. ROBY, Mme DRAINS, Mme DUNAND, M. GONTIER, Mme GOVAERTS-BENSARIA, M. NOEL, Mme NINORET, M. GASTON, Adjoints au Maire, M. KOROLOFF, M. YACOUBI, Mme BATICLE-POTHIER, Conseillers municipaux délégués M. PALTEAU, M. DAFLON, Mme LOUCHART, M. LOPES, Mme KERMAGORET, Mme MAGNIER, M. BIGORGNE, M. DUMONTIER, M. SCHWARZ, Conseillers municipaux Etaient représentés : M. AUGUET par M. DAFLON M. THEVENOT par M. FLAMANT Mme MEURANT par M. ROBY Mme SIMON par Mme DUNAND Mme CATOIRE par Mme NINORET Mme TIXIER par Mme DRAINS Mme CAPRON par Mme KERMAGORET Etaient absents : M. TEIXEIRA M. HERVIEU Etaient excusés : M. TOUZET Mme TOUZET Secrétaire de séance : M. KOROLOFF *** Monsieur le Maire invite les membres de l’Assemblée à traiter l’ordre du jour de la présente séance : Approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2012 ; Compte rendu du Maire au Conseil Municipal des décisions prises dans le cadre de sa délégation ; Communication des D.I.A. ; Présentation du projet de réalisation du bassin de stockage ; ADMINISTRATION GENERALE : Dénomination du collège des Terriers ; VIE ASSOCIATIVE Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association Passion Gazelles 60 ; DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS : -

Comite De L'oise
CALENDRIER 2013 COMITE DE L’OISE COMITE DIRECTEUR DU COMITE DE L’OISE PRESIDENT : M. DANHIEZ André 4 rue de la BRECHE 60100 CREIL ( 03 44 25 34 02 06 86 66 97 84 *** : [email protected] VICE-PRESIDENTS: M. DUCROCQ Gaston 24, rue Albert ROBIDA 60200 COMPIEGNE 06 87 93 61 72 *** : [email protected] M. LEBESGUE Michel 4, rue du Charolais bat B5 n° 796 60000 BEAUVAIS 06 80 75 98 50 *** : [email protected] M. FETILLEUX Christian 20, rue Clos de l'AUTOMNE 60410 SAINT VAAST DE LONGMONT ( 03 44 40 58 63 06 26 54 55 23 *** : [email protected] M. TREVOIZAN Yves 4, rue RONSARD 60180 NOGENT SUR OISE ( 03 44 66 05 21 06 78 57 23 31 *** : [email protected] SECRETAIRE GENERAL: M. DESGROUX Jacques 42 bis rue Principale 60220 LA NEUVILLE MOLIENS ( 03 44 46 47 19 06 84 35 77 66 *** : [email protected] TRESORIER GENERAL: M. GLAIS Bernard 51, rue LA ROCHEFOUCAULT 60360 CREVECOEUR LE GRAND ( 03 44 46 92 68 06 88 75 33 14 *** : [email protected] SECRETAIRE-ADJOINT : M. BRAURE Gérard 3, rue de la Vallée 60930 BAILLEUL SUR THERAIN ( 03 44 03 22 28 06 72 18 67 78 *** : [email protected] TRESORIER-ADJOINT : Mme DELFORGE Annette 9, avenue Elsa TRIOLET 60340 -SAINT LEU D'ESSERENT ( 03 44 56 53 14 *** : [email protected] 1 MEMBRES Mme CAMPS Claudine 3/4, rue de San FRANCISCO 60000 BEAUVAIS 06 81 92 28 82 M. CHOURAQUI Gérard 10, rue de la FORTERELLE 60300 – SENLIS ( 03 44 53 28 18 06 08 33 46 45 *** : [email protected] M. -

Télécharger La Liste Des Établissements
SECTEUR GEOGRAPHIQUE TYPOLOGIE NOM Association gestionnaire AGREMENT AGE REGIME ADRESSE ADMINISTRATIVE CP VILLE TEL FAX mail SELON AGREMENT Enfants déficients auditif Enfants présentant des troubles APAJH [email protected] Langage et Intégration sévères du langage SEES Rue de la Croix Verte Les Sables IME 185, Bureaux de la Colline Département 0/20 60600 AGNETZ 03.44.68.28.30 03.44.68.28.49 [email protected] Centre Rabelais Contre-indications : de Ramecourt 92213 Saint-Cloud Cedex [email protected] Troubles sévères de la personnalité Déficience intellectuelle. La Nouvelle Forge Int. 2 avenue de l'Europe Déficients intellectuels avec ou sans [email protected] IMPRO IMPRO (IRPR) 14/20 Appart. Longueil Annel 60777 THOUROTTE 03.44.96.30.00 03.44.96.30.01 60 100 CREIL troubles associés. [email protected] S/Int. AF [email protected] La Nouvelle Forge Troubles du comportement avec ou Internat 2 avenue de l'Europe sans troubles associés. Contre- ITEP Sources et Vallées (IRPR) 14/20 Semi internat Longueil Annel 60777 THOUROTTE 03.44.96.30.00 03.44.96.30.01 60 100 CREIL indications : troubles du comportement [email protected] AF [email protected] de type psychopathique. La Nouvelle Forge Sources et Vallées (IRPR-La nouvelle 2 avenue de l'Europe Troubles du comportement avec ou SESSD Arrondissement de Compiègne 0/20 à domicile 12 Rue Sas de Gang 60150 THOUROTTE 03.44.85.26.44 03.44.97.38.57 [email protected] Forge) 60 100 CREIL sans troubles associés. -

Enquête Déplacements Sud De L'oise
Les premiers chiffres ENQUÊTE DÉPLACEMENTS SUD DE L’OISE Septembre 2017 TRAVAIL Trajet 2 et 4 RESTAURATION Trajet 3 ÉCOLE DOMICILE Trajet 1 Trajet 6 LOISIRS / ACHATS Trajet 5 /1 POURQUOI UNE ENQUÊTE DÉPLACEMENT DANS LE SUD DE L’OISE ? Entre janvier et mai 2017, 5 000 habitants du Sud Cette étude, véritable photographie des mobi- de l’Oise ont été interrogés sur leurs déplace- lités quotidiennes, dote les collectivités d’une ments quotidiens. connaissance statistique complète ce qui per- mettra de proposer des politiques de mobili- Cette enquête téléphonique a été menée conjoin- té plus en adéquation avec les attentes et les tement sur 6 intercommunalités avec le soutien besoins de chacun. technique et financier de l’État et du Centre d’Études et d’expertise sur les Risques, l’Envi- Cette publication est un premier éclairage dont ronnement, la Mobilité et l’Aménagement (CE- les résultats sont ici analysés à l’échelle du REMA). Les enquêtes déplacements réalisées périmètre d’étude. Des publications complé- en France respectent toutes une méthodologie mentaires plus fines suivront prochainement standardisée. Les résultats permettent ainsi de sous la forme de cahiers territoriaux afin de comparer les pratiques de déplacements du Sud traiter les mobilités à l’échelle de chaque de l’Oise avec les 90 territoires déjà audités dans intercommunalité. l’hexagone. Périmètre d’enquête Erquery Saint Aubin Communauté de Communes sous Erquery Maimbeville du Liancourtois La Vallée Dorée (CCLVD) Fitz James Agnetz CHIFFRES-CLÉS Nointel Catenoy Clermont -

Orry-La-Ville, Le 26 Avril 2006
Orry-la-Ville, le 05 septembre 2014 Monsieur le Préfet de l’Oise A l’attention de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l’Oise Service de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Énergie 40 rue Jean Racine B.P. 317 60021 BEAUVAIS CEDEX N. Réf.: JMG/ALB 2014-N°000762 Objet: porter à connaissance du PLU d’Aumont-en-Halatte Dossier suivi par: Jean-Marc GIROUDEAU Apremont Asnières-sur-Oise Aumont-en-Halatte Avilly-Saint-Léonard Monsieur le Préfet, Barbery Baron Beaurepaire J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les informations suivantes détenues par Bellefontaine le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional Oise - Pays Boran-sur-Oise de France, et jugées utiles à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Borest Brasseuse commune d’Aumont-en-Halatte. Chamant Chantilly Châtenay-en-France La commune d’Aumont-en-Halatte fait l’objet d’une fiche communale dans le Chaumontel document «Cartographie: Plan et notice» de la charte du Parc (cf. documents en Courteuil Coye-la-Forêt pièces jointes). Creil Epinay-Champlâtreux Ermenonville La commune d’Aumont-en-Halatte est concernée par l’unité paysagère «Massif Fleurines d’Halatte», définie par la charte du Parc naturel régional Oise - Pays de France. Fontaine-Chaalis Fosses Gouvieux Cette unité paysagère fait l’objet d’une fiche dans le document «Cartographie: Plan et Jagny-sous-Bois La Chapelle-en-Serval notice» de la charte du Parc, et d’un repérage sur le plan de référence (cf. Lamorlaye documents en pièces jointes). -

Carte-Oise-Velo-2018-2.Pdf
M1 M11 M4 Rotterdam 18 D6 ROYAUME-UNI 32 51 GAREGARE T.G.V.T.G.V. A 3131 A29 2 PAYS-BAS LE TRÉPOR D211 16 HAUTEHAUTE PPICARDIEICARDIE Londres Hornoy- AMIENS AMIENS L' M4 A29 5252 T AMIENS Omignon Saint- A29 D1029 D116 AMIENS 53 LILLE le-Bourg LILLE A29 Anvers D 6 CALAIS 17 M5 M25 M20 Bruges www.oise-a-velo.com920 D9 ALBER CALAIS, Quentin CALAIS ABBEVILLE, D138 D934 D141 Breteuil ABBEVILLE, D5 42 PÉRONNE,CAMBRAI Douvres E17 T AMIENS D A26 1 ABBEVILLE, D935 D337 D79 54 A3 Calais E40 1 vélorouteA28 - voie verte départementale : La Trans’Oise Boves BRUXELLES, TUNNEL D1015 D38 Noyon D3 A27 SOUS LA 6 D210 A31 2 MANCHE E15 Bruxelles - CALAIS, LONDRES Portsmouth D18 D7 Gerberoy A38 BELGIQUESAINT D1 E402 Lille 2 itinéraires européens : L’Avenue verte London - Paris et La Scandibérique (EV3) A16 D28 28 km D930 6 D1001 Rosières- Plymouth QUENTIN 24 km A1 D316 Luce D920 La en-Santerre 24 km D4 nche 27 circuits cyclotouristiques,9 11 randonnées permanentes, 13 voies de circulation douce, 4 vélopromenades Chaulnes a 1111 3 M 13 D28 ROUEN 25 km Amiens LAON, 9 D2 BEAUVAIS E402 e REIMS A2 CLERMONT 26 km E44 m D103 Cherbourg m COMPIÈGNE o E17 029 S Plus de 100 départs de circuits VTT / VTC D1 22 km Le Havre A29 A16 E46 Basse Forêt d'Eu D18 D934 a E15 28 km 1 Rouen SOMME L Laon E46 5 km REIMS Aéroport de D1901 Caen E46 Beauvais Beauvais-Tillé Reims Nouveau Carnets de route en français et en anglais (rubrique voies vertes) Saint-Lô D930 E46 D321 D928 Poix-de- 80 Crépy- E50 La Selle 10 A28 D28 Chaumont- Creil en-Valois Aéroport de Picardie D138 Bois Moreuil -

Rapport Activites 2018
p. 4 p. 51 Institutionnel Développement économique p. 9 p. 54 Environnement Tourisme p. 31 p. 57 Patrimoine Communication historique et culturel et sensibilisation p. 34 Architecture / Urbanisme / Paysage PARC NATUREL RÉGIONAL OISE - PAYS DE FRANCE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 Les élus et le comité syndical en 2018 Collège des délégués des communes ASNIERES-SUR-OISE Paule LAMOTTE LASSY Jean-Pierre BLAIMONT Carine LECOANET Marie THILLIET APREMONT Daniel DOUCELIN LE PLESSIS-LUZARCHES Alain MELIN Frédéric DUROSOY Estelle BENOIT AUMONT-EN-HALATTE Christel JAUNET LUZARCHES Damien DELRUE Didier GROSPIRON Amandine DIUDAT AVILLY-SAINT-LEONARD Bertrand GUILLELMET MAREIL-EN-FRANCE Cédric MORVAN Irène GRAZDA Vincent TOMKIEWICZ BARBERY Dimitri ROLAND MONTAGNY-SAINTE-FELICITE Jean-Paul DOUET Vincent BOUCHER Jeanne BOULANGER BARON Julien BOCQUILLON MONTEPILLOY Patrice URVOY Brice DE LA BEDOYERE Laurent BLOT BEAUREPAIRE Philippe FROIDEVAL MONT-L’EVEQUE Patrice LARCHEVEQUE Thierry BENARD-DEPEAUPUIS Valéry PATIN BELLEFONTAINE Alain RINCHEVAL MONTLOGNON Daniel FROMENT Éric COLLIN BORAN-SUR-OISE Philibert de MOUSTIER Benoît DESHAYES MORTEFONTAINE Jannick RONCIN Ghislain JONNART BOREST Bruno SICARD Christian LAMBLIN Vincent BACOT OGNON Yves MENEZ BRASSEUSE Maxime ACCIAI Gilbert PERRIER Robert FEYT ORRY-LA-VILLE Henri HERRY CHAMANT William LESAGE Laurence AUGUSTE Patricia BOWMAN PLAILLY Géraldine BYCZINSKI CHANTILLY Frederic SERVELLE Sophie LOURME 1 Éric WOERTH PONT-SAINTE-MAXENCE Bernard FLAMANT CHATENAY-EN-FRANCE Jacques RENAUD PONTARME Alain BATTAGLIA Nicolas -

Canton De Pont-Sainte-Maxence Prospection Diachronique (2008)
ADLFI. Archéologie de la France - Informations une revue Gallia Hauts-de-France | 2008 Canton de Pont-Sainte-Maxence Prospection diachronique (2008) Jean-Marc Popineau Édition électronique URL : https://journals.openedition.org/adlfi/86440 ISSN : 2114-0502 Éditeur Ministère de la Culture Référence électronique Jean-Marc Popineau, « Canton de Pont-Sainte-Maxence » [notice archéologique], ADLFI. Archéologie de la France - Informations [En ligne], Hauts-de-France, mis en ligne le 06 juillet 2021, consulté le 07 juillet 2021. URL : http://journals.openedition.org/adlfi/86440 Ce document a été généré automatiquement le 7 juillet 2021. © ministère de la Culture et de la Communication, CNRS Canton de Pont-Sainte-Maxence 1 Canton de Pont-Sainte-Maxence Prospection diachronique (2008) Jean-Marc Popineau ADLFI. Archéologie de la France - Informations , Hauts-de-France Canton de Pont-Sainte-Maxence 2 1 Les 126 ha quadrillés tous les 10 m et les 3 195 artefacts antérieurs au XIXe s. récoltés cette année (dont 720 céramiques et 2 192 terres cuites architecturales) ont permis de préciser notre connaissance du territoire du canton de Pont-Sainte-Maxence aux époques antique et médiévale. 2 À la prospection systématique en labour ont été adjointes cette année la prospection à vue dans les caves. 3 La campagne 2008 s’est concentrée sur les communes de Brasseuse, Raray, Rhuis, Roberval et Villeneuve-sur-Verberie. Les sites étudiés sont de natures différentes : • trois villae gallo-romaines, l’une à Verberie, La Remise du Noyer Ruffin, associée à un riche mobilier (terra nigra, tegulae, marbre, huîtres, céramique commune), une deuxième à Villeneuve-sur-Verberie, La Couture, de la Protohistoire au IIIe s., une troisième à Villers- Saint-Frambourg, La Forêt d’Halatte, associée à des enduits peints et à du mobilier alto- médiéval ; • un vicus gallo-romain et village médiéval déserté (Roberval, L’Épinette ; Rhuis, La Plaine) ; • une fonderie médiévale (Roberval, Le Cornouiller) du XIIIe-XVe s. -
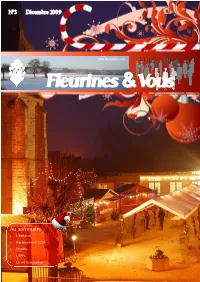
Fleurines &Vous
N°3 Décembre 2009 www.fleurines.com Fleurines &Vous Au sommaire : L’Editorial Recensement 2010 Impôts L’EPFL La vie associative 2 ACTUALITE S Fleurines & Vous Edito Marché de Noël Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous l’actualité de notre commune au travers du dernier numéro de Fleurines & Vous de cette année 2009 avant d’entamer les festivités tant attendues par petits et grands. Depuis quelques jours, notre village a re- vêtu sa parure de fête. Vous pouvez admi- rer les splendides illuminations dont une Dimanche 13 décembre Fleuri- nicipalité et le Comité des fêtes: grande partie nous a été prêtée par la ème commune de Pont Sainte Maxence. Je nes a inauguré son 4 mar- Chorale de Verneuil-en-Halatte profite donc de l’occasion pour lui renou- ché de Noël sous quelques flo- « le chœur des Aulnes » en l’é- veler nos plus sincères remerciements. cons de neige venus pour la glise St Gilles, dégustation de circonstance virevolter dans le produits régionaux, tombola, Le marché de Noël a transformé notre ciel. sans oublier les délicieuses crê- place de village et nous a offert par avan- pes et le traditionnel vin chaud. ce un peu de cette magie et de cette cha- 27 exposants artisans et com- leur de Noël. Le froid n’a pas découragé merçants ont répondu présent à L’arrivée du Père Noël chargé les Fleurinois qui sont venus nombreux cette fête et de nombreux visi- de bonbons et de cadeaux en- parcourir ce marché. Cette manifestation, teurs ont pu apprécier les mani- chanta les petits et les grands parfaitement organisée fut, une fois de festations organisées par la Mu- enfants.