Un Document De Respiration Qu'a Fait I
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Translation and Historicity of the Book of Abraham You from Me.”2 the Same Principle Can Be Applied to the Book of Abraham
Book of Abraham Translation and Historicity of the Book of Abraham you from me.”2 The same principle can be applied to the book of Abraham. The Lord did not require Joseph The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints em- Smith to have knowledge of Egyptian. By the gift and braces the book of Abraham as scripture. This book, a power of God, Joseph received knowledge about the life record of the biblical prophet and patriarch Abraham, and teachings of Abraham. recounts how Abraham sought the blessings of the On many particulars, the book of Abraham is con- priesthood, rejected the idolatry of his father, covenant- sistent with historical knowledge about the ancient ed with Jehovah, married Sarai, moved to Canaan and world.3 Some of this knowledge, which is discussed lat- Egypt, and received knowledge about the Creation. The er in this essay, had not yet been discovered or was not book of Abraham largely follows the biblical narrative well known in 1842. But even this evidence of ancient but adds important information regarding Abraham’s origins, substantial though it may be, cannot prove the life and teachings. truthfulness of the book of Abraham any more than ar- The book of Abraham was first published in 1842 chaeological evidence can prove the exodus of the Isra- and was canonized as part of the Pearl of Great Price in elites from Egypt or the Resurrection of the Son of God. 1880. The book originated with Egyptian papyri that Jo- The book of Abraham’s status as scripture ultimately seph Smith translated beginning in 1835. -

Chapter 1 Introduction to the Pearl of Great Price
CHAPTER 1 INTRODUCTION TO THE PEARL OF GREAT PRICE The fourth sacred volume within the Standard Works of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is the Pearl of Great Price. This valuable little work consists of selections from the revelations, translations, and narrations of Joseph Smith, first prophet, seer, and revelator to the Church in this dispensation. In its present form, it contains the following works: “The Book of Moses,” “The Book of Abraham,” “Writings of Joseph Smith, I,” “Writings of Joseph Smith, II,” and “The Articles of Faith of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.” Ancient Records To Come Forth In The Latter Days God’s Promise to Moses The Pearl of Great Price fulfills, in part, the promise of God to bring forth His word for the salvation of the righteous in the latter days. To Moses, God said: And, now Moses, my son, I will speak unto thee concerning this earth upon which thou standest; and thou shalt write the things which I shall speak. And in a day when the children of men shall esteem my words as naught and take many of them from the book which thou shalt write, behold, I will raise up another like unto thee; and they shall be had again among the children of men—among as many as believe.1 The one like unto Moses, designated in the above quotation, was Joseph Smith; and the Book of Moses is a restoration, in part, of the words that Moses recorded in the history he wrote. -
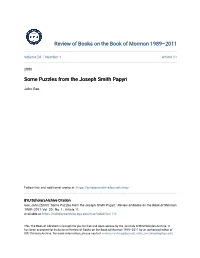
Some Puzzles from the Joseph Smith Papyri
Review of Books on the Book of Mormon 1989–2011 Volume 20 Number 1 Article 11 2008 Some Puzzles from the Joseph Smith Papyri John Gee Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/msr BYU ScholarsArchive Citation Gee, John (2008) "Some Puzzles from the Joseph Smith Papyri," Review of Books on the Book of Mormon 1989–2011: Vol. 20 : No. 1 , Article 11. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/msr/vol20/iss1/11 This The Book of Abraham is brought to you for free and open access by the Journals at BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Review of Books on the Book of Mormon 1989–2011 by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Title Some Puzzles from the Joseph Smith Papyri Author(s) John Gee Reference FARMS Review 20/1 (2008): 113–37. ISSN 1550-3194 (print), 2156-8049 (online) Abstract This article explores what we know about the Joseph Smith Papyri, whether they are connected to the Book of Abraham, and the approaches that Latter-day Saints and non-LDS scholars take when trying to understand such a connection. Some Puzzles from the Joseph Smith Papyri John Gee lthough the concept of preexistence is alluded to in various ALatter-day Saint scriptures, the clearest discussion comes from the Book of Abraham, and it is almost the only reason that Latter-day Saints use that book. Of the 378 quotations of the Book of Abraham in general conferences of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints since 1942, 238, or 63 percent, come from the section on the preexis- tence in Abraham 3:18–28.1 The next most commonly cited passage is the section on the Abrahamic covenant in Abraham 2:6–11, which is cited 43 times for 11 percent of the citations. -

Antonio Lebolo: Excavator of the Book of Abraham
BYU Studies Quarterly Volume 31 Issue 3 Article 2 7-1-1991 Antonio Lebolo: Excavator of the Book of Abraham H. Donl Peterson Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/byusq Recommended Citation Peterson, H. Donl (1991) "Antonio Lebolo: Excavator of the Book of Abraham," BYU Studies Quarterly: Vol. 31 : Iss. 3 , Article 2. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/byusq/vol31/iss3/2 This Article is brought to you for free and open access by the Journals at BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in BYU Studies Quarterly by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Peterson: Antonio Lebolo: Excavator of the Book of Abraham antonio lebolo excavator of the book of abraham H donl peterson when I1 began teaching classes in the pearl of great price in 1965 at brigham young university I1 spent little class time discussing the historical background of this book of scripture because only limited information was available particularly about the book ofabraham it was commonly believed that the mummies and papyri that came from egypt via ireland were sold to the early church leaders by a michael H chandler a nephew of the excavator joseph smith had translated some of the papyrus manuscripts then all were reportedly burned in the great chicago fire of 18718711 little more was known this much I1 had learned in a graduate class on the pearl of great price taught by james R darkoarkclark author of the story ortheofthe -

La Storia E L'origine Del Libro Di Abrahamo
La storia e l’origine del Libro di Abrahamo Kevin Barney, FAIR ITALIA 2013 Quando Napoleone invase l'Egitto nel 1798, portò con sé un piccolo esercito di scienziati e artisti, i quali pubblicarono dei rapporti delle meraviglie dell'Egitto nei molti volumi della serie francese Description of Egypt (descrizioni dell'Egitto), pubblicato tra il 1809 e il 1813, che subito alimentò un'ondata di egittomania tra gli europei. Questo intenso interesse in tutte le cose egiziane stimolò una domanda di antiquariato egizio, che uomini come Antonio Lebolo, l'escavatore dei Papiri di Joseph Smith, erano tutti troppo [ben? molto?] disposti a soddisfare. L'italiano Lebolo fu un gendarme durante l'occupazione napoleonica della penisola italiana. Quando Napoleone fu sconfitto, Lebolo si trasferì in Egitto in esilio volontario. Lì fu impiegato da Bernardino Drovetti, l'ex console generale della Francia in Egitto, per sorvegliare i suoi scavi in Egitto. Lebolo fece anche degli scavi per conto suo. Circa il 1820, su per giù un paio di anni, egli ritrovò 11 mummie ben conservate da una tomba sulla riva occidentale del Nilo di fronte alla antica città di Tebe (l'attuale Luxor). Queste mummie furono spedite a Trieste e consegnate per la vendita, attraverso Albano Oblasser. Quest’ultimo mandò poi le mummie a New York, dove furono acquistate da un imprenditore della Pennsylvania di nome Michael H. Chandler in un periodo iniziale dell'anno 1833. Chandler portò la collezione in un tour espositivo del nordest degli Stati Uniti, vendendo di tanto in tanto una mummia o due. Nel luglio 1835 arrivò a Kirtland nell'Ohio, e vendette ciò che restava della collezione (quattro mummie, due o tre rotoli di papiri e alcuni fogli di papiro sciolti) ad un gruppo di cittadini che li acquistarono per 2400 dollari per conto di Joseph Smith e la Chiesa. -
The Original Length of the Scroll of Hôr
ARTICLESAND ESSAYS The Original Length of the Scroll of Hôr Andrew W. Cook and Christopher C. Smith These records were torn by being taken from the roll of embalming salve which contained them, and some parts entirely lost; but Smith is to translate the whole by divine inspiration, and that which is lost, like Nebuch- adnezzar’s dream, can be interpreted as well as that which is preserved; and a larger volume than the Bible will be required to contain them.—William S. West (1837)1 [Ed. note—Figures 1–4 and 25–28 contain features not visible in black and white. For the tracings etc., please see the color version of the article online at http://dialoguejournal.com/2010/the-original-length-of-the-scroll-of-hor.] The Story So Far Early in the second century B.C., an Egyptian scribe copied a Doc- ument of Breathing Made by Isis onto a roll of papyrus for a Theban priest named Hôr.2 Near the beginning of the document, the scribe penned the following set of ritual instructions: “The Breathing Document, being what is written on its interior and ex- terior, shall be wrapped in royal linen and placed (under) his left arm in the midst of his heart. The remainder of his wrapping shall be made over it.”3 Hôr’s mummy, with the Breathing Document enclosed, was buried in a pit tomb near Thebes, where it lay un- disturbed for two millennia. Sometime around 1820, Italian adventurer Antonio Lebolo exhumed a cache of mummies, including Hôr. After Lebolo’s death in February 1830, eleven of his mummies were sold to bene- fit his children. -

Appendix IV Modern Chronology of the Joseph Smith Egyptian Antiquities
Appendix IV Modern Chronology of the Joseph Smith Egyptian Antiquities [Peterson, 1995; Todd, 1969; Gee, 1999; Gee, Eyewitness; Commentary Notes] Date Place Event Antonio Lebolo excavating in the Valley of the Nobles. His name appears on pit tomb 32. He excavates many antiquities, which now reside in numerous European museums. Although Lebolo sold many Egyptian artifacts and collections including 1817-1820 Thebes mummies, he kept eleven mummies acquired in Egypt as his personal property. These eleven mummies had the Joseph Smith papyri with them. These mummies were probably stored in Trieste after 1822. 1820-1822 Egypt Antonio Lebolo deals in antiquities in Egypt. Various locations 1822-1825 from Egypt to Lebolo deals in antiquities. Europe Castellamonte, 1826 Lebolo returns to his Italian home. Italy Lebolo dies; his possessions are willed to his family, the February 18, Castellamonte existence of the eleven mummies is not mentioned in the will. 1830 The mummies are discovered later. Turin archives contain a power of attorney this date from the guardian of Lebolo's minor children to Pietro Lebolo to collect July 30, Italy various debts owed to the deceased Antonio Lebolo including 1831 one from Albano Oblassa who had been given possession of the eleven mummies to arrange their sale. March 1833 The mummies arrive in New York at shippers mentioned below New York City (abt.) [see at Oct 1833]. Michael H. Chandler is showing the mummies as a curiosity show. How he acquired them is unknown, but they were obtained from the New York shipping firms mentioned below. Chandler claims he is Lebolo's nephew, but no evidence exists for this. -

The Improvementimprovement Era Also Hashas Done Done Post-Doctoral Post-Doctoralwork
1140111 • n January 1%8 in this Beginning a fascinating The Ancient Land ries by Dr.Hugh N dale), of Egypt-Neighbor A New Look at the of Palestine—Refuge of Pearl of Great Price the Prophets with color photographs "- EgyptianEgyptian PapyriPapyri Rediscovered, Regional Represen-Represen- Presented to Church tativestatives of thethe TwelveTwelve Manuscript from whichwhich thethe ProphetProphet Joseph Smith obtainedobtained Facsimile 1,1, partpart of the Book of Abraham,Abraham, is includedincluded in this valuablevaluable find. Egyptian PapyriI^pyri Rediscovered B2JBy Jay M.M. ToddTodd Editorial AssociateAssociate • Perhaps nono discoverydiscovery in recent mem- uscripts isis oneone identifiedidentified as thethe ory isis expectedexpected to arousearouse asas muchmuch original document from which Joseph widespread interest in the restoredrestored gos-gos- Smith obtainedobtained FacsimileFacsimile 1,1, whichwhich pel as isis thethe recentrecent discoverydiscovery ofof somesome prefaces the Book of Abraham in the Egyptian papyri, one of whichwhich isis Pearl of GreatGreat Price.Price. AccompanyingAccompanying knownto to have been used by thethe the manuscriptsmanuscripts waswas aa letterletter dateddated Prophet Joseph SmithSmith inin producingproducing May 26, 1856,1856, signed by both Emma the BookBook ofof Abraham.Abraham. Smith Bidamon, widow ofof thethe Prophet The papyri,papyri, longlong thoughtthought to havehave Joseph Smith, and theirtheir son,son, JosephJoseph been burned in thethe ChicagoChicago firefire ofof Smith, attesting thatthat the papyripapyri hadhad 1871, werewere presentedpresented to the Church on been the property of the Prophet.Prophet. November 27, 1967, inin New York City Some of thethe piecespieces ofof papyruspapyrus by thethe MetropolitanMetropolitan MuseumMuseum of Art, apparently includeinclude conventionalconventional hiero- more than a yearyear afterafter Dr.Dr. -

Journal of Mormon History Vol. 23, No. 1, 1997
Journal of Mormon History Volume 23 Issue 1 Article 1 1997 Journal of Mormon History Vol. 23, No. 1, 1997 Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usu.edu/mormonhistory Part of the Religion Commons Recommended Citation (1997) "Journal of Mormon History Vol. 23, No. 1, 1997," Journal of Mormon History: Vol. 23 : Iss. 1 , Article 1. Available at: https://digitalcommons.usu.edu/mormonhistory/vol23/iss1/1 This Full Issue is brought to you for free and open access by the Journals at DigitalCommons@USU. It has been accepted for inclusion in Journal of Mormon History by an authorized administrator of DigitalCommons@USU. For more information, please contact [email protected]. Journal of Mormon History Vol. 23, No. 1, 1997 Table of Contents CONTENTS LETTERS vi ARTICLES PRESIDENTIAL ADDRESS • --The Web of Print: Toward a History of the Book in Early Mormon Culture David J. Whittaker, 1 TANNER LECTURE • --National Perceptions of Utah's Statehood Howard R. Lamar, 42 • --St. Johns's Saints: Interethnic Conflict in Northeastern Arizona, 1880-85 Mark E. Miller, 66 • --LDS Sister Missionaries: An Oral History Response, 1910-71 Jessie L. Embry, 100 REVIEW ESSAY • --Issues in Writing European History and in Building the Church in Europe Review of Bruce A. Van Orden. Building Zion: The Latter-day Saints in Europe Wilfried Decoo, 140 REVIEWS --Dean L. May, Three Frontiers: Family, Land, and Society in the American West, 1850-1900 Charles S. Peterson, 177 --Irene M. Bates and E. Gary Smith, Lost Legacy: The Mormon Office of esidingPr Patriarch Craig L. Foster, 181 --A Gentile Account of Life in Utah's Dixie, 1872-73: Elizabeth Kane's St. -

31.3 Peterson
Antonio Lebolo: Excavator of the Book of Abraham BYU Studies copyright 1991 BYU Studies copyright 1991 Antonio Lebolo: Excavator of the Book of Abraham H. Donl Peterson When I began teaching classes in the Pearl of Great Price in 1965 at Brigham Young University, I spent little class time discussing the historical background of this book of scripture because only limited information was available, particularly about the Book of Abraham. It was commonly believed that the mummies and papyri that came from Egypt via Ireland were sold to the early Church leaders by a Michael H. Chandler, a nephew of the excavator. Joseph Smith had translated some of the papyrus manu- scripts; then all were reportedly burned in the great Chicago fire of 1871. Little more was known. This much I had learned in a graduate class on the Pearl of Great Price taught by James R. Clark, author of The Story of the Pearl of Great Price. He had meticulously detailed all that was known in those days relative to the Abrahamic history. He was ploughing new ground and establishing a solid foundation upon which others could build. The Latter-day Saint community was startled by an announcement in November 1967 that the Church had obtained from the Metropolitan Museum of Art in New York City eleven fragments of Egyptian papyri that had once been in the hands of the prophet Joseph Smith. This announce- ment piqued the interest of students and soon the number of young people who registered for Pearl of Great Price classes skyrocketed. I, along with my colleagues, was unprepared to field the many questions that were forth- coming because of the find. -

Tangled Afterlives
EGYPT • AFRICA TANGLED How an Egyptian Papyrus Became the Mormon Book AFTERLIVES of Abraham by paul mitchell fter 2,000 years of repose, 11 mummified mercenary-archaeologist, to human corpses and a few scrolls of papyrus excavate scores of catacombs A entombed at Thebes became entangled in the in the Valley of the Kings interwoven threads of an Egyptian autocrat's ambitions, near Thebes. Through a the American public's fascination with displays of the series of excavations along odd and exotic, and the formulation of the United States’ the Nile conducted over most prominent homegrown religion. Life after death has almost five years, Lebolo been far from dull for the only 2 surviving specimens of and hundreds of Egyp- those 11 mummies, now lying undisturbed in the Penn tian workers extracted 11 Museum. The story of the remains that captured the mummies and associated artifacts from a large Ptolemaic attention of both early America's most eminent physical period (305–30 BCE) catacomb. Having collected thou- anthropologist and the founder of the Church of Jesus sands of antiquities for the viceroy's exchanges across the Christ of Latter Day Saints begins in the late 1810s, Mediterranean, Lebolo was granted the Ptolemaic mum- with the political machina- mies as partial compensation for his service. Although tions of the Egyptian viceroy, he arranged for the transport of the mummies to Europe Muhammad Ali. for consignment sale, Lebolo died prior to their arrival in Ali, eager to modernize 1830, leaving the exquisitely preserved corpses with his and militarize his country, antiquities dealer. -

Sweeping Events Leading to the Discovery of the Joseph Smith Papyri
Brigham Young University BYU ScholarsArchive Faculty Publications 2004-01-01 Prelude to the Pearl: Sweeping Events Leading to the Discovery of the Joseph Smith Papyri Kerry M. Muhlestein [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/facpub Part of the Biblical Studies Commons, Mormon Studies Commons, and the Other Religion Commons BYU ScholarsArchive Citation Muhlestein, Kerry M., "Prelude to the Pearl: Sweeping Events Leading to the Discovery of the Joseph Smith Papyri" (2004). Faculty Publications. 1016. https://scholarsarchive.byu.edu/facpub/1016 This Peer-Reviewed Article is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Faculty Publications by an authorized administrator of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Sperry 2004 Prelude New 6.1 11/2/07 3:09 PM Page 149 8 PRELUDE TO THE PEARL SWEEPING EVENTS LEADING TO THE DISCOVERY OF THE BOOK OF ABRAHAM Kerry Muhlestein n a general conference, Elder John A. Widtsoe of the Quorum Iof the Twelve Apostles taught that “throughout all the ages of history the hand of God has overruled the actions of mankind, that nothing is done except as the Lord may use it for the accomplish- ment of his mighty purposes. The things accomplished by humanity become in the end God’s accomplishments, as he makes use of them in working out his infinite purposes.”1 Even the great movements of nations and armies often serve to accomplish the workings of the Lord, such as when the empire of Assyria rose to great heights in order that the Lord could “send him against an hypocritical nation [Israel]” (Isaiah 10:6).