Chalezeule – Notice Cas -Par -Cas
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Recueil Des Actes Administratifs N°25-2017-043 Publié Le 25 Octobre 2017
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°25-2017-043 PRÉFET DU DOUBS PUBLIÉ LE 25 OCTOBRE 2017 1 Sommaire DDFIP du Doubs 25-2017-10-13-004 - Arrêté de composition des membres titulaires et suppléants de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (4 pages) Page 4 DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté 25-2017-10-17-002 - 20171017 Arrêté Repos Dom DECATHLON BESANCON (2 pages) Page 9 25-2017-10-17-003 - 20171017 Arrêté Repos Dom PAVIMENTI SPECIALI (2 pages) Page 12 25-2017-10-18-006 - ARRETE AGREMENT esus la fruitiere a energies (2 pages) Page 15 DIRECCTE UT25 25-2017-10-11-003 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne AVS Besançon n°SAP750510075 (2 pages) Page 18 25-2017-10-23-003 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne BERLOT Jackyn°SAP 832397301 (2 pages) Page 21 Direction Départementale des Territoires du Doubs 25-2017-10-20-001 - ACCA de BY - abrogation suspension de la chasse (2 pages) Page 24 25-2017-10-13-003 - Arrêté indice fermages 2017 (10 pages) Page 27 25-2017-10-19-002 - Arrêté préfectoral autorisant la régulation de l'Ouette d'Egypte (alopochen aegyptica) sur le département du Doubs (2 pages) Page 38 25-2017-10-19-001 - Arrêté préfectoral fixant la liste des communes où la présence du castor d'Eurasie est avérée pour le département du Doubs, en application de l'arrêté ministériel du 28 juin 2016 (2 pages) Page 41 25-2017-10-16-003 - Arrêté préfectoral portant délégation de signature pour les actes relevant de la compétence d'ordonnateur dans les applications informatiques de l'ANRU interfacées avec le système d'information financière de l'ANRU. -

N°81 Édition D'octobre 2016 PAGES
N°81 Édition d'octobre 2016 PAGES 3 LE MOT DU MAIRE 4-5 PELLES&PIOCHES 5 PERMANENCE ADS FRANOIS 6 LES PRÉLIMINAIRES 7 LES GRANDS PROJETS 8 ELLESSONTREVENUES... 8 BALADE GOURMANDE 9 JUMELAGE 10-11 PRECISIONSSURLACNI 11-12 LAFORETENERGIE 13-25 LES CONSEILS MUNICIPAUXEN BREF 26-32 CENTRE SOCIO-CULTUREL LE MOT DU MAIRE Quel avenir pour nos communes ? Une fusion avec notre commune voisine de Vaux les Prés actée par le préfet, une agglo comptant 70 communes, une agglo dont l’ambition est de devenir communauté urbaine, tel est le contexte territorial dans lequel les élus municipaux doivent s’investir. De plus en plus de compétences seront transférées de droit à la CAGB suite à la loi NOTRe. D’autres encore le seront avec le qualificatif d’agglo urbaine. Au 1 janvier 2018, l’eau l’assainissement, les zones d’activités économiques passeront sous le contrôle de la CAGB. Si le caractère urbain de l’agglo est acté, les compétences voirie, éclairage public, signalétique et stationnement seront aussi transférées par obligation. Le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) en cours de réflexion et de concertation prendra certainement le même chemin. En effet la loi ALUR rend obligatoire le transfert des documents d’urbanisme ( POS, PLU…) aux communautés d’agglo dans un délai de 3 ans, saufsi opposition d’au moins un quart des communes membres, représentant au moins 20% de la population. Ce destin reste entre les mains des communes membres qui délibèreront en mars 2017. Dans l’édito précédent, j’écrivais qu’il était nécessaire d’engager une réflexion sur l’optimisation des richesses financières, humaines et démographiques plutôt que de s’étioler les uns et les autres. -
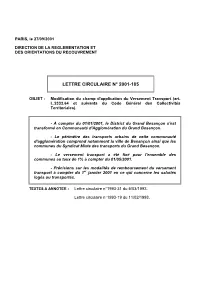
Modification Champ Application Transport Besancon
PARIS, le 27/09/2001 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES ORIENTATIONS DU RECOUVREMENT LETTRE CIRCULAIRE N° 2001-105 OBJET : Modification du champ d'application du Versement Transport (art. L.2333.64 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales). - A compter du 01/01/2001, le District du Grand Besançon s'est transformé en Communauté d'Agglomération du Grand Besançon. - Le périmètre des transports urbains de cette communauté d'agglomération comprend notamment la ville de Besançon ainsi que les communes du Syndicat Mixte des transports du Grand Besançon. - Le versement transport a été fixé pour l'ensemble des communes au taux de 1% à compter du 01/05/2001. - Précisions sur les modalités de remboursement du versement transport à compter du 1er janvier 2001 en ce qui concerne les salariés logés ou transportés. TEXTES A ANNOTER : Lettre circulaire n°1993-31 du 5/03/1993. Lettre circulaire n°1993-19 du 11/02/1993. 1) Précisions sur le périmètre des transports urbains du Syndicat Mixte du Grand Besançon avant la transformation du District du Grand Besançon en communauté d’agglomération Le périmètre des transports urbains du Syndicat Mixte du Grand Besançon comprenait les communes de : AMAGNEY, ARGUEL, AUDEUX, AUXON- DESSOUS, AUXON-DESSUS, AVANNE-AVENAY, BESANCON, BEURE, BOUSSIERES, BRAILLANS, CHALEZE, CHALEZEULE, CHAMPAGNEY, CHAMPVANS LES MOULINS, CHATILLON LE DUC, CHAUCENNE, CHAUDEFONTAINE, CHEMAUDIN, DANNEMARIE SUR CRETE, DELUZ, ECOLE-VALENTIN, FONTAIN, FRANOIS, GENNES, GENEUILLE, GRANDFONTAINE, LA CHEVILLOTTE, LA VEZE, LARNOD, LE GRATTERIS, MAMIROLLE, MARCHAUX, MAZEROLLES LE SALIN, MISEREY-SALINES, MONTFAUCON, MONTFERRAND LE CHATEAU, MORRE, NANCRAY, NOVILLARS, OSSELLE, PELOUSEY, PIREY, PIREY, POUILLEY LES VIGNES, PUGEY, RANCENAY, ROCHE LEZ BEAUPRE, ROUTELLE, SAONE, SERRE LES SAPINS, TALLENAY, THISE, THORAISE, TORPES, VAIRES ARCIER, VAIRE LE PETIT, VAUX LES PRES, BUSY, VORGES LES PINS et DEVECEY. -

EN BREF... Qui Le Composent, Des Disparités Qui Peuvent Parfois Mener À Un Renforcement, Dans Certains Domaines, De La Spécialisation De Ce Dernier
OBSERVATOIRE socio-urbain Juin 2015 Synthèse des secteurs L’agglomération bisontine sous l’angle socio-urbain Le phénomène de périurbanisation se poursuit aujourd’hui, et avec lui s’est mis en place un fonctionnement en couronnes au sein de l’agglomération et au-delà. Parallèlement, l’entremêlement de la ville et de la campagne s’est accentué : la ville centre ne fonctionne pas sans sa périphérie, et inversement, l’organisation de la périphérie reste liée à celle de sa ville centre. L’analyse des indicateurs socio-démographiques montre que, ces dernières années, un ralentissement démographique est en cours dans l’ensemble de l’agglomération. L’évolution du territoire fait aussi ressortir, entre les secteurs EN BREF... qui le composent, des disparités qui peuvent parfois mener à un renforcement, dans certains domaines, de la spécialisation de ce dernier. Une fragilisation de certains ménages, due notamment à la crise économique de 2009, est aussi à prendre en compte. Enfin, Besançon se distingue souvent des autres secteurs et accumule des caractéristiques qui lui sont propres. L’Observatoire Socio-Urbain (OSU) des quartiers et des secteurs de Besançon et des communes du Grand Besançon est un outil de veille des disparités territoriales au sein de l’agglomération. Des indicateurs, suivis sur des périodes longues et déclinés aux échelles communales et infracommunales (IRIS), permettent d’identifier les fragilités sociales en y apportant une clé de lecture urbaine et de fonctionnement territorial. Cette publication permet, par la mise en avant des particularités de chacun des six secteurs de l’agglomération, de parvenir à construire une vue d’ensemble de cette dernière, de son état actuel et des évolutions qui s’y font jour. -

Fiche Structure : Alliance Villes Emploi
Fiche structure : Alliance Villes Emploi - www.ville-emploi.asso.fr TERRITOIRE Région : Bourgogne et Franche-Comté Département : (25) Doubs Ville : Besançon Liste des communes couvertes : Amagney ((25) Doubs), Arguel ((25) Doubs), Audeux ((25) Doubs), Auxon-Dessous ((25) Doubs), Auxon-Dessus ((25) Doubs), Avanne-Aveney ((25) Doubs), Beure ((25) Doubs), Bonnay ((25) Doubs), Boussières ((25) Doubs), Braillans ((25) Doubs), Busy ((25) Doubs), Byans-sur-Doubs ((25) Doubs), Chalèze ((25) Doubs), Chalezeule ((25) Doubs), Champagney ((25) Doubs), Champoux ((25) Doubs), Champvans-les-Moulins ((25) Doubs), Châtillon-le-Duc ((25) Doubs), Chaucenne ((25) Doubs), Chaudefontaine ((25) Doubs), Chemaudin ((25) Doubs), Chevillotte (La) ((25) Doubs), Chevroz ((25) Doubs), Cussey-sur-l'Ognon ((25) Doubs), Dannemarie-sur-Crète ((25) Doubs), Deluz ((25) Doubs), Devecey ((25) Doubs), École-Valentin ((25) Doubs), Fontain ((25) Doubs), Franois ((25) Doubs), Geneuille ((25) Doubs), Gennes ((25) Doubs), Grandfontaine ((25) Doubs), Gratteris (Le) ((25) Doubs), Larnod ((25) Doubs), Mamirolle ((25) Doubs), Marchaux ((25) Doubs), Mazerolles-le-Salin ((25) Doubs), Mérey-Vieilley ((25) Doubs), Miserey-Salines ((25) Doubs), Montfaucon ((25) Doubs), Montferrand-le-Château ((25) Doubs), Morre ((25) Doubs), Nancray ((25) Doubs), Noironte ((25) Doubs), Novillars ((25) Doubs), Osselle ((25) Doubs), Palise ((25) Doubs), Pelousey ((25) Doubs), Pirey ((25) Doubs), Pouilley-Français ((25) Doubs), Pouilley-les-Vignes ((25) Doubs), Pugey ((25) Doubs), Rancenay ((25) Doubs), Roche-lez-Beaupré -

Arrêts Accessibles Urbain
Liste des arrêts accessibles (Besançon) (mis à jour au 05/10/2018) Attention : il se peut que des arrêts soient accessibles dans un seul sens. Référez-vous à la colonne "Direction des lignes à cet arrêt" pour consulter le détail des lignes à l'arrêt. Commune Nom de l'arrêt Direction des lignes à cet arrêt Besançon AFPA L3 Pôle Temis Besançon AFPA L3 Centre-ville Besançon Allende T1 Hauts du Chazal T2 Hauts du Chazal Besançon Allende T1 Chalezeule T2 Gare Viotte Besançon Artois L4 Châteaufarine Besançon Ateliers Municipaux 10 CHRU Minjoz Besançon Bascule L4 Pôle Orchamps Besançon Battant T1 Chalezeule T2 Gare Viotte Besançon Battant T1 Hauts du Chazal T2 Hauts du Chazal Besançon Béarn L4 Châteaufarine 22 Avanne-Aveney 54 Boussières 55 Boussières 56 Osselle-Routelle/Byans-sur-Doubs 57 Dannemarie-sur-Crète Besançon Bregille L5 St Claude D3 Lycée Pergaud Besançon Brulard T1 Chalezeule T2 Gare Viotte Besançon Brulard T1 Hauts du Chazal T2 Hauts du Chazal Besançon Brûlefoin T1 Hauts du Chazal Besançon Brûlefoin T1 Chalezeule Besançon Campus Arago L3 Pôle Temis 7 Palente Espace Industriel 62 Pôle Temis 63 Pôle Temis D8 Collège Camus Besançon Campus Arago L3 Centre-ville 7 Hauts du Chazal 62 Noironte 63 Chaucenne D8 Montboucons Besançon Canot T1 Hauts du Chazal T2 Hauts du Chazal Page 1/8 Besançon Canot T1 Chalezeule T2 Gare Viotte Besançon Chalezeule T1 Hauts du Chazal Besançon Chamars T1 Hauts du Chazal T2 Hauts du Chazal Besançon Chamars T1 Chalezeule T2 Gare Viotte Besançon Chamars 9 Velotte Ginko Hôpital CHRU Minjoz 85 Fontain 86 Pugey 406 -

Maryse Gressier Coordinatrice Plateforme Répit Aidants
CONTACT Maryse Gressier Coordinatrice Plateforme Répit Aidants ELIAD - 41 rue Thomas Edison - CS 92146 - 25052 Besançon CEDEX 03 70 72 02 56 | [email protected] www.eliad-fc.fr SECTEUR GEOGRAPHIQUE Liste des communes au verso LISTE DES COMMUNES ABBENANS ÉCOLE-VALENTIN MONTFAUCON UZELLE MONTFERRAND-LE- ACCOLANS ÉMAGNY VAIRE-ARCIER ADAM-LÈS-PASSAVANT ESNANS CHÂTEAU MONTIVERNAGE VAL-DE-ROULANS AÏSSEY ÉTRABONNE VALLEROY AMAGNEY ÉTRAPPE MONTUSSAINT MORRE VALONNE ANTEUIL FAIMBE VAUCHAMPS APPENANS FERRIÈRES-LES-BOIS NANCRAY VAUDRIVILLERS ARCEY FLAGEY-RIGNEY NANS VELESMES-ESSARTS AUDEUX FONTAIN NOIRONTE VELLEROT-LÈS-BELVOIR AUTECHAUX FONTAINE-LÈS-CLERVAL NOVILLARS VELLEVANS AVANNE-AVENEY FONTENELLE-MONTBY OLLANS VENISE AVILLEY FONTENOTTE ONANS VENNANS BATTENANS-LES-MINES FOURBANNE ORVE VERGRANNE BAUME-LES-DAMES FRANEY OSSE VERNE BELLEHERBE FRANOIS OSSELLE VERNOIS-LÈS-BELVOIR BELVOIR FROIDEVAUX OUGNEY-DOUVOT VIEILLEY BERTHELANGE GÉMONVAL PALISE VIÉTHOREY BESANÇON GENEUILLE PASSAVANT VILLARS-SAINT-GEORGES BEURE GENEY PELOUSEY VILLERS-BUZON BLARIANS GENNES PÉSEUX VILLERS-GRÉLOT BLUSSANGEAUX GERMONDANS PIREY VILLERS-SAINT-MARTIN BLUSSANS GLAMONDANS PLACEY VOILLANS BONNAL GONDENANS-LES- POMPIERRE-SUR-DOUBS VORGES-LES-PINS BONNAY MOULINS PONT-LES-MOULINS VYT-LÈS-BELVOIR BOUCLANS GONDENANS-MONTBY POUILLEY-FRANÇAIS BOURNOIS GOUHELANS POUILLEY-LES-VIGNES BOUSSIÈRES GRANDFONTAINE POULIGNEY-LUSANS BRAILLANS GROSBOIS PROVENCHÈRE BRANNE GUILLON-LES-BAINS PUESSANS BRECONCHAUX PUGEY BRETIGNEY-NOTRE-DAME HUANNE-MONTMARTIN BRETONVILLERS HYÉMONDANS RAHON -

Horaires De La Ligne 55 Et 56
BYANS-SUR-DOUBS . GRANDFONTAINE . OSSELLE-ROUTELLE . TORPES Guide des mobilités Toutes les solutions au départ ou à destination de votre commune Horaires du 3 septembre 2018 au 31 août 2019 Mise à jour le 5 novembre 2018 LES LIGNES ET NOUVEAUTÉS DANS MON SECTEUR LIGNES Communes desservies Destinations Boussières Torpes Pôle Micropolis - Besançon Grandfontaine Byans-sur-Doubs Osselle-Routelle Pôle Micropolis - Besançon Torpes Sommaire Grandfontaine Gare / Centre- ville / • Les lignes et nouveautés dans mon secteur ...................................................3 Byans-sur-Doubs Villars-St-Georges Zone commerciale • Plan des lignes dans mon secteur .............................................................................................4 des Belles Ouvrières Roset-Fluans à Saint-Vit • Plan du pôle d’échanges ................................................................................................................................6 • Les autres solutions de mobilité à ma disposition .............................8 Byans-sur-Doubs Gare Viotte - Besançon • Les tarifs ...................................................................................................................................................................................................9 Lons-le-Saunier <> Besançon Torpes • Comment se rendre aux principaux équipements de l’agglomération ? ............................................................................................................................................10 • Comment se rendre aux établissements -

Thise- 3 Ruel Le Des Clos Chalezeule (BTC)
Le Petit Chalezeulois illustré . 2015-2016 Le petit mot du Groupe Communication Le grand frère des « Brèves de Chalezeule », « le Petit Chalezeulois Illustré », est de retour en ce début d’année. Complémentaire, cohérent, mêmes couleurs, il propose une présentation des services et des associations qui font la richesse de notre commune. A chacun, il a été demandé de nous écrire et de faire une photographie de ses activités passées et futures. De nombreuses pages rappellent également les consignes et obligations de chaque citoyen en matière de déchets, de respect pour le voisinage et la commune : chiens, jardin, bruit,... Chalezeule Village Respect ! Le Groupe Communication du Comité consultatif Animation et Vie du Village, est maintenant pleinement opérationnel pour publier les informations municipales et communales tout au long de l’année. N’hésitez pas à lui faire part de vos suggestions ou projets d’articles ! Bonne lecture et bonne année à toutes et tous ! Hervé GROULT Adjoint au maire à la Communication Le Petit Chalezeulois Illustré Edition : Mairie de Chalezeule Impression : Est Imprim Tirage : 700 exemplaires sur papier recyclé Dépôt légal : Janvier 2016 Directeur de la Publication : C.MAGNIN–FEYSOT Mise en page & Coordination : H.GROULT Rédaction : Groupe Communication H.GROULT, A. ANTOINE, N.GERARD-MELET, J.WUILLEMIER, G.DUBOIS, V.SAINT-CYR et M.MAIRE Habitants volontaires : P.KIEFFER, Y.DEUSCHER, D.COMMERCON, A.BURNEY et les responsables des services, des associations et des organismes qui ont écrit leurs articles et ont fait Renseignements pratiques parvenir des photos de leurs activités et actions. SAMU 15 [email protected] GENDARMERIE 17 POMPIERS 18 - 112 Plan CABINET MEDICAL 03.81.61.71.55 Vous pouvez retrouver le plan de la commune MAIRIE 03.81.61.04.63 au milieu du magazine et sur le site : ECOLE 03.81.61.02.50 www.grandbesancon.fr ANIMATION 03.81.51.59.92 BIBLIOTHEQUE 03.81.61.01.34 / rubrique : 59 communes : Chalezeule ESPACE MEDICO SOCIAL 03.81.25.44.44. -

MARIAGES CANTONAUX an 7 ET an 8 (Liste Des Cantons Du Doubs Par Districts)
MARIAGES CANTONAUX AN 7 ET AN 8 (Liste des cantons du Doubs par districts) DISTRICT DE BESANCON Canton de Besançon 1ère section l’Egalité 2ème section le Capitole 3ème section la Loi 4ème section la Liberté 5ème section l’Abondance 6ème section la Fraternité 7ème section la Constitution 8ème section la Victoire La Vèze Canton de Beure Arguel Avanne Aveney Beure Busy Fontain Larnod Montferrand le Château Pugey Rancenay Vorges les Pins Canton de Bonnay Bonnay Châtillon le Duc Chevroz Devecey Geneuille Merey Vieilley Palise Tallenay Valentin (voir Ecole Valentin) Venise Vieilley Canton de Pouilley les Vignes Auxon Dessous Auxon Dessus Champagney Champvans les Moulins Chaucenne Chemaudin Cussey sur l’Ognon Ecole Franois Miserey Salines Pelousey Pirey Pouilley les vignes Sauvagney Serre Les Sapins Vaux-les –Près Canton de Nancray Bouclans Champlive La Chevillotte Dammartin les Templiers Gennes Gonsans Granges de Vienney Le Gratteris Mamirolle Montfaucon Morre Naisey Nancray Osse Ougney Douvot Saône Vauchamps Canton de Recologne Audeux Burgille Chazoy Chevigney sur l’Ognon Cordiron Courchapon Emagny Franey Jallerange Lavernay Mazerolles le Salin Moncley Le Moutherot Noironte Placey Recologne Ruffey le Château Canton de Rigney Blarians La Bretenière Cendrey Champoux Châtillon Guyotte Chaudefontaine Corcelle Mieslot Flagey Rigney Germondans La Tour de Scay Moncey Ollans Rigney Rignosot Rougemontot Thurey le Mont Valleroy Canton de Roche lez Beaupré Amagney Arcier Braillans Chalèze Chalezeule Marchaux Novillars Roche lez Beaupré Thise Vaire le -

Préfet De La Côte-D'or Préfet Du Doubs Préfet Du Jura
PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR PRÉFET DU DOUBS PRÉFET DU JURA PRÉFET DE LA NIÈVRE PRÉFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE PRÉFÈTE DE LA HAUTE – SAÔNE PRÉFET DE L’YONNE PRÉFET DU TERRITOIRE-DE-BELFORT Liberté Égalité Fraternité Arrêté c !r" #$t"r!é% rt"&"$t ' $()*)+ ,,,---- r"' t#. / ' �" "$ %' c" !"0 %r#$c#%"0 c1&&2$0 !" 3#4#' $c" "t !" 4"0t#1$ !" ' r"0012rc" "$ " 2 "$ %ér#1!" !’ét# 4" "$ BOUR5O5NE-FRANCHE-CO6TE VU la Directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.211-3 à L.213.3, L.214-7, L.214-18, L.215-1 à L.215-13, L.214-7, L.214-1 , L.215-1 à L.215-13, ".211-66 à ".211-70 et "214-1 à ".214-56 $ VU le code du domaine public fluvial et notamment les articles 25, 33 et 35 $ VU le code civil et notamment les articles 640 et 645 $ VU le code de la santé publique et notamment les articles ".1321-1 à ".1321-66 $ VU le code )'n'ral des collectivit's territoriales et en particulier l’article L.2212-5 et l’article L.2215-1 relati& aux pouvoirs du repr'sentant de l’État dans un département en mati,re de police $ VU le d'cret n-2010-0146 du 1# &'vrier 2010 modi&iant le décret n- 2004-374 du 29 avril 2004 relati& au* %ouvoirs des pr'&ets, à l’or)anisation et à l’action des services de l’+tat dans les r')ions et les d'partements $ VU la circulaire du 1 mai 2011 relative au* mesures e*ceptionnelles de limitation ou de suspension des usa)es de l’eau en p'riode de s'cheresse $ VU les 0D123 Loire-Breta)ne, "/ône-M'diterran'e et Seine-Normandie en vi)ueur $ VU l’arr8té n- 2015103-0014 du 13 avril 2014 -

2017-0000016
LETTRE CIRCULAIRE n° 2017-0000016 Montreuil, le 24/04/2017 DRCPM OBJET Sous-direction production, Modification du champ d'application et du taux de versement gestion des comptes, transport (art. L. 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités fiabilisation Territoriales VLU-grands comptes et VT Texte(s) à annoter : LCIRC-2009-0000005 Affaire suivie par : ANGUELOV Nathalie A compter du 01/01/2017, le périmètre de transports urbains de la Communauté d'Agglomération du Grand Besancon est étendu aux communes de Bonnay, Byans sur Doubs, Chevroz, Cussey sur l'Ognon, Devecey, Geneuille, Merey Vieillez, Palise, Pouilley Français, Roset Fluans, St Vit, Velesmes Essarts, Venise, Vieilley, Villars St Georges. A compter du 01/05/2017, le versement transport s’applique à ces communes au taux de 0,90 puis 1,80 au 01/01/2018 Par un arrêté du 22/09/2016, la Préfecture du Doubs a autorisé l’adhésion des communes de Bonnay, Byans sur Doubs, Chevroz, Cussey sur l'Ognon, Devecey, Geneuille, Merey Vieillez, Palise, Pouilley Français, Roset Fluans, St Vit, Velesmes Essarts, Venise, Vieilley, Villars St Georges, avec prise d’effet à compter du au 01/01/2017. Par une délibération du 19/09/2016, la Communauté d’Agglomération du Grand Besancon (9302504) a décidé de mettre en place le versement transport sur le territoire des communes comprises dans son périmètre de transports urbains. Les nouveaux taux prennent effet à compter du : - 01/05/2017 à 0,90 % - 01/01/2018 à 1,80 % Dans ces conditions, un nouvel identifiant est attribué 9302506 La Communauté d’Agglomération du Grand Besancon (9302504) nous informe de son changement d’adresse.